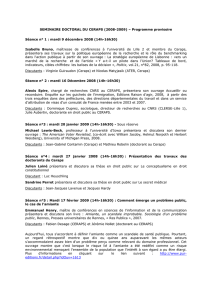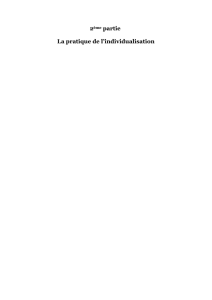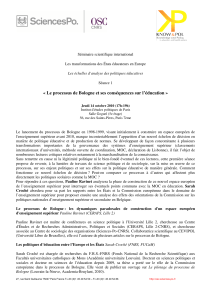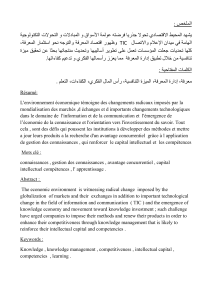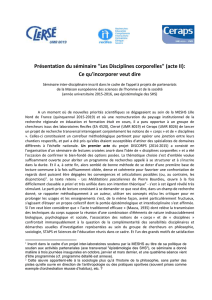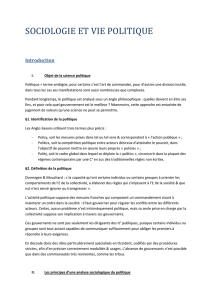SEMINAIRE DOCTORAL DU CERAPS (2009

SEMINAIRE DOCTORAL DU CERAPS (2009-2010)
Programme provisoire
Séance n°1 : Mercredi 14 octobre 2009 (14h-16h30) : L'institutionnalisation de la participation en
démocratie
Conférence de Raymond Hudon, professeur à la Faculté des sciences sociales, département de
science politique, de l'Université Laval au Québec. Il est directeur du diplôme d'études supérieures
spécialisées en Affaires publiques et représentation des intérêts (APRI).
Discutante : Hélène Michel (professeur de science politique à l’IEP de Strasbourg, chercheuse au
CERAPS)
Il est courant d’expliquer les difficultés de la démocratie représentative par le désengagement et la désaffection
des populations à l’égard des mécanismes (traditionnels) et des acteurs de la représentation (aspirants comme
désignés). De nombreux indices semblent probants : recul de la participation électorale, baisse du niveau de
confiance, etc. Mais ne serait-ce pas justement ce qui est à expliquer? Peut-être adhérons-nous à des
conceptions plus ou moins romantiques de la démocratie. Ou encore peut-être avons-nous des visions idéalisées
de la participation citoyenne et du modèle qu’elle appelle, la démocratie participative. Au-delà de cette
provocation délibérée, quelques avenues théoriques et conceptuelles sont explorées pour éclairer et, qui sait, «
expliquer » les énigmes des démocraties contemporaines… qui, par ailleurs, ne prennent réellement sens qu’en
contexte. L’action politique est quasi inévitablement axée sur le compromis; pour être reconnu, il faut
reconnaître (l’autre). Mais elle est impensable sans le pouvoir, qui renvoie pratiquement à la capacité de
réaliser ses intérêts… dans des rapports de force avec d’autres. De ce dernier point de vue, elle appelle
concrètement l’organisation. Celle-ci impose des renoncements additionnels à son profit et pour celui de
dirigeants qui tiennent à sa survie. Les effets combinés de l’institutionnalisation et de l’organisation deviennent
ainsi sources de déceptions et peuvent sans trop grande surprise entraîner le décrochage. Sur cet arrière-plan,
les jugements normatifs portés plus spécifiquement sur le patronage (clientélisme) et le lobbying se
comprennent à l’aune de craintes que « l’autre » jouisse d’avantages qui provoqueraient des déséquilibres
(jugés répréhensibles) dans les rapports de force entre acteurs de différents niveaux. Par contre, « tout le
monde » joue le jeu dans l’espoir d’y trouver son profit propre! Plus prosaïquement, cependant, le patronage et
le lobbying mettent en rapport des éléments de la société avec les institutions et les acteurs qui s’y mobilisent.
Paradoxe déstabilisant : ce qui est, à l’entrée, dénoncé comme perversion de la démocratie ouvre, à l’usage, des
voies à sa réalisation, même si bien imparfaitement !
Séance n°2 : Mardi 27 octobre 2009 (14h-16h30) : Comment vivent et que votent les habitants des
cités pavillonnaires ?
Olivier Masclet et Yasmine Siblot, sociologues, présenteront et discuteront l’ouvrage co-écrit avec
Marie Cartier et Isabelle Coutant, La France des « petits-moyens ». Enquête sur la banlieue
pavillonnaire, Paris, La Découverte, « Textes à l’appui-enquêtes de terrain », 2008.
Discutants : Frédéric Sawicki (Ceraps) et Igor Martinache (doctorant du Ceraps)
Dans les médias, les banlieues françaises sont souvent réduites aux cités, aux grands ensembles, quand ce n'est
pas aux émeutes des " quartiers ". Il est pourtant une autre banlieue, celle des pavillons, qui abrite une
population au moins aussi importante, mais paradoxalement beaucoup moins visible et connue. Fruit d'une
longue enquête, ce livre restitue l'histoire et la vie quotidienne don quartier pavillonnaire de la région
parisienne, situé à mi-chemin entre l'univers des cités et les lotissements aisés. Sans être séparé des zones de
pauvreté. Il n'en matérialise pas moins des parcours d'ascension sociale. On découvre alors les conditions. les
effets et les figures de la promotion sociale, du couple d'agent EDF arrivant de province dans les années 1960 au
couple d'enfants d'immigrés sortant des cités dans les années 2000. Si les ressources acquises par les ménages

les éloignent des classes populaires, leur appartenance aux classes moyennes n'est pas plus évidente. Ces "
petits-moyens " comme ils se désignent parfois eux-mêmes aspirant à vivre " comme tout le monde " sont au
cœur de ce livre qui en dresse les contours et le style de vie. Les auteurs montrent notamment que, dans ces
quartiers longtemps partagés politiquement, la vie associative est ancienne, de nouvelles formes de division et
de compétition sociale les font aujourd'hui nettement basculer à droite. Ils s'efforcent d'expliquer pourquoi,
après le Front national, la droite de Sarkozy séduit une large fraction de la France des " petits-moyens ". Plus
d’informations en cliquant sur le lien suivant : http://www.liens-socio.org/article.php3?id_article=3679
Séance n°3 : Mardi 17 novembre 2009 (14h-16h30) : Pourquoi se mobilise-t-on ?
Daniel Cefaï, maître de conférences en sociologie à l’Université Paris X-Nanterre présentera et
discutera son livre : Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l'action collective, Paris, La
Découverte, « Recherches », 2007.
Discutants : Jean-Gabriel Contamin (CERAPS) et Karel Yon (post-doctorant au CERAPS)
Pourquoi se mobilise-t-on ? L’un des traits propres aux régimes démocratiques est que leurs citoyens disposent
d’un droit de regard sur les affaires publiques et, en contrepoint des élections, d’un droit à la critique et à la
révolte. Ils discutent, s’associent, s’organisent. Ils constituent des collectifs, revendiquent dans l’espace public,
passent des alliances avec partis et syndicats et entrent en conflit avec les pouvoirs établis. Mais qu’est-ce qui
les y pousse ? La mobilisation a un coût en énergie et présente des risques, y compris financiers. Pourquoi ne pas
laisser les autres se mobiliser à notre place ? Ce livre propose une cartographie de l’état des savoirs sur l’action
collective, à partir de tout ce qui a été écrit sur le sujet depuis plus d’un siècle, sur les deux rives de l’Atlantique.
L’histoire commence avec les travaux sur les foules et les publics de Tarde et Le Bon, à la fin du XIXe siècle.
L’auteur exhume la tradition du comportement collectif née à Chicago dans les années 1920. Il montre le virage
accompli par Touraine et Melucci au moment de l’émergence des nouveaux mouvements sociaux – étudiant,
féministe, écologiste… – dans les années 1960 et 1970. Il passe en revue les théories de l’action rationnelle, les
modèles du processus politique et les analyses des réseaux et des organisations, qui prédominent aujourd’hui.
Et il propose de nouvelles perspectives, inspirées de la sociologie culturelle nord-américaine et de la
microsociologie de Goffman. Un ouvrage indispensable à tous ceux qui s’intéressent aux mouvements sociaux
de notre temps.
Plus d’informations en cliquant sur le lien suivant : http://www.journaldumauss.net/spip.php?article145
Séance n°4 : Mardi 8 décembre 2009 (14h-16h30) : Le recours à la justice administrative
Présentation et discussion du livre de Jean-Gabriel Contamin, Emmanuelle Saada, Alexis Spire et
Katia Weidenfeld, Le recours à la justice administrative. Pratiques des usagers et usages des
institutions, Paris, La documentation française, « Perspectives sur la justice », 2009.
Discutants : Rachel Vanneuville (chargée de recherches au CERAPS-CNRS), Stéphane Guérard (MCF
en droit public, CERAPS)
Les litiges portés devant les tribunaux administratifs sont en constante augmentation : 20.000 affaires
enregistrées au début des années 1970, 160.000 en 2004, 170.000 en 2007… Mettant à mal les délais de
jugement, cette hausse vertigineuse domine depuis plusieurs années la réflexion et les réformes portant sur la
justice administrative. Pour rendre compte d’une telle inflation, beaucoup se contentent d’évoquer la «
judiciarisation » de la société. Refusant de s’en tenir à un tel constat, ce livre propose d’explorer les mécanismes
par lesquels un différend entre l’administration et son usager se transforme en recours juridictionnel. Dans cette
optique, trois matières ont fait l’objet d’enquêtes sociologiques approfondies : les contentieux « fiscal », «
étrangers » et « logement ». Contrairement à une idée largement répandue, la croissance du contentieux ne
reflète absolument pas une amélioration des aptitudes juridiques des citoyens. L’étude réalisée dans plusieurs
tribunaux administratifs met plutôt en évidence le rôle essentiel joué par les « intermédiaires » du droit, que
sont notamment les avocats et les associations et dont la présence est très inégale selon les domaines. Surtout,

elle souligne le caractère déterminant des pratiques administratives et des usages que les agents de
l’administration font de la justice : le recours au juge n’apparaît plus seulement comme une contrainte externe
mais aussi comme un paramètre parmi d’autres du fonctionnement bureaucratique.
Séance n°5 : Mardi 19 janvier 2010 (14h-16h30) : Penser l’individualisation
Christian Le Bart, professeur de science politique à l’IEP de Rennes, présentera et discutera
son livre : L’individualisation, Paris, Presses de Sciences Po, 2008.
Discutants : Rémi Lefebvre (CERAPS), Emmanuel Pierru (CERAPS) et Anne-Sophie Decroes
(doctorante au Ceraps)
Un grand nombre de travaux développent depuis vingt ans l’idée d’une individualisation de la société, en France
par des auteurs tels que de Singly, Kaufmann, Dubar…, et autour de Beck et Bauman notamment, à l’étranger.
Ces travaux se déploient sur des terrains très divers : sociologie de la famille, du travail, des religions, de la
politique, de la culture, des idées, etc. Cet ouvrage vient combler un manque en apportant une synthèse sur la
sociologie de l’individualisation à la fois historique (remontant aux intuitions de Jacob Burckhardt sur
l’individualisme de la Renaissance) et pluridisciplinaire (anthropologie, sociologie, science politique, histoire…). Il
s’efforce d’analyser l’évolution des dispositifs destinés à faire exister l’individu sous de multiples formes (du
confessionnal à l’isoloir, de la littérature autobiographique au journal intime, de l’artisan anonyme à l’artiste
signant son travail, des mouvements sociaux « collectifs » aux revendications « identitaires », etc.). Cette socio-
histoire de l’individualisation suppose le détour par une théorie originale qui, reprenant pour partie Simmel,
distingue individualisme générique et individualisme différencié. Elle aboutit à une réflexion sur l’individu
contemporain, et tente de recenser les supports actuels de l’individualisation. L’ouvrage défend l’idée d’une
possible histoire continue de l’individualisation, au moins dans le contexte occidental marqué par le
christianisme et l’économie de marché. Il montre que les postulats durkheimiens sur « le social » ne sont plus
recevables tels quels aujourd’hui, et cherche dans la sociologie contemporaine les outils qui permettent de
problématiser cette catégorie inédite que constitue « l’individu ». L’intérêt est d’offrir aux praticiens des
sciences sociales, aux étudiants et aux lecteurs que ces questions intéressent une synthèse sur la sociologie de
l’individualisation, synthèse qui tout à la fois évoque les auteurs représentatifs de ces courants, et qui les situe
aussi par rapport à d’autres auteurs, classiques (Durkheim, Dumont, Elias, Bourdieu) ou récents (Lahire, Dubet).
Séance n°6 : Mardi 23 février 2010 (14h-16h30) : présentation des travaux des doctorants du
laboratoire
Lise Perino : le rapport au politique des travailleurs sociaux : le cas des assistantes de service social
Discutante : Isabelle Bruno (CERAPS)
Dorothée Reignier : La discipline de vote dans les assemblées parlementaires sous la Ve République
Discutant : Olivier Nay (CERAPS)
Séance n°7 : Mardi 23 mars 2010 (14h-16h30) : La réforme permanente de l’administration
française
Présentation et discussion du livre de Philippe Bezès, chercheur au CNRS membre du laboratoire CERSA
(Centre d'études et de recherches de science administrative, Université Paris 2), Réinventer l’Etat. Les
réformes de l’administration française (1962-2008), Paris, PUF, « Lien social », 2009.
Discutants : Fabien Desage (CERAPS), Nicolas Matyjasik et Thomas Alam (post-doctorants au CERAPS)
Depuis les années 1960, les problèmes d'organisation, de contrôle et de financement des systèmes
administratifs constituent des enjeux collectifs majeurs dans les démocraties occidentales. Ils alimentent les
diagnostics de crise des bureaucraties et favorisent l'essor de réformes préconisant de nouveaux modes de

fonctionnement, souvent inspirés du New Public Management. En dépit de l'importance historique de l'État, la
France n'échappe pas à ces changements. L'administration est l'objet de nombreuses critiques et de réformes.
Comment, pourquoi et avec quels effets les élites françaises ont-elles développé, à grand renfort de publicité,
des politiques de réforme de l'État destinées à transformer les règles historiques patiemment mises en oeuvre
depuis le début du XIXe siècle ? Voilà la question centrale que pose cet ouvrage. Il analyse les réformes de
l'administration française du début des années 1960 jusqu'à la présidence Sarkozy. Avec la perspective d'une
sociologie historique de l'État, il retrace l'essor et le développement de ces réformes sous la Ve République et
analyse les multiples configurations d'acteurs qui y participent : personnels politiques, hauts fonctionnaires,
ministères, experts patentés, citoyens... Il donne à comprendre le tournant néo-managérial de l'administration
française, ses limites et la spécificité des voies du changement dans le contexte hexagonal. Soulignant la
singularité de la préoccupation des gouvernants pour l'organisation et la transparence de la machinerie
administrative, l'auteur diagnostique finalement l'émergence d'une nouvelle rationalité politique marquée par
l'impératif du « souci de soi de l'État ».
Séance n°8 : [Date non fixée]
Jacques Caillosse, présentera et discutera son ouvrage : La constitution imaginaire de
l'administration : Recherche sur la politique du droit administratif, Paris, PUF, « Les voies du droit »,
2009.
Une monographie critique sur le droit administratif, depuis sa constitution et ses théories jusque dans
ses implications les plus sociales. L'ensemble de ces textes, produit d'une réflexion critique, n'est pas à
considérer comme une sorte d' "antimanuel", mais comme un parcours critique d'une discipline en
cours d'évolution. Ce n'est donc pas un état de la discipline aujourd'hui qui est proposé, mais une
démarche intellectuelle pour penser ce que pourrait être ou devrait être cet "objet" juridique. Il s'agit
de se demander ce que fait en situation le "droit administratif" et comment il le fait. Or, toute
interrogation sur les modes opératoires du droit administratif, sur les manières dont il agit sur et dans
les rapports sociaux, conduit naturellement à considérer ce qui, dans ce droit, procède et participe du
champ politique. Au regard des tendances actuelles qui le traversent et le déconstruisent, comment
recomposer le droit administratif sur de nouvelles bases ?
Discutants : Arnauld Noury (MCF en droit public, Ceraps)
Séance n°9 : [Date non fixée]
Christina Boswell, Senior Lecturer, School of Social and Political Science, University of Edinburgh,
présentera et discutera son ouvrage : The Political Uses of Expert Knowledge: Immigration Policy and
Social Research (Cambridge University Press, 2009)
http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521517416
Discutante : Virginie Guiraudon
Why do politicians and civil servants commission research, and what use do they make of it in
policymaking? The received wisdom is that research contributes to improving government policy.
Christina Boswell challenges this view, arguing that policymakers are just as likely to value expert
knowledge for two alternative reasons: as a way of lending authority to their preferences; or to
signal their capacity to make sound decisions. Boswell develops a compelling new theory of the role
of knowledge in policy, showing how policymakers use research to establish authority in contentious
and risky areas of policy. She illustrates her argument with an analysis of European immigration
policies, charting the ways in which expertise becomes a resource for lending credibility to
controversial claims, underpinning high-risk decisions or bolstering the credibility of government

agencies. This book will make fascinating reading for those interested in the interface between
policymaking, academic research and political legitimacy.
• Draws on a range of theories from politics and sociology to develop a rigorous and original account
of the political uses of knowledge • Applies theories of knowledge utilization to the case of
immigration policy in the UK, Germany and the European Union • A highly topical issue, of interest to
the growing community of migration scholars
Contents
Part I. The Political Functions of Knowledge: 1. The puzzle: explaining the uses of knowledge; 2.
Instrumental knowledge and organizational legitimacy; 3. The symbolic functions of knowledge; 4.
The use of knowledge in public policy debates; Part II. The Case of Immigration Policy: 5. The politics
of immigration in Germany and the UK; 6. The British Home Office; 7. The German Federal Office for
Migration and Refugees; 8. The European Commission; 9. Organizations and cultures of expertise;
Part III. Extending the Theory: 10. Knowledge and policy.
Séance n°10 : Mardi 25 mai 2010 (14h-16h30) : présentation des travaux des doctorants du
laboratoire [Date à confirmer]
Mathieu Robelin : Les coalitions électorales
Discutant : Nicolas Bué
Clément Desrumaux : les campagnes électorales en France et en Grande-Bretagne
Discutant : Frédéric Sawicki
1
/
5
100%