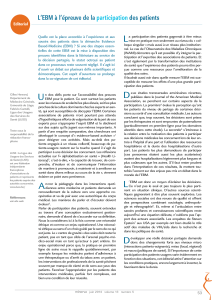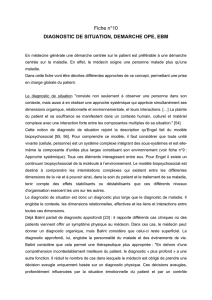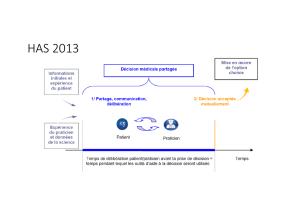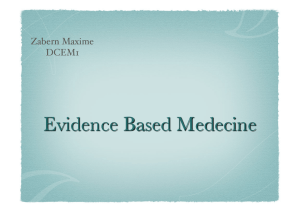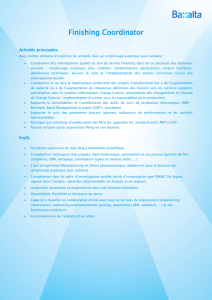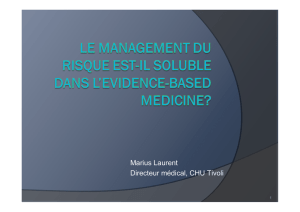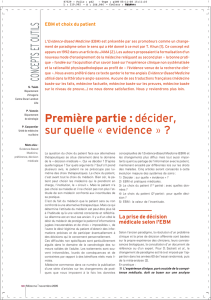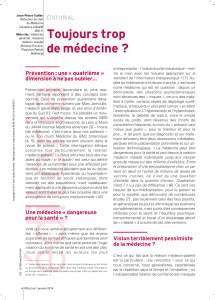Lire l'article complet

Acquis et limites de l’EBM
Le terme d’evidence-based medicine
(EBM), en francais “médecine fondée
sur les preuves”, a pris son essor dans
les années 1980 à la faculté des
sciences de la santé McMaster, à
Hamilton. Cette approche a alors
connu une grande notoriété outre-
Manche et s’est ensuite développée
dans la plupart des facultés du Canada
et des États-Unis.
Les promoteurs de l’EBM ont œuvré à
la diffusion d’outils pédagogiques et
pratiques permettant de résoudre des
cas de patients, en proposant des
démarches diagnostiques et thérapeu-
tiques standardisées, fondées sur des
preuves validées dans la littérature.
À l’exemple des données publiées
dans l’EBM Journal, l’EBM a pour
principe d’analyser régulièrement
(tous les mois ou tous les trimestres) le
contenu de plus de 50 périodiques
médicaux référencés et de sélectionner
tous les articles (couvrant les
domaines du diagnostic, du pronostic,
de la thérapeutique) à la fois utiles
pour la pratique quotidienne et rigou-
reux quant à leurs standards méthodo-
logiques. À partir de cette sélection,
des recommandations standard pra-
tiques sont proposées aux cliniciens
sous forme d’algorithmes décisionnels
et de conduites à tenir.
Ainsi, au sein même du département
de médecine interne de l’hôpital
Radcliffe, à Oxford (base anglaise du
Center for evidence-based medicine) a
été mis en place au cours des visites
médicales hospitalières un “chariot à
preuves”, dans lequel se trouve dispo-
nible instantanément l’ensemble des
“données prouvées” pour résoudre le
cas d’un patient. Les publications des
résultats de cette expérience montrent
que 80 % des cas rencontrés durant les
visites ont pu être documentés et réso-
lus. À l’inverse, l’absence de ce “cha-
riot à preuves” faisait que plus de
50 % des questions soulevées restaient
sans réponse documentée lors de la
prise en charge des patients.
Un grand courant international a
œuvré en faveur de l’EBM pendant les
années 1990, avec de nombreuses
publications vantant ses mérites et
visant à instruire les médecins en for-
mation initiale ou continue en utilisant
cette technique.
C’est ainsi que l’EBM Journal, publié
en français, affichait dès 1996 son
objectif dans un éditorial intitulé “De
la nécessité d’une médecine basée sur
des faits prouvés” (1).
Cette revue propose de se mettre au
service de l’evidence-based medicine,
discipline naissante qui “apporte au lit
du malade, au cabinet médical, aux
services hospitaliers et à la commu-
nauté médicale tout entière les résul-
tats les plus pertinents de la recherche
clinique”.
L’EBM se propose alors de transfor-
mer les besoins d’information en
questions claires, auxquelles il est
possible d’apporter une réponse avec
les meilleurs arguments (fournis par
l’examen clinique, le diagnostic biolo-
gique, et les données de la littérature).
Selon Covell et al. (2), les cliniciens
sont confrontés à ce besoin de repères
fiables pour deux tiers environ des
patients ou huit décisions cliniques
importantes par jour. L’éditorial de
l’EBM Journal affirme qu’en regard
de ces besoins, les manuels classiques
sont souvent dépassés et que la dispo-
nibilité des cliniciens à lire des jour-
naux est insufisante : ainsi, un méde-
cin qui souhaiterait se tenir informé
des évolutions de sa discipline devrait
assimiler 19 articles originaux par
jour, 365 jours par an. Il n’est donc pas
étonnant, poursuivent les auteurs, de
constater une corrélation négative, sta-
tistiquement et cliniquement signifi-
cative, entre notre connaissance des
méthodes de soins les plus perfor-
mantes et le nombre d’années écou-
lées depuis l’obtention du diplôme de
médecin. Un travail montre ainsi que
la décision d’instituer un traitement
antihypertenseur serait davantage liée
à l’apprentissage initial du médecin et
à ses habitudes qu’à la sévérité de l’at-
teinte organique du patient et qu’à la
connaissance des évolutions thérapeu-
tiques.
En 1993, Shin et al. (3) ont montré
également que, comparativement à des
praticiens formés traditionnellement,
ceux issus de McMaster étaient signi-
ficativement mieux informés de la
* Universitaire au laboratoire d’éthique
médicale, de droit de la santé et de
santé publique de Necker (université
Paris-V) depuis 1999, Grégoire Moutel
assure, en parallèle, les consultations de
médecine interne à l’hôpital Fourestier
(Nanterre). Outre ses DEA et doctorat
en éthique médicale, il est titulaire d’un
DES endocrinologie et métabolisme et
d’un DESC d’andrologie.
Depuis deux ans, le Dr Moutel a – entre
autres – pris en charge le secrétariat
général de la SFFEM (Société française
et francophone d’éthique médicale). Il
assure avec le Pr Hervé l’enseignement
et la direction des mémoires (maîtrise,
DEA et DIU) d’éthique médicale de la
faculté Necker et la coordination des
programmes de recherche dans le cadre
de l’IREB.
Evidence-based medicine :
source normative
de la relation médecin-patient
et de la décision médicale ?
G. Moutel*, C. Hervé
Éthique
181
Act. Méd. Int. - Neurologie (3) n° 8, octobre 2002
G. Moutel
Éthique

teneur des recommandations (guide-
lines) les plus récentes sur des sujets
classiques tels que la prise en charge
de l’HTA. Tamblyn et al. (4) ont
démontré par ailleurs que des étu-
diants (issus de différentes facultés
ayant réorganisé leur cursus autour des
innovations prônées par McMaster)
continuaient à adopter, au cours des
trois premières années de leur exercice
professionnel, des attitudes spéci-
fiques, notamment pour la prévention
et le dépistage, par lesquelles ils se
distinguaient déjà significativement
de leurs aînés.
D’autres travaux ont montré que l’on
peut maîtriser les techniques de
l’EBM (en s’investissant dans des
groupes ou des programmes de perfec-
tionnement postuniversitaires fondés
sur des apprentissages actifs), quels
que soient l’âge des praticiens et leur
ancienneté d’exercice (1).
Il semble donc que le principe de
l’EBM puisse effectivement moduler
efficacement les connaissances théo-
riques, voire les pratiques et compor-
tements des médecins.
Il remet donc en cause la formation
médicale académique traditionnelle
qui, selon ses promoteurs, n’arriverait
pas à modifier nos comportements et
ne parviendrait pas à améliorer le
devenir sanitaire de nos patients.
Ainsi, l’EBM se présente comme une
nouvelle approche pédagogique, et,
soutenue par de gros intérêts organisa-
tionnels mais aussi financiers, elle
tente de s’imposer dans les pro-
grammes de formation initiale et sur le
marché des formations médicales
continues.
Mais, si l’EBM a validé par des publi-
cations sa capacité à modifier le
niveau de connaissance ainsi que le
comportement de certains médecins,
aucun travail de grande ampleur ne
montre que l’EBM améliore réelle-
ment l’état de santé de la population et
permet de répondre aux réelles
attentes des patients : le manque de
données “prouvées” sur ces deux
points constitue le talon d’Achille de
l’EBM !
Grey zones et risque de
dérives
Plusieurs critiques sont formulées sur
l’EBM. Tout d’abord, elle ne semble
pas applicable à une médecine qui,
comme la médecine générale ou cer-
taines situations complexes de méde-
cine interne ou de spécialités, aborde
des patients présentant des problèmes
multiples et intriqués qui intera-
gissent fortement, souvent dans un
cadre polypathologique, et où se
mêlent les dimensions sanitaires,
sociales et familiales. Ainsi, l’EBM
n’apparaît pas adaptée au concept de
prise en charge globale des personnes,
puisqu’elle est fondée sur une
approche souvent monopathologique
et ne prend pas toujours en compte le
contexte de vie, ni les dimensions
complexes de la personne et des com-
portements humains (5).
Noylor (6), dans le Lancet, a formulé
une seconde critique fondamentale sur
l’EBM qu’il appelle les “grey zones”.
Il explique que, pour de très nombreux
domaines de l’activité clinique, il
n’existe pas d’études ni de données
scientifiques, ou qu’elles ne sont pas
représentatives des malades auxquels
elles prétendent s’appliquer. Dès lors,
“ce qui peut être présenté comme
blanc ou noir dans un article d’une
revue scientifique peut rapidement
devenir gris dans la pratique”.
Par ailleurs, il convient de souligner
un risque redouté, à savoir que l’EBM
pourrait s’imposer comme recomman-
dations ou comme références médi-
cales qui viseraient à normaliser et à
encadrer rigoureusement la pratique
médicale. Une telle approche compor-
terait alors un risque de dérive juri-
dique ou économique si l’EBM était
utilisée comme seule référence médi-
cale opposable en cas de conflits. Tout
médecin qui dérogerait à l’EBM pour-
rait dès lors être sanctionnable. Or,
nous connaissons tous des situations
cliniques dans lesquelles le praticien
prend un risque face à une incertitude
ou prescrit en dehors des règles tradi-
tionnelles, non pas de manière irres-
ponsable, mais en fonction de sa
propre expérience (ou de celle de ses
maîtres ou collaborateurs), en pesant
le risque qu’il prend en regard d’un
bénéfice attendu, tenant compte de la
spécificité d’un patient et d’une situa-
tion. En regardant dans l’histoire et le
quotidien de la médecine, dans des
services tout à fait rigoureux, des trai-
tements connus pour être efficaces
dans certaines pathologies sont pres-
crits dans d’autres indications de
manière empirique ou compassion-
nelle, suivant le sens clinique du
médecin (7), en dehors des indications
“réglementaires” validées par l’autori-
sation de mise sur le marché (AMM).
Ces réserves sur l’EBM sont réaffir-
mées par une école française de
grands cliniciens (8), qui insistent sur
la nécessité d’une pratique médicale
fondée sur l’expérience individuelle,
sur le compagnonnage dans le cadre
d’une approche talentueuse de la
médecine clinique. Ce point de vue est
parfaitement défendu dans les travaux
du doyen P. Even et de B. Guiraud-
Chaumeil :
“Le principe même de l’EBM
témoigne de l’abandon d’un système
dominé par la confiance en l’intelli-
gence, la formation et l’expérience des
médecins, en faveur d’une politique de
codification et de contrôle de la pra-
tique médicale. Au lieu de parier, en
amont, sur la qualité de médecins
ayant initialement acquis à l’univer-
sité, savoir, savoir-faire, expérience
clinique, aptitude au raisonnement,
goût de l’information critique, sens
des responsabilités à l’égard des
malades et de la communauté, la poli-
tique des guidelines vise, en aval, à
encadrer et à contrôler a posteriori
l’activité médicale. Au nom de ce que
la médecine est un art autant qu’une
science, parce que le pari et l’incerti-
tude sont inhérents à sa pratique et
parce que diagnostic et choix théra-
peutiques relèvent plus d’une délibé-
ration interne que de l’application
simpliste d’algorithmes préétablis, les
principes mêmes de l’experience-
182
Éthique
Éthique

based medicine (c’est bien “expe-
rience” qui figure dans le texte origi-
nal et non “evidence”, lapsus !), pré-
sentée comme un nouveau paradigme
dominant, sont énergiquement com-
battus. Beaucoup, en effet, n’acceptent
pas la prétendue supériorité d’une
connaissance factuelle, statistique,
impersonnelle et soi-disant objective,
sur les connaissances acquises, l’intui-
tion, l’expérience individuelle, les
rationnels physiopathologiques et la
qualité idiosyncrasique du raisonne-
ment clinique, seuls capables, à leurs
yeux, de répondre à des myriades de
situations cliniques différentes, qui ne
peuvent être mécaniquement résolues
à partir de guidelines simplifica-
trices.”
D’un point de vue non plus conceptuel
mais méthodologique, la principale
critique qui peut enfin être faite à
l’EBM est qu’elle codifie et valide les
connaissances et les croyances scienti-
fiques d’un instant, et que, par défini-
tion, elle ne répond qu’aux questions
posées. Comme le souligne P. Even,
les réponses ne valent donc que ce que
valent les questions posées et permet-
tent surtout au consensus largement
majoritaire de s’exprimer, consensus
nécessaire à la mise en place des gui-
delines. Parfois même, les experts
conviés à l’élaboration des recomman-
dations sont choisis de façon non aléa-
toire pour obtenir la réponse souhaitée
par les organisateurs.
Enfin, le dogme de l’EBM renferme
lui aussi des risques de dérive en
regard des principes éthiques de la
recherche clinique. Ainsi “l’affaire Di
Bella” est éclairante (7). Rechercher
une validation scientifique à tout prix
a fait instaurer une étude en cancéro-
logie sur l’association de somatosta-
tine, mélatonine, vitamine (?) et
Endoxan®à faible dose, pouvant coû-
ter jusqu’à 5 000 dollars par mois.
Cette étude, conduite en phase II et
d’emblée à grande échelle, pour être
plus significative (dans une logique de
concurrence scientifique par ailleurs),
a non seulement “prouvé” que cette
association n’est pas efficace et
qu’elle n’est pas dénuée d’effets
secondaires, mais a également mis en
évidence que la recherche de la
“preuve” a coûté 20 millions de dol-
lars et probablement mis fin, chez cer-
tains malades, à d’autres projets théra-
peutiques. L’ampleur prise par
l’affaire Di Bella a poussé la commu-
nauté médicale à modifier son com-
portement et à bousculer le dogme de
la “médecine fondée sur les preuves”.
La décision médicale recouvre
un champ plus vaste et plus
subtil que le concept de l’EBM
Il convient de rappeler (ce que recon-
naissent d’ailleurs les promoteurs de
l’EBM) que les études randomisées
cliniques, présentées comme le stan-
dard méthodologique de la recherche
clinique et de l’EBM ne parviennent
pas toujours à convaincre tous les pra-
ticiens, à imposer leurs conclusions,
ou même à s’entourer d’un consensus
sur les questions posées.
Les travaux menés dans le laboratoire
d’éthique médicale de la faculté
Necker montrent que plusieurs points
fondamentaux ressortent dans la réa-
lité de la décision médicale (7, 9).
Tout d’abord, l’importance de la
conviction dans la pratique médicale.
Le savoir théorique, la littérature, le
bon sens, l’expérience et la sensibilité
clinique, le partage avec d’autres
médecins, tout cela peut contribuer à
donner force à l’acte médical, ainsi
que l’ensemble des valeurs en jeu dans
la décision (10).
Ces travaux tendent à montrer que,
même s’il “sait”, le médecin n’agit pas
forcément en conséquence, et un
nombre important d’études montrent
que, malgré de nouvelles données
dans la littérature, les médecins ne
modifient pas toujours leurs prescrip-
tions médicales (entre 50 et 75 % pour
un panel de médecins interrogés). Ils
adaptent souvent leurs prescriptions
en fonction de leur conviction et des
attentes des patients, et ils évoquent la
crainte d’un amenuisement de la rela-
tion médecin-malade dans une méde-
cine qui ne serait que “scientifique”.
Certains médecins mettent en avant la
nécessité de rendre service en priorité
aux patients qui viennent leur deman-
der assistance. L’importance de cette
fonction du médecin (nouer une rela-
tion utile au malade, rassurante face à
sa maladie) peut prédominer sur un
choix thérapeutique “scientifique-
ment” rationnel et, souvent, le patient,
“d’après ce que ressent son médecin”,
se sent mieux et vit mieux avec un
traitement adapté à son mode de
vie (11).
Ce sont bien d’abord la confiance et le
confort du malade qui sont recherchés,
et le médecin est alors l’arbitre entre
des arguments théoriques (fondés sur
les publications, les données scienti-
fiques et éventuellement l’EBM) et
des arguments pratiques et humains
(la facilité d’accéder à un soin, la
compliance, l’acceptabilité, l’habitude
d’une équipe sur laquelle repose aussi
la compétence) (12). Comme l’écrit
E. Lucchi (7), “en choisissant la méde-
cine, les médecins acceptent d’en por-
ter l’inconfort et parfois la part en
apparence irrationnelle des décisions”
(les “états d’âme”). Cette dimension
de l’art médical suppose du temps,
une grande disponibilité et l’accepta-
tion culturelle d’une médecine qui
place la spécificité de chaque individu
et de chaque situation au premier plan.
Ainsi, l’incertitude peut avoir sa place
dans une médecine moderne que ne
renient pas pour autant le progrès
scientifique et les données validées de
la littérature. Savoir relativiser la
science et l’utiliser à bon escient serait
alors le plus grand art du médecin.
Le National Cancer Institute et la
National Library of Medicine ont ainsi
programmé d’établir un guide pour
chaque type de cancer mais en insis-
tant sur la nécessité de distinguer
entre, d’une part, l’expérimental, le
scientifique et, d’autre part, l’expé-
rience clinique, chacun ayant son
importance. Il conduit à des recom-
mandations novatrices remettant en
Éthique
183
Éthique
Act. Méd. Int. - Neurologie (3) n° 8, octobre 2002

cause, dans une certaine mesure, le
concept uniciste de l’EBM. Ces der-
nières visent en particulier à :
– réduire le nombre d’études de
phase II ou III inappropriées ;
– considérer qu’un usage “hors
AMM” est une modalité thérapeutique
et non une recherche ;
– ajouter un recueil de données d’ex-
périence clinique pour l’Agence pour
les politiques de santé et la recherche
(Agency for Health Care Policy and
Research) pouvant entrer dans les pro-
grammes d’éducation médicale.
Ces recommandations reconnaissent
et revalorisent le choix du médecin au
cas par cas.
Cette approche permet de rappeler que
la personne malade demeure marquée
par son histoire, sa philosophie, ses
croyances qui rendent la demande de
soins complexe. Il appartient au méde-
cin d’apprendre à déchiffrer cette
demande dans sa complexité, d’écou-
ter la personne qui se dévoile face à
lui. Il lui appartient de s’interroger sur
lui-même et sur les réponses qu’il peut
apporter. Ainsi, plusieurs considéra-
tions doivent être prises en compte :
– quels sont les faits médicaux et
scientifiques ?
– quelles sont les préférences du
patient ? quelles sont ses valeurs ?
– quelles sont l’aptitude et la compé-
tence d’une équipe à gérer telle ou
telle démarche diagnostique ou théra-
peutique ?
– quels éléments socioéconomiques
doivent être pris en compte?
– suivant quels choix le clinicien se
sent-il plus à l’aise et plus compétent
pour assister, accompagner et soigner
son patient ?
Ces questions débouchent sur trois
interrogations simples face à toute
situation clinique :
– que devrait-on faire dans ce cas ?
– quels sont les buts visés ?
– que signifie être un bon médecin ?
La nécessité de redonner place à la
relation avec le malade apparaît donc
de plus en plus, ainsi que le besoin de
trouver des méthodes scientifiques qui
laisseraient une part à l’expérience du
médecin et permettraient une évalua-
tion des pratiques “telles qu’elles
sont” (et ainsi atteindraient leur but :
améliorer les pratiques existantes). Il
paraît alors essentiel de trouver des
lieux de discussion et de rencontre des
différents professionnels autour de ces
questions, d’inciter les médecins à
s’interroger sur les raisons de leurs
prises de décision, et d’écouter ou
enseigner toutes les voix alternatives.
Conclusion
L’émergence de l’EBM a le mérite de
nous interroger sur la médecine telle
que nous l’apprenons et la pratiquons.
Elle permet d’apporter à des praticiens
une actualisation du savoir scienti-
fique médical et constitue de ce fait un
des éléments de l’arsenal du médecin.
Mais, le risque d’une utilisation dog-
matique de l’EBM est certain, car il
tendrait à “normer” de manière
inadaptée l’exercice médical et la rela-
tion médecin-patient. Pour pondérer le
courant de pensée lié à une utilisation
uniciste de l’EBM, Greenhalgh
constate que même les adeptes de
l’EBM se doivent aujourd’hui de réaf-
firmer l’importance du jugement cli-
nique, qu’il est impératif de sortir des
représentations schématiques, et qu’il
doit rester de la place pour la repré-
sentation personnelle du médecin,
mais aussi du patient.
Références
1. De la nécessité d’une médecine basée
sur des faits prouvés. EBM journal 1996 ;
5-7.
2. Covell DG et al. Information needs in
office practice : are they being met ? Ann
Intern Med 1985 ; 103 : 596-9.
3. Shin JH, Haynes RB. Effect of problem-
based, self directed undergraduate educa-
tion on long-life learning. Can Med
Association J 1993 ; 148 : 969-76.
4. Tamblyn RM, Abrahamowicz M,
Brailovsky C. Association between licen-
sing examination scory and resource and
quality of care in primary care practice.
JAMA 1998 ; 280 : 989-96.
5. Sock’tt D, Rosenberg W, Groy JAM.
Evidence-Based Medicine : what it is and
what isn’t. BMJ 1996 ; 312 : 71-4.
6. Noylor CD. Grey zones of clinical prac-
tice : some limits to evidence-based medi-
cine. Lancet 1995 ; 345 : 840-2.
7. Lucchi E, Hervé C. Études randomisées
cliniques : questions éthiques. DEA éthique
médicale et biologique, Faculté de méde-
cine Necker-Paris. 1995-1996.
8. Guiraud-Chaumeil B, Even P.
Confrontation avec le système de santé
américain. ln : Les hôpitaux universitaires
de l’an 2000. Toulouse, Privat 1996 ; 239-45.
9. La relation médecin patient. Dossier thé-
matique, Laboratoire d’éthique médicale de
Necker/Inserm. Site www.inserm.fr/ethique,
2000.
10. Mant D. Can randomized trials inform
clinical decisions about individuals
patients ? Lancet 1999 ; 353 : 743-6.
11. Mulrow CD, Cook DJ, Davidoff F.
Systematic review : critical links in the
great chain of evidence. Ann Intern Med
1997 ; 126 : 289-91.
12. Haynes RB, Haines A. Barriers and
bridges to evidence-based clinical prac-
tice. BMJ 1998 ; 317 : 273-6.
Éthique
184
Éthique
Act. Méd. Int. - Neurologie (3) n° 8, octobre 2002
1
/
4
100%