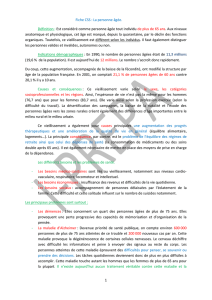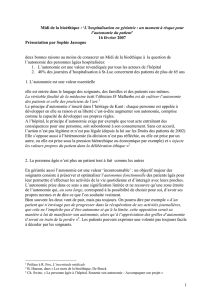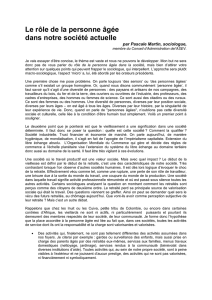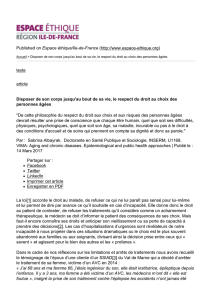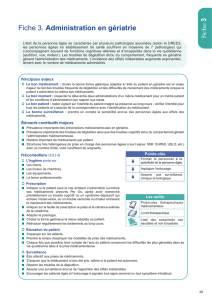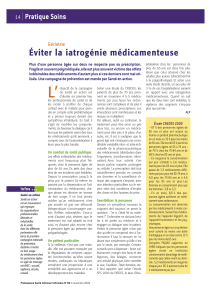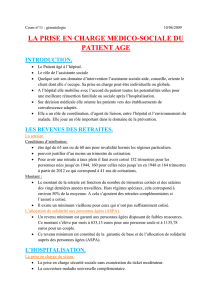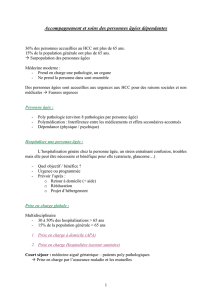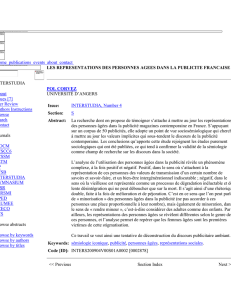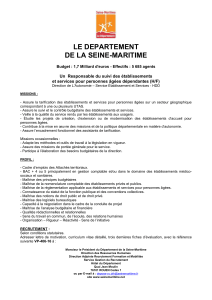Lire l'article complet

© Alix/Phanie
© PhotoDisc®
Tout d’abord, qui est vieux ?
Selon les économistes, la
vieillesse débute à 60 ans,
l’âge de la retraite. Selon les démo-
graphes ou les institutions inter-
nationales on est vieux à partir de
65 ans. Quant aux gériatres qui
aujourd’hui s’intéressent davan-
tage au vieillissement de l’état de
la personne plutôt qu’au chiffre
signalé par l’état civil, ils soignent
“les octos +”. Joliment dit. Exit troi-
sième, quatrième et pourquoi pas
cinquième âge !
Les facteurs environnementaux et
l’hygiène de vie sont les premiers
déterminants de la santé, la mé-
decine et les médicaments ayant
leur part surtout après 50 ans. Il
doit en être de même pour la
population vieillissante.
Un système de santé à revoir
Il est indéniable que le vieillisse-
ment de la population est une
des causes principales qui fait
exploser le système des retraites
et déséquilibre les comptes de la
Sécurité sociale. Or, les données
prospectives restent floues et l’on
s’aperçoit, au décours d’une ca-
tastrophe comme celle provoquée
par la canicule de l’été 2003, du
manque de coordination et de
connaissance des besoins de
cette population, somme toute
particulière. On a pu
s’interroger
sur la capacité de réaction du sys-
tème français alors qu’approches
sanitaire et sociale restent peu
cohérentes et que les moyens
mis en place sur le terrain sont
insuffisants. L’objectif du rapport
Laroque n’est pas encore atteint
alors qu’il date de 40 ans ! En
effet, la dimension psychosociale
demeure inexplorée. Ainsi, en
dehors des problèmes financiers,
le phénomène solitude, lié aux
nouveaux modes de vie, devient
un problème majeur. En effet, la
personne isolée est potentielle-
ment en danger même si elle ne
souffre d’aucune pathologie
grave. Son retrait de la société la
fait se retirer également de l’hy-
giène (alimentaire, corporelle,
etc.) et, enfin, des soins quand la
lassitude s’installe. La gériatrie est
Gériatrie
Les enjeux du vieillissement
Professions Santé Infirmier Infirmière N° 58 • octobre 2004
Sommaire
•Fondation Hôpitaux de Paris –
Hôpitaux de France
•Insuffisance rénale chronique terminale
•Cancers
•Affections cardiovasculaires
•Chutes
•Prothèse articulaire
•Iatrogénie
•Dénutrition
•Cataracte
•Maladie d’Alzheimer
•Douleur
•Violence
•Formation
•Unités de soins de longue durée (USLD)
>> DOSSIER
GÉRIATRIE 15
Assurer la prise en charge sanitaire et médico-sociale des
personnes âgées relève du défi. Pour être en mesure de
répondre, demain, aux besoins supplémentaires d’une
population plus nombreuse il faut une volonté politique
forte et une mobilisation de tous les acteurs du système
de santé. Très “consommatrices de soins”, les personnes
de plus de 65 ans, seront un million de plus en 2010
(10,4 millions*). Le paysage pathologique, déjà dominé
par les maladies chroniques, qui surviennent après
50 ans dans la majorité des cas, ne le sera que davantage.
Par ailleurs, au plan médico-social, l’espérance de vie s’ac-
compagne aussi d’une croissance prévisible du nombre de
personnes dépendantes (1,2 million en 2040).
>>

reconnue aujourd’hui comme
une spécialité à part entière. Les
pathologies ont certes des simili-
tudes avec celles d’une personne
plus jeune. Cependant, la réaction
n’est pas la même d’autant que
plusieurs pathologies cohabitent
et requièrent divers traitements.
Ce qui entraîne une iatrogénie
médicamenteuse, favorisée en
effet par les modifications physio-
logiques liées à l’âge, par une
évaluation clinique insuffisante,
par la polymédication et les
conditions d’usage du médica-
ment. Si les thérapies de cer-
taines maladies, dans le domaine
cardiovasculaire en particulier,
permettent de faire reculer la
mortalité et le handicap, il est de
nombreuses pathologies, la mala-
die d’Alzheimer, par exemple,
pour ne citer qu’elle, qui ne béné-
ficient pas de traitement satisfai-
sant. Soigner une personne âgée,
c’est lui permettre de vivre plus
longtemps, certes, mais surtout
en bonne santé. On entend ici par
bonne santé : éviter les douleurs,
le handicap et la dépendance.
Cependant, si certaines affections
comme la cataracte, Alzheimer ou
Parkinson sont rencontrées avec
l’âge, d’autres maladies peuvent
être repoussées, voire évitées par
une prévention primaire et secon-
daire efficace, pouvant corres-
pondre à une prise en charge de
l’adulte (maladies ischémiques,
maladies respiratoires, certains
cancers, etc.).
Prévenir jeune
pour bien vivre vieux
En matière sanitaire et sociale, les
données démographiques ne suf-
fisent pas à elles seules à dimen-
sionner les besoins futurs. Ceux-ci
seront dépendants de plusieurs
autres facteurs dont l’état de
santé de la population en général,
son attitude face à la santé, le
progrès thérapeutique disponible
et les aléas environnementaux.
Lorsque les systèmes de santé
n’arrivent pas à traiter ou à pren-
Professions Santé Infirmier Infirmière N° 58 • octobre 2004
dre suffisamment en charge les
maladies devenues chroniques,
on observe, avec lâge, une aug-
mentation de leur incidence, de
leur prévalence et de leurs com-
plications. Ce qui oblige à prélever
des ressources sur d’autres priori-
tés sanitaires, comme la santé
maternelle et infantile.
« Le travail
fait par un dispensaire attentif aux
personnes âgées est utile à l’en-
semble de la population »,
comme l’exprime le slogan des
Nations-unies et “une société
pour tous les âges”, rappelle le
Dr Alexandre Kalache, qui coor-
donne les activités de l’OMS sur
le vieillissement.
Andrée-Lucie Pissondes
* Source OMS
Infos ...
Des états de
santé nouveaux
L’allongement
de la durée de vie
confronte
les soignants
à de nouveaux états
de santé :
émergence
des démences
et des “octos +”,
c’est-à-dire les plus
de 80 ans.
La prise en charge
est de plus en plus
complexe :
le diagnostic est
plus difficile,
la polypathologie
est fréquente.
De plus, le risque
de iatrogénie est
plus important,
soit deux fois plus
fréquent qu’avant
65 ans.
DOSSIER
16
>>
>> DOSSIER
20
18
16
14
12
10
8
6
2000 2010 2020 2030 2040 2050
910
13
16
18 19
millions
Figure 1. Évolution de la population
des plus de 65 ans.
(en millions) entre 2000 et 2050, INSEE.
1 600 000
1 200 000
800 000
400 000
0
2000 2020 2040
Figure 2. Évolution du nombre de per-
sonnes dépendantes de 60 ans ou plus,
DREES.
Dix huit principales pathologies
Sont liées au vieillissement ou aggravées par lui :
– cancers
– insuffisance cardiaque
– troubles du rythme
– cardiopathies ischémiques
– artériopathies des membres inférieurs
– accident vasculaire cérébral (AVC)
– diabète
– maladie d’Alzheimer
– dépression
– Parkinson
– troubles du sommeil
– dégénérescence maculaire
– cataracte
– glaucome
– ostéoporose
– arthrose
– broncho-pneumopathies obstructives (BPCO)
– incontinence urinaire...
Malgré une position officielle condamnant toute discrimination liée à
l’âge, il y a en pratique sous-médicalisation de la population âgée.
Étude Leem/LIR réalisé par les cabinets ACE et JNB Développement (2003).
Une demande croissante
Plus d’un milliard de personnes* auront plus de 60 ans en 2025 et la
charge des maladies chroniques ira de pair avec le vieillissement de la
population. On compte aujourd’hui dans le monde plus de 600 millions
de personnes de plus de 60 ans. Ce chiffre devrait doubler d’ici 2025 et
atteindre les 2 milliards en 2050, avec une immense majorité de ces per-
sonnes âgées vivant dans les pays en développement. Le vieillissement de
la population se caractérise par une augmentation de la charge des
maladies non transmissibles, maladies cardiovasculaires, diabète, mala-
die d’Alzheimer et autres pathologies mentales associées à la vieillesse,
cancers, pneumopathies obstructives chroniques et problèmes de l’appa-
reil locomoteur. En conséquence, les systèmes de santé devront faire face
dans le monde entier à une demande croissante.

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 58 • octobre 2004
Il y a huit ans, la Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux
de France a choisi de contri-
buer à l’amélioration de la qualité
de vie des personnes âgées avec
l’opération “+ de vie”. Prévue
pour durer un mois, du 1er au 31
octobre, cette campagne, parrai-
née par Aimé Jacquet et Henri
Salvador, a contribué à quelque
1 200 projets propres au séjour
des personnes âgées à l’hôpital.
À cette occasion, nous avons ren-
contré Madame Chirac, qui a
commenté les motivations qui
animent la Fondation, nous a
donné son avis sur les personnes
âgées et a souligné le rôle primor-
dial des soignants dont, bien sûr,
celui des infirmières.
PSII : Quels sont les objectifs de
votre engagement dans la cause
des personnes âgées ?
Madame Bernadette Chirac :
Les
personnes âgées souffrent de l’in-
différence et nous tentons de les
replacer au cœur de la vie. Bien
avant la canicule de l’été dernier
nous étions engagés pour essayer
de rompre cette indifférence. Mais
les événements de l’été 2003 ont
provoqué une prise de conscience
brutale des besoins du 4
e
âge
aujourd’hui et ont montré que le
vieillissement de la population est
un véritable enjeu de société.
Nous sommes tous, vous comme
moi, des personnes âgées en
devenir. C’est vrai qu’il est difficile
de s’imaginer vieux et handicapé.
Notre attention se porte naturelle-
ment davantage vers les enfants.
Or, je le répète, la canicule a mobi-
lisé davantage et cette population
de plus en plus nombreuse a
besoin de nous tous, de béné-
voles aussi, notamment quand
elle séjourne à l’hôpital. Les per-
sonnes âgées sont attachées à
leur maison et à leurs habitudes et
sont désorientées quand elles
sont obligées de séjourner à l’hô-
pital. Nous essayons donc de sen-
sibiliser les Français à travers cette
action de solidarité et de recueillir
des fonds pour financer certaines
réalisations. Il s’agit de faciliter le
rapprochement des familles, de
développer les loisirs pour per-
mettre aux personnes de sortir et
de rompre la monotonie de la vie
à l’hôpital. Nous essayons d’amé-
liorer leur vie avec du matériel que
nous leur procurons et en créant
des lieux conviviaux. Enfin, il nous
faut lutter contre la douleur, car
vous ne vous doutez pas de ce
qu’il y a de physiquement doulou-
reux dans la vieillesse !
PSII : Comment se décline votre
action dans l’opération “+ de vie” ?
Madame B. Chirac : D’une façon
générale, nous procédons, j’insiste,
avec le concours des équipes soi-
gnantes qui élaborent elles-mêmes
des projets et en évaluent le coût.
Ces projets nous sont envoyés et
nous choisissons de les aider en
fonction de leur faisabilité et des
moyens dont nous disposons.
Ainsi, à ce jour, nous avons sub-
ventionné près de 1 200 projets
proposés par des équipes soi-
gnantes dans 570 hôpitaux répar-
tis dans 518 villes de France. Ce
sont des réalisations très diverses.
Nous avons créé, par exemple,
des “espaces famille”, des “es-
paces intergénérations”, des ate-
liers de cuisine. Nous avons fait
l’acquisition de fauteuils roulants,
ou encore nous avons subven-
tionné l’achat de minibus pour
que les personnes, même handi-
capées, puissent se déplacer en
dehors de l’hôpital. Nous nous
occupons de l’aménagement de
parcs et de jardins également.
>>
>> DOSSIER
Madame Chirac a mobilisé l’hôpital Vaugirard-Gabriel Pallez, le 30 septembre dernier,
pour inaugurer la 8ecampagne de solidarité nationale “+ de vie”. Cette campagne en
faveur des personnes âgées a été initiée par la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de
France, dont elle est la présidente depuis 1994.
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France
Madame Bernadette Chirac :
« Avançons et soyons positifs »
GÉRIATRIE 17

Notre action contre la douleur
consiste pour l’instant en 144 pro
-
jets dans plus de cent établisse-
ments. Nous fournissons ainsi
des matelas anti-escarres qui,
comme vous le savez, coûtent
extrêmement cher ; des pompes
à morphine aussi, des coussins
de positionnement ou encore des
pousses seringues…
Vous savez, le grand âge, ce n’est
pas la fin de la vie active ! Nos
deux parrains, Aimé Jacquet et
Henri Salvador le montrent bien
par leur activité et l’aide qu’ils
nous apportent. Mais il faut lutter
contre l’isolement que procure
l’hospitalisation. C’est pourquoi
nous organisons ces lieux de vie
qui permettent de rapprocher les
personnes âgées non seulement
de leur famille ou de leurs proches
mais aussi des jeunes. Il y a des
expériences avec des élèves de
CP ou de maternelle. En Corrèze,
je viens d’inaugurer un espace qui
permet aux tout petits de passer
une journée ou une après-midi
avec des personnes âgées. Ce
type d’action intergénérationnelle
est bénéfique pour tous et, de
plus, les enfants sont ravis.
Nous sommes également sensibles
à une demande croissante de la
présence d’animaux à l’hôpital. Je
sais que c’est extrêmement difficile.
Mais quand on voit ce que peut
apporter un chien, par exemple,
comme je le constate dans la rela-
tion positive de mon petit-fils avec
son chien, je suis sensible à la
détresse des personnes âgées qui
doivent se séparer de leur animal
lors d’une hospitalisation.
PSII : Quelles sont vos priorités
pour cette année ?
Madame Chirac : Il est difficile
de dégager des priorités tant il y a
à faire. À titre indicatif, nous avons
reçu cette année plus de 600 dos
-
siers qui représentent un budget
de 6 millions d’euros !…
Le nombre de projets dépendra
des résultats de la collecte que
nous engageons en ce moment.
Celle de l’année dernière était de
1,3 million d’euros.
J’espère que cette année, la cam-
pagne que nous avons mise en
place grâce à des sponsors nous
permettra de dépasser ces résultats.
Il appartient maintenant à chaque
Française et à chaque Français de
faire un don, aussi minime soit-il.
PSII : Votre action, en tant que
présidente de la Fondation et
votre engagement dans l’opéra-
tion “+ de vie” ne peut réussir que
si elle s’inscrit dans le cadre d’une
volonté politique. Est-ce le cas ?
Madame Chirac : C’est quoi une
volonté politique ? Je ne suis pas
ministre et je ne fais pas ici de
politique. Mais il faut bien réaliser
que notre population vieillit.
L’INSEE prédit qu’en 2040, les
personnes dépendantes dépasse-
ront le million. Dans toutes les
enquêtes, les Français considè-
rent que les hôpitaux remplissent
toutes les missions de prise en
charge des personnes âgées. Et
c’est vrai que le travail des
équipes soignantes est extraordi-
naire. Mais peu de gens savent ce
que c’est de vivre hors de chez
soi surtout quand on est âgé. Peu
de gens veulent regarder la réalité
de la vieillesse en face. Aucun de
nous ne veut se projeter dans un
avenir de dépendance. Moi la
première ! Aussi, si cette action
citoyenne que je mène peut
contribuer à une meilleure qualité
de vie de ces Français vulné-
rables, elle peut effectivement
être considérée comme une
action politique. Même s’il ne
s’agit que de rendre leur dignité,
donner une certaine convivialité
aux personnes qui, par leur grand
âge, leur état de dépendance,
leur destin... s’en trouvent privées.
Par cette 8eédition de la cam-
pagne “+ de vie”, il s’agit de
remettre en place, en l’amélio-
rant, la condition de vie des per-
sonnes âgées. Il est de notre
devoir de soutenir, en somme,
ceux qui ont construit la France
d’aujourd’hui. Car l’État ne peut
tout faire. Il est donc du devoir de
chacun d’accompagner la poli-
tique d’un État qui ne peut pas
Professions Santé Infirmier Infirmière N° 58 • octobre 2004
tout résoudre concrètement. Cela
va au-delà de l’État et devient un
enjeu de société.
PSII : Que vous inspirent les
inquiétudes de la profession en ce
qui concerne la prise en charge
de la dépendance ? Notamment
quant au faible niveau de recrute-
ment chez les soignants ?
Madame Chirac : Je suis cons-
ciente qu’il y a un manque d’infir-
mières. C’est une évidence. Mais
ce qui me surprend, c’est que per-
sonne ne l’ait prévu, alors que la
France ne manque pas d’orga-
nismes de prévision. On a réduit la
voilure en remontant le niveau du
concours national, par exemple,
sans se soucier de relever les quo-
tas du nombre d’infirmières. Il y a
eu incontestablement un défaut
de prévision. Aujourd’hui, le gou-
vernement de Monsieur Raffarin
fait face avec beaucoup de talent
pour intéresser les jeunes gens à
ce beau métier. Mais nous avons
perdu beaucoup de temps. Une
infirmière, c’est Bac plus 3. C’est
vous dire qu’il est bien difficile de
répondre instantanément aux
besoins qui existent.
PSII : Comment, à votre avis, sus-
citer les vocations chez les soi-
gnants et valoriser la profession ?
Madame Chirac : On ne va pas se
lamenter. Avançons et soyons posi-
tifs. J’ai souhaité, parce que j’ai une
grande admiration pour les infir-
mières – et que j’en ai aussi dans
ma famille –, j’ai donc souhaité
avec Michel Drucker que certaines
d’entre elles (de l’hôpital
Bretonneau,
pour ne pas le nom-
mer), viennent
témoigner, lors de
l’émission que nous
avons organisée
avec Michel Drucker
et France
Télévision, le 4 octobre, sur
France 3.
J’espère que cette émission et leur
témoignage convaincront beaucoup
de jeunes de tout l’intérêt qu’il y a à
se mobiliser pour notre cause.
Pour ce qui est de moi, je continue ce
travail que je mène à la Fondation
depuis 1976. Sans perdre courage.
Propos recueillis par François Engel
et Andrée-Lucie Pissondes
Infos ...
Quelques chiffres
– Près de
500 000 personnes
vivent dans
des établissements
spécialisés ;
– trois résidents sur
quatre sont âgés de
80 ans et plus ;
– 43,3 % de la
population française
ayant 80 ans ou
plus vivent dans un
service de soins de
longue durée ;
– 2/3 des résidents
souffrent d’une
dépendance
physique sévère ou
d’une dépendance
psychique ;
– 2/3 des personnes
dépendantes âgées
de 60 ans et plus
vivent en institution
quand elles sont
seules.
DOSSIER
18
>>
>> DOSSIER

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 58 • octobre 2004
Selon une enquête de l’ins-
pection générale des affaires
sociales, il y aurait, en France,
30 000 personnes au stade de l’in-
suffisance rénale terminale. Sur les
20 000 dialysés, 30 % auraient
plus de 65 ans et 10 % plus de
80 ans.
Qu’est-ce que l’IRC ?
L’IRC est définie par une diminution
permanente du débit de filtration
glomérulaire secondaire à une
maladie rénale. Cette définition
implique une stratégie de prise en
charge selon le niveau de DFG
(débit de filtration glomérulaire) et
des marqueurs d’atteinte rénale
éventuellement associés. Sa princi-
pale cause quand elle est terminale
– stade où les reins fonctionnent à
moins de 10 % de leur capacité
normale – est le diabète ; viennent
immédiatement après les cardio-
pathies, dont l’hypertension. Les
néphropathies vasculaires (pre-
mière cause d’insuffisance rénale
terminale traitée chez le malade
âgé de plus de 60 ans) et diabé-
tiques représentent 40 % des
causes. Une prise en charge
néphrologique tardive (20 à 35 %
des patients admis en dialyse sont
adressés aux néphrologues moins
de 6 mois avant la mise en dialyse)
conduit également à la phase IRCT
et a des conséquences néfastes
pour le patient. Plusieurs facteurs
l’expliquent : le caractère volontiers
asymptomatique de l’insuffisance
rénale, l’existence de comorbidités
et l’âge élevé. Car l’insuffisance
rénale est aussi un concept physio-
logique. En effet, le nombre de
néphrons fonctionnels diminuant
avec l’âge, l’insuffisance rénale
impliquera donc une adaptation
thérapeutique de certains médica-
ments diurétiques, le choix de ces
produits et une surveillance accrue.
À partir d’un certain âge, on pour-
rait presque parler d’insuffisance
rénale physiologique.
En effet, l’important est la vitesse
de progression de l’insuffisance
rénale, et surtout la façon dont on
va s’écarter de la courbe de dégra-
dation normale en fonction de
l’âge. Un certain degré d’insuffi-
sance rénale, à partir du moment
où on en est averti, peut être
toléré, mais pas sa progression
trop rapide ou son trop grand
dépassement par rapport à ce que
l’on pourrait attendre à un âge par-
ticulier. Des tableaux donnent, en
fonction de l’âge, la fonction rénale
“normale”. Même à un certain
degré d’insuffisance, celle-ci doit
correspondre à ce que l’on peut
attendre à un âge donné. Ainsi,
chez un sujet de 70 ans, on peut
attendre une clairance aux envi-
rons de 60 ml/mn, alors que la
normale d’un adulte se situe à
100 ml/mn. Chez un adulte, on
doit s’alerter lorsque la clairance de
la créatinine atteint 80 ml/mn,
mais chez un vieillard, on le fera
lorsque la clairance de la créatinine
atteindra 40 ml/mn.
Méthodes d’évaluation
de la fonction rénale
La fonction rénale est appréciée
par l’évaluation du DFG. Celui-ci
peut être mesuré ou estimé. Les
méthodes de mesure du DFG
(clairance de l’inuline, méthode
isotopique, Iohexol) sont de réalisa-
tion complexe et nécessitent une
infrastructure spécifique. Leur utili-
sation en pratique clinique cou-
rante est donc limitée, d’où la
nécessité d’utiliser des méthodes
d’estimation et, plus particulière-
ment, la mesure de la créatininé-
mie et la formule de Cockcroft et
Gault, dont la performance est
cependant peu évaluée chez le
sujet âgé (> 75 ans) et inconnue
chez l’obèse (IMC > 30 kg/m2).
Le caractère terminal de l’insuffisance
rénale se définit par un DFG
< 15 ml/
mn/1,73 m
2
indépendam
ment du
début du traitement de suppléance.
D’après plusieurs études, l’inci-
dence de l’IRC semble près de
deux fois plus élevée chez les
hommes que chez les femmes
dans toutes les tranches d’âge. Elle
est plus élevée chez les sujets âgés,
phénomène majoré par l’exclusion
de ces patients en transplantation.
ALP
Source Anaes
>> DOSSIER
La prévalence de l’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) traitée par dialyse
peut être estimée à 400 par million d’habitants, et son incidence, à 100 par million d’ha-
bitants. Prévalence et incidence sont en augmentation*, d’autant plus que l’insuffisance
rénale est aussi un concept physiologique et que la population générale vieillit.
Insuffisance rénale chronique terminale
Des prises en charge trop tardives
GÉRIATRIE 19
Formule de Cockcroft et Gault
Avec la créatininémie exprimée en mg/l
•
chez l’homme :
DFG (ml/mn) = [(140-âge) x poids / 7,2 x créatininémie en mg/l],
•
chez la femme :
DFG (ml/mn) = [(140-âge) x poids / 7,2 x créatininémie en mg/l] x 0,85
Avec la créatininémie exprimée en µmol/l
DFG (ml/min) = [(140-âge) x poids / créatininémie en µmol/l] x k,
Avec k = 1,23 pour les hommes, 1,04 pour les femmes, poids en kg, âge en années.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%