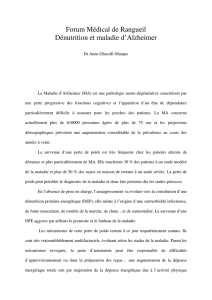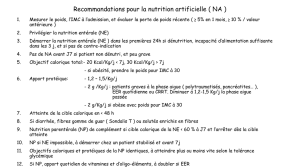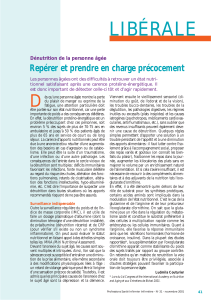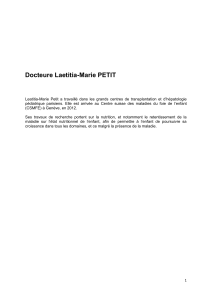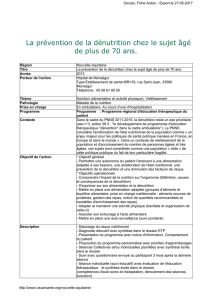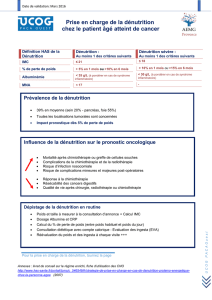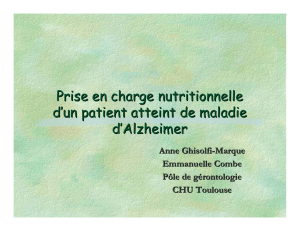Besoins nutritionnels

Besoins nutritionnels
Les apports quotidiens recommandés
par l’OMS sont de 1 800 kcal pour les
femmes et de 2 000 kcal pour les hommes,
soit environ 35 kcal/kg de poids par
jour. Une répartition équilibrée des apports
contient 12 à 15 % de protides, 55 à
60 % de glucides et 30 à 35 % de lipides.
La malnutrition protéino-énergétique
concerne 3 à 5 % des sujets âgés à
domicile, 50 % en hospitalisation aiguë,
et touche de 20 à 60 % des patients qui
résident en institution. Ces chiffres,
considérables s’ils sont exprimés en
nombre absolu, expliquent la nécessité
d’intégrer la prise en charge nutrition-
nelle dans les priorités thérapeutiques
des unités hébergeant des personnes
âgées.
Étiologies des malnutritions
Elles relèvent de deux mécanismes prin-
cipaux : les carences par insuffisance
d’apports et celles imputables à un hyper-
catabolisme. Cette dernière, aussi appe-
lée dénutrition endogène est fréquente,
notamment lors de pathologies à l’ori-
gine de syndromes inflammatoires. La
survenue d’une affection aiguë chez
une personne, déjà fragilisée par des
apports énergétiques faibles, va entraî-
ner une dénutrition grave par augmen-
tation des besoins (1). De nombreuses
causes à l’origine d’une carence d’ap-
ports peuvent être retrouvées chez les
sujets âgés, comme la solitude et l’iso-
lement, des ressources insuffisantes, une
diminution des capacités physiques et sen-
sorielles, une démence ou une dépres-
sion, les hospitalisations, le nombre de
médicaments qu’ils prennent quotidien-
nement, ou encore les régimes abusifs sur
prescription médicale ou imputables à
leurs propres croyances.
Évaluation
du statut nutritionnel
Le diagnostic et l’évaluation d’une dénu-
trition reposent sur la connaissance de
plusieurs éléments ou indices comprenant
au minimum une enquête diététique,
rendue parfois difficile lorsque des
troubles mnésiques existent, le relevé de
paramètres anthropométriques, comme
le poids et l’indice de masse corporelle
(IMC) et la mesure de marqueurs bio-
logiques (2). Le BMI ou indice de Que-
telet, correspond au poids, en kilo-
grammes, que divise le carré de la taille
(IMC = P(kg)/T2(m2)). Lorsque l’indice
est inférieur à 21 chez la femme ou
20 chez l’homme, le patient âgé est
considéré comme dénutri. S’agissant des
marqueurs biologiques, ils comprennent
des protéines nutritionnelles comme
l’albumine (seuil pathologique < 35 g/l)
et la pré-albumine (SP < 200 mg/l), et
des protéines de l’inflammation comme
la protéine C réactive (SP > 20 mg/l) et
l’orosomucoïde (SP > 1,2 g/l). Cer-
taines grilles d’évaluation standardisées
comme le Mini Nutritional Assessment
(MNA) (3) prennent en considération
ces différents types de marqueurs
(annexe 1).
L’évaluation de l’état nutritionnel fait
partie de l’examen clinique du sujet âgé.
Elle est indispensable à l’élaboration
d’une stratégie thérapeutique. Cepen-
dant, cette évaluation ne peut être le fait
d’un seul outil car aucun n’a suffisam-
ment de sensibilité et de spécificité pour
permettre le diagnostic du type et de la
sévérité de la dénutrition. L’ensemble
de ces marqueurs doit permettre de
savoir si le patient est dénutri, quel est
son type de dénutrition, et enfin quelle
en est son intensité (4). Ils permettent
également de surveiller l’efficacité d’une
renutrition protéino-énergétique.
Prise en charge
thérapeutique
Le diagnostic de dénutrition étant posé,
son étiologie et sa sévérité connues, le
praticien dispose alors de plusieurs pro-
grammes de renutrition parmi lesquels
il choisit celui qui est le plus adapté à la
situation clinique du patient (annexe 2).
169
Le sujet âgé
Act. Méd. Int. - Gastroentérologie (17), n
os
8-9, nov.-déc. 2003
Nutrition
T. Cudennec, N. Faucher, L. Teillet*
* Service de médecine gériatrique,
hôpital Sainte-Périne, Paris.
La population des personnes
âgées de plus de 75 ans
regroupe des patients fragiles
particulièrement exposés au risque
de dénutrition protéino-calorique.
Les problèmes nutritionnels que pré-
sentent ces patients sont malheu-
reusement trop fréquemment relé-
gués au second plan alors que le
maintien d’un état nutritionnel
adapté est souvent décisif pour
l’évolution globale de la santé et de
la qualité de vie du sujet âgé fragile,
qu’il se trouve à son domicile, en ins-
titution ou, a fortiori, en milieu hos-
pitalier. Les patients dénutris guéris-
sent moins vite, récupèrent plus
lentement et développent davan-
tage de complications. Il paraît alors
fondamental de pouvoir disposer, au
plus vite, d’une évaluation du statut
nutritionnel afin de proposer une
prise en charge adaptée à la situa-
tion clinique.
Le sujet âgé

L’alimentation orale, par stimulation et
par restauration de l’appétit, doit tou-
jours être privilégiée. Les régimes stricts
doivent être assouplis, les habitudes ali-
mentaires respectées et la présentation
soignée. Il peut être nécessaire d’y asso-
cier des compléments caloriques enrichis
éventuellement en protéines. Cependant,
certaines situations médico-chirurgi-
cales, ainsi que l’existence de troubles
de la déglutition, rendent ces pratiques
aléatoires ou impossibles.
L’alimentation entérale artificielle est
une alternative. Elle permet l’utilisation
physiologique du tube digestif en admi-
nistrant les nutriments directement dans
l’estomac ou dans le grêle proximal.
Elle ne contraint pas le sujet à l’alite-
170
Le sujet âgé
Act. Méd. Int. - Gastroentérologie (17), n
os
8-9, nov.-déc. 2003
Le sujet âgé
Annexe 1. Une grille d’évaluation rapide du statut nutritionnel, le MNA.
D’après Guigoz Y, Vellas B, Garry PJ. Mini Nutritional Assessment : a practical assessment for grading the nutritional state of elderly
patients. Facts and Research in Gerontology, Nestlé Ltd/Clintec, 1994 (suppl. 2).
Dépistage
A. Le patient présente-t-il une perte d’appétit ?
A-t-il mangé moins ces 3 derniers mois par manque d’appétit,
problèmes digestifs, difficultés de mastication ou de déglutition ?
0 = anorexie sévère
1 = anorexie modérée
2 = pas d’anorexie
B. Perte récente de poids (< 3 mois)
0 = perte > 3 kg
1 = ne sait pas
2 = perte entre 1 et 3 kg
3 = pas de perte de poids
C. Motricité
0 = du lit au fauteuil
1 = autonome à l’intérieur
2 = sort du domicile
D. Maladie aiguë ou stress psychologique lors des 3 derniers mois ?
0 = oui / 1 = non
E. Problèmes neuropsychologiques
0 = démence ou dépression sévère
1 = démence ou dépression modérée
2 = pas de problème psychologique
F. Indice de masse corporelle
[IMC = poids/taille2en kg/m2]
0 = IMC < 19
1 = 19 ≤IMC < 21
2 = 21 ≤IMC < 23
3 = IMC ≥23
Score de dépistage (sous-total max. 14 points)
12 points ou plus : normal, pas besoin de continuer l‘évaluation
11 points ou moins : possibilité de malnutrition, continuez l’évaluation
Évaluation globale
G. Le patient vit-il de façon indépendante au domicile ?
0 = non / 1 = oui
H. Prend plus de trois médicaments ?
0 = oui / 1 = non
I. Escarres ou plaies cutanées ?
0 = oui / 1 = non
J. Combien de véritables repas le patient prend-il par jour ?
(petit déjeuner, déjeuner, dîner > 2 plats)
0 = 1 repas / 1 = 2 repas / 2 = 3 repas
K. Consomme-t-il :
– une fois par jour au moins des produits laitiers ? oui / non
– une ou 2 fois par semaine des œufs ou des légumineuses ? oui / non
– chaque jour de la viande, du poisson ou de la volaille ? oui / non
0,0 = si 0 ou 1 oui
0,5 = si 2 oui
1,0 = si 3 oui
L. Consomme-t-il 2 fois par jour au moins des fruits et légumes ?
0 = non / 1 = oui
M. Combien de verres de boissons consomme-t-il par jour ?
0,0 = < 3 verres
0,5 = de 3 à 5 verres
1,0 = plus de 5 verres
N. Manière de se nourrir
0 = nécessité d’une assistance
1 = se nourrit seul avec difficultés
2 = se nourrit seul sans difficultés
O. Le patient se considère-t-il bien nourri ?
0 = malnutrition sévère
1 = ne sait pas ou malnutrition modérée
2 = pas de problème de nutrition
P. Le patient se sent-il en meilleure ou en moins bonne santé
que la plupart des personnes de son âge ?
0,0 = moins bonne / 0,5 = ne sait pas
1,0 = aussi bonne / 2,0 = meilleure
Q. Circonférence brachiale (CB en cm)
0,0 = CB < 21
0,5 = 21 ≤CB ≤22
1,0 = CB > 22
R. Circonférence du mollet (CM en cm)
0 = CM < 31
1 = CM ≥31
Évaluation globale (max. 16 points)
Score de dépistage
Score total (max. 30 points)
Appréciation de l’état nutritionnel
De 17 à 23,5 points : risque de malnutrition
Moins de 17 points : mauvais état nutritionnel

ment et permet l’administration de médi-
caments. Des troubles de la déglutition
ou l’observation d’une dénutrition sévère
avec impossibilité ou insuffisance de renu-
trition par voie orale rendent nécessaire
le recours à une alimentation entérale.
Elle doit s’inscrire dans un projet théra-
peutique cohérent, envisagé avec le patient
ou avec son entourage lorsqu’il est inca-
pable de s’exprimer, et ne concerne pas
les situations de fin de vie. Cette ali-
mentation peut se réaliser en gériatrie à
l’aide de deux voies d’abord :
– la sonde naso-gastrique (SNG) est
facile à poser mais peut engendrer diffé-
rentes complications comme un incon-
fort nasal et oro-pharyngé, des ulcéra-
tions sur son trajet ou des sinusites. De
plus, elle est peu discrète et facile à
arracher pour un sujet confus ou agité.
Cette méthode ne peut être retenue en
milieu gériatrique que pour une courte
période et sa nécessité régulièrement
réévaluée (5) ;
– la gastrostomie per endoscopique (GPE)
est posée au cours d’une endoscopie
digestive haute après insufflation et trans-
illumination de l’estomac qui est ponc-
tionné pour permettre la mise en place de
la canule. Cette méthode a peu de com-
plications et est particulièrement adap-
tée à une alimentation entérale artificielle
de longue durée qui peut être débutée
dès la douxième heure après sa pose (6).
Ses indications, nécessitant une concer-
tation préalable, sont parfois transitoires,
notamment lors d’une perte rapide d’au-
tonomie, d’une prise en charge d’escarres
importantes ou d’une dénutrition sévère
engageant le pronostic vital.
Afin de limiter les complications impu-
tables à ces méthodes, il est nécessaire
d’augmenter progressivement la quan-
tité de nutriments à assimiler. Le débit
d’administration est régulé par une
pompe, le patient doit se trouver en posi-
tion demi-assise au cours et au décours
immédiat de l’alimentation pour limi-
ter les régurgitations et diminuer ainsi
le risque d’inhalation bronchique. Le
choix du produit de nutrition et sa quan-
tité dépendent de l’objectif nutritionnel
fixé. Conditionnés en flacon de 500 ml,
ces mélanges nutritifs complets con-
tiennent de 500 à 750 kcal. Ces produits
contiennent peu de sodium et il est sou-
vent nécessaire d’y associer un complé-
ment de NaCl. En plus de l’alimentation,
ces deux méthodes permettent l’admi-
nistration de médicaments en prenant
bien soin de rincer à l’eau les sondes pour
éviter qu’elles ne se bouchent.
Cependant, l’attitude des équipes géria-
triques françaises a changé concernant
l’alimentation entérale, avec un recours
moins fréquent à ces méthodes chez les
patients présentant un état démentiel
avancé et lors de contexte de fin de vie (7).
L’alimentation parentérale consiste en
l’administration d’apports nutritionnels
par voie intraveineuse. Cette méthode
ne présente pas d’aspects spécifiques
en médecine gériatrique où elle est peu
employée devant les risques d’hyper-
volémie, de perturbations de l’équilibre
hydro-électrolytique, de mauvaise tolé-
rance loco-régionale et d’infections.
Une carence en vitamines et en oligo-
éléments est le plus souvent associée aux
états de dénutrition. Les carences les plus
fréquentes, chez le sujet âgé fragile,
concerne l’acide folique, le calcium et la
vitamine B 12 qu’il faut penser à recher-
cher et à supplémenter.
L’observation d’une déshydratation est
souvent associée à la malnutrition pro-
téino-énergétique chez la personne âgée.
L’hydratation peut alors se faire soit par
voie orale, soit à l’aide des sondes uti-
lisées pour l’alimentation entérale arti-
ficielle, ou encore par voie parentérale
intraveineuse, mais également par hypo-
dermoclyse. Cette dernière technique
consiste à administrer de 500 ml à 1 l de
sérum physiologique ou de glucosée à
5 % par voie sous-cutanée stricte à
l’aide d’une aiguille de type Butterfly®.
Cette perfusion délivrée sur 12 heures,
de nuit, permet au patient de conserver
une bonne autonomie diurne (8).
Conclusion
Le diagnostic des malnutritions protéino-
énergétiques, ainsi que leurs évalua-
tions et la mise en place rapide de stra-
tégies thérapeutiques, est une priorité dans
la prise en charge des patients âgés. Elle
permet notamment de réduire l’impor-
tance de la morbidité et de la mortalité
qui leur sont associées. Bien qu’il soit
toujours souhaitable de favoriser l’ali-
mentation par voie orale, certaines situ-
ations cliniques peuvent nécessiter le
recours à une nutrition artificielle lorsque
l’apport devient insuffisant. ■
171
Le sujet âgé
Act. Méd. Int. - Gastroentérologie (17), n
os
8-9, nov.-déc. 2003
Le sujet âgé
Ingesta Statut nutritionnel
Normal Altéré Très altéré
(dénutrition modérée, (dénutrition sévère,
albumine < 30 g/l albumine < 30 g/l)
Normaux Surveillance Surveillance, conseils Supplémentation orale
réévaluations, d’emblée
adaptations alimentaires
Diminués Surveillance, conseils Supplémentation orale Alimentation entérale,
(≤1/3) réévaluations d’emblée surtout si affection
adaptations alimentaires cachectisante
Très diminués Supplémentation orale Alimentation entérale, Alimentation entérale,
(> 1/3) d’emblée surtout si affection d’emblée
cachectisante
Annexe 2. Schéma de décision d’intervention nutritionnelle en fonction du statut et des ingesta.

Références
1. Noel D. Stratégie nutritionnelle en
médecine gériatrique. Louvain Med 1998 ;
117 : S47-S51.
2. Derycke B, Blonde-Cynober F, Ballan-
ger E. Évaluation des pratiques d’évalua-
tion de l’état nutritionnel des patients en
soins de suite et de réadaptation et amé-
lioration de la prise en charge. Revue de
Gériatrie 2003 ; (suppl. B), 28, 5 : 24-25.
3. Guigoz Y, Vellas B, Garry PJ. Assessing
the nutritional status of the elderly : the
mini nutritional assessment as part of the
geriatric evaluation. Nutr Rev 1996 ; (54)
II : 59-65.
4. Vellas B, Lauque S, Andrieu S et al.
Nutrition assessment in elderly. Curr Opin
Clin Nutr Metab Care 2001 ; 1 : 5-8.
5. Ferry M. Le support nutritionnel chez
le malade âgé. Revue de Gériatrie 1995 ;
20 : 10, 29.
6. Ferry M, Alix E, Brocker et al. Nutrition
de la personne âgée, 2eÉd. Paris : Masson,
2002 ; 145-59.
7. Pfitzenmeyer P, Manckoundia P, Mischis-
Troussard C et al. et le Club francophone
gériatrie et nutrition. Enteral nutrition in
french institutionalized patients : a multi-
centric study. J Nutr Health Aging 2002 ;
(6) ; 5 : 301-5.
8. Dardaine V, Ferry M, Constans T. La per-
fusion sous-cutanée ou hypodermoclyse : une
technique de réhydratation utile en gériatrie.
Presse Med 1999 ; (28) 40 : 672-9.
172
Le sujet âgé
Act. Méd. Int. - Gastroentérologie (17), n
os
8-9, nov.-déc. 2003
Le sujet âgé
1
/
4
100%