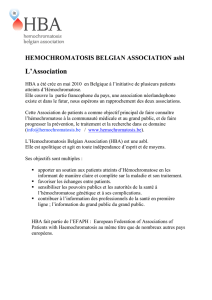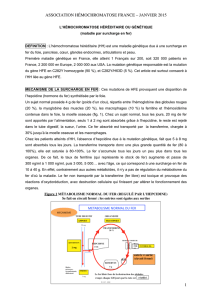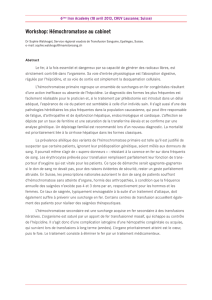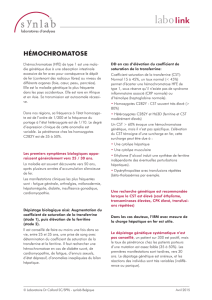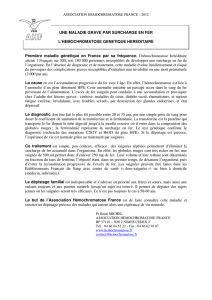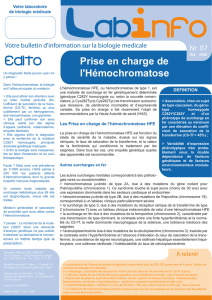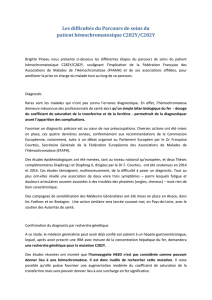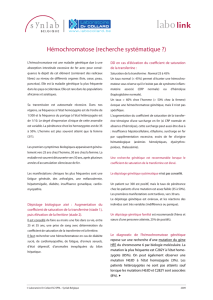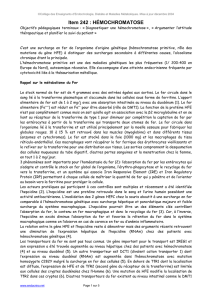L’ L’hémochromatose : une maladie rhumatologique ? MISE AU POINT

10 | La Lettre du Rhumatologue • No 365 - octobre 2010
MISE AU POINT
L’hémochromatose :
une maladie rhumatologique ?
Hemochromatosis: a rheumatic disease?
P. Guggenbuhl1, 2, P. Brissot2, 3, G. Chalès1, 2, O. Loréal2
1. Service de rhumatologie, pôle
locomoteur, hôpital Sud, CHU de
Rennes.
2. UMR INSERM U991, IFR 140, uni-
versité Rennes-I.
3. Service des maladies du foie,
centre de référence des surcharges
en fer rares d’origine génétique, hô-
pital Pontchaillou, CHU de Rennes.
L’hémochromatose décrite par Trousseau et
Troisier était une maladie grave engageant
le pronostic vital du fait du développement
d’une cirrhose, d’un carcinome hépatocellulaire,
d’un diabète et d’une insuffisance cardiaque.
Depuis la mise en place d’un traitement par sai-
gnées, ces complications peuvent être évitées
dans la majorité des cas. En revanche, la qualité
de vie des patients est souvent altérée, en parti-
culier du fait de 2 complications rhumatologiques :
le rhumatisme hémochromatosique et l’ostéo-
porose.
Définition et classification
Définition
L’hémochromatose est une surcharge chronique
en fer d’origine génétique qui peut aller du simple
excès tissulaire sans conséquences cliniques
jusqu’aux situations de surcharge massive suscep-
tibles d’ affecter des organes divers et d’enga ger
le pronostic vital. L’affection est liée, dans la
majorité des cas, à une mutation du gène HFE,
et beaucoup plus rarement à la mutation d’autres
gènes.
Classification clinique
◆Hémochromatose de type 1 (1)
L’hémochromatose de type 1 est de loin la forme
la plus fréquente. Elle est la conséquence d’une
mutation majeure du gène HFE localisé sur le bras
court du chromosome 6 appelée C282Y (nouvelle
nomenclature : p.Cys282Tyr). S’agissant d’une
maladie récessive, 2 mutations C282Y, l’une reçue
du père, l’autre de la mère, sont requises pour que la
maladie se développe. L’homozygotie C282Y est une
condition nécessaire mais non suffisante pour que se
développe une surcharge en fer. Il a été récemment
rapporté que seuls 1 femme homozygote sur 100 et
un peu plus d’un quart des hommes homozygotes
développent un excès en fer pathologique durant
leur vie (2).
◆Hémochromatose de type 2 (3, 4)
L’hémochromatose de type 2, également appelée
“hémochromatose juvénile”, est une patho-
logie rare touchant l’adolescent ou l’adulte de
moins de 30 ans. Elle est due à des mutations
des gènes de l’hémojuvéline (chromosome 1) ou
de l’hepcidine (chromosome 19) correspondant
respectivement aux hémochromatoses 2A et 2B.
Les atteintes cardiaques et endocriniennes sont
prédominantes.
◆Hémochromatose de type 3 (5)
Exceptionnelle, l’hémochromatose de type 3 res-
semble à l’hémochromatose de type 1 de l’adulte,
mais peut s’exprimer chez le sujet jeune. Elle est
due à des mutations du gène du récepteur de la
transferrine de type 2 (RTf2) [chromosome 7].
◆Hémochromatose de type 4 (6)
Moins rare que les hémochromatoses de types 2
et 3, l’hémochromatose de type 4 est en rapport
avec des mutations du gène codant pour la fer-
roportine (chromosome 2). C’est la seule hémo-
chromatose à transmission dominante. Il existe
2 phénotypes connus : le plus fréquent (l’hémo-
chromatose 4A) se caractérise par une surcharge
en fer macro phagique avec fer sérique et satura-
tion de la transferrine normaux (ou bas) ; l’autre
phénotype (l’hémochromatose 4B) est analogue à
l’hémo chromatose de type 1.

Figure 1. Hepcidine et surcharge en fer. A. Représentation schématique de l’impact
biologique de l’hepcidine sur la ferroportine, protéine exportatrice du fer, expliquant
l’impact biologique de l’hepcidine sur la libération de fer à partir des entérocytes et
des macrophages. Au cours des hémochromatoses liées à un niveau bas d’hepcidine, le
contenu en fer plasmatique augmente, car du fer est en permanence adressé au plasma.
B. Représentation schématique des relations entre les protéines mutées au cours des
hémochromatoses génétiques (HFE, TFR2, HJV) et l’hepcidine. Une mutation de ces
protéines induit une transmission anormale de la signalisation régulant positivement
l’expression de l’hepcidine. Un niveau anormalement bas d’hepcidine va alors favoriser
le développement de la surcharge en fer.
A B
P
Gène de l’hepcidine
TFR2 HFE
HJV
BMPR
Phospho
SMAD1/5/8SMAD1/5/8
SMAD4
?
Entérocyte Macrophage
Hépatocyte
Plasma Hepcidine
?
+
La Lettre du Rhumatologue • No 365 - octobre 2010 | 11
Points forts
»
Diagnostic de la forme la plus fréquente d’hémochromatose génétique : hyperferritinémie ou signes
cliniques + élévation du coefficient de saturation de la transferrine + homozygotie C282Y.
»
Tout bilan d’arthropathie doit comporter un dosage de la ferritine et du coefficient de saturation de
la transferrine.
»La découverte d’une chondrocalcinose précoce impose la recherche d’une surcharge en fer.
»L’hémochromatose est une cause d’ostéoporose indépendamment de tout hypogonadisme.
»Les saignées ont peu (ou pas) d’impact sur le rhumatisme hémochromatosique ; leur effet sur la patho-
logie osseuse n’est pas connu.
»Le traitement du retentissement osseux et articulaire n’est pas spécifique. Les traitements locaux des
arthropathies ne doivent pas être négligés.
Mots-clés
Hémochromatose
Fer
Gène HFE
Hepcidine
Ferroportine
◆Autres causes de surcharge génétique en fer
L’acéruloplasminémie [7], ou hypocéruloplasmi-
némie [8] héréditaire, consiste en des mutations
du gène de la céruloplasmine (chromosome 3) res-
ponsables d’une inhibition totale de la production
de la protéine et/ou de son activité ferroxydase. Il
en résulte une surcharge en fer, une anémie et des
signes neurologiques.
Les autres surcharges génétiques rarissimes corres-
pondent à des entités de description soit ancienne
telle que l’atransferrinémie héréditaire (9), soit
récente telles les surcharges par mutation du gène
DMT1 (10) ou de la glutarédoxine (11).
Classification physiopathologique
Ces 5 entités peuvent être classées en 2 grands
groupes selon le mécanisme sous-tendant le déve-
loppement de la surcharge en fer : la déficience en
hepcidine ou la déficience en ferroportine (figure 1).
Cette distinction en fonction du mécanisme impliqué
dans la surcharge en fer est importante, car elle
détermine la prise en charge diagnostique et théra-
peutique (1).
◆La déficience en hepcidine
L’hepcidine, essentiellement produite par le foie (12),
est l’hormone principale de régulation du métabo-
lisme du fer (13).
Dans les hémochromatoses de type 1, 2 ou 3, les
mutations en cause sont à l’origine d’une cascade
d’événements moléculaires, utilisant en particulier la
voie BMP (Bone Morphogenetic Protein)/Smad (14) ;
la conséquence est un défaut de production hépa-
tique (15) de l’hepcidine, donc une diminution de
la concentration plasmatique d’hepcidine et une
augmentation de la sidérémie. Cette hypersidérémie
est due à la fois à une hyperabsorption duodénale
du fer alimentaire et à un excès de libération du
fer splénique provenant de la dégradation physio-
logique des globules rouges sénescents dans le
cadre de l’érythrophagocytose. Il en découle une
accumulation progressive de fer dans les principaux
parenchymes (foie, pancréas, cœur) compte tenu
de l’absence de mécanismes d’élimination du fer
viscéral excédentaire efficaces chez l’homme.
Dans l’hémochromatose de type 4B (maladie de la
ferroportine de type B), les mutations en cause per-
turbent la fonction du récepteur de l’hepcidine, qui
est assurée à l’état physiologique par la ferroportine.
Dans cette situation, la production d’hepcidine n’est
pas affectée, mais il y a une résistance à l’hepcidine.
Le phénotype de cette affection est comparable à
celui des hémochromatoses par insuffisance de pro-
duction hépatique de l’hepcidine.
◆La déficience en ferroportine
La déficience en ferroportine est en cause dans 2 types
de surcharges génétiques. Les mutations responsables
altèrent l’autre fonction de la ferroportine, à savoir
l’export cellulaire du fer. Il s’ensuit un piégeage du fer
à l’intérieur des cellules et une diminution secondaire
de la concentration plasmatique du fer.
Keywords
Hemochromatosis
Iron
HFE gene
Hepcidin
Ferroportin

12 | La Lettre du Rhumatologue • No 365 - octobre 2010
L’hémochromatose : une maladie rhumatologique ?
MISE AU POINT
Hémochromatose de type 4A
(maladie de la ferroportine de type A)
La ferroportine est particulièrement exprimée au
niveau des macrophages. La surcharge cellulaire
touche principalement le système réticulo-endo-
thélial (macrophages spléniques et cellules de
Kupffer au niveau hépatique).
Acéruloplasminémie
L’acéruloplasminémie, ou hypocéruloplasminémie,
est responsable d’une déficience en activité ferroxi-
dase qui assure l’oxydation du fer ferreux en fer fer-
rique, transformation nécessaire à la captation du
fer par la transferrine circulante. Cette déficience
serait aussi à l’origine d’une dégradation excessive
de la ferroportine entravant la sortie cellulaire du
fer (16).
Retentissement clinique
de l’hémochromatose HFE 1
Classification en 5 stades
Les modalités pratiques de prise en charge du
sujet homozygote pour C282Y ont été précisées
par la Haute Autorité de santé (HAS) sous la
forme de recommandations accessibles sur le site
www. has-sante.fr. Cinq stades sont définis pour
décrire l’expression phénotypique de la maladie.
➤
Stade 0 : absence de toute expression clinique
ou biologique.
➤
Stade 1 : augmentation isolée du taux de satu-
ration de la transferrine (Cs-Tf) [supérieur à 45 %,
en fait souvent supérieur à 60 % chez l’homme et
à 50 % chez la femme].
➤
Stade 2 : augmentation conjointe des taux de
saturation de la transferrine et de ferritinémie (fer-
ritine supérieure à 300 µg/l chez l’homme et supé-
rieure à 200 µg/ l chez la femme) sans signes cliniques.
➤Stades 3 et 4 : apparition de signes cliniques.
• Stade 3 : altération de la qualité de vie (asthénie
chronique, impuissance, arthropathies).
• Stade 4 : compromission du pronostic vital (cirrhose
– avec le risque de carcinome hépatocellulaire –,
diabète insulinodépendant, cardiomyopathie).
Examens à effectuer
chez le sujet C282Y/C282Y en fonction
du stade d’expression phénotypique
Le bilan est adapté au stade de la maladie.
◆Stades 0 et 1
➤Absence d’hyperferritinémie.
➤
Outre l’examen clinique et le bilan martial stan-
dard (Cs-Tf et ferritinémie), aucun examen n’est
recommandé.
◆Stades 2, 3 et 4
En plus de l’examen clinique et du bilan martial,
les explorations doivent se focaliser sur 4 organes.
➤
Le foie : transaminases et échographie hépatique
en cas d’hépatomégalie clinique ou d’hypertransami-
nasémie. En cas d’hépatomégalie, d’hypertransami-
nasémie ou de ferritinémie supérieure à 1 000 µg/ l,
une ponction-biopsie hépatique est justifiée afin de
déceler une éventuelle fibrose ou cirrhose.
➤
Les gonades : chez l’homme, on recherche des
signes cliniques d’hypogonadisme et on dose la
testostéronémie.
➤
L’os : en présence de cofacteurs d’ostéoporose
tels que l’hypogonadisme, la ménopause ou la
cirrhose, une ostéodensitométrie est réalisée.
➤Le cœur : effectuer une échocardiographie.
Les manifestations articulaires
de l’hémochromatose
Les atteintes articulaires de l’hémochromatose
sont particulièrement fréquentes, puisqu’elles sont
présentes dans environ les deux tiers des cas. Elles
constituent actuellement la principale cause de perte
de qualité de vie chez des patients généralement dia-
gnostiqués et traités précocement, ce qui leur évite
de développer d’autres complications viscérales. Elles
sont révélatrices de la maladie dans environ un tiers
des cas, mais aussi négligées 1 fois sur 2 (17, 18).
L’atteinte rhumatismale de l’hémochromatose est
diverse et peut poser des problèmes de diagnostic
différentiel avec un certain nombre de pathologies
rhumatologiques fréquentes dont elle partage la pré-
sentation clinique, comme l’arthrose ou la maladie
à cristaux de pyrophosphate de calcium dihydratés
(PPCD), avec ou sans chondrocalcinose articulaire
(CCA). Il peut s’agir d’atteintes mono- ou poly-
articulaires, périphériques ou axiales, mécaniques
ou inflammatoires, avec des degrés de sévérité
variables. Cela va de la crise de pseudo-goutte aux
douleurs d’allure arthrosique. Les déformations liées
à des atteintes chroniques peuvent être particulière-
ment déformantes et orienter le diagnostic vers une
polyarthrite rhumatoïde. Néanmoins, le rhumatisme
hémochromatosique a des spécificités cliniques et
radiographiques.

Figure 2. Chondrocalcinose articulaire du genou
dans le cadre d’un rhumatisme hémochromatosique.
Figure 3. Pincement scapho-trapézien isolé dans le cadre d’un rhumatisme hémochro-
matosique.
La Lettre du Rhumatologue • No 365 - octobre 2010 | 13
MISE AU POINT
Manifestations articulaires cliniques
L’ensemble des articulations peuvent être atteintes
dans l’hémochromatose. Certaines localisations,
telles que les 2
e
et 3
e
articulations métacarpopha-
langiennes (MCP), sont cependant tout à fait carac-
téristiques. Leur atteinte entraîne la classique douleur
lors de la poignée de main. Son expression clinique est
variable : simples arthralgies d’effort, raideur doulou-
reuse limitant la flexion des MCP ; progressivement
apparaît une tuméfaction peu inflammatoire des MCP,
ce qui la distingue des rhumatismes inflammatoires,
et notamment de la polyarthrite rhumatoïde. Les
douleurs peuvent s’étendre aux articulations interpha-
langiennes proximales et aux poignets. L’atteinte de
la hanche, des genoux et des chevilles est fréquente ;
le rhumatisme hémochromatosique peut également
toucher les épaules, les coudes et le rachis.
Les symptômes articulaires peuvent débuter pré-
cocement, vers l’âge de 25 ans chez l’homme, dans
la forme classique HFE 1, plus tardivement chez la
femme, après la ménopause (19). Des atteintes arti-
culaires ont également été observées dans l’hémo-
chromatose juvénile chez des patients ayant une
forte surcharge en fer non liée à HFE. Dans les cas
rapportés, l’hémochromatose avait été diagnosti-
quée entre 19 et 39 ans et les symptômes articulaires
étaient apparus entre 23 et 45 ans. La topographie
des atteintes articulaires était similaire à celle de la
forme classique : MCP avec, dans tous les cas, une
arthropathie sur les radiographies lorsque celles-ci
avaient été effectuées (20).
Signes articulaires radiographiques
Les signes radiographiques, lorsqu’ils existent, sont
proches de ceux du rhumatisme à cristaux de PPCD,
avec ou sans CCA (figure 2), dont l’hémochroma-
tose est une cause (21). Le mode évolutif aboutit à
des lésions arthrosiques identiques à la forme pri-
mitive de la maladie.
◆Atteintes évocatrices
de rhumatisme hémochromatosique
➤
Un pincement isolé de l’articulation scapho-tra-
pézienne sans rhizarthrose oriente vers le diagnostic
de rhumatisme à cristaux PPCD, dont l’hémochro-
matose est une cause particulièrement fréquente
(figure 3).
➤
Des calcifications intra-articulaires, un pince-
ment articulaire sont fréquemment rencontrés,
mais l’atteinte articulaire de l’hémochromatose se
distingue du rhumatisme à PPCD par une ostéosclé-
rose sous-chondrale, avec de petites géodes sous-
chondrales finement cerclées en chapelet (figure 4).
➤
Une ostéophytose caractéristique au niveau
des MCP avec un aspect dit “en hameçon” ou “en
crochet” (figure 5) oriente fortement le diagnostic.
➤
Le poignet et l’articulation radio-ulnaire
(figure 6) sont souvent atteints, alors qu’ils sont
épargnés dans l’arthrose primitive en dehors de
causes traumatiques.

Figure 4. Arthropathie de cheville dans le cadre d’un
rhumatisme hémochromatosique.
Figure 5. Atteinte des articulations métacarpophalangiennes (MCP) dans le cadre d’un
rhumatisme hémochromatosique. Aspect en hameçon des MCP 3 et 4.
Figure 6. Atteinte des articulations radio-carpienne
et radio-ulnaire dans le cadre d’un rhumatisme hémo-
chromatosique. Chondrocalcinose articulaire avec
calcification du ligament triangulaire.
14 | La Lettre du Rhumatologue • No 365 - octobre 2010
L’hémochromatose : une maladie rhumatologique ?
MISE AU POINT
Dans certains cas, on ne peut pas distinguer l’aspect
radiographique des arthropathies de l’hémochro-
matose de celui de l’arthrose. Néanmoins, certaines
localisations, telles que les MCP, les poignets, les
coudes et les épaules (omarthrose centrée), sont
épargnées par l’arthrose primitive et doivent faire
rechercher une cause. Le rhumatisme hémochroma-
tosique peut parfois aboutir à de véritables arthro-
pathies destructrices des membres et du rachis : le
bilan martial doit donc faire partie du bilan d’une
arthropathie en l’absence de cause évidente (18, 22).
Physiopathologie
de l’atteinte articulaire
Les données concernant l’intérêt d’un dépistage
génétique en cas d’atteinte articulaire en l’absence
de surcharge en fer sont contradictoires. Le dépis-
tage systématique de la mutation C282Y chez
128 patients atteints de rhumatisme à cristaux de
PPCD montre une augmentation de la fréquence des
homozygotes par rapport à une population contrôle
(n = 3 011) [1,6 % versus 0,5 % ; p < 0,037] (23).
Une autre étude portant sur un sous-groupe de
2 095 patients de la cohorte de Rotterdam tirés au
hasard et génotypés montre une augmentation des
douleurs articulaires et des lésions radiographiques,
dans un groupe plus restreint de sujets qui avaient
eu des radiographies d’arthrose ou de CCA, chez les
patients homozygotes pour la mutation H63D ou
hétérozygotes composites H63D/ C282Y. Aucun lien
n’a été trouvé avec les homozygotes C282Y (24).
Dans une étude australienne portant sur 1 372 sujets,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%