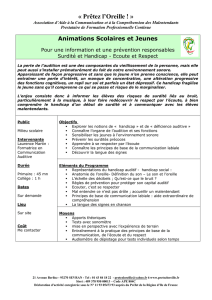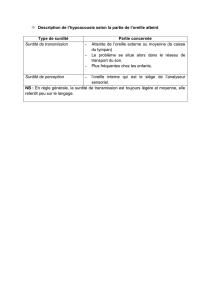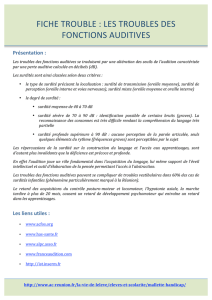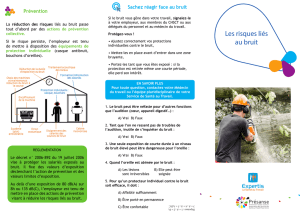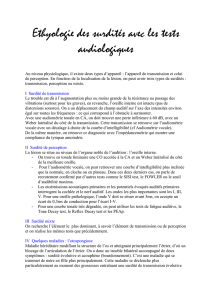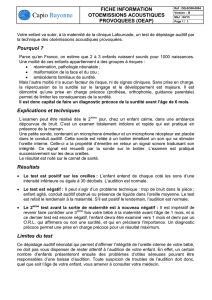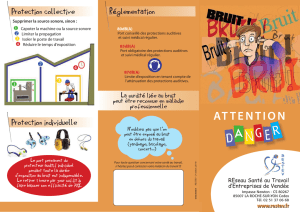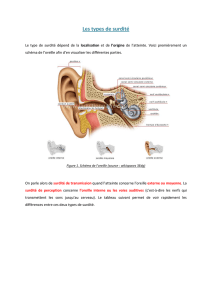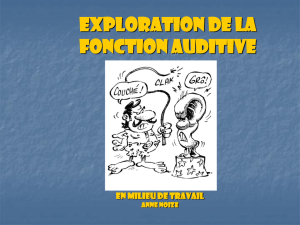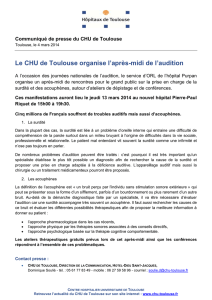Les actualités du 6 Otoforum e CONGRÈS

8 | La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 324 - janvier-février-mars 2011
CONGRÈS
RÉUNION
Les actualités du 6e Otoforum
Toulouse, 3 et 4 décembre 2010
M. François*
L’Otoforum, qui s’est tenu à Toulouse les 3 et 4 décembre 2010, a eu, comme toujours,
beaucoup de succès. Nous rapportons ici quelques ateliers concernant les prothèses
auditives et l’examen d’un enfant ayant un retard de langage.
Les nouveaux tests
de perception dans le bruit
Stéphane Garnier, audioprothésiste,
groupe Entendre
Le but des tests dans le bruit est multiple : préciser
le diagnostic audiométrique, guider le choix des
prothèses auditives et accompagner l’adaptation
prothétique, enfin contrôler l’efficacité des prothèses.
Au moins 4 stratégies sont possibles pour entendre
la parole dans le bruit : le démasquage énergétique,
le démasquage temporel, le démasquage informa-
tionnel et le démasquage spatial. Le démasquage
énergétique est apprécié en psychoacoustique par la
mesure de la sélectivité fréquentielle et en clinique
par l’audiométrie dans le bruit. Cette méthode
peut être réalisée selon 2 modalités : en laissant
fixe l’intensité du son masquant et en faisant varier
l’intensité de la parole ou, au contraire, en laissant
fixe l’intensité de la parole et en faisant varier
l’intensité du son masquant. Dans ces 2 cas, le bruit
masquant est un bruit stationnaire. Quant au démas-
quage temporel, c’est le mécanisme qui permet au
système auditif de tirer un bénéfice perceptif de
la fluctuation rapide du bruit masquant (“lecture
dans les vallées du bruit”). Les fluctuations du bruit
masquant peuvent être régulières ou aléatoires. Le
démasquage informationnel vient du fait que c’est
le contenu et non l’énergie du masque qui entre en
compétition avec le signal. À énergie égale, une voix
concurrente est plus masquante qu’un bruit rose.
Enfin, concernant le démasquage spatial, lorsque les
sources sonores sont spatialement séparées, l’oreille
arrive à faire plus ou moins bien la différence entre
le son à privilégier et les autres bruits.
L’auteur a mis au point un test autoadministrable,
simple et rapide, pour évaluer de manière dissociée
les 4 aspects – énergétique, temporel, informa-
tionnel et spatial – de la perception de la parole
dans le bruit. Le test de reconnaissance des mots
(en l’occurrence des listes de 5 nombres de 1 à 99)
se fait dans 5 conditions : dans le silence, avec un
bruit stationnaire, avec un bruit fluctuant, avec
3 voix concurrentes et avec 3 voix concurrentes
spatialement séparées. Il dure 5 à 10 minutes au
maximum. Il est réalisé avec 5 haut-parleurs : 1 de
face qui délivre les mots à reconnaître, 2 à droite et
2 à gauche (1 en avant et 1 en arrière) qui délivrent
les sons masquants.
La différence entre les conditions 2 et 1 mesure
le masquage énergétique, entre les conditions 3 et 2
le démasquage temporel, entre les conditions 4 et 2
le démasquage informationnel et entre les condi-
tions 5 et 4 le démasquage spatial.
Mon enfant est-il sourd ?
Atelier animé par le Pr Naïma Deggouj (Bruxelles),
avec le Dr Yannick Lerosey (Rouen), le Dr Stéphane
Roman (Marseille) et le Pr Thierry Van den Abbeele
(Paris)
Confirmer ou infirmer l’existence d’une surdité
chez un enfant n’est pas toujours facile ni anodin.
Le diagnostic d’une surdité irréversible a des implica-
tions importantes au niveau thérapeutique et éduca-
tionnel. Il a aussi inéluctablement des répercussions
psychologiques sur les parents.
En l’absence de signe d’alerte à la naissance
et pendant les premiers mois de vie, seuls les
programmes de dépistage néonatal de la surdité
permettent un diagnostic précoce des surdités
congénitales ainsi qu’une diminution notable du délai
de prise en charge et des séquelles fonctionnelles
d’une surdité de l’enfant. Cependant, beaucoup de
surdités apparaissent après la période néonatale : en
effet, si la fréquence des surdités moyennes, sévères
et profondes est de l’ordre de 2 ‰ à la naissance, elle
double à 9 ans. De plus, chez les enfants, le risque
d’hypoacousies transitoires, mais parfois prolongées
* Hôpital Robert-Debré, Paris.

La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 324 - janvier-février-mars 2011 | 9
CONGRÈS
RÉUNION
est bien présent : elles sont dues aux otites séreuses,
qui apparaissent, surtout l’hiver, chez les enfants de
moins de 5 ans.
Il est dès lors important de connaître les signes
d’appel d’une surdité du nourrisson ou de l’enfant.
Le doute parental, le retard de langage, les troubles
du comportement (hyperactivité, troubles autis-
tiques), le fait qu’un enfant soit très visuel (lecture
labiale), qu’il fasse des confusions auditives, qu’il
ait des troubles de l’attention, une fatigabilité plus
importante que celle de ses pairs, et, d’une manière
plus générale, tout retard scolaire imposent, avant
toute autre exploration, un bilan auditif complet.
Le retard de langage est à interpréter en fonction de
l’âge : gazouillis peu développé, qui ne se diversifie
pas chez le nourrisson de 5 à 9 mois, pas d’apparition
des syllabes entre 9 et 12 mois, pas de mots entre 12
et 15 mois, pas d’associations de mots entre 18
et 24 mois, pas de compréhension des consignes
vocales sans geste ou lecture labiale entre 2 et 3 ans,
communication signée, inintelligibilité, troubles
articulatoires entre 3 et 4 ans.
L’audiométrie comportementale doit être adaptée à
l’âge psychomoteur de l’enfant, et doit souvent être
complétée par quelques tests objectifs : essentiel-
lement des otoémissions provoquées, des potentiels
évoqués auditifs précoces (PEA) et des PEA station-
naires (ASSR). Avant 5 à 6 mois, l’état de veille est
modifié par les stimulations sonores. De 5 ou 6 mois
à 30 mois, les examens (ROI et ROC) sont basés sur
la capture attentionnelle d’une irruption sonore.
Après 30 mois, l’attention est contrôlée et l’attente
de la stimulation permet un conditionnement volon-
taire (encastrements, etc.).
Appareillage de l’enfant sourd
Atelier modéré par le Dr Soizick Pondaven (Tours),
avec MM. Thierry Renglet (audioprothésiste,
Bruxelles), Éric Bizaguet (audioprothésiste, Paris),
et Mme Sandrine Chardon-Roy (Saint-Étienne)
À partir de quel âge
appareiller un enfant ?
Il ne faut pas faire pression sur les parents pour
qu’ils appareillent leur enfant : il est important de
respecter leur rythme. Si le diagnostic de surdité
est fait en maternité, les parents ont besoin de
beaucoup de temps avant de faire cette démarche,
car le diagnostic arrive de manière abrupte. Au
contraire, lorsque le diagnostic est plus tardif, les
parents souhaitent rattraper le retard et prennent
rendez-vous très vite chez l’audioprothésiste. Par
ailleurs, en cas de surdité de perception sévère ou
profonde, les parents ne discutent pas le diagnostic :
ils sont pressés et pensent rapidement à l’implant
cochléaire (car beaucoup consultent Internet). De
ce fait, ils risquent de ne pas s’investir dans les
prothèses auditives conventionnelles. En revanche,
en cas de surdité de perception moyenne, les parents
discutent souvent le diagnostic et mettent en doute
la nécessité d’un appareillage. C’est encore plus
difficile en cas de surdité fluctuante.
L’audioprothésiste ne proposera des prothèses
auditives que, d’une part, s’il a observé une audio-
métrie tonale précise pour chaque oreille ainsi
qu’une cohérence entre les seuils obtenus aux
PEA et ASSR et les seuils obtenus en audiométrie
comportementale, et, d’autre part, s’il a fait une
mesure du Real-Ear Coupler Difference (RECD), qui
tient compte de la taille du conduit auditif externe
de l’enfant. T. Renglet a illustré son propos de
quelques cas cliniques montrant qu’il est parfois
nécessaire de faire plusieurs évaluations audiomé-
triques avant d’arriver à la certitude que l’enfant a
une surdité irréversible et avant de pouvoir apprécier
le niveau d’audition sur chaque oreille. Mais grâce
au dépistage et aux campagnes d’information sur
la surdité néonatale, de plus en plus d’enfants sont
appareillés avant l’âge de 6 mois.
À partir de quel niveau de surdité ?
L’enfant étant en phase d’apprentissage, ses besoins
en matière d’audition sont plus importants que ceux
d’un adulte (tableau). Il faut appareiller un enfant si
la perte auditive moyenne sur les fréquences conver-
sationnelles est supérieure à 30 dB sur la meilleure
oreille ou si le seuil tonal sur le 2 kHz est supérieur
à 35 dB. Il s’agit de le faire également en cas de
surdité légère si l’enfant a une gêne scolaire, un
retard de parole et de langage ou en cas de surdité
de transmission supérieure à 25 dB Hl, en cas de
Tableau. Les divers seuils d’audition.
Audibilité 0 dB
Reconnaissance 10 dB
Intelligibilité 20 dB
Apprentissage 30-40 dB (non mesurable, en fait,
dépend de beaucoup de facteurs, entre autres le recrutement)
Confort 60 dB
Inconfort 120 dB

10 | La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 324 - janvier-février-mars 2011
CONGRÈS
RÉUNION
surdité de transmission fluctuante et enfin en cas
de neuropathie auditive. Il faut appareiller au plus
vite car la fonction crée l’organe : les zones tempo-
rales dévolues vont être utilisées pour la vue si elles
restent trop longtemps non utilisées pour l’audition.
Les surdités unilatérales
Elles sont aussi fréquentes chez les garçons que
chez les filles. Leur prévalence est de 0,5 à 9 ‰.
Les surdités unilatérales sont prénatales dans deux
tiers des cas, postnatales dans un tiers des cas.
Elles sont souvent méconnues et négligées. L’âge
moyen du diagnostic est de 7 ans. Or, une étude
faite sur plus de 7 000 collégiens a montré que
la surdité unilatérale est un facteur de risque de
troubles du comportement (20 % versus 4,4 %), de
redoublement (30 % versus 15%) et de difficultés
d’apprentissage scolaire. Une prothèse augmentera
l’intelligibilité – dans le calme, mais aussi et surtout
en milieu bruyant. Elle est à conseiller à l’école
primaire et au collège, les adolescents abandonnant
en général leur prothèse ensuite.
Le suivi des enfants sourds appareillés
Le rôle de l’ORL ne s’arrête pas au diagnostic initial
de la surdité. Il faut aussi faire un bilan étiologique
(anamnèse, évolutivité, examen crânio-facial,
examen neuropédiatrique, ophtalmologique,
imagerie, consultation génétique) et proposer un
suivi (état des téguments et du conduit auditif
externe, mais aussi évolution de la perte auditive, du
port des prothèses, suivi orthophonique et scolaire).
Retard de langage sans surdité
Atelier animé par le Pr Naïma Deggouj (Bruxelles)
avec les Dr Geneviève Lina-Granade (Lyon)
et Evelyne Veuillet (Lyon)
Devant tout retard de langage, il importe de
vérifier en premier lieu que l’audition est normale.
Si l’enfant n’a pas d’hypoacousie, il peut s’agir d’un
retard simple du langage, d’une dysphasie, d’un
trouble central de l’audition, d’un retard mental
ou d’un trouble envahissant du développement, pour
lesquels la prise en charge est bien différente de celle
d’une hypoacousie.
Pour parler, il faut avoir quelque chose à dire,
avoir envie de le dire et savoir comment le dire.
Comprendre la parole et parler mettent en jeu
beaucoup d’aires cérébrales et nécessitent de faire
la synthèse de diverses perceptions (l’audition mais
aussi la vision et la proprioception). De bonnes
stimulations auditives et langagières sont néces-
saires pour obtenir l’émergence, puis le renfor-
cement du langage, mais il faut aussi de bonnes
appétences à la communication, de bons organes
sensoriels, avec, en particulier mais pas seulement,
de bonnes capacités auditives et l’intégrité des aires
corticales cérébrales impliquées dans le traitement
des mouvements, des informations sensorielles et
du langage. La production du langage, quant à elle,
requiert une bonne perception auditive, mais aussi
le développement des circuits du langage, un bon
contrôle moteur et proprioceptif de l’articulation
(mouvements et aussi séquence des mouvements
articulatoires) et de bons effecteurs (larynx, voile
du palais, langue, lèvres).
La cause la plus fréquente de retard de langage
sans hypoacousie est le retard simple du langage.
Il touche 5 à 10 % des enfants. Mais ce diagnostic
ne peut être porté qu’après avoir éliminé les autres
causes. Il est en particulier à distinguer d’une
dysphasie développementale, trouble structurel
de l’élaboration du langage sans déficit sensoriel
ou mental, qui touche 1 % des enfants, un peu
plus les garçons que les filles (sex-ratio : 1,5). Ce
diagnostic doit être évoqué si 3 des critères suivants
sont présents : dissociation automatico-volontaire,
troubles de l’évocation lexicale, trouble d’encodage
syntaxique, hypospontanéité, trouble de la compré-
hension verbale. Ces enfants doivent être pris en
charge de manière multidisciplinaire, avec une
recherche de lésions cérébrales (épilepsie, dilatation
ventriculaire, etc.) et d’anomalies génétiques.
Les troubles centraux de l’audition touchent 2 à 3 %
des enfants. Ces enfants sont adressés en consul-
tation pour des difficultés scolaires. Les parents
rapportent des difficultés d’audition mais l’audio-
métrie tonale et l’intelligence sont normales. Tout
se passe comme si le système nerveux central
avait du mal à utiliser l’information auditive. Ces
enfants ont des difficultés à comprendre, surtout
s’il y a plusieurs locuteurs ou un fond sonore. Ils
donnent des réponses inappropriées, sont lents dans
leurs réponses, jamais sûrs d’eux (“hein”, “quoi”,
“comment”, etc.), et sont facilement distraits par
l’environnement. Ces enfants ont beaucoup de
mal à suivre les consignes orales et obtiennent
donc de mauvais résultats scolaires. Il existe chez
eux un grand nombre de comorbidités : 25 % sont
dyslexiques et 50 % ont un trouble du langage. ■
1
/
3
100%