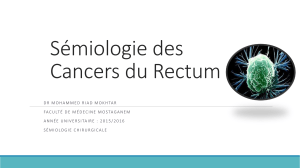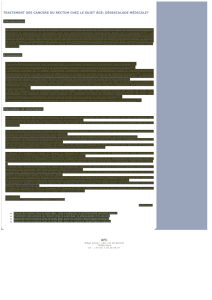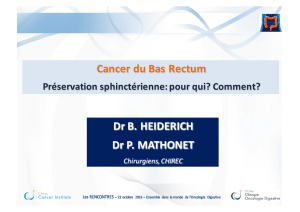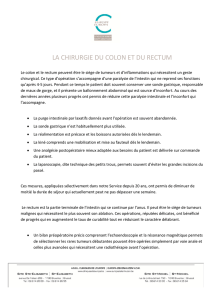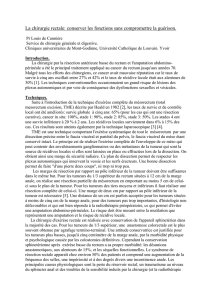Traitement des petits cancers du rectum

La Lettre de l’Hépato-Gastroentérologue - n° 4 - vol. II - septembre 1999 203
e traitement carcinologique du cancer du tiers infé-
rieur du rectum à visée curative implique à l’heure
actuelle une exérèse chirurgicale large qui sera soit
une amputation abdominopérinéale, soit une résection antérieure
du rectum, ces deux interventions étant associées à une exérèse
totale du mésorectum et en cas de tumeur infiltrante, c’est-à-dire
au moins de stade T2, à une radiothérapie préopératoire, habi-
tuellement délivrée à la dose de 45 Gy, en six semaines (1).
Bien que la mortalité postopératoire de ces interventions ait baissé
ces dernières années, la morbidité ainsi que les séquelles fonc-
tionnelles (incontinence anale, incontinence urinaire, impuissance
éventuelle chez l’homme) restent élevées.
Pour ces raisons, des traitements locaux ont pu être proposés chez
certains patients porteurs de “petits cancers” afin d’éviter cette
morbidité induite, en espérant bien entendu, ne pas obérer le pro-
nostic carcinologique.
La place de ces traitements locaux reste difficile à déterminer, car
on ne dispose que de très peu d’études comparant ces traitements
au traitement radical, en dehors de l’étude randomisée de Winde
et coll. (2) qui compare, pour des petits cancers rectaux de stade
T1, l’excision par voie transanale à la résection antérieure avec
un résultat favorable au traitement local. De plus, le nombre de
séries rapportées dans la littérature est faible, chaque série n’in-
clut que peu de patients ; les techniques chirurgicales, quand ce
traitement est utilisé, sont hétérogènes et le suivi est en général
court. Malgré ces écueils, l’étude des différentes séries de la lit-
térature semble montrer que les traitements locaux, appliqués à
des patients bien sélectionnés, sont susceptibles d’offrir les
meilleures chances de survie au prix d’une morbidité moindre.
CRITÈRES DE SÉLECTION
Logiquement, les traitements locaux ne devraient s’adresser qu’aux
patients qui présentent des tumeurs sans envahissement ganglion-
naire. En effet, il est bien démontré depuis Dukes, que la survie est
corrélée à l’envahissement ganglionnaire, et de manière indirecte,
qu’une chirurgie radicale peut, grâce au curage ganglionnaire, gué-
rir 25 % des patients N+ qui probablement ne seraient pas guéris,
s’ils avaient bénéficié d’un traitement local seul (3).
Un autre impératif, qui s’applique aux traitements locaux chi-
rurgicaux, est qu’ils ne peuvent a priori se concevoir que si l’exé-
rèse peut être complète, à la fois latéralement et en profondeur.
Les nombreux critères qui ont été discutés pour savoir si une tumeur
pouvait être accessible à un traitement local sont présentés ci-dessous.
La taille de la tumeur
Pour la plupart des auteurs, un diamètre de moins de 3 cm semble
être une taille raisonnable pour envisager un traitement local. Cela
est justifié par le fait démontré par Faivre et Weber (4) qu’il y a
une corrélation entre la taille de la tumeur et sa pénétration en
profondeur. Pour ces auteurs, lorsque le diamètre est inférieur à
13 mm, la tumeur atteint la sous-muqueuse, lorsque le diamètre
est supérieur à 37 mm, elle atteint la musculeuse interne, alors
que lorsque le diamètre est supérieur à 48 mm, elle atteint la mus-
culeuse externe. Parallèlement, il semble que le risque d’enva-
hissement ganglionnaire, comme cela a été démontré par
Killingback (5) soit lui aussi corrélé au diamètre de la tumeur.
De plus, comme l’a dit Lasser (6), un diamètre de 3 cm semble être
une taille maximale pour envisager raisonnablement une exérèse chi-
rurgicale locale. En effet, si l’on veut conserver au pourtour de la
Traitement des petits cancers du rectum
●
L. Bresler*, S. Faivre*
■Les traitements locaux des cancers du rectum ne devraient
s’adresser qu’à des tumeurs qui ne présentent pas d’envahis-
sement ganglionnaire.
■Les bons critères de choix sont une tumeur de moins de 3 cm,
d’aspect polypoïde, ne dépassant pas la sous-muqueuse, bien dif-
férenciée histologiquement, de stade uT1N0 en écho-endoscopie.
■L’exérèse locale par voie transanale est une technique
fiable, s’accompagnant d’une faible mortalité postopératoire,
d’un taux de récidive locale de 5 à 20 %, d’une survie à 5 ans
de l’ordre de 85 %.
■La radiothérapie endocavitaire est une technique fiable, réa-
lisable en ambulatoire et moins onéreuse que la chirurgie. Les
résultats thérapeutiques sont équivalents à ceux de la chirurgie,
mais il n’y a pas d’examen anatomopathologique, ce qui ne
permet pas de modifier la stratégie thérapeutique s’il y a lieu.
POINTS FORTS
POINTS FORTS
* Service de chirurgie C, CHU de Brabois, Vandœuvre-les-Nancy.
L

DOSSIER THÉMATIQUE
La Lettre de l’Hépato-Gastroentérologue - n° 4 - vol. II - septembre 1999204
lésion une marge de sécurité de 1 cm, le diamètre de la plaie opéra-
toire va atteindre 5 cm, ce qui fait qu’il va être de plus en plus diffi-
cile d’obtenir une marge de sécurité périphérique correcte dans des
conditions techniques acceptables, en cas de tumeur de plus de 3 cm.
L’aspect macroscopique de la lésion
La plupart des auteurs insistent sur le caractère péjoratif des
lésions ulcérées par rapport aux lésions exophytiques, cet aspect
étant corrélé, semble-t-il, à l’envahissement ganglionnaire. Dans
la série de Reed et coll. (7), sur 32 patients traités pour petits can-
cers du rectum par contacthérapie, 22 patients présentaient une
tumeur polypoïde, 5 une tumeur sessile et 5 une tumeur ulcérée.
Avec un recul de 43 mois, 4 des 5 patients (80 %) avec une tumeur
ulcérée ont présenté une récidive locale alors que seulement 4 des
27 autres (15 %) ont récidivé. Malgré tout, le caractère ulcéré
d’une tumeur ne semble pas contre-indiquer formellement un trai-
tement local mais mérite réflexion.
L’infiltration en profondeur
L’envahissement ganglionnaire est corrélé à l’infiltration en pro-
fondeur de la tumeur pour la plupart des auteurs. Il n’est pas nul
pour les cancers limités à la muqueuse et à la sous-muqueuse,
puisque Huddy et coll. (8) retrouvaient 11 % d’envahissements
ganglionnaires pour des cancers limités à la sous-muqueuse contre
30 % pour les cancers atteignant en profondeur la musculeuse.
Cette différence n’était pas statistiquement significative. Pour
Billingham (9), à propos d’une série multicentrique, l’envahis-
sement ganglionnaire était directement corrélé à l’infiltration en
profondeur de la tumeur, puisqu’il retrouvait un taux d’envahis-
sement ganglionnaire de 12 % pour les lésions limitées à la sous-
muqueuse, 35 % pour les lésions limitées à la musculeuse et 44 %
pour les lésions qui dépassaient la musculeuse.
Il semble, à l’heure actuelle, que l’écho-endoscopie puisse per-
mettre de déterminer avec une précision importante l’extension
en profondeur de la lésion et dans la série de Solomon et Mac
Leod (10), cet examen présentait une valeur prédictive positive
de 84 % pour les T2 et de 95 % pour les T1.
La différenciation histologique
Pour la plupart des auteurs (6), le grade histologique selon Bro-
ders est corrélé à l’existence d’un envahissement ganglionnaire.
Dans l’étude de Saclarides et coll. (11) portant sur 69 patients, le
grade histologique est l’élément du pronostic le plus important
dans le cadre d’une étude multivariée. Tous les auteurs sont ainsi
d’accord pour éliminer des traitements locaux des tumeurs peu
différenciées grade III de Broders ou indifférenciées grade IV de
Broders. En revanche, l’unanimité n’est pas faite pour les tumeurs
moyennement différenciées de grade II. Lasser (6) insistait sur le
fait que les biopsies de la tumeur donnent des résultats qui ne sont
pas toujours représentatifs du type histologique réel qui ne peut
être obtenu que sur la pièce opératoire en entier.
Les autres facteurs anatomopathologiques
D’autres facteurs anatomopathologiques semblent défavorables
pour envisager un traitement local sans que l’on en ait la preuve
formelle. Le caractère mucineux de la lésion serait un élément de
mauvais pronostic. La présence d’embols tumoraux dans les lym-
phatiques ou les vaisseaux, au contact de la lésion, serait aussi un
mauvais facteur pronostic. Enfin, l’existence d’un engainement
tumoral périnerveux serait là aussi un facteur pronostic péjoratif.
Ainsi, on pourrait admettre qu’un cancer du rectum pourrait être
une bonne indication de traitement local, s’il mesure moins de
3 cm de diamètre, s’il est bien ou moyennement différencié sur
le plan histologique, si la tumeur est plutôt de type exophytique,
si la lésion n’est pas de type mucineux, s’il n’y a pas d’envahis-
sement vasculaire ou lymphatique sur les prélèvements. Tous ces
critères semblent minimiser le risque d’envahissement ganglion-
naire. De plus, à l’heure actuelle, on peut apprécier la profondeur
de la lésion de façon assez formelle grâce à l’écho-endoscopie ;
profondeur qui ne doit donc pas, si possible, dépasser la muscu-
laire muqueuse. Enfin, l’écho-endoscopie semble jouer un rôle
important dans la recherche d’un envahissement ganglionnaire
et, dans la série de Solomon et Mac Leod (10), cet examen a une
valeur prédictive négative de l’ordre de 85 %.
Si l’on respecte parfaitement ces critères, il semble qu’environ 15 %
des cancers rectaux pourraient bénéficier des traitements locaux (12).
On peut donc sélectionner les tumeurs accessibles à un traitement
local. L’examen clinique permettra de bien apprécier le siège de
la lésion, sa taille, son caractère ulcéré ou non ; l’échographie
endorectale éliminera les tumeurs T3, voire les T2 et les tumeurs
s’accompagnant d’adénopathies locorégionales ; enfin, les biop-
sies préopératoires éradiqueront les tumeurs indifférenciées.
Parmi les traitements locaux, on peut distinguer, d’une part les exé-
rèses locales de la tumeur et d’autre part, les destructions tumorales
par électrocoagulation ou par radiothérapie. Nous ne parlerons pas
dans cet exposé des exérèses par laser, cryochirurgie ou résection
de type endoscopique, qui ne sont que des gestes palliatifs.
EXCISION LOCALE
Seul ce traitement permet d’obtenir une pièce opératoire et donc un
résultat anatomopathologique. Il s’agit d’une véritable intervention
chirurgicale, nécessitant une anesthésie générale ou locorégionale et
qui a sa morbidité propre. Différentes techniques ont été décrites que
l’on peut distinguer en fonction de leur voie d’abord (tableau I).
Tableau I. Critères de choix d’exérèse locale d’un petit cancer du
rectum.
•Critères diagnostiques :
– diamètre de moins de 3 cm
– lésion de type polypoïde
•Critères histologiques :
– lésion histologiquement moyennement à bien différenciée
– caractère non mucineux
– absence d’envahissement nerveux et lymphatique
sur les prélèvements
•Critère échographique :
– lésion uT1 N0

La Lettre de l’Hépato-Gastroentérologue - n° 4 - vol. II - septembre 1999 205
Voies endo-anales
La technique de référence a été décrite au St Marks Hospital (13).
Elle consiste à réaliser une excision en pleine épaisseur empor-
tant toute la paroi rectale avec une marge de sécurité péritumo-
rale de 1 cm. L’anus dilaté est maintenu ouvert par un écarteur
de type Parks et la fermeture de la tranche opératoire est faculta-
tive (figure 1).
Cette technique ne peut s’adresser qu’à des tumeurs basses en
raison du risque de perforation intra-péritonéale et de plus, elle
est contre-indiquée pour les tumeurs antérieures en raison du
risque de fistule recto-vaginale chez la femme ou de fistule uré-
trale chez l’homme.
Pour faciliter l’exérèse qui n’est pas toujours simple, plusieurs
artifices ont été décrits :
– Faivre et coll. (14) ont présenté la technique du lambeau trac-
teur, encore appelée électro-résection transanale qui consiste à
créer un lambeau rectal débuté au niveau de la peau de la marge
anale et permettant ainsi d’abaisser progressivement la lésion rec-
tale pour en faciliter l’exérèse (figure 2) ;
– Buess et coll. (15) ont développé une technique intitulée “trans-
anal endoscopic microsurgery” (TEM) qu’ils utilisent pour résé-
quer à vue des lésions au travers d’un rectoscope de 4 cm de dia-
mètre avec un dispositif optique permettant une vision en relief et
un agrandissement (figure 3). Une insufflation par du CO2est néces-
saire pour maintenir le rectum ouvert. Habituellement, les plaies
opératoires sont suturées sous contrôle endoscopique (figure 4).
Autres voies
Pour mémoire, la voie de Kraske ou voie trans-sacrée, ainsi que
la voie trans-sphinctérienne postérieure de York-Mason ou l’ano-
rectotomie antérieure décrite par Toupet ont toutes été utilisées
pour réaliser ces traitements locaux des tumeurs rectales. La mor-
bidité, inhérente à ces voies d’abord, les ont fait abandonner par
la plupart des auteurs.
Figure 1. Exposition à l’aide
du rétracteur de Parks.
Figure 2. Dissection de la tumeur selon la technique du lambeau tracteur.
Figure 3. “Transanal endoscopic microsurgery” (TEM).
Figure 4. Fermeture
du défect.

La Lettre de l’Hépato-Gastroentérologue - n° 4 - vol. II - septembre 1999206
DOSSIER THÉMATIQUE
Résultats
(tableau II)
• Mortalité opératoire
Elle est pratiquement nulle pour la plupart des auteurs. Mala-
fosse et coll. (16) ne notaient aucun décès dans leur série de
33 patients traités en 1979 et 1989, plus récemment Mentges et
coll. (17), qui ont utilisé la technique de Buess, rapportent un
décès sur une série de 355 patients, et Faivre et coll. (14) ont
enregistré un décès par infarctus du myocarde sur une série de
126 patients traités par la technique d’électro-résection trans-
anale. Ces résultats sont à comparer aux résultats des séries com-
portant un geste chirurgical classique. Si l’on se reporte à la série
de l’Association française de chirurgie publiée en 1987 (18), sur
2 540 résections colorectales, on note une mortalité opératoire
de 7,5 %. Il est certain que les chiffres actuels de mortalité opé-
ratoire se sont améliorés et dans une série personnelle non
publiée, nous ne notons aucun décès chez 76 patients traités par
radiothérapie préopératoire suivie d’une résection colorectale au
cours des cinq dernières années.
• Morbidité opératoire
En ce qui concerne la morbidité opératoire, celle-ci paraît
faible mais elle n’est pas évaluée de façon précise dans toutes
les séries. Faivre et coll. (14) rapportaient deux hémorragies
postopératoires nécessitant une réintervention et une rétention
d’urine dans leur série. Sur l’étude des complications à plus
long terme, ils retrouvaient cinq cas d’incontinence anale et
deux sténoses. Frazee et coll. (19), en 1995, rapportaient une
morbidité de 7 % sur une série de 38 patients avec essentiel-
lement des rétentions d’urines postopératoires et des pneu-
mopathies. Rouanet et coll. (20) rapportaient, dans une série
de 37 patients, une fistule rectovaginale, une désunion de la
suture de la paroi rectale dans presque un tiers des cas et trois
rectites chez les patients qui avaient bénéficié d’une radio-
thérapie associée.
• Reprises immédiates pour chirurgie complémentaire
Le taux de chirurgie complémentaire après exérèse locale est
variable selon les auteurs, selon les critères initiaux de sélection.
Morson et coll. (21) effectuaient sur 143 patients, 24 chirurgies
complémentaires, soit 17 %, Lasser et coll. (22) reprenaient
4 patients sur 44, soit 9 %, et Malafosse et coll. (16) reprenaient
18 patients sur 33, soit 54 % en raison d’un nombre élevé d’exé-
rèses incomplètes. Cette chirurgie secondaire devrait être évitée
le plus possible car les conditions opératoires sont souvent rela-
tivement défavorables.
• Récidives locorégionales
Le taux de récidives locorégionales de ces tumeurs varient dans
la littérature de 3 à 25 % environ. Cette variabilité du taux de réci-
dive est directement corrélée à l’extension en profondeur de la
lésion et c’est pour les tumeurs les plus profondes que les taux
de récidives sont les plus élevés. Ainsi, dans la série de Hager et
coll. (23), on notait trois récidives locales sur 39 patients de stade
T1 (8 %) contre trois récidives locales pour 20 patients de stade
T2 soit 17 %. Ces récidives locales peuvent théoriquement être
diagnostiquées de façon précoce si une surveillance rigoureuse
est effectuée et les malades peuvent alors bénéficier d’une chi-
rurgie de rattrapage. Cette chirurgie de rattrapage est possible
selon les séries de la littérature dans un pourcentage qui va de 0
à 100 % des cas, avec une moyenne de 60 % environ.
• Survie à 5 ans
Celle-ci varie dans les séries de la littérature de 75 à 100 % des
cas et elle semble elle aussi corrélée à l’extension en profondeur
de la lésion. Dans la série de Hager et coll. (23), la survie était de
89,6 % pour les patients classés T1 alors qu’elle n’était que de
78 % pour les patients classés T2.
• Excision locale et traitements adjuvants
Finalement, l’exérèse locale semble donc recommandable pour
les tumeurs de type T1. Le taux de récidive locale augmente et la
survie à cinq ans diminue dès que les lésions sont de stade T2.
C’est la raison pour laquelle des auteurs ont préconisé un traite-
ment adjuvant pour certaines lésions. C’est notamment l’intérêt
de la radiothérapie qui a pour but de diminuer les récidives locales
pures et, éventuellement, de stériliser les adénopathies métasta-
tiques. Ces traitements adjuvants pourraient ainsi être appliqués
à certaines lésions se révélant de stade T2 sur l’analyse anato-
mopathologique ou étant des T1 défavorables, en fonction par
exemple d’un grade histologique élevé.
Radiothérapie postopératoire
Quinze patients du MD Anderson Hospital (États-Unis) (24), trai-
tés de principe pour des tumeurs de stade T2 par une excision
locale, ont bénéficié en postopératoire d’une irradiation associée
à une chimiothérapie à base de 5FU. Les auteurs rapportent une
survie de 93 % à cinq ans. Plus récemment, le “Cancer and Leu-
cemia Groupe B” (CALGB) (25) a rapporté les résultats d’une
étude comportant 60 tumeurs T1, traitées par excision locale seule,
comparée à 53 tumeurs de stade T2, traitées par excision locale
puis radio-chimiothérapie postopératoire. Cette série ne retrou-
vait que deux récidives locales pures sur les 113 patients et, au
final, 4 % de décès liés à l’évolution du cancer avec un recul de
deux ans.
Tableau II. Résultats des exérèses locales des “petits cancers” du rectum
dans quelques séries de la littérature.
Auteur Nombre Invasion Récidive Survie
pariétale locale (%) à 5 ans
(%)
T1 T2 T3
Hager
(23)
59 39 20 0 10 84
Killingbach
(5)
34 0 28 6 23 82
Malafosse
(16)
33 15 14 4 11 79
Lasser
(6)
44 28 15 1 7,5 85
Faivre
(4)
126 44 82 0 25 85

La Lettre de l’Hépato-Gastroentérologue - n° 4 - vol. II - septembre 1999 207
Radiothérapie préopératoire
La place de la radiothérapie préopératoire est moins bien docu-
mentée. Mohiuddin et coll. (26) ont traité 18 patients de stade T1-
T2 par une radiothérapie préopératoire à la dose de 45 Gy suivie
d’une excision locale. Ils notaient dans cette série 11 % de com-
plications postopératoires, 15 % des récidives locales et 92 % de
survie à cinq ans. Ces résultats sont peu différents de ceux des
autres séries où l’excision locale seule était réalisée. Aucune étude
de la littérature ne semblait permettre de tirer des conclusions
précises et pour Ahmad et Nagle (27), il n’y aurait pas, à l’heure
actuelle, de données scientifiques suffisantes pour recommander
cette attitude.
L’ÉLECTROCOAGULATION
L’électrocoagulation des cancers du bas rectum est un procédé
ancien. À la suite de Madden et Kandalaft (28), quelques rares
équipes l’ont utilisée. Eisenstat et Oliver (29) ont traité par élec-
trocoagulation des patients âgés porteurs d’un petit cancer du
rectum. Les complications dans cette série ont été nombreuses
(hémorragie, sténose, perforation) et 38 patients ont dû subir une
amputation abdominopérinéale secondaire. L’équipe de
Lazorthes (30) a traité 20 patients entre 1973 et 1990 par élec-
trocoagulation. La survie à cinq ans était de 78,3 % et le taux de
récidives locales de 16,5 %. Durant la même période, 26 patients
étaient traités par excision locale avec une survie à cinq ans de
94,4 % et un taux de récidives locales de 4,5 %. Les résultats
étaient significativement différents et ces auteurs recomman-
daient l’abandon de l’électrocoagulation comme méthode à visée
curative.
RADIOTHÉRAPIE ENDOCAVITAIRE
(31)
Sous le terme de radiothérapie endocavitaire, on distingue deux
modalités techniques différentes. D’une part, la radiothérapie de
contact et d’autre part, la curiethérapie interstitielle, qui est uti-
lisée en général comme complément de la précédente.
Technique de la radiothérapie de contact
La radiothérapie de contact s’effectue à l’aide d’un tube à rayon X
de la marque Philips, appelé RT 50. Le localisateur a un diamètre
de 30 mm et peut coulisser dans un rectoscope. Le patient doit
être placé en position genu-pectorale. Une anesthésie locale du
sphincter est parfois nécessaire.
Pour les petits cancers de stade T1 probable, une dose totale de
90 à 120 Gy est délivrée en quatre à six fractions étalées sur cinq
à huit semaines. Ce traitement est effectué en ambulatoire.
Technique de la curiethérapie interstitielle
Cette technique se fait habituellement en utilisant des aiguilles
d’iridium qui permettent de délivrer 15 à 30 Gy supplémentaires
sur la lésion. D’autres modalités d’application de l’irathérapie
existent et certains ont utilisé des fourchettes d’iridium, des guides
plastiques dans lesquels sont introduites des aiguilles d’iridium
ou des cylindres d’iridium de 1 à 2 cm de diamètre. Le choix de
chacune de ces modalités pratiques de curiethérapie est fonction
de la localisation de la lésion. Il est habituellement délivré un sur-
dosage de 15 à 30 Gy sur la zone lésionnelle.
Indications
Ce sont les mêmes indications que celles de l’exérèse locale. De
façon claire pour tous les auteurs, il doit y avoir une réponse nette
après les deux premières séances de contacthérapie. Il est ainsi
démontré que si au 21ejour après le début du traitement, la tumeur
a disparu ou a diminué de plus de 80 %, les chances d’obtenir un
contrôle local sont très élevées. Si la réponse au 21ejour ne réunit
pas ces critères, il semble logique de modifier la stratégie théra-
peutique et soit d’avoir recours à la chirurgie, soit de combiner
cette approche avec de l’irathérapie ou de la radiothérapie externe.
D’un point de vue pratique, les tumeurs doivent être accessibles
au tube d’irradiation et la limite supérieure se situe entre 10 et
12 cm de la marge anale. Les lésions situées sur la face posté-
rieure du rectum, juste au-dessus du canal anal, sont difficilement
accessibles à ce traitement, du fait d’une orientation tangentielle
du tube.
Les résultats de cette technique, appliquée en Europe et aux États-
Unis à plus de 1 000 patients à l’heure actuelle, sont résumés dans
le tableau III (31). Pour les lésions présumées T1 N0, le contrôle
local est ainsi proche de 90 % et la survie à cinq ans varie de 60
à 90 % en fonction de la sélection des patients. Le taux de com-
plication est faible et notamment, il n’a jamais été signalé de fis-
tule recto-vaginale après ce type de traitement. Quelques patients
présentent des atrophies de la muqueuse rectale avec parfois des
télangiectasies qui ont pu occasionner des phénomènes hémor-
ragiques. De plus, en cas de récidive dépistée précocement grâce
à un examen clinique régulier, une chirurgie de rattrapage est très
souvent possible. Gerard et coll. (31) estimaient qu’à long terme,
la préservation sphinctérienne peut être donc obtenue entre 90 et
95 % des cas avec une continence anale considérée comme bonne
ou très bonne chez 80 % des patients.
Compte tenu des excellents résultats obtenus par cette technique
pour les tumeurs T1 ou T2 de faible taille, certains ont essayé
d’étendre cette technique aux tumeurs T2 et aux tumeurs T3 chez
des patients considérés comme inopérables. C’est ainsi que
l’équipe de Gerard (31) a traité 43 patients entre 1986 et 1995 en
combinant une contacthérapie et une radiothérapie externe pour
des lésions évoluées. Il y avait en effet dans cette série, 3 lésions
de stade T1, 23 lésions de stade T2 et 17 lésions de stade T3, la
profondeur ayant été estimée par échographie endorectale. Ces
patients avaient bénéficié tout d’abord d’une contacthérapie à la
dose de 70 à 90 Gy, puis d’une radiothérapie externe en trois
champs délivrant une dose de 39 Gy avec un surdosage local de
4 Gy. Six semaines plus tard, des aiguilles d’iridium étaient
implantées chez 32 patients assurant un nouveau surdosage de
20 Gy. Un contrôle local pouvait être obtenu chez 32 patients sur
43 et les auteurs n’ont pas noté de récidive lymphatique locoré-
gionale. Avec un suivi de 42 mois, la survie moyenne a été de
68 %. Aucun patient n’a nécessité la réalisation d’une colostomie.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%