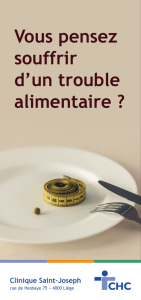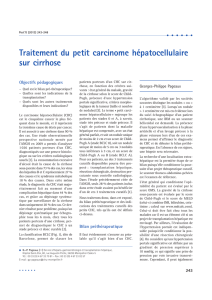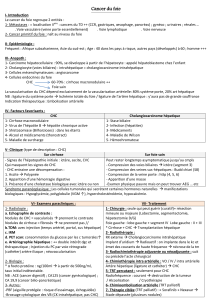Lire l'article complet

La Lettre de l’Hépato-Gastroentérologue - n° 1 - vol. II - février 1999 23
e traitement chirurgical du carcinome hépatocellulaire
(CHC) comporte plusieurs types d’interventions,
depuis l’hépatectomie partielle jusqu’à l’hépatectomie
totale avec transplantation. Le traitement chirurgical du CHC est
le traitement dont on connaît le mieux les résultats et il est remar-
quable que ceux-ci continuent de s’améliorer (1-4). Il est clair
que la transplantation, traitement en un temps de la tumeur et de
la maladie hépatique sous-jacente, constitue la seule chance de
guérison d’un malade atteint de CHC. Cependant, comme nous
le verrons, cette option a des indications et surtout des possibili-
tés très limitées. L’hépatectomie a une efficacité controversée
pour au moins deux raisons :
– son risque est élevé chez un malade ayant une hépatopathie
sous-jacente ;
– les malades ayant survécu développent une récidive (5).
Un des objectifs de cette actualisation des résultats du traitement
chirurgical du CHC est de montrer que la résection hépatique
garde une place importante dans le traitement des CHC.
Bien que plus de 90 % des CHC se développent sur une hépato-
pathie chronique sous-jacente, il existe un sous-groupe de malades
qui peuvent développer un CHC sur foie sain. Ces malades posent
des problèmes thérapeutiques différents.
TRAITEMENT CHIRURGICAL DU CHC SUR FOIE SAIN
En dehors d’une faible proportion de malades ayant une infec-
tion chronique par le virus B, l’étiologie du CHC développé sur
un foie sain reste le plus souvent inconnue. Le fibrolamellaire est
une forme particulière de CHC qui se développe préférentielle-
ment chez la femme jeune. Cette variante ne justifie pas de trai-
tement particulier (6).
Bien que, lors de sa découverte, le CHC sur foie sain soit sou-
vent volumineux, il est une indication de résection en l’absence
de diffusion bilobaire ou de métastase. Quelle que soit la taille
de la tumeur, la présence d’un parenchyme normal permet une
hépatectomie extensive qui est bien tolérée, car ces malades pré-
sentent le plus souvent un bon état général. La survie à cinq ans
sans récidive de ces malades est supérieure à 60 % (6). Ce pro-
nostic est plus favorable que lorsqu’il existe une hépatopathie
sous-jacente, mais il persiste un risque important de récidive
quelle que soit la variété de CHC. Si la récidive reste intrahépa-
tique, il est possible d’envisager soit une nouvelle résection, soit
une transplantation.
L’indication d’une transplantation pour un CHC sur foie sain est
envisagée en l’absence de métastase et si la tumeur n’est pas résé-
cable.
TRAITEMENT CHIRURGICAL DU CHC
SUR HÉPATOPATHIE CHRONIQUE
Un traitement chirurgical, qu’il s’agisse d’une transplantation ou
d’une résection, n’est envisageable que chez un malade ne pré-
sentant pas certaines contre-indications (tableau I). L’étape sui-
vante consiste à projeter une transplantation qui est le seul trai-
tement complet de la tumeur et de la maladie sous-jacente. Si le
malade ne réunit pas tous les critères de transplantation (tableaux
Ia et Ib), une résection chirurgicale peut être envisagée.
La résection chirurgicale du CHC
La présence d’une hépatopathie augmente singulièrement le
risque lié à tout acte chirurgical ; et tout particulièrement celui
d’une résection hépatique qui modifiera l’hémodynamique por-
Traitement chirurgical
●
J. Belghiti*
■La résection chirurgicale reste le meilleur traitement du
CHC supérieur à 5 cm, chez les malades ayant une bonne
fonction hépatocellulaire.
■La transplantation représente le meilleur traitement des
malades ayant un CHC unique de moins de 5 cm ou deux
CHC de moins de 3 cm chacun et s’il n’existe pas d’envahis-
sement portal.
■Les malades opérés d’un CHC doivent continuer à être sui-
vis, car une récidive intrahépatique peut être accessible à un
nouveau traitement local avec une amélioration de leur sur-
vie.
POINTS FORTS
POINTS FORTS
* Fédération de pathologie digestive,
hôpital Beaujon, Clichy, université Paris VII.
L
Maq HGE1 vol II 21/08/03 16:20 Page 23

tale, en amputant le lit d’aval hépatique, et surtout réduire la masse
de parenchyme hépatique fonctionnel. Le risque opératoire pré-
coce dépend de l’étendue de l’exérèse et de la gravité de la cir-
rhose appréciée par la classification de Child-Pugh.
Une résection hépatique est contre-indiquée lorsqu’il existe une
insuffisance hépatique ou une atrophie hépatique. Bien qu’il soit
admis qu’une résection limitée est possible chez les malades Child
B, notre attitude est de récuser cette exérèse chez ceux souffrant
d’une insuffisance hépatocellulaire pour deux raisons :
– ces malades sont soumis, dans les mois qui suivent l’interven-
tion, à un très haut risque de complication de leur hépatopathie ;
– ces résections limitées augmentent le risque de récidive locale.
Aussi, chez un malade qui ne pourrait tolérer qu’une résection
limitée, nous paraît-il préférable de proposer un traitement non
chirurgical. Dans ce sous-groupe, l’alcoolisation percutanée est
probablement aussi efficace et certainement moins dangereuse
que “l’alcoolisation chirurgicale” (7, 8).
Chez un malade sans insuffisance hépatocellulaire (Child-Pugh
A), il est théoriquement possible de proposer une résection hépa-
tique emportant plus de deux paramètres. En fait, cette notion
doit être nuancée par au moins deux facteurs : l’évaluation du
score de Child-Pugh en préopératoire reste un critère insuffisant
pour estimer le risque opératoire, et, surtout, le terme d’hépato-
pathie chronique recouvre des atteintes parenchymateuses qui
vont de la fibrose périportale à la cirrhose, en passant par la fibrose
extensive. Chez un malade classé Child-Pugh A, le degré d’hy-
pertension portale et surtout l’existence d’une hépatopathie active
(en particulier lorsqu’il s’agit d’une hépatite chronique C), carac-
térisée par une élévation des transaminases préopératoires (supé-
rieures à 2N), sont deux facteurs de risque supplémentaires (9,
10). Nous avons démontré que les malades ayant une volumi-
neuse tumeur développée sur une hépatopathie chronique peu-
vent bénéficier d’une résection large si les conditions suivantes
sont réunies :
– absence d’insuffisance hépatocellulaire (Child-Pugh A) ;
– absence de varices œsophagiennes supérieures au grade 2 ;
– transaminases préopératoires inférieures à 2N ;
– absence de cirrhose.
L’appréciation du degré de fibrose peut nécessiter une biopsie
préopératoire sur le foie non tumoral.
L’indication d’une exérèse chirurgicale d’un CHC de petite taille
est actuellement bien établie. Elle s’adresse aux malades souffrant
d’une tumeur unique, sans envahissement portal et avec une fonc-
tion hépatocellulaire conservée. L’unicité de la tumeur est établie
au terme d’un bilan morphologique préopératoire, qui comporte
une échographie, un examen tomodensitométrique, une artério-
graphie avec injection de lipiodol suivie d’un nouveau scanner deux
à trois semaines plus tard (scanner post-LUF). L’injection préa-
lable de lipiodol, qui se fixe durablement dans le tissu tumoral, aug-
mente en effet les capacités de détection des lésions de petite taille
par la tomodensitométrie. Ce bilan est complété par une échogra-
phie peropératoire afin de localiser la lésion et de rechercher
d’autres tumeurs non vues au cours du bilan préopératoire. Ce
“long” bilan préopératoire est en voie de simplification grâce aux
performances du scanner hélicoïdal qui semble pouvoir remplacer
l’artériographie avec injection de lipiodol suivie d’un scanner
conventionnel. De même, la sensibilité de l’imagerie préopératoire
a modifié les indications de l’échographie peropératoire qui est sur-
tout utilisée pour guider la résection chirurgicale en fonction de la
situation des structures vasculaires adjacentes.
Chez les malades n’ayant pas d’insuffisance hépatocellulaire, la
chirurgie doit théoriquement répondre à deux objectifs antino-
miques : réaliser une exérèse carcinologique aussi large que pos-
sible, passant à distance de la tumeur, et conserver au maximum
le parenchyme non tumoral afin d’éviter une insuffisance hépa-
tocellulaire postopératoire. Bien que les résultats de la chirurgie
se soient améliorés, le risque opératoire des exérèses limitées reste
proche de 5 % (11). Chez ces malades, la mortalité postopéra-
toire est liée à la survenue d’une insuffisance hépatocellulaire, au
développement d’une ascite avec ses risques pariétaux, et aux
complications infectieuses, notamment pulmonaires.
À long terme, les causes de mortalité après résection de CHC sont
principalement dues à la récidive tumorale (5). Globalement, la
survie après résection est de 40 % à cinq ans et la survie sans réci-
dive est de 20 % à cinq ans. Le risque de récidive est lié à plu-
sieurs facteurs dont :
– les caractéristiques de la tumeur ;
– l’étendue de la résection ;
– la nature de l’hépatopathie sous-jacente.
L’existence d’une maladie chronique et active du foie (en particulier
lorsqu’il s’agit d’une hépatite virale C) augmente le risque de réci-
dive (12). Il a été démontré que les exérèses tumorales emportant le
territoire portal adjacent à la tumeur (segmentectomie ou bisegmen-
tectomie) avaient un meilleur pronostic que les résections limitées
(4).Les caractéristiques de la tumeur qui semblent augmenter le risque
de récidive sont la faible différenciation, la présence d’embols vas-
culaires tumoraux et un taux d’alpha-fœtoprotéine (AFP) élevé (2).
DOSSIER THÉMATIQUE
La Lettre de l’Hépato-Gastroentérologue - n° 1 - vol. II - février 199924
- Métastases viscérales et ganglionnaires.
- Présence de plus de trois tumeurs.
- Tumeur associée à une obstruction biliaire avec ictère.
- Tumeur associée à une thrombose portale tronculaire.
- Rupture tumorale associée à la présence d’autres tumeurs.
Tableau I. Contre-indications à un traitement chirurgical du CHC.
- Insuffisance hépatocellulaire :
- TP < 50% ;
- Ascite ;
- Bilirubinémie > 30 µmoles/l.
- Atrophie hépatique.
- Âge > 65 ans ;
- Réplication virale B ;
- Tumeur unique > 5 cm ;
- Thrombose vasculaire.
Tableau Ia. Contre-indications à une
exérèse chirurgicale du CHC.
Tableau Ib. Contre-indications
à une transplantation pour
CHC.
Maq HGE1 vol II 21/08/03 16:20 Page 24

La Lettre de l’Hépato-Gastroentérologue - n° 1 - vol. II - février 1999 25
Ce risque de récidive nécessite une surveillance médicale régu-
lière des malades, au moins une fois tous les six mois, et ce indé-
finiment. Le bilan doit comporter un examen clinique à la
recherche de nodules sous-cutanés (surtout si le malade a eu une
biopsie percutanée de la tumeur), un dosage de l’AFP, une écho-
graphie hépatique et une radiographie pulmonaire. Le traitement
des récidives est justifié car il est établi qu’il augmente la survie
des malades. Lorsqu’il existe une récidive intrahépatique isolée
(sans métastase extrahépatique, notamment pulmonaire ou
osseuse), le choix du traitement dépend à la fois du délai de la
récidive, de son caractère unique ou non et de la fonction hépa-
tocellulaire. Un nouveau traitement chirurgical est possible chez
10 % à 15 % des malades. Si une nouvelle résection n’est pas réa-
lisable, on peut proposer soit une chimioembolisation intra-arté-
rielle, soit une alcoolisation percutanée (11).
La transplantation hépatique pour CHC
L’analyse des résultats des premières séries de transplantation
hépatique avait montré que, chez un transplanté pour une cir-
rhose, la découverte d’une tumeur “incidentale” non diagnosti-
quée (car de petite taille) lors du bilan de prétransplantation ne
modifiait pas le pronostic de ces malades (12). Ces résultats
avaient alors conduit de nombreuses équipes à élargir les indica-
tions de transplantation à ceux souffrant de tumeurs non résé-
cables. Le pronostic de ces malades est très mauvais. Il est main-
tenant clairement prouvé qu’une survie sans récidive supérieure
à 60 % à cinq ans ne peut être obtenue que chez des malades
réunissant les deux critères suivants :
– présence d’une tumeur unique de moins de 5 cm ou de deux
tumeurs de moins de 3 cm chacune ;
– absence d’envahissement veineux portal ou sus-hépatique (6,
13, 14). Chez les malades qui répondent à ces critères, les résul-
tats de la transplantation sont supérieurs à ceux de tous les autres
traitements (6, 15).La transplantation est donc a priori le meilleur
traitement que l’on puisse proposer pour des CHC de petite taille
développés sur une hépatopathie chronique.
Pour de nombreuses raisons, cette option ne peut cependant pas
être offerte à tous les malades ayant un CHC développé sur une
hépatopathie sous-jacente. Le nombre de greffons hépatiques est
limité et la transplantation reste une intervention chirurgicale lourde
associée à une mortalité opératoire supérieure ou voisine de 10 %.
En effet, cette intervention ne peut être proposée qu’à des malades
âgés de moins de 65 ans et ne présentant pas d’affection cardio-
vasculaire ni pulmonaire ni rénale sévère (tableau II).
En outre, il existe un risque de récidive de la maladie hépatique
causale, notamment lorsqu’il s’agit d’une infection par les virus
des hépatites B et C (9). Enfin, même si la tumeur initiale était
unique et de petite taille, il persiste un risque de récidive tumo-
rale qui est favorisé par le traitement immunosuppresseur néces-
saire à la tolérance du greffon après la transplantation.
À ces restrictions, il faut ajouter que le délai d’obtention d’un
greffon est imprévisible et que la tumeur peut progresser pendant
la période d’attente. Cette possible évolution pendant la période
d’attente soulève des questions concernant :
– la nature et la périodicité des examens morphologiques pré-
opératoires ;
– la nature du traitement d’attente de la tumeur ;
– l’utilité d’une chimiothérapie adjuvante périopératoire.
Bien qu’il sous-estime l’extension tumorale, le bilan morphologique
réalisé chez les malades en attente de transplantation est compa-
rable à celui qui est effectué avant une résection. Ce bilan doit être
complété par au moins une échographie tous les trois mois, suivie
d’un scanner hélicoïdal s’il existe une progression tumorale. Le délai
d’attente d’un greffon peut être de plusieurs mois, et, pendant cette
période, on peut proposer soit une alcoolisation percutanée, soit une
ou plusieurs séances de chimioembolisation, soit une résection chi-
rurgicale limitée (7). Une intervention chirurgicale préalable pour-
rait augmenter les difficultés de réalisation de la transplantation en
créant des adhérences multiples. Pour prévenir ces difficultés, chez
les malades ayant une tumeur du dôme hépatique, on peut avoir
recours à une exérèse chirurgicale par voie thoracique. Quelques
études “pilotes” ont suggéré qu’une chimiothérapie péri-opératoire
pouvait réduire le risque de récidive (16). ■
Mots Clés : Carcinome hépatocellulaire – Résection – Trans-
plantation.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Franco D., Capussoti L., Smadja C. et coll. Resection of hepatocellular carci-
noma. Results in 72 European patients with cirrhosis. Gastroenterology 1990 ;
98 : 733-8.
2. Liver Cancer Study Group of Japan. Predictive factors for long-term progno-
sis after partial hepatectomy for patients with hepatocellular carcinoma in Japan.
Cancer 1994 ; 74 : 2772-80.
3. Kawasaki S., Makuuchi M., Miyagawa S. et coll. Results of hepatic resection
for hepatocellular carcinoma. World J Surg 1995 ; 19 : 31-4.
4. Makuuchi M., Takayama T., Kubota K. et coll. Hepatic resection for hepatocellu-
lar carcinoma – Japanese experience. Hepato-Gastroenterology 1998 ; 45 : 1267-74.
5. Belghiti J., Panis Y., Farges O. et coll. Intrahepatic recurrence after resection of
hepatocellular carcinoma complicating cirrhosis. Ann Surg 1991 ; 214 : 1114-7.
6. Figueras J., Jaurrieta E., Valls C. et coll. Survival after liver transplantation
in cirrhotic patients with and without hepatocellular carcinoma : a comparative
study. Hepatology 1997 ; 25 : 1485-9.
7. Trinchet J.C., Beaugrand M. Treatment of hepatocellular carcinoma in
patients with cirrhosis. J Hepatol 1997 ; 27 : 756-65.
8. Livraghi T. Percutaneous ethanol injection in the treatment of hepatocellular
carcinoma in cirrhosis. Hepato-Gastroenterology 1998 ; 45 : 1248-53.
9. Bruix J., Castells A., Bosch J. et coll. Surgical resection of hepatocellular car-
cinoma in cirrhotic patients : prognostic value of preoperative portal pressure.
Gastroenterology 1996 ; 111 : 1018-22.
- Âge < 60 ans.
- Absence d’affection cardiaque, pulmonaire ou rénale grave.
- Tumeur unique < 5 cm ou deux tumeurs < 3 cm.
- Absence d’atteinte portale.
- Cirrhose avec insuffisance hépatocellulaire.
- Absence de réplication virale B (DNA-VHB absent dans le sérum).
Tableau II. Indication de transplantation chez un malade ayant un
CHC sur hépatopathie chronique.
Maq HGE1 vol II 21/08/03 16:20 Page 25

DOSSIER THÉMATIQUE
La Lettre de l’Hépato-Gastroentérologue - n° 1 - vol. II - février 199926
10. Noun R., Jagot P., Farges O. et coll. High preoperative serum alanine trans-
ferase levels : effect on the risk of liver resection in Child grade A cirrhotic
patients. World J Surg 1997 ; 21 : 390-4.
11. Farges O., Regimbeau J.M., Belghiti J. Aggressive management of recurrence
following surgical resection of hepatocellular carcinoma. Hepato-
Gastroenterology 1998 ; 45 : 1275-80.
12. Bruix J. Treatment of hepatocellular carcinoma. Hepatology 1997 ; 25 : 259-62.
13. Ringe B., Pichlmay R., Wittekind C. et coll. Surgical treatment of hepatocel-
lular carcinoma : experience with liver resection and transplantation in
198 patients. World J Surg 1991 ; 15 : 270-85.
14. Mazzaferro V., Regalia E., Doci R. et coll. Liver transplantation for the treat-
ment of small hepatocellular carcinomas in patients with cirrhosis. N Engl J Med
1996 ; 334 : 693-9.
15. Bismuth H., Chiche L., Adam R. et coll. Liver resection versus transplanta-
tion for hepatocellular carcinoma in cirrhotic patients. Ann Surg 1993 ; 218 :
145-51.
16. Cherqui D., Piedbois P., Pierga J.Y. et coll. Multimodal adjuvant treatment
and liver transplantation for advanced hepatocellular carcinoma. Cancer 1994 ;
73 : 2721-6.
i, au cours de ces dernières années, l’identification
des facteurs de risque clinico-histologiques et l’ap-
proche de la carcinogenèse hépatique ont connu d’im-
portantes avancées, le pronostic des malades atteints de carci-
nome hépatocellulaire (CHC) reste très sombre. En effet, du point
de vue thérapeutique, les progrès ont surtout consisté à mieux
cerner les indications et les résultats de différentes techniques
déjà expérimentées depuis quelques années : la transplantation
hépatique reste a priori le meilleur traitement à proposer aux
malades présentant un CHC de petite taille développé sur une
hépatopathie chronique, puisqu’elle offre la possibilité de traiter
à la fois la tumeur et la maladie sous-jacente. Lorsque la trans-
plantation n’est pas envisageable, la résection n’est une alterna-
tive chirurgicale que pour les patients ne présentant pas d’insuf-
fisance hépatocellulaire grave. Parmi les traitements non
chirurgicaux, l’alcoolisation qui connaît actuellement un essor
considérable, est le seul véritable concurrent de la chirurgie. À
l’inverse, la chimio-embolisation lipiodolée semble actuellement
en régression en raison d’un bénéfice peu clair sur la survie. De
même, à la lumière des études randomisées prospectives, les trai-
tements hormonaux se sont révélés décevants. Dans cet arsenal
thérapeutique, seul le lipiodol radioactif fait figure de nouveau
venu (prometteur ?), pour lequel les indications comme les résul-
tats doivent cependant être précisés.
Dans ce contexte assez morose, le développement de la pré-
vention chez les malades identifiés comme étant à haut risque
de CHC pourrait apparaître comme une perspective d’avenir.
Les modalités de cette prévention restent encore à définir :
s’agira-t-il d’une extension des indications de la transplanta-
tion ou du traitement systématique de toute lésion identifiée
comme précancéreuse par alcoolisation ? En fait, la chimio-
prévention par administration d’interféron alpha dans les cir-
rhoses dues au virus de l’hépatite C, d’acide polyprénoïque ou
encore d’inhibiteurs de l’angiogenèse, constitue une approche
plus séduisante.
Cependant, bien entendu, la prévention préprimaire, par l’exten-
sion des campagnes de vaccination contre l’hépatite B, le dépis-
tage et le traitement des hépatites chroniques C et bien sûr les
campagnes antialcooliques, restera l’outil le plus efficace. ■
Conclusion
●
L. Choné
S
Le prochain dossier
thématique... INSUFFISANCE INTESTINALE
Coordinateur : Pr X. Hébuterne (Nice)
Maq HGE1 vol II 21/08/03 16:20 Page 26

La Lettre de l’Hépato-Gastroentérologue - n° 1 - vol. II - février 1999 27
Parmi les principaux facteurs de risque de développer un CHC, on peut citer :
A. le sexe masculin ;
B. l’infection par le virus de l’hépatite C ;
C. la maladie de Wilson ;
D. l’exposition à l’aflatoxine ;
E. l’âge supérieur à 50 ans.
Parmi les affirmations suivantes, citer celles qui sont exactes :
A. les cirrhoses micronodulaires présentent le plus fort risque de développer un CHC ;
B. la dysplasie hépatocytaire à grandes cellules est une lésion fréquente et diffuse au cours des hépatopathies chroniques ;
C. contrairement à la dysplasie à grandes cellules, la dysplasie à petites cellules n’est pas un véritable précurseur de CHC ;
D. les macronodules dysplasiques sont retrouvés dans 70 % à 75 % des cirrhoses ;
E. la carcinogenèse hépatique est un processus séquentiel et souvent multifocal.
Parmi les affirmations suivantes, citer celles qui sont exactes :
A. l’incidence du CHC sur cirrhose est de l’ordre de 10 % par an ;
B. les modalités du dépistage sont maintenant clairement définies ;
C. dans un contexte évocateur, lors de la découverte d’un nodule hépatique, il n’est pas nécessaire
d’obtenir la preuve histologique du diagnostic de cirrhose sous-jacente ;
D. la TDM lipiodolée est un examen très sensible détectant 90 % des nodules tumoraux de moins de 5 mm ;
E. l’IRM et la TDM spiralée ont actuellement supplanté la TDM lipiodolée.
Concernant, le traitement du CHC :
A. celui-ci n’est licite qu’en cas de cirrhose Child A ou B ;
B. en cas de cirrhose Child C, la survie est uniquement liée au degré d’insuffisance hépatocellulaire ;
C. après résection, la survie est supérieure à celle obtenue après alcoolisation ;
D. trois ans après un traitement par alcoolisation, une récidive tumorale est constatée chez 50 % des malades ;
E. le tamoxifène est un traitement palliatif permettant d’augmenter la survie par rapport à l’abstention thérapeutique.
Citer parmi les affirmations suivantes, celles qui sont exactes :
A. en cas de CHC sur cirrhose, la transplantation hépatique est contre-indiquée chez les malades présentant plus d’une tumeur hépatique ;
B. la survie à 5 ans des CHC sur foie sain est supérieure à 60 % ;
C. le risque opératoire d’une résection hépatique est corrélé à la gravité de la cirrhose ;
D. chez un malade sans insuffisance hépatocellulaire, des transaminases supérieures à 2N augmentent le risque d’une résection
hépatique large ;
E. la survie sans récidive à 5 ans, après transplantation, est de l’ordre de 30 % chez les malades présentant une petite tumeur unique
sans envahissement portal.
AUTO-ÉVALUATION
AUTO-ÉVALUATION
Réponses :
1 :A, B,D,E L’incidence des CHC au cours de la maladie de Wilson est faible.
2 : B, E Les cirrhoses macronodulaires présentent le plus fort risque de développer un CHC. La dysplasie à petites cellules est considérée comme un véritable précurseur
du CHC. Les macronodules dysplasiques sont retrouvés dans 10 % à 42 % des cirrhoses.
3 : E L’incidence du CHC sur cirrhose est de l’ordre de 5 % par an. En cas de découverte d’un nodule hépatique, il faut être certain du diagnostic de cirrhose, car c’est un argu-
ment important pour le diagnostic de CHC. La TDM lipiodolée a une sensibilité médiocre pour les nodules de petite taille, qui sont rarement détectés par cette technique.
4 :A,B,D Les taux de survie après alcoolisation chez des malades ayant des tumeurs limitées sont semblables à ceux de la résection. Six études randomisées prospectives ont mon-
tré que le tamoxifène n’apportait pas de gain de survie par rapport à l’abstention thérapeutique.
5 : B,C,D La transplantation hépatique est envisageable chez un malade présentant 2 tumeurs hépatiques, si celles-ci font moins de 3 cm chacune. Une survie sans récidive de l’ordre
de 60 % à 5 ans peut être obtenue après transplantation, chez les malades ayant un CHC unique de moins de 5 cm ou 2 CHC de moins de 3 cm et en l’absence d’enva-
hissement portal.
1
2
3
4
5
Maq HGE1 vol II 21/08/03 16:20 Page 27
1
/
5
100%