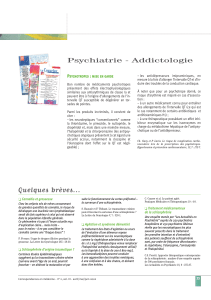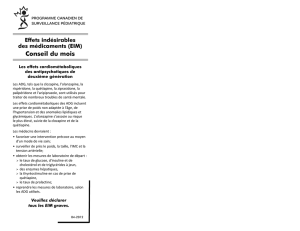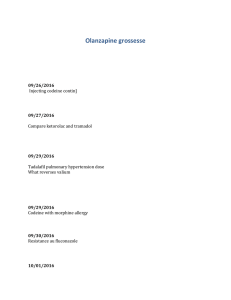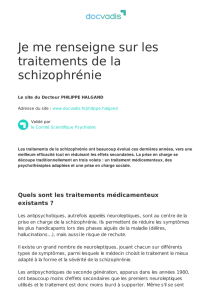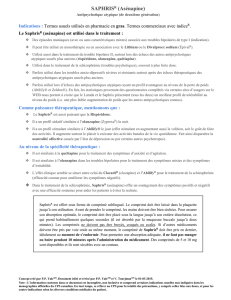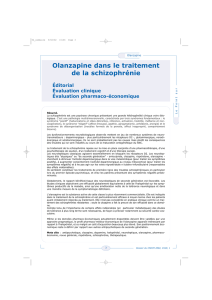Lire l'article complet

25
La Lettre du Psychiatre - Suppl. Les Actualités au vol. II - n° 3 - juin 2006
>Actualités
thérapeutiques
C
ette revue se propose d’exposer
certains résultats d’études qui
ont retenu toute notre attention de
par leur originalité et/ou leur pertinence.
Ces résultats mettent en avant l’effica-
cité de certaines molécules dans les
pathologies du système nerveux cen-
tral, l’importance des échelles cliniques
ou des épreuves cognitives dans l’éva-
luation des déficits et l’avancée de cer-
taines hypothèses de recherche, offrant
ainsi l’occasion d’améliorer la qualité de
vie du patient.
Un manque d’effort
chez le schizophrène
La schizophrénie est associée à un défi-
cit des fonctions cognitives, notam-
ment de la mémoire.
L’utilisation de tests neuropsycholo-
giques afin de quantifier le déficit repose
traditionnellement sur l’idée qu’un fonc-
tionnement cérébral anormal sous-tend
ce dysfonctionnement cognitif.
Or, la performance aux épreuves cogni-
tives ne requiert pas seulement un traite-
ment de l’information, mais également un
processus motivationnel, ou effort mental.
Si les processus motivationnels tendent
à être désorganisés, comme cela peut
être le cas dans la plupart des patholo-
gies mentales, la performance cognitive
devient déficitaire, majorant ainsi l’im-
pression d’une perturbation du traite-
ment de l’information.
Ainsi, M. Gorissen et al. ont voulu évaluer
si les faibles résultats obtenus aux tests
cognitifs chez le sujet schizophrène
étaient dus ou non à ce qu’ils ont défini
comme un effort mental insuffisant.
Soixante-quatre sujets schizophrènes,
63 sujets souffrant de pathologies psy-
chiatriques mais non psychotiques,
20 sujets présentant un trouble neuro-
logique et 44 sujets sains étaient éva-
lués par une batterie de tests neuro-
psychologiques mesurant l’attention, la
mémoire et les fonctions exécutives
(Digit Symbol Substitution Test [DSST]
de la Wechsler Adult Intelligence Scale
Revised [WAIS-R], test de Stroop, Trail
Making Test versions A [TmT-A] et B
[TmT-B], fluences verbales, California
Verbal Learning Test, Wechsler mémoire
et mots de Rey).
L’effort mental était, quant à lui,
mesuré par un test de mémoire de mots
(Word Memory Test ou WMT). Ce test,
bien qu’il se présente comme un test de
mémoire, n’évalue pas les fonctions
mnésiques en tant que telles. Il est
d’ailleurs très faiblement corrélé au test
de mémoire de Wechsler. Cette épreuve
consiste en fait en l’apprentissage
d’une liste de 20 paires de mots
concrets reliés sémantiquement. Cette
liste est présentée deux fois au sujet,
avec pour consigne qu’il retienne le
plus de mots possible. Une tâche de
reconnaissance est à effectuer sitôt la
seconde lecture de la liste. Chaque mot
figure alors avec un distracteur séman-
tique, et le sujet doit dire quel était le
mot lu initialement. Une deuxième
tâche de reconnaissance est proposée
30 minutes après.
Les performances des sujets schizo-
phrènes étaient significativement plus
faibles que celles des trois autres
groupes à l’épreuve du WMT. Une hété-
rogénéité des scores aux différentes
épreuves neuropsychologiques était
observée chez ces sujets. Un quart des
non-psychotiques obtenaient égale-
ment des scores inférieurs au seuil nor-
mal.
Ces faibles performances pourraient
s’expliquer par un trouble du traitement
sémantique, mais, dans ce cas, on s’at-
tendrait à une corrélation forte entre
WMT et symptômes positifs, notamment
les désordres de la pensée formelle : il
n’en est rien. Cela n’expliquerait pas
non plus l’échec des non-psychotiques
à l’épreuve d’effort mental.
Malgré la variabilité des performances
obtenues aux différentes épreuves neuro-
psychologiques, il semblerait donc que
le manque d’effort explique ces résul-
tats déficitaires. Il pourrait être lié aux
symptômes négatifs de la schizophré-
nie, notamment l’apathie et l’avolition.
Aussi, cet effort mental insuffisant
pourrait être considéré comme un
trouble dysexécutif, supposant une
incapacité du sujet à contrôler ses
propres performances, à corriger sa
baisse d’attention.
On peut également le considérer comme
un problème motivationnel, ce qui cor-
robore l’idée que le feedback peut amé-
liorer les performances cognitives des
sujets (1). Cela suggère aussi que les
fonctions sous-considérées ne sont pas
réellement “perdues” (2).
Il faut donc se montrer très prudent
dans l’interprétation des performances
obtenues aux épreuves neuropsycholo-
giques, notamment chez les sujets
souffrant de troubles psychiatriques, et
toujours prendre en considération l’as-
pect motivationnel des sujets.
>
Gorissen M, Sanz JC, Schmand B. Effort and cognition
in schizophrenia patients. Schizophrenia Research
2005;78:199-208.
>
Traiter le cerveau malade en 2006
S. Harrois (neuropsychologue, service de psychiatrie, CHU de Reims)
>

26 La Lettre du Psychiatre - Suppl. Les Actualités au vol. II - n° 3 - juin 2006
>Actualités
thérapeutiques
Prise en charge
des patients souffrant
de schizophrénie
au quotidien
Si, dans les pays anglo-saxons, il existe
de nombreux référentiels permettant
d’optimiser la prise en charge des
patients souffrant de schizophrénie,
cette démarche est, en France, sinon
confidentielle, du moins quasiment
inexistante.
Par ailleurs, ces référentiels s’appuient le
plus souvent sur des avis d’experts, voire
sur les études ayant servi à l’obtention
de l’autorisation de mise sur le marché,
ces dernières servant à démontrer une
efficacité clinique et un rapport béné-
fice/risque dans une situation donnée.
Or, ces études sont réalisées dans un
contexte “fermé” de population très
homogène qui ne reflète en rien la réa-
lité quotidienne de prescription.
Aussi, pour remédier à ce manque, il est
demandé que des études dites natura-
listiques, observationnelles, se mettent
en place pour apporter plus d’informa-
tions quant à la pertinence clinique en
termes d’efficacité des molécules utili-
sées pour soigner, notamment, les
patients souffrant de schizophrénie.
C’est dans cette perspective que deux
études observationnelles ont été mises
en place aux États-Unis, à partir des-
quelles un certain nombre de résultats
ont vu le jour en 2005.
La première étude est un suivi observa-
tionnel, prospectif, réalisé aux États-
Unis et qui mettait à contribution
57 sites de recrutement sur tout le ter-
ritoire américain ; elle est appelée
CATIE, pour Clinical Antipsychotic Trial
of Intervention Effectiveness.
Ce suivi de patients souffrant de schi-
zophrénie a été initié pour répondre à
une demande des pouvoirs publics amé-
ricains concernant, d’une part, l’effecti-
vité (effectiveness), c’est-à-dire l’effi-
cacité d’une thérapie en conditions
naturalistiques, et d’autre part l’effi-
cience (efficiency), c’est-à-dire la
meilleure efficacité clinique au meilleur
coût, des neuroleptiques atypiques
dans des conditions de pratique cou-
rante.La deuxième est également une
étude observationnelle, comparant trois
neuroleptiques atypiques prescrits lors
d’un premier épisode psychotique, en
termes d’effectivité (effectiveness) et
de tolérance ; elle est appelée étude
CAFE, pour Comparison of Atypicals in
First Episode Psychosis.
L’étude CATIE et ses résultats
C’est une étude en double aveugle ayant
un suivi de plus de 18 mois, avec inclu-
sion de 1 493 patients souffrant de schi-
zophrénie, dont 1 432 dossiers analysés.
Les traitements, attribués par randomi-
sation, reposaient sur l’olanzapine à la
dose moyenne de 20,1 mg (7,5-
30 mg/j), la quétiapine à la dose
moyenne de 543,4 mg (200-800 mg/j),
la rispéridone à la dose moyenne de
3,9 mg (1,5-6 mg/j), la ziprasidone à la
dose moyenne de 118,8 mg (40-
160 mg/j) ou la perphénazine, neuro-
leptique typique, à la dose moyenne de
20,8 mg (8-30 mg/j).
Schématiquement, en fonction des résul-
tats obtenus au cours de l’analyse en
intention de traiter, les auteurs indi-
quent que, dans ce suivi observationnel :
– les neuroleptiques atypiques étudiés
ne sont pas plus “effectifs” que le seul
neuroleptique typique prescrit, ce qui
représente un biais d’interprétation non
négligeable ;
– globalement, les molécules neurolep-
tiques prescrites dans les conditions de
cette étude se révèlent efficaces sur la
symptomatologie schizophrénique ;
– près de 74 % des patients (n = 1 061)
ayant participé à ce suivi ont cessé de
prendre l’un ou l’autre des traitements
prescrits après 18 mois, en raison de
leurs effets secondaires délétères ou de
leur inefficacité ;
– la durée au terme de laquelle le trai-
tement était arrêté, soit par manque
d’efficacité, soit par décision du
patient, était plutôt favorable à l’olan-
zapine, comparativement aux autres
traitements. En revanche, en ce qui
concerne ces neuroleptiques atypiques,
les auteurs ont mis en évidence d’autres
effets indésirables aussi délétères que
peuvent l’être les effets neurologiques.
Il était notamment observé davantage
de syndromes métaboliques avec l’olan-
zapine et davantage de syndromes
extrapyramidaux avec la perphénazine
qu’avec les neuroleptiques atypiques.
Enfin, dans un contexte de système
de santé anglo-saxon, cette étude
confirme que le coût lié aux traite-
ments est, d’une part, élevé pour
les neuroleptiques atypiques et,
d’autre part, relativement différent
entre molécules. Ainsi, à dose équiva-
lente, le coût mensuel de chaque pro-
duit a été estimé à 60 $ pour la per-
phénazine, à 250 $ pour la rispéridone,
à 290 $ pour la ziprasidone, à 450 $
pour la quétiapine et à 520 $ pour
l’olanzapine. Ce suivi naturalistique
doit encore fournir de nombreuses don-
nées en ce qui concerne la prise en
charge des patients schizophrènes,
celles-ci pouvant permettre, si elles
sont prises en compte, d’améliorer la
qualité des soins, dans un contexte ou
les quatre neuroleptiques atypiques
prescrits dans cette étude représentent
un chiffre d’affaires de 10 millions de
dollars par an au total et, toutes molé-
cules confondues, 90 % de ce marché
aux États-Unis.
>
Lieberman JA, Stroup TS, McEvoy JP et al. Effective-
ness of Antipsychotic Drugs in Patients with Chronic
Schizophrenia (CATIE). N Engl J Med 2005;353:1209-23.

27
La Lettre du Psychiatre - Suppl. Les Actualités au vol. II - n° 3 - juin 2006
L’étude CAFE et ses résultats
L’objectif de cette étude mise en place
par Astra-Zeneca a été d’évaluer, lors
d’un suivi naturalistique d’un an, d’une
part l’effectivité de la quétiapine, de
l’olanzapine et de la rispéridone chez
des patients âgés de 16 à 40 ans pré-
sentant un premier épisode psychotique
et, d’autre part, la ou les causes d’arrêt
du traitement.
Pour cette étude, 26 centres aux États-
Unis et au Canada ont inclus au total
400 patients. Au cours de ce suivi d’un
an, les patients ont été évalués au
moyen des échelles PANSS (The Positive
and Negative Syndrome Scale) et Cal-
gary Depression, par le questionnaire
CGI et par deux batteries de tests
mesurant les fonctions cognitives. Les
différents types d’effet secondaire pou-
vant survenir étaient également
recueillis.
Les résultats obtenus montrent que, en
ce qui concerne l’aspect clinique, il
n’existe pas de différence significative
entre les traitements. De la même
manière, aucune différence n’est notée
lors de l’évaluation des différentes
fonctions cognitives appréhendées (à
l’inclusion, à 3 mois et à 1 an),
excepté, peut-être, selon les investiga-
teurs, chez les patients traités par ris-
péridone et chez ceux traités par qué-
tiapine, chez qui la mémoire de travail
et la fluence verbale, respectivement,
semblent meilleurs.
À un an, le pourcentage d’arrêts de trai-
tement, quelle qu’en soit la cause, est
similaire entre les traitements (70,9 %
pour la quétiapine, 68,4 % pour l’olan-
zapine et 71,4 % pour la rispéridone).
En ce qui concerne la tolérance, le pour-
centage d’effets secondaires semble
identique, quel que soit le traitement.
Une prise de poids est constatée chez
pratiquement tous les patients. Toute-
fois, elle apparaît significativement
plus importante chez ceux traités par
olanzapine. Près de 80 % des patients
traités par olanzapine présentaient, en
effet, une prise de poids supérieure ou
égale à 7 % depuis leur inclusion,
contre 57,6 % de ceux traités par rispé-
ridone et 50 % de ceux recevant de la
quétiapine.
En résumé, R. Keefe, présentant les
résultats de cette étude, concluait que,
dans ces conditions, les trois produits
prescrits – olanzapine (dose moyenne
de 11,7 mg), rispéridone (2,4 mg) et
quétiapine (506 mg) – étaient aussi
“effectifs“ dans la prise en charge des
patients présentant un premier épisode,
tant sur le plan de l’efficacité que de la
tolérance, et notamment en ce qui
concerne la préservation des fonctions
cognitives.
Il conclut également à l’intérêt d’avoir
une variété de molécules aussi efficaces
les unes que les autres, afin de
répondre aux besoins “individuels” des
patients, ce qui renforce l’idée d’une
optimisation du traitement.
>
Keefe R. Comparison of atypicals in first-episode
psychosis (CAFE): a randomized, 52-week comparison
of olanzapine, quetiapine and risperidone. Breaking
news session at the 18th ECNP congress, The Nether-
lands, 2005 (october,25).
Les chaussures à talons
dans la schizophrénie
Il y a plus de 1 000 ans que les hommes
ont commencé à porter des chaussures
à talons ; fait du hasard ou non, c’est
également à cette période que les pre-
miers cas de schizophrénie ont été rap-
portés.
Étrangement, l’industrialisation de la
production de chaussures, des États-
Unis à l’Angleterre, à l’Allemagne et au
reste de l’Europe de l’Ouest, a laissé
dans son sillage une importante aug-
mentation du nombre de sujets souf-
frant de schizophrénie.
Des taux élevés de schizophrénie ont
été observés dans la première généra-
tion de migrants venant des régions
chaudes vers des régions à climat froid,
où l’utilisation des chaussures devenait
plus fréquente. Un nombre encore plus
élevé a été noté dans la seconde géné-
ration issus de ces premiers immigrés,
pour laquelle l’utilisation des chaus-
sures s’était faite dès l’apprentissage de
la marche.
L’hypothèse avancée par J. Flensmark
est que, durant la marche, les stimuli
traités au niveau des mécanorécepteurs
favoriseraient l’augmentation de l’acti-
vité des récepteurs NMDA (N-methyl-D-
aspartate) au niveau des voies méso-
corticales et tubéro-infundibulaires.
Porter des chaussures à talons diminue-
rait donc la stimulation des fonctions
dopaminergiques de ces voies neuro-
nales.
L’activité corticale réduite entraînerait
un dysfonctionnement des systèmes
dopaminergiques, lesquels sont impli-
qués dans diverses structures et sys-
tèmes neuronaux comme les ganglions
de la base, la voie nigro-striée et méso-
limbique, etc., dont on sait qu’ils pré-
sentent un dysfonctionnement chez le
sujet souffrant de schizophrénie.
Au vu de ces résultats, faut-il induire
une stimulation par électrodes au niveau
des différentes voies incriminées pour
rétablir une fonction dopaminergique
normale, ou faire marcher les patients
pieds nus ?
>
Flensmark J. Is there an association between the use
of heeled footwear and schizophrenia? Medical Hypo-
theses 2004;63(4):740-7.
Qualité de vie
et schizophrénie :
le point de vue du patient
À l’heure actuelle, le point de vue du
patient est de plus en plus important
pour l’évaluation de la qualité de vie,

28 La Lettre du Psychiatre - Suppl. Les Actualités au vol. II - n° 3 - juin 2006
>Actualités
thérapeutiques
que ce soit en pathologie mentale
(particulièrement chez le sujet schizo-
phrène) ou en santé publique. Son uti-
lisation est destinée à évaluer non seu-
lement la perception qu’a un sujet de
sa propre vie dans un contexte qui lui
est propre, mais également l’impact
que peuvent avoir ses traitements et sa
maladie. La qualité de vie est donc un
des éléments principaux qui doivent
contribuer à la décision médicale. Tou-
tefois, il paraît nécessaire de redéfinir
ce qu’est la qualité de vie chez le sujet
schizophrène et la pertinence des ins-
truments d’évaluation utilisés jusqu’à
présent. C’est dans ce contexte qu’une
nouvelle échelle de qualité de vie, fon-
dée sur le point de vue du patient et
utilisable sous forme d’autoquestion-
naire, a été créée et validée.
Trois étapes majeures ont été réalisées.
La première a consisté à identifier et à
faire interviewer par des psychologues
un panel de 100 patients souffrant de
schizophrénie (DSM-IV), le personnel
soignant (n = 20) et la famille (n = 20).
Dans un deuxième temps, le verbatim
ainsi constitué a servi de base de tra-
vail à un groupe de 25 experts qui a, in
fine, consensuellement proposé une
première version (VF1) constituée de
133 items répartis en 17 domaines. À
partir des données de J0 et d’un suivi
prospectif observationnel, 337 psy-
chiatres ont inclus près de 700 sujets
afin de permettre la validation et la
mise en évidence des propriétés psy-
chométriques de cet instrument. Par
ailleurs, une cohorte indépendante de
100 sujets a été constituée afin d’éva-
luer la fiabilité de l’échelle au travers
de deux évaluations (J0 et J7).
Un total de 686 patients présentant un
diagnostic de schizophrénie (85,1 %)
ou de type schizo-affectif (14,9 %) ont
été inclus. La structure de l’échelle de
qualité de vie (SOL) après une analyse
exploratoire (ACP) a permis d’identifier
74 items répartis en 14 dimensions,
avec une valeur d’alpha de Cronbach
comprise entre 0,75 et 0,95, signifiant
une bonne cohérence interne. La vali-
dité concourante a été établie en cor-
rélation avec l’échelle BPRS et le ques-
tionnaire CGI (aspect clinique),
l’échelle EAPS (aspect social) et une
échelle générique de qualité de vie
RFS. Le coefficient de corrélation est
significatif pour tous les facteurs,
excepté pour deux avec la BPRS et trois
avec la CGI. L’analyse test/retest
indique une bonne fiabilité et une
bonne reproductibilité pour chaque
facteur, avec un coefficient de corréla-
tion pour le plus bas égal à 0,53.
Les auteurs concluent que cette
échelle de qualité de vie, basée sur le
point de vue du patient, est un instru-
ment valide, multidimensionnel, perti-
nent et de bonne acceptabilité per-
mettant d’évaluer les conséquences de
la maladie sur la qualité de vie des
patients souffrant de schizophrénie.
>
Martin P, Caci H, Azorin JM et al. Création et valida-
tion d’un autoquestionnaire mesurant la qualité de vie
de patients souffrant de schizophrénie : l’échelle Schi-
zophrenia Quality of Life (SOL). L’Encéphale
2005;31:559-66.
Comment traiter l’enfant
dépressif ?
Chez l’enfant, un épisode dépressif
majeur doit être considéré comme une
pathologie sérieuse qui peut avoir des
répercussions sur son développement
social, émotionnel et scolaire. Il est
par conséquent important de pouvoir
identifier une médication efficace et
peu génératrice d’effets secondaires
permettant de traiter ce trouble chez
les sujets jeunes.
Seuls certains inhibiteurs de la recap-
ture de la sérotonine (IRS) comme la
fluoxétine, la sertraline et le citalo-
pram ont démontré une efficacité
supérieure à celle du placebo, comme
résumé ci-dessous.
Les résultats de l’étude de Emsy et al.
(1997), portant sur 96 enfants et ado-
lescents âgés de 7 à 17 ans qui présen-
taient une dépression majeure, ont
montré une différence significative au
score de la CDRS-R (échelle de dépres-
sion pour enfants). Le groupe recevant
de la fluoxétine 20 mg avait de
meilleurs résultats au bout de huit
semaines que le groupe placebo. Le
taux de rémission sous fluoxétine était
supérieur à celui observé sous placebo
(31 % versus 23 %).
L’étude Team (2004) montrait également
des résultats meilleurs à la CDRS-R pour
les enfants traités par fluoxétine et sui-
vant une thérapie cognitivo-comporte-
mentale (TCC) que pour les enfants
recevant soit de la fluoxétine seule soit
une TCC seule. Un traitement par
fluoxétine obtenait aussi des scores
supérieurs par rapport à une TCC seule.
Les effets secondaires observés étaient
principalement des troubles gastro-
intestinaux et de l’insomnie.
Concernant les effets de la sertraline,
l’étude de Wagner et al (2003) portait
sur 376 enfants et adolescents âgés de
6 à 17 ans présentant un épisode
dépressif majeur, et comparait l’action
de la sertraline (50 à 200 mg/j) à un
placebo pendant 10 semaines.
Malgré quelques effets secondaires
(vomissements, diarrhée, agitation,
anorexie, etc.), une supériorité de l’ac-
tion de la sertraline était notée au
score de la CRDS-R.
Le citalopram a également fait l’objet
d’une étude montrant ses effets posi-
tifs chez les enfants et les adolescents,
alors que, dans une autre, les effets
observés étaient plutôt négatifs chez
les adolescents.
D’autres études ont, quant à elles, mis
en avant des résultats négatifs avec

29
La Lettre du Psychiatre - Suppl. Les Actualités au vol. II - n° 3 - juin 2006
d’autres molécules, comme la paroxé-
tine (Keller et al., 2001), la venlafaxine
(Emsy et al., 2004), l’escitalopram
(Wagner et al., 2004), la néfazodone
(Rynn et al., 2002 ; FDA, 2004), la mir-
tazapine (FDA, 2004), le bupropion et
les antidépresseurs imipraminiques (Kye
et al., 1996 ; Geller et al., 1990).
En revanche, il existe peu d’informa-
tions sur la durée maximale du traite-
ment. D.S. Pine, dans une étude longi-
tudinale réalisée en 2002, montrait
l’efficacité de l’antidépresseur chez l’en-
fant quand il était pris pendant un an,
avec éventuellement mise en place
d’une médication libre en période de
stress.
Les études sur les traitements à long
terme sont donc nécessaires pour déter-
miner la durée de traitement optimale
et évaluer les effets à long terme des
antidépresseurs chez les enfants.
>
Dineen Wagner K. Pharmacotherapy for major
depression in children and adolescents. Progr Neuro-
psychopharmacol 2005;29:819-26.
La dépression tardive :
un facteur prédictif
de la maladie
d’Alzheimer ?
Cette étude s’est proposé de comparer
deux groupes de sujets âgés qui pré-
sentaient un antécédent de dépression :
23 sujets qui avaient développé une
“dépression tardive” (LOD) versus 22
qui avaient eu une “dépression pré-
coce” (EOD).
Sept ans après le premier suivi des
sujets, le nombre de maladies d’Alzhei-
mer (MA) diagnostiquées était plus
élevé pour le groupe LOD que pour le
groupe EOD, avec un risque deux fois
plus élevé pour les sujets LOD.
Nous savons que le diagnostic précoce
de la MA est très important pour le trai-
tement des déficits cognitifs sous-
jacents. Bien qu’il n’apporte pas de
réelle guérison, il contribue au main-
tien des acquis pendant un temps. Ce
temps sera plus ou moins long en fonc-
tion de la précocité de ce diagnostic.
Si le risque de développer la MA est
plus élevé chez les sujets ayant souffert
de dépression tardive, ces derniers
pourraient faire l’objet de “cibles” pour
des programmes de détection de cette
pathologie.
>
Van Reekum R, Binns M, Clarke D et al. Late life
depression increases risk for Alzheimer’s disease. Int
J Geriatric Psychiatry 2005;20:80-2.
Comment prendre du poids
en un rien de temps ?
Si les neuroleptiques atypiques, en
ce qui concerne les effets secondaires
neurologiques, sont généralement
mieux tolérés par les patients que
les neuroleptiques typiques, ils
entraînent en revanche d’autres effets
délétères, comme une perturbation
du système métabolique, qui se tra-
duit, notamment, par une prise
de poids importante. Ces effets iatro-
gènes pourraient même être considé-
rés comme plus graves, de par leur
retentissement en termes de santé
publique.
En effet, cette prise de poids impor-
tante entraîne des répercussions phy-
siques, en favorisant l’augmentation du
risque cardiovasculaire par exemple,
avec parfois présence d’hypertension,
de troubles cardiaques, d’hyperlipidé-
mie ; mais elle a aussi un impact sur
l’estime de soi, le fonctionnement
social et la réalisation d’une activité
physique.
Cette étude a voulu comparer les effets
de l’olanzapine et de la rispéridone sur
les troubles des conduites alimentaires
chez des sujets sains. Quarante-huit
sujets ont donc reçu, pendant deux
semaines, de l’olanzapine, de la rispéri-
done ou un placebo.
L’augmentation des doses de traitement
était progressive, et l’on atteignait, au
bout de six jours et jusqu’à la fin de
l’essai, une dose de 10 mg/j pour
l’olanzapine versus 4 mg/j pour la ris-
péridone. Dès le sixième jour et jusqu’à
la fin de l’étude, les résultats objecti-
vaient une hausse significative du poids
des sujets traités par olanzapine par
rapport au groupe placebo.
Au final, il était également observé une
prise de poids significativement plus
importante pour le groupe olanzapine
(deux fois plus) que pour le groupe ris-
péridone. De plus, les sujets traités par
olanzapine avaient davantage d’appétit
au petit déjeuner et consommaient
davantage de calories au dîner que les
deux autres groupes.
En plus des effets indésirables qu’elles
génèrent, l’olanzapine et la rispéridone
entraînent toutes deux une prise de
poids rapide chez les sujets traités.
Elles peuvent majorer l’appétit et, de ce
fait, la consommation calorique. Toute-
fois, il est dommage que les auteurs
n’aient pas recherché les antécédents
familiaux pour tenter de mettre en évi-
dence une prédisposition éventuelle à
cette prise de poids.
>
Roerig JL, Mitchell JE, De Zwaan M et al. A compari-
son of the effects of olanzapine and risperidone versus
placebo on eating behaviors. J Clin Psychopharmacol
2005;25:5.
Différentes échelles
pour détecter la dépression
dans la maladie d’ Alzheimer
La dépression est une condition fré-
quente chez le sujet souffrant de MA, et
elle n’est pas toujours facile à diagnos-
tiquer. En effet, les symptômes observés
dépendent-ils de la pathologie démen-
tielle ou d’une dépression isolée ?
 6
6
1
/
6
100%