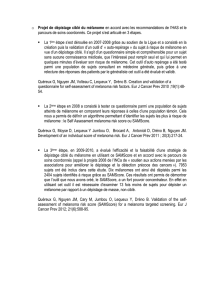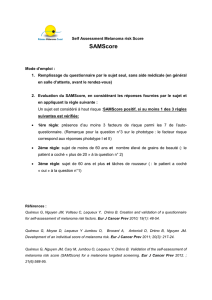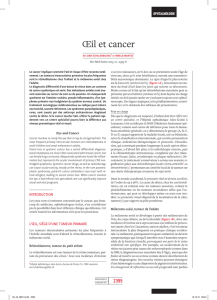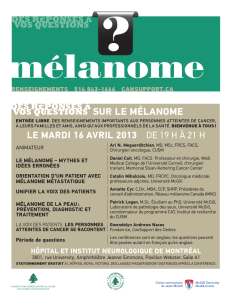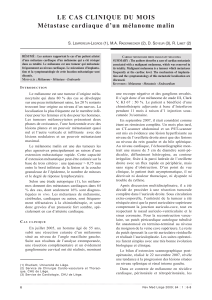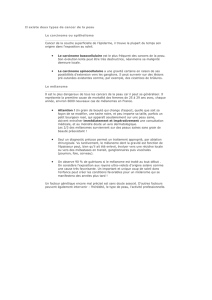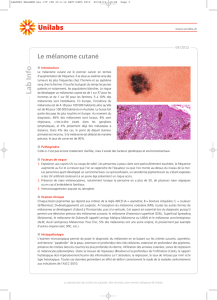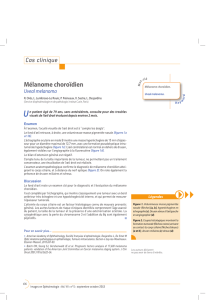MISE AU POINT
20
La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 1 - janvier-février 2006
L
e mélanome de l’uvée est la tumeur intraoculaire pri-
mitive de l’adulte la plus fréquente. Elle est issue
embryologiquement de cellules dérivant de la crête
neurale antérieure. Elle se caractérise par un risque élevé d’évo-
lution métastatique, faisant toute la gravité de cette lésion. Nous
avons tenté ici de faire le point sur la prise en charge théra-
peutique et sur les connaissances biologiques acquises ces der-
nières années.
ÉPIDÉMIOLOGIE
Bien que ce soit la tumeur oculaire la plus fréquente chez
l’adulte (80 % des tumeurs diagnostiquées), il s’agit d’une
pathologie rare (1). L’incidence en France en est de 500 à
600 nouveaux cas par an. Dans une étude rétrospective multi-
centrique française, J.L. Vidal et al. (2) ont recensé 412 cas de
mélanome de la choroïde en 1992. Il s’agit d’une étude fondée
sur le recueil de données issues d’un questionnaire rempli par
les ophtalmologistes de ville et confirmées par les centres de
traitement spécialisés. Les données épidémiologiques aux
États-Unis retrouvent une incidence comparable, soit 0,7 pour
100 000 habitants (3). La localisation au niveau de l’uvée peut
varier (iris, corps ciliaires, choroïde), mais se situe le plus fré-
quemment au pôle postérieur. L’âge médian de survenue est
de 55 ans. Cette tumeur est rare avant l’âge de 20 ans, et son
incidence augmente avec l’âge. Elle survient principalement
chez les sujets de race blanche, et se raréfie chez les sujets de
race noire. Le sex-ratio est de 1,03 (légère prédominance mas-
culine selon les études) (4).
La mortalité à 5 ans est d’environ 50 %. La cause de mortalité
principale est la survenue de métastases hépatiques (80 % des
cas de métastases), entraînant le décès en 6 mois en l’absence
de traitement (5).
PHYSIOPATHOLOGIE
Le mélanome de la choroïde dérive des mélanocytes uvéaux issus
des cellules de la crête neurale antérieure. À l’origine, il s’agit
du même type cellulaire que le mélanome cutané. Pourtant, ces
deux types de mélanome sont différents, aussi bien dans leur pro-
fil évolutif que dans les anomalies génétiques identifiées.
Les facteurs étiologiques restent mal connus. L’âge n’est pas
un facteur de pronostic unanimement reconnu.
Les données de la littérature concernant l’exposition solaire
sont contradictoires (6), avec tantôt une association signifi-
cative, tantôt une absence de relation. Le phototype semble
jouer un rôle : couleur de l’iris (7), couleur de la peau et cou-
leur des cheveux. D’autres études ont tenté d’établir une rela-
tion entre l’activité professionnelle et la survenue d’un méla-
nome uvéal, sans association significative. Par ailleurs,
l’analyse des patients porteurs de xeroderma pigmentosum (6)
ou d’albinisme ne montre pas d’augmentation significative
du nombre de mélanomes uvéaux, alors qu’il existe une sus-
ceptibilité accrue aux lésions liées aux U.V. Une étude
récente menée par J.M. Harbour (8) a montré une associa-
tion significative entre la pigmentation de la choroïde et la
survenue d’un mélanome chez les patients de race blanche
et à l’iris clair. Les patients porteurs de mélanome et avec
iris clair ont une pigmentation de la choroïde significative-
ment plus foncée. La pigmentation foncée de la choroïde est
associée à une augmentation significative de la densité de
mélanocytes d’un point de vue histologique et pourrait par-
ticiper à la cancérogenèse de la choroïde.
Il ne semble pas s’agir d’une maladie héréditaire ; pourtant, des
cas familiaux ont été rapportés, ainsi que l’association dans une
même famille à des mélanomes cutanés. Des études génétiques
sont en cours (9). C’est pourquoi les patients porteurs d’un
mélanome uvéal avec un antécédent personnel ou familial de
mélanomes cutanés doivent être adressés en consultation
d’oncogénétique.
Un nombre certain de mélanomes se développent à partir de
nævi, en particulier le nævus d’Ota. Il s’agit d’une tumeur pig-
mentée bénigne de la choroïde très fréquente. Des cas asso-
ciés à la neurofibromatose de type I ont également été rap-
portés.
DIAGNOSTIC
Diagnostic positif
Le plus souvent, le patient consulte l’ophtalmologiste pour des
symptômes visuels : phosphènes intermittents quand la tumeur
refoule la rétine, myodésopsies en cas d’hémorragie du vitré,
Le mélanome de la choroïde : revue de la littérature
Biology and therapeutic advances for uveal melanoma
●
L. Bengrine-Lefevre*, L. Desjardins**, S. Piperno-Neumann*
* Service d’oncologie médicale, Institut Curie, Paris.
** Service d’ophtalmologie, Institut Curie, Paris.

21
La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 1 - janvier-février 2006
de baisse d’acuité visuelle lorsque la tumeur est située au pôle
postérieur de l’œil ou d’amputation du champ visuel quand la
tumeur est volumineuse et entraîne un décollement de rétine.
Il peut également s’agir de douleurs orbitaires, souvent en rap-
port avec le développement d’un glaucome. Parfois, la décou-
verte est fortuite à l’occasion d’un examen ophtalmologique
systématique.
Au fond d’œil, l’examen clinique retrouve le plus souvent une
lésion pigmentée (le mélanome est rarement achromique). En
échographie, il se présente souvent sous une forme de “cham-
pignon” caractéristique lorsque la tumeur se développe au tra-
vers d’une rupture de la membrane de Bruch séparant la cho-
roïde de la rétine. On note en surface un dépôt de pigment
orange. Parfois, le mélanome s’accompagne d’un décollement
rétinien séreux, compromettant le pronostic visuel. Une forme
particulière est celle du mélanome diffus, à développement
plan ; le patient présente une inflammation de l’iris, pouvant
entraîner un retard au diagnostic (10).
Les examens complémentaires confirment le diagnostic clinique
et mesurent la tumeur. L’échographie de type A ou B (11)
permet d’en mesurer la taille et l’épaisseur, et localise préci-
sément la tumeur. Le mélanome a une échogénicité élevée en
surface, avec décroissance rapide typique de cette tumeur. En
échographie B, on note souvent une excavation choroïdienne.
L’angiographie en fluorescence visualise les vaisseaux intra-
tumoraux sur les clichés précoces pour les tumeurs achro-
miques. Pour les tumeurs fortement pigmentées, on observe un
effet masque au temps précoce, suivi d’une imprégnation pro-
gressive inhomogène de la rétine correspondant à de petits
décollements séreux localisés.
L’angiographie au vert d’indocyanine permet le diagnostic dif-
férentiel par rapport à l’hémangiome. Les mélanomes présen-
tent souvent des vaisseaux à structure anarchique, contraire-
ment aux tumeurs bénignes, dont les vaisseaux sont réguliers.
Le scanner et l’IRM (12) sont pratiqués si une extension extra-
sclérale ou un envahissement du nerf optique sont soupçonnés.
L’IRM montre une image hyperintense en T1, hypo-intense en
T2, et prenant le gadolinium.
Diagnostic différentiel
Le mélanome de la choroïde doit être distingué des autres
tumeurs choroïdiennes :
❯bénignes : hémangiomes choroïdiens, ostéomes, lésions pig-
mentées (nævi, mélanocytomes). Plus rarement, il peut s’agir
de sclérites postérieures ou d’hématomes ;
❯surtout des métastases, principalement d’adénocarcinome
(sein, adénocarcinome bronchique) (13).
ANATOMOPATHOLOGIE
L’examen histologique n’est disponible qu’en cas d’énucléa-
tion. Les biopsies à l’aiguille ne sont pratiquées qu’en cas de
doute diagnostique avant traitement conservateur, ce geste pré-
sentant un risque de dissémination tumorale intra-orbitaire. Le
pathologiste précise le type histologique, ainsi que la localisa-
tion, le plus large diamètre et l’épaisseur de la tumeur.
La description des mélanomes de l’uvée fait appel à la classifica-
tion de G.R. Callender (14) développée en 1931 et modifiée par
I.W. Mc Lean, W.D. Foster et L.E. Zimmerman (15). On distingue :
❯les mélanomes fusiformes composés exclusivement de cellules
allongées. Elles peuvent être de type A ou B (principalement dis-
tinguées par la présence ou non d’un nucléole). Ces tumeurs sont
associées à un faible pourcentage de décès par métastases ;
❯les mélanomes mixtes, composés à la fois de cellules fusi-
formes et de cellules épithélioïdes. Les cellules épithéliales sont
caractérisées par leur manque d’adhésion. Elles ont également
un noyau plus large et plus rond que les cellules fusiformes. Ce
groupe est associé à un pronostic intermédiaire ;
❯les mélanomes de type épithélioïde exclusivement, consti-
tuant le groupe de pronostic le plus péjoratif ;
Le pathologiste recherche également la présence d’un enva-
hissement extrascléral et du nerf optique, facteur de risque de
récidive, et précise la vascularisation tumorale.
Le diagnostic différentiel par rapport à une métastase de car-
cinome peut être difficile. L’utilisation de la protéine S100 en
immunohistochimie aide à l’établir.
PRONOSTIC
La taille de la tumeur, en particulier le plus large diamètre basal (16)
et l’épaisseur, est corrélée au pronostic des patients. On
distingue :
❯les petits mélanomes, dont le diamètre est inférieur à 10 mm
et/ou l’épaisseur inférieure à 3 mm ;
❯les mélanomes intermédiaires, dont le diamètre est compris
entre 11 et 15 mm et/ou l’épaisseur entre 3 et 8 mm ;
❯les mélanomes de grande taille, dont le diamètre basal est
supérieur à 16 mm et/ou l’épaisseur est supérieure à 10 mm
(groupe de mauvais pronostic).
L’extension aux corps ciliaires (16) a été associée au risque
métastatique. Enfin, l’extension extrasclérale de la tumeur de
même que l’atteinte du nerf optique sont des facteurs de mau-
vais pronostic. L’extension extrasclérale prédispose à la réci-
dive orbitaire après traitement.
De nombreux travaux de cytogénétique et de biologie molé-
culaire ont permis d’identifier la monosomie du chromosome 3
comme facteur de pronostic péjoratif (17). Nous en reparlerons
plus loin.
Le pronostic du mélanome de la choroïde est lié à son poten-
tiel métastatique. Il diffuse par voie hématogène (absence de
drainage lymphatique au niveau de l’uvée). Toute la gravité est
liée au foie, site principal des métastases. Plus rarement, des
métastases pulmonaires, osseuses, ganglionnaires, cutanées ou
cérébrales peuvent se développer, mais elles surviennent le plus
souvent après le diagnostic de métastases hépatiques. Le seul
traitement actuellement efficace est la chirurgie des métastases
hépatiques lorsqu’elle est carcinologique.
Les mélanomes des corps ciliaires sont considérés comme étant
de moins bon pronostic, car ils sont rarement révélés par des
troubles visuels précoces. Les mélanomes de l’iris sont, eux,
de meilleur pronostic, car leur diagnostic est plus précoce.

MISE AU POINT
22
La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 1 - janvier-février 2006
STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE
Traitement de la tumeur primitive
●Méthodes
Traitement chirurgical
L’énucléation est longtemps restée la seule option thérapeu-
tique. Des progrès ont été faits concernant la technique chirur-
gicale, comme en témoigne la diminution des récidives, avec
notamment la chirurgie sans ouverture.
La chirurgie conservatrice a été développée, mais ne fait pas
l’objet d’un consensus (18). Différentes techniques ont été uti-
lisées : endorésection, iridocyclectomie, résection choroïdo-
sclérorétinienne.
Radiothérapie externe
Elle est nécessaire en cas d’extension extrasclérale de la tumeur
et permet de limiter les récidives locales.
Aucun bénéfice en termes de survie n’est apporté par la radio-
thérapie préénucléation (19).
De nouvelles techniques de radiochirurgie sont en cours de
développement, mais leur utilisation n’est pas recommandée
en dehors d’essais thérapeutiques.
Curiethérapie
La pose et la dépose du matériel de curiethérapie est réalisée
par un ophtalmologiste, sous anesthésie locale ou générale. Dif-
férents matériaux peuvent être utilisés : l’iode 125 (aux États-
Unis), le ruthénium 106 très utilisé en Europe, le cobalt 60, le
palladium 103 et l’iridium 192. Le cobalt et l’iridium émettent
un rayonnement gamma de haute énergie irradiant les tissus
oculaires adjacents, ainsi que l’entourage familial du patient.
L’iode et le palladium émettent un rayonnement gamma plus
faible, entraînant moins de lésions sur les structures adjacentes.
Le ruthénium émet des rayons bêta permettant d’augmenter
l’intensité de rayonnement sur la tumeur, mais malheureuse-
ment également sur la sclère. Ce traitement peut être adminis-
tré en hospitalisation ou en ambulatoire, avec des mesures de
protection pour l’entourage familial.
L’insuffisance du contrôle local et l’atteinte des tissus sains
constituent les limites de cette technique ; le taux de contrôle
local à 5 ans varie de 82 à 93 % selon les équipes (20).
Le risque principal est celui des complications locales : réti-
nopathie radique, atrophie optique, œdème maculaire, cata-
racte, hémorragie du vitré, glaucome, occlusion de la veine cen-
trale de la rétine et nécrose sclérale. Ces complications peuvent
conduire à l’énucléation dans 6 à 20 % des cas.
Cinq pour cent des patients vont développer un strabisme lié
au déplacement des muscles oculomoteurs lors du positionne-
ment des plaques.
Des études comparatives ont montré un meilleur contrôle local
avec l’iode 125 (20).
Protonthérapie
La protonthérapie permet d’irradier précisément la tumeur avec
peu d’impact sur les tissus adjacents. Cette technique récente
utilise un accélérateur de particules (uniquement deux sites en
France : Orsay et Nice) et permet de délivrer le rayonnement
après repérage de la tumeur par des anneaux de tantale placés
chirurgicalement. La localisation périmaculaire ou péripapil-
laire semble être à plus haut risque de récidive (21) avec cette
technique. La récidive locale est associée à un fort risque de
métastases, et par conséquent de décès (22). Le taux d’énu-
cléation secondaire est de 6 %. Un index mitotique élevé après
radiothérapie est corrélé à un risque de récidive élevé. D’après
les recherches du groupe d’étude des mélanomes oculaires
(COMS) fondées sur l’analyse des pièces d’énucléation après
radiothérapie, l’index mitotique est abaissé, mais pas nul (23).
Laser diode ou thermothérapie transpupillaire
Il s’agit ici de délivrer un faisceau d’énergie à travers la
pupille dilatée du patient, ce qui permet d’induire une nécrose
tumorale. L’avantage théorique de cette technique est la pré-
cision de délivrance de l’énergie, sans atteinte des tissus adja-
cents. Elle ne nécessite pas d’anesthésie générale. Après avoir
suscité beaucoup d’enthousiasme, l’utilisation de cette tech-
nique a été fortement ralentie en raison de publications mon-
trant des pourcentages élevés de récidive locale. Une des
explications en est la persistance de vaisseaux non occlus par
la technique (24). Les récidives ont été observées principale-
ment chez les patients porteurs de tumeurs présentant une
épaisseur supérieure à 3 mm, de tumeurs achromiques, qui
n’absorbent pas l’énergie, ou des tumeurs localisées près du
nerf optique.
L’absence de réponse après trois séances serait également un
facteur de récidive locale (25) ; la présence de symptômes
visuels, une acuité visuelle faible avant le traitement et une
tumeur proche de la papille optique sont des critères de mau-
vais pronostic visuel. Les conséquences visuelles après traite-
ment apparaissent dans les 8 mois.
●Indications thérapeutiques
Les mélanomes de grande taille (diamètre supérieur à 16 mm
et/ou épaisseur supérieure à 10 mm) doivent être traités par
énucléation, en dehors de cas particuliers (refus du patient, pro-
nostic visuel).
Le traitement des mélanomes de la choroïde de taille intermé-
diaire ne fait pas l’objet d’un consensus. L’option non chirur-
gicale peut être envisagée, après évaluation précise du déve-
loppement et de la localisation : pôle postérieur, proximité par
rapport au nerf optique ou la papille, atteinte des corps ciliaires.
L’énucléation a été comparée à la curiethérapie par iode 125
pour les mélanomes de taille intermédiaire chez 1 317 patients
inclus, 660 dans le bras énucléation et 657 dans le bras curie-
thérapie : le taux de survie à 5 ans est comparable dans les deux
groupes, d’environ 80 % (26).
Le traitement des mélanomes de petite taille se discute en rai-
son du développement des techniques non chirurgicales. Si la
tumeur a d’évidence une vitesse de croissance élevée, une
extension d’emblée extrasclérale, ou si elle s’associe à un glau-
come néovasculaire ou à un décollement complet de la rétine,
l’énucléation reste la seule approche thérapeutique envisa-
geable.

23
La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 1 - janvier-février 2006
La protonthérapie est efficace en cas de tumeur postérieure, à
cheval sur l’équateur, ou antérieure de plus de 5 mm. Les petites
tumeurs antérieures sont plus accessibles à un traitement par
disque d’iode.
La chirurgie conservatrice est peu développée, pour plusieurs
raisons : l’impossibilité d’assurer des marges chirurgicales
saines, le risque de dissémination tumorale dans la cavité
vitréenne, le risque de rétinopathie secondaire, le manque de
suivi efficace après une telle chirurgie (27), et surtout l’exis-
tence de techniques non chirurgicales efficaces.
Le pronostic visuel doit être soigneusement évalué. La pro-
tonthérapie permet de conserver la vision sur l’œil traité (1/10).
Le traitement des tumeurs à localisation antérieure peut entraî-
ner une cataracte secondaire, accessible à un traitement chi-
rurgical.
Après traitement conservateur, l’ophtalmologiste peut être
amené à réaliser une énucléation secondaire. Les causes peu-
vent en être une complication du traitement conservateur (glau-
come néovasculaire par exemple) ou un échec (progression
tumorale malgré traitement).
La radiothérapie externe est utilisée lors d’une atteinte extra-
sclérale en complément d’une énucléation.
La thermothérapie est le plus souvent réservée à des tumeurs
de petite taille et de faible épaisseur. La pupille doit pouvoir
être dilatée suffisamment pour permettre une bonne visibilité.
Elle doit être réalisée par des équipes entraînées et des études
de suivi à long terme sont nécessaires.
●Surveillance
Après traitement d’un mélanome uvéal, la surveillance recom-
mandée est un examen ophtalmologique tous les 6 mois avec
fond d’œil et échographie, ainsi qu’une échographie hépatique
tous les 6 mois.
Après traitement conservateur, il est conseillé de réaliser un
examen ophtalmologique tous les 3 mois pendant 2 ans, avec
échographie de l’œil tous les 6 mois.
Une surveillance biologique hépatique pourrait aider au dia-
gnostic plus précoce des métastases hépatiques, mais cette
hypothèse ne fait pas encore l’objet d’un consensus.
●Traitement médical
Aucun traitement médical adjuvant n’a fait la preuve de son
efficacité. Les essais spécifiques du mélanome de la choroïde
sont peu nombreux en raison du faible nombre de patients. Les
patients sont le plus souvent inclus dans les essais s’intéressant
aux mélanomes cutanés. L’essai randomisé comparant l’utili-
sation du déticène adjuvant contre surveillance n’a pas montré
de bénéfice de l’utilisation de la chimiothérapie.
Traitement des métastases
●Méthodes
Les données de la littérature concernant le taux de survenue de
métastases sont variables. Celui-ci se situe entre 20 et 60 % à
5 ans selon la taille et le type histologique du mélanome uvéal (3).
Le délai d’apparition peut atteindre 15 ans après le diagnostic.
La médiane de survie des patients métastatiques est de 6 à
9 mois en l’absence de traitement. La localisation la plus fré-
quente est le foie : 70 à 95 % des patients métastatiques pré-
sentent des localisations hépatiques. Des métastases osseuses,
pulmonaires, cérébrales ou ganglionnaires, en général asso-
ciées à des localisations hépatiques, sont décrites plus rarement.
Quelques études ont recherché des facteurs de prédiction
d’apparition des métastases. Dans une étude rétrospective (28)
menée chez 307 patients, 50 % des patients porteurs de méta-
stases (versus 5 % des patients non métastatiques) avaient au
moins une anomalie du bilan biologique hépatique. Par ailleurs,
une augmentation des taux du LDH, de PAL, de gamma GT,
d’ASAT et d’ALAT était constatée dans les 6 mois précédant
le diagnostic de métastases hépatiques.
Chirurgie
La chirurgie des métastases hépatiques est réservée aux loca-
lisations uniques ou multiples siégeant dans un seul lobe hépa-
tique. Il existe une discordance fréquente entre le diagnostic
radiologique préopératoire et le diagnostic peropératoire : les
lésions sont souvent plus nombreuses que ne le laissait supposer
l’imagerie. L’existence d’une miliaire hépatique, en particu-
lier, n’est diagnostiquée qu’en peropératoire. Les différentes
études rétrospectives ont montré que moins de 10 % des patients
pouvaient bénéficier d’une chirurgie carcinologique (29), per-
mettant d’obtenir une survie plus longue. Dans l’étude de
R.J. Salmon et al. (30), les patients ayant bénéficié d’une chi-
rurgie carcinologique avaient une médiane de survie de
22 mois, versus 9 mois pour les patients dont l’exérèse n’était
pas complète.
La tomographie par émission de positrons pourrait aider à pré-
ciser le diagnostic préopératoire et l’opérabilité des métastases
hépatiques.
Les métastases hépatiques peuvent être accessibles à un traite-
ment par radiofréquence (31) par voie transcutanée ou chirur-
gicale. Celle-ci permet de traiter des nodules hépatiques
lorsqu’ils sont peu nombreux et de taille inférieure à 3 cm (taux
d’échec élevé au-delà de 4 cm).
Radiothérapie
Elle peut être utilisée dans une optique antalgique ou décom-
pressive dans le cas de métastases osseuses douloureuses ou
menaçantes. Elle a parfois été proposée à des patients présen-
tant une volumineuse hépatomégalie métastatique compressive
et douloureuse, permettant une amélioration partielle et transi-
toire des symptômes.
Chimiothérapie
Le mélanome uvéal est peu chimiosensible.
La chimiothérapie systémique utilise le déticène, la carmustine,
la fotémustine ou le cisplatine avec des taux de réponse objec-
tive inférieurs à 10 % et une médiane de survie de 6 mois (3).
La chimio-embolisation intra-artérielle hépatique a également
été développée. Il s’agit de l’administration directement au
contact de la tumeur d’un agent cytotoxique (cisplatine) asso-
cié à des agents d’embolisation permettant de séquestrer le cyto-
toxique localement. Les avantages théoriques de cette technique

MISE AU POINT
24
La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 1 - janvier-février 2006
sont de réduire les complications systémiques, de créer une
hypoxie locale permettant la nécrose tumorale et d’augmenter
la concentration locale en agent cytotoxique d’un facteur 10 à
15, ainsi que son temps de contact au niveau de la tumeur. Les
taux de réponse varient selon les études : jusqu’à 46 % de
réponses avec une médiane de survie de 6 à 11 mois (5).
Enfin, la chimiothérapie intra-artérielle par fotémustine a donné
des résultats encourageants. S. Leyvraz et al. (32) ont publié
les résultats préliminaires d’un essai de phase II chez
31 patients. Le taux de réponse objective est de 40 %, avec une
médiane de survie globale de 14 mois. Le schéma d’adminis-
tration est de 100 mg/m
2
pendant 4 heures toutes les semaines
pendant 4 semaines, suivi d’une période de repos de
5 semaines, puis d’une reprise toutes les 3 semaines. La com-
plication principale est la myélosuppression, notamment une
thrombopénie ou une neutropénie. La pose du cathéter intra-
artériel est réalisée par voie chirurgicale ou sous contrôle radio-
logique. Ce type de traitement peut se compliquer d’une throm-
bose du cathéter ou de douleurs au moment de l’injection. Des
cas rares de désinsertion du cathéter ont été relevés. Cette tech-
nique doit être réservée aux équipes chirurgicales entraînées.
Un essai randomisé européen de l’EORTC est en cours, com-
parant l’administration de la fotémustine par voie intra-arté-
rielle hépatique et par voie intraveineuse.
Des essais ont également été réalisés avec le témozolomide ou
la thalidomide. Le témozolomide a fait l’objet de nombreuses
publications dans le traitement des métastases cérébrales du
mélanome cutané. Les taux de réponses objectives varient entre
13 et 20 %. L’efficacité du témozolomide a été testée dans le
traitement du mélanome choroïdien métastatique (33). La dose
utilisée était de 75 mg/m
2
pendant 21 jours toutes les
4 semaines. Chez 14 patients, 2 stabilisations ont été observées.
La thalidomide a été testée chez 14 patients en échec (34). Une
stabilité et une réponse mineure ont été observées. Enfin, l’asso-
ciation thalidomide (100 à 400 mg/j selon l’âge) + témozolo-
mide (75 mg/m
2
/j) a permis l’obtention de 32 % réponses objec-
tives chez 38 patients porteurs de mélanomes cutanés avancés
(35, 36). La survie médiane est de 9,5 mois dans cette étude.
Ces associations sont à envisager dans le mélanome uvéal.
Un essai randomisé a testé l’efficacité de l’association IL-2
+ histamine chez 305 patients porteurs de mélanomes de
stade IV, dont quelques patients atteints de mélanome choroï-
dien. Pour le sous-groupe de patients présentant des métastases
hépatiques, la survie dans le groupe traité par IL-2 + histamine
était significativement meilleure (9,4 mois) que dans le groupe
IL-2 seul (5,1 mois). La formation de radicaux libres par les
cellules phagocytaires pourrait jouer un rôle dans la diminu-
tion de la réponse immunitaire contre les cellules tumorales.
L’histamine empêche la formation de ces radicaux libres et
pourrait avoir un rôle synergique avec les cytokines telles que
l’interleukine 2 (37).
A. Schmittel et al. (38) ont obtenu 5 % de réponses partielles
avec l’association gencitabine + tréosulfan et une médiane de
survie de 9 mois chez 19 patients ; un essai de phase I chez
33 patients avait montré une réponse partielle et 15 stabilisa-
tions (39).
Chimio-immunothérapie
L’interféron alpha et l’interleukine 2 sont largement utilisés
dans le mélanome cutané avancé, avec des taux de réponses
objectives de l’ordre de 15 %. Quelques patients atteints de
mélanome choroïdien ont participé à ces études. Des essais
associant interféron alpha et polychimiothérapie (déticène, vin-
cristine, bléomycine et lomustine) ont été publiés. Les résul-
tats sont contradictoires. S. Pyrhönen et al. (40), chez
20 patients, obtiennent 15 % de réponses objectives, 55 % de
stabilisation et une survie globale de 12 mois. T. Kivelä et al.
(41) n’ont pas confirmé ces résultats : aucune réponse objec-
tive chez 24 patients, 8 % de stabilisation et une survie globale
de 10,6 mois.
L’interleukine 2 et l’interféron alpha ont également été utilisés
en association avec la fotémustine (42). L’étude de J.C. Bec-
ker et al. a inclus 86 patients. Les taux de réponses objectives
étaient de 21,7 % dans le bras fotémustine intra-artérielle et de
8 % dans le bras fotémustine intraveineuse. Ces résultats n’ont
pas entraîné de bénéfice en termes de survie : 12,3 mois dans
le bras fotémustine intra-artérielle, 11,6 mois dans le bras foté-
mustine intraveineuse.
Vaccination
Le concept d’immunosurveillance a été développé depuis de
nombreuses années. Celle-ci consiste en la reconnaissance par
les cellules immunitaires du patient des cellules ayant un poten-
tiel néoplasique afin de les détruire. La vaccination antitumo-
rale nécessite la présence d’antigènes tumoraux spécifiques
issus des cellules néoplasiques et leur présentation aux cellules
immunocompétentes via le complexe majeur d’histocompati-
bilité de classe I.
La vaccination est développée chez les patients atteints de
mélanome cutané au stade locorégional dans des essais thé-
rapeutiques. Les protéines ou les peptides antigéniques (43)
spécifiques sont présentés aux lymphocytes T CD8+, dans le
but d’induire une réponse antigénique spécifique, caractéri-
sée par immunomonitoring (tétramères et ELISPOT). Après
l’utilisation d’un seul antigène (44, 45), des essais de vacci-
nation multipeptide (43) ont été développés, avec parfois asso-
ciation d’un adjuvant immunologique. D’autres protocoles
utilisent les cellules dendritiques. Enfin, certaines équipes
développent des stratégies à l’aide de virus recombinants, ou
de plasmides qui pénètrent dans les tissus par stimulation élec-
trique. Des résultats intéressants ont été publiés avec de
longues stabilisations, voire des régressions tumorales dans
les études animales et chez un nombre non négligeable de
patients.
Des essais sont en cours dans le mélanome uvéal au stade méta-
statique. Tyrosinase (46), Melan-A (47) et gp 100 (48) sont des
antigènes de différenciation codés par des gènes exprimés dans
les mélanocytes et les mélanomes. Ils sont utilisés dans les pro-
tocoles de vaccination. Na17 est un antigène spécifique de
tumeur exprimé dans plus de 95 % des mélanomes uvéaux, uti-
lisé en association aux précédents.
Ce type de traitement ne peut être proposé que dans le cadre
d’essais thérapeutiques.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%