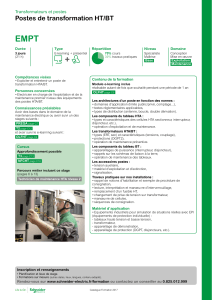Hypertension artérielle après transplantation rénale Hypertension after renal transplantation »

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XI - n° 1 - janvier-février-mars 2011
8
Dossier thématique
Transplantation
rénale
Hypertension artérielle
après transplantation rénale
Hypertension after renal transplantation
G. Mourad*
Résumé
Summary
»»
L’hypertension artérielle (HTA) est présente chez 50 à 90 %
des transplantés rénaux. Comme dans la population générale,
elle augmente le risque de morbi-mortalité cardio-vasculaire et
raccourcit la durée de vie des greffons.
»»
Il est recommandé de fixer comme cibles du traitement des
chiffres de pression artérielle < 130/80 mmHg après l’âge de 18 ans,
et < 90
e
percentile pour le sexe, l’âge et la taille avant 18 ans. Tous
les médicaments antihypertenseurs peuvent être utilisés, en
surveillant attentivement les effets secondaires et les interactions
médicamenteuses, en particulier avec les immunosuppresseurs.
Chez les transplantés protéinuriques (> 1 g/j), il est préférable
de faire appel à un IEC ou un ARA-II comme première ligne du
traitement.
Mots-clés : Hypertension – Transplantation rénale – Sténose artère
greffon (SAG) – Inhibiteurs de la calcineurine (ICN).
The incidence of hypertension (HT) in kidney transplant
recipients (KTR) is up to 90%. As in the general population, HT
increases the risk of cardiovascular events and graft dysfunction.
It is recommended to maintain blood pressure at <130 mmHg
systolic and < 80 mmHg diastolic in KTR >18 years of age,
and < 90th percentile for sex, age and height for adolescents
and children.
Any class of antihypertensive drugs may be used to treat HT, but
it is important to closely monitor side-effects and interactions
with other drugs, particularly immunosuppressants. In
KTR with proteinuria > 1g/day, the use of an angiotensin
converting enzyme inhibitor or an angiotensin II receptor
blocker as first-line therapy is preferable.
Keywords: Hypertension – Transplantation – Transplant
renal artery stenosis – Calcineurin inhibitors (CNI).
*Service de néphrologie-
transplantation,
CHU de Montpellier.
L
’hypertension artérielle (HTA) est la complica-
tion non immunologique la plus fréquente après
transplantation rénale, puisqu’elle est présente
chez 60 à 80 % des receveurs. Cette forte prévalence ne
devrait pas surprendre, et ce pour 3 raisons :
✓
Les transplantés ont généralement un long passé d’HTA,
d’insuffisance rénale chronique (IRC) et/ou de dialyse, patho-
logies dont le rôle athérogène est désormais bien établi.
✓
Ils sont aussi porteurs d’un rein unique, souvent
siège de lésions parenchymateuses, comme nous l’ont
appris les biopsies systématiques.
✓
Enfin, ils sont fréquemment micro- ou macroalbu-
minuriques et insuffisants rénaux, avec des débits de
filtration glomérulaire (DFG) < 60 ml/min/1,73 m2.
Causes de survenue d’HTA
chez le transplanté
Contrairement à l’HTA du non-transplanté, l’HTA du
transplanté est souvent secondaire. Schématiquement,
on l’attribue à une atteinte parenchymateuse ou réno-
vasculaire du greffon, à la sécrétion de substances
vasoconstrictives par les reins natifs, ou à l’effet
vasoconstricteur de certains immunosuppresseurs
(tableau I). Cependant, plusieurs causes peuvent
coexister chez un même patient (par exemple : héré-
dité familiale, rejet chronique et sténose de l’artère du
greffon), compromettant l’efficacité du traitement d’une
cause précise et expliquant la fréquente nécessité d’un
traitement médicamenteux au long cours. La démarche
diagnostique est schématisée dans la figure 1.
Sténose de l’artère du greffon
Il s’agit d’une complication survenant le plus souvent
dans les 6 premiers mois suivant la transplantation et
dont l’incidence varie entre 2 et 12 % (1). La sténose
peut être située au niveau de l’anastomose, en amont
de celle-ci (sur les axes iliaques) ou, plus souvent, en aval
(sur l’artère du greffon). Unique ou multifocale, elle est
essentiellement due à une athéromatose des artères du
donneur ou du receveur, à un traumatisme chirurgical

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XI - n° 1 - janvier-février-mars 2011 9
ou de canulation lors du prélèvement ou de la transplan-
tation, ou à une plicature artérielle (greffon avec artère
longue et veine courte). L’élargissement des indications
de prélèvement et de transplantation à des donneurs
et des receveurs âgés et athéromateux explique que
l’incidence de cette complication reste toujours élevée,
malgré la maîtrise des techniques chirurgicales.
La sténose de l’artère du greffon se manifeste par un
souffle de l’artère du greffon (inconstant), l’apparition ou
l’aggravation d’une HTA ou une altération de la fonction
rénale, en particulier si la sténose est sévère, dépassant
70 % de réduction de diamètre ou si le patient est traité
avec des inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) ou
avec des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine
II (ARA-II). Actuellement, la surveillance systématique
Tableau I. Principales causes d’hypertension chez le transplanté rénal.
Greffon - Sténose de l’artère du greffon
- Néphropathie chronique d’allogreffe
- Récidive de la néphropathie initiale
- Hypertension transmise par le donneur
Reins natifs Sécretion inappropriée de rénine ou d’autres vasoconstricteurs
Médicaments
immunosuppresseurs - Corticoïdes
- Inhibiteurs de la calcineurine (ciclosporine, tacrolimus)
Autres - Obésité (pré ou post-transplantation)
- Prédisposition génétique du receveur
- Hypercalcémie
- Rejet aigu, etc.
Figure 1. Conduite à tenir face à une hypertension chez un transplanté rénal.
Hypertension
Vérifier les concentrations de ciclosporine ou de tacrolimus, diminuer les doses si besoin
• Fonction du greffon (créatininémie, protéinurie)
• Existence d’un souffle / doppler de l’artère du greffon
• Degré de sténose
• IRM/réponse aux IEC
Sténose ≥ 50 %
Réponse aux IEC ⊕
• Souffle ⊕
• Doppler ⊕Sténose artérielle
}• Fonction rénale normale
• Doppler normal
• créatininémie ± protéinurie
• Doppler normal
Néphrotoxicité des inhibiteurs
de la calcineurine
• Réduire la posologie
• Changer d’immunosuppresseur ?
Biopsie du greffon
Lésions chroniques
Échec
ÉchecÉchec
Chirurgie
Surveillance
IEC : inhibiteurs de l’enzyme de conversion ;
IRM : imagerie par résonance magnétique.
Néphrectomie des reins natifs ?
Succès Succès
Artériographie + angioplastie
Récidive de la maladie initiale
• Régime hyposodé
• Règles hygiénodiététiques
• Traitement médical
Sténose ≤ 50 %
Réponse aux IEC
Hypertension artérielle après transplantation rénale

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XI - n° 1 - janvier-février-mars 2011
10
Dossier thématique
Transplantation
rénale
par écho-Doppler permet de détecter la majorité des
sténoses. La précision du Doppler dépend en grande
partie du manipulateur, mais cet examen, non invasif et
de bonne sensibilité, indique facilement la localisation de
la sténose et son retentissement sur la perfusion d’aval.
Dans les cas difficiles (superpositions, plicatures), l’IRM
peut dévoiler une sténose qui a échappé au Doppler.
L’artériographie établit un diagnostic de certitude et
constitue souvent la première étape d’une revascula-
risation par angioplastie. Cette décision sera discutée
en fonction de la balance bénéfice-risque, tout geste
vasculaire comportant un risque de dissection et/ou
de thrombose. Doivent être pris en considération : le
degré de la sténose, ses caractères radiologiques et sa
responsabilité dans l’HTA et/ou la dégradation de la
fonction du greffon. L’administration d’un IEC, aiguë
ou chronique, peut aider à déterminer si une sténose est
hémodynamiquement significative. Dans ce cas, la prise
d’un IEC provoque une baisse franche du DFG (> 20 %). Si
elle est courte et localisée sur l’artère iliaque ou en aval
de l’anastomose artérielle, la sténose est généralement
corrigée par angioplastie avec pose de stent (figure 2).
La chirurgie est très rarement proposée ; ses indications
actuelles sont surtout l’échec de l’angioplastie, ou bien
une situation anatomique particulière comme la plicature
artérielle. Le taux de resténose est plus important après
angioplastie (50 %) qu’après chirurgie (15 %).
Dysfonction chronique de l’allogreffe
Elle provoque quasi constamment une HTA, comme on
l’observe dans les maladies parenchymateuses rénales.
Cette HTA peut précéder ou accompagner les signes
cardinaux de la dysfonction chronique que sont la pro-
téinurie et l’élévation de la créatininémie.
Récidive de la néphropathie initiale
La récidive de la néphropathie initiale sur le greffon
s’accompagne fréquemment d’une HTA. Dans ce cas,
le contrôle optimal de la pression artérielle est diffi-
cile à obtenir, en particulier pour certains syndromes
néphrotiques sévères dans lesquels la détérioration
fonctionnelle est rapide.
Hypertension due aux reins natifs
Ici, l’HTA est généralement attribuée à la persistance
d’une activation du système rénine-angiotensine.
Ce type d’HTA ressemble au modèle de Goldblatt
(“1 clip-2 reins”). Habituellement, l’HTA était déjà pré-
sente en dialyse et persiste après la transplantation.
L’administration d’un IEC est le traitement de choix,
aboutissant à une baisse franche de la pression artérielle
et à une amélioration de la fonction rénale (2). Dans de
rares cas d’HTA difficile à contrôler, la néphrectomie des
reins natifs, éventuellement par voie laparoscopique,
peut être indiquée, avec une bonne efficacité (3).
Médicaments immunosuppresseurs
Ils participent à la genèse de l’HTA du transplanté. Si les
stéroïdes peuvent jouer un rôle dans l’HTA par augmen-
tation de la réactivité vasculaire et du fait d’un certain
degré de rétention hydrosodée, ce sont surtout les inhi-
biteurs de la calcineurine (CNI) qui sont incriminés (4).
En effet, l’HTA était observée chez 30 à 40 % des trans-
plantés rénaux avant la ciclosporine, et son incidence
a augmenté jusqu’à 60-80 % après l’introduction de la
ciclosporine. Le mécanisme principal de l’HTA est une
vasoconstriction systémique et rénale, en particulier
au niveau de l’artériole afférente du glomérule. Cette
vasoconstriction afférente s’accompagne d’une baisse
de la filtration glomérulaire et d’une augmentation de
la réabsorption sodée au niveau tubulaire, aboutissant
à une hypervolémie. La néphrotoxicité de la ciclospo-
rine et la stimulation du système orthosympathique
sont également impliquées (figure 3). Le tacrolimus
provoquerait moins d’HTA que la ciclosporine, peut-
être en raison d’un effet vasoconstricteur rénal moins
intense. Théoriquement, les inhibiteurs de mTOR, les
dérivés de l’acide mycophénolique et le bélatacept ne
provoquent pas d’HTA.
Autres facteurs de survenue d’HTA
D’autres facteurs peuvent expliquer la survenue fréquente
d’une HTA chez le transplanté. Il peut s’agir d’une prédis-
position génétique du greffon à l’hypertension, comme
on l’observe dans les transplantations de greffons de don-
neurs ayant des antécédents familiaux d’HTA à des rece-
veurs normotendus (5). Les facteurs de risque classiques
Figure 2. Sténose postanastomotique de l’artère du greffon, avant et après angioplastie.

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XI - n° 1 - janvier-février-mars 2011 11
peuvent également jouer un rôle, en particulier l’âge,
la sédentarité, le surpoids, la présence d’un syndrome
métabolique, l’athéromatose et les antécédents familiaux.
Conséquences de l’HTA
chez les transplantés
La morbi-mortalité cardio-vasculaire est élevée chez
les transplantés : le taux annuel de décès ou d’événe-
ments cardio-vasculaires est de 3,5 à 5 %, soit 50 fois
plus que dans la population générale (6). Comme dans
la population générale, l’HTA du transplanté est une
cause essentielle de morbi-mortalité cardio-vasculaire.
Pour des raisons éthiques, il n’est pas possible d’étudier
de façon prospective et contrôlée les effets néfastes de
l’HTA dans cette population. De ce fait, la majorité des
informations dont nous disposons provient d’études
rétrospectives, monocentriques ou de registre.
Effets de l’HTA sur le patient
Opelz et al., analysant rétrospectivement une cohorte
de 29 751 receveurs du registre CTS (Collaborative
Transplant Study), ont mis en évidence une corrélation
significative entre l’HTA un an après la transplantation
(pression artérielle systolique [PAS] > 140 mmHg ou
pression artérielle diastolique [PAD] > 90 mmHg) et la
survie globale des patients (7). Des analyses transver-
sales ont montré une corrélation entre l’HTA et cer-
tains événements cardio-vasculaires majeurs : accident
vasculaire cérébral (8), insuffisance cardiaque (9) ou
ischémie coronaire (10). Globalement, la relation entre
pression artérielle et événement cardio-vasculaire, en
particulier l’ischémie coronaire, correspond à l’équation
de Framingham de calcul du risque coronarien (10).
Plusieurs analyses ont récemment attiré l’attention sur
le fait que la pression pulsée (PP), un marqueur de la
compliance artérielle, était mieux corrélée aux événe-
ments cardio-vasculaires que la PAS ou la PAD (11, 12).
Effets de l’HTA sur le greffon
L’HTA réduit de façon significative la survie du greffon.
En analysant la cohorte du registre CTS, Opelz et al. ont
également montré une augmentation très significa-
tive de la perte du greffon, parallèle à l’élévation des
chiffres de PAS (140 mmHg) ou PAD (90 mmHg) à un
an (7). Dans cette étude, cependant, l’analyse de survie
n’était pas ajustée sur la fonction rénale, mais plusieurs
autres travaux ont confirmé le rôle délétère de l’HTA sur
la survie des greffons après ajustement sur la fonction
rénale (13, 14). Reprenant une série de 493 patients trans-
plantés entre 1996 et 2005, nous avons mis en évidence
une corrélation significative entre la pression pulsée,
mesurée à 3 mois post-transplantation, et la survie des
greffons (figure 4). La PP était un meilleur marqueur de
risque de perte de greffon que la PAS ou la PAD (15).
Figure 3. Mécanismes de l’hypertension induite par les inhibiteurs de la calcineurine.
Inhibiteurs de la calcineurine
vasoconstricteurs (endothéline, angiotensine, etc.)
vasodilateurs (NO, prostacycline, etc.)
Hypertension
Vasoconstriction systémique
débit cardiaque
Augmentation de la
réabsorption rénale de sodium
Activation du système nerveux
sympathique Vasoconstriction rénale Détérioration de
la fonction rénale
Figure 4. La survie du greffon est influencée par la pression pulsée.
Pression pulsée < 60 mmHg
Pression pulsée > 60 mmHg
100
80
60
3 5 8 10 120
Suivi (années)
Survie du greffon rénal (%)
Hypertension artérielle après transplantation rénale

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XI - n° 1 - janvier-février-mars 2011
12
Dossier thématique
Transplantation
rénale
Diagnostic
La plupart des recommandations (Comité américain
JNC 7 ou OMS) définissent l’HTA de l’adulte par des
valeurs > 140/90 mmHg (16, 17). Il faut cependant noter
que ces mêmes recommandations fixent comme cibles
du traitement des chiffres inférieurs à 130/80 mmHg
dans les populations à haut risque cardio-vasculaire ou
rénal comme les diabétiques ou les insuffisants rénaux.
Cela s’applique au transplanté rénal, que les recomman-
dations américaines et les guides européens de bonnes
pratiques recommandent de classer dans la population
à haut risque cardio-vasculaire (18, 19).
En raison de la fréquence de l’HTA et de son rôle
délétère, il est fortement recommandé de mesurer
la pression artérielle à chaque consultation, dans des
conditions rigoureuses. Le patient doit être allongé,
au repos depuis au moins 5 minutes, avec un appareil
adapté, en effectuant au minimum 2 mesures (20).
Une mesure ambulatoire de la PA (MAPA) peut être néces-
saire pour diagnostiquer l’HTA “blouse blanche”, l’HTA
masquée ou l’HTA transitoire, évaluer la résistance au
traitement antihypertenseur ou la survenue de malaises
ou d’épisodes hypotensifs. La question de la pratique
d’une MAPA systématique chez tout transplanté peut
se poser : une étude récente a montré que la MAPA per-
mettait de diagnostiquer 29 % des patients avec une HTA
nocturne, et que la protéinurie et la créatininémie à 1 an
(témoins de l’atteinte de l’organe cible qu’est le greffon
rénal) étaient corrélées aux valeurs de PA obtenues par
MAPA et non à celles obtenues en consultation (21).
Les automesures de la PA sont utiles pour surveiller les
effets du traitement antihypertenseur ; elles se révèlent
utiles pour augmenter l’adhérence au traitement (lire
l’article de R. Sberro-Soussan, p. 25 de ce dossier).
Traitement de l’HTA
Dans la population générale, les études observation-
nelles et les essais randomisés ont montré que l’HTA
était un facteur de risque indépendant de maladie
cardio-vasculaire et d’IRC. De plus, des études inter-
ventionnelles ont solidement établi que le traitement de
l’HTA diminuait le risque de maladie cardio-vasculaire.
Généralement, il y a un bénéfice évident à réduire la
PA en deçà de 140/90 mmHg, même chez les patients
à faible risque cardio-vasculaire. Chez les insuffisants
rénaux chroniques, la réduction de la PA diminue égale-
ment la protéinurie et ralentit la progression de l’IRC (22).
Chez les transplantés rénaux, pour des raisons logis-
tiques (nombre de patients insuffisant) et éthiques
(groupe contrôle non traité), il n’existe pas d’étude
interventionnelle prospective prouvant le bénéfice
de la réduction de la PA sur la morbi-mortalité cardio-
vasculaire ou sur la progression de la dysfonction du
greffon. Cependant, de nombreux arguments suggèrent
que les bénéfices obtenus chez les non-transplantés
seraient retrouvés chez les transplantés. Opelz et al.,
analysant une cohorte de 24 404 transplantés du
registre CTS, ont montré que les patients ayant une
PAS >140 mmHg à 1 an mais < 140 mmHg à 3 ans béné-
ficiaient d’une meilleure survie du greffon (RR : 0,79 ; IC :
0,73-0,86 ; p < 0,001) et avaient moins d’événements
cardio-vasculaires à 5 ans que ceux dont la PA restait
supérieure à 140 mmHg (23). Il y a quelques années, une
étude multicentrique randomisée a cherché à mettre
en évidence un effet bénéfique du candésartan sur
les décès et la morbi-mortalité cardio-vasculaire du
transplanté. Il faut noter que cette étude fut arrêtée pré-
maturément, car le nombre d’événements dans le bras
contrôle était plus faible que prévu. Elle a néanmoins
montré que la protéinurie était significativement plus
faible dans le groupe candésartan (24). Plusieurs études
interventionnelles ont montré un effet bénéfique de la
réduction de la PA sur la protéinurie, en particulier par
les IEC ou les ARA-II, ce qui est considéré comme un bon
critère intermédiaire d’évolution rénale (25). Cependant,
il n’existe à ce jour aucun essai disponible étudiant le
rôle des IEC sur la survie des patients et des greffons.
Quel que soit le mécanisme de l’HTA, il est donc
essentiel de traiter agressivement. Les guides euro-
péens de bonnes pratiques suggèrent des cibles de
130/85 mmHg chez les transplantés non protéinu-
riques et de 125/75 mmHg chez les patients protéinu-
riques (19). Les recommandations de la Haute Autorité
de santé (HAS) proposent plus simplement des cibles
de 130/80 mmHg chez tous les receveurs (26). Pour
diverses raisons, ces cibles sont loin d’être atteintes :
dans une cohorte de 583 patients transplantés depuis
58 ± 48 mois, la PA n’était dans les cibles recomman-
dées (< 130/80) que chez 53 % d’entre eux. L’âge des
receveurs, la présence d’un syndrome métabolique
et la protéinurie sont significativement associés à un
contrôle non optimal des chiffres de PA (article soumis).
En plus des recommandations diététiques et des règles
d’hygiène de vie, toutes les classes d’antihypertenseurs
peuvent être utilisées chez les transplantés. Souvent, le
choix de l’antihypertenseur est guidé par une patho-
logie cardio-vasculaire présente chez le patient, et qui
justifie l’utilisation préférentielle d’une classe spécifique
d’antihypertenseurs (tableau II). De plus, chez la majo-
rité des patients, l’association de 2 ou 3 médicaments
 6
6
 7
7
1
/
7
100%


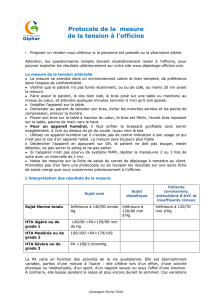
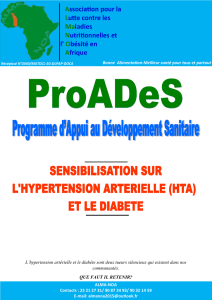

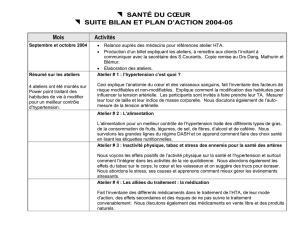



![EXII Exploitation d’une installation industrielle Installations haute tension [nouvelle version]](http://s1.studylibfr.com/store/data/008500893_1-ce1bcbfa853c7dcb5fe9f0d1673b72f8-300x300.png)