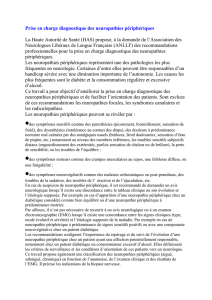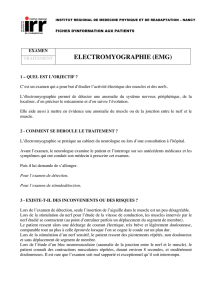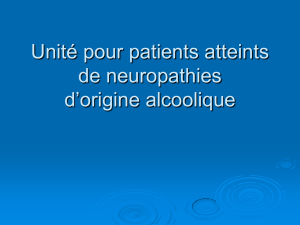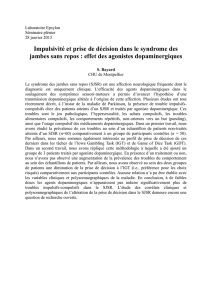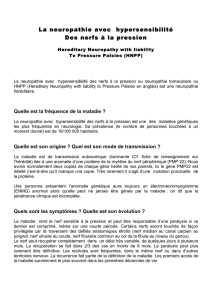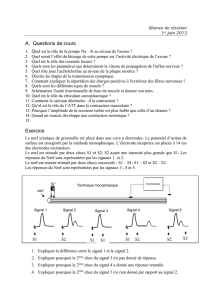Lire l'article complet

REVUE DE PRESSE dirigé par
le Pr P. Bouche
268 | La Lettre du Neurologue Nerf & Muscle • Vol. XIII - n° 9 - octobre 2009
Atteinte ulnaire dans le syndrome du canal carpien ?
Les auteurs proposent, de façon rétrospective, l’analyse de la conduction du nerf ulnaire
chez 417patients souffrant d’un syndrome du canal carpien (SCC). Les SCC sont subdivisés
en 5 sous-groupes de sévérité croissante. Dans chacun des sous-groupes, la conduction
sensitive du nerf ulnaire (annulaire-poignet) est comparée à celle de sujets contrôles appariés
pour l’âge et le sexe (210sujets sains). À l’exception du sous-groupe1 (SCC débutant),
la moyenne des amplitudes et des vitesses de conduction sensitive (VCS) du nerf ulnaire
est significativement plus basse chez les patients que chez les sujets contrôles. Les auteurs
rapportent également une corrélation inverse entre la classe du SCC et la VCS du nerf
ulnaire, d’une part (r=–0,218), et l’amplitude du potentiel sensitif (APS) du nerf ulnaire,
d’autre part (r = – 0,156). Une corrélation inverse est également retrouvée entre la latence
distale motrice du nerf médian et les paramètres d’analyse du nerf ulnaire (APS: r=–0,218;
VCS: r=–0,166). Une corrélation positive est rapportée entre les nerfs médian et ulnaire
concernant l’APS (r=0,264) et la VCS (r=0,157). La transmission des pressions élevées
du canal carpien à la loge de Guyon pourrait expliquer ces résultats.
F.C. Wang,
CHU Sart-Tilman, Liège
Le syndrome du muscle pyramidal existe-t-il ?
Le syndrome du muscle pyramidal, ou pyriformis syndrome (PS), a été décrit pour la première
fois par D. Robinson en 1947. Il correspondrait à une constellation de symptômes qui incluent
des douleurs lombo-sacrées et de la fesse irradiant au membre inférieur. Il serait sous-diagnos-
tiqué et confondu avec des pathologies plus fréquentes, telles que la radiculopathie L5-S1.
J.S. Kirschner et al. ont fait une revue pertinente de la littérature sur ce syndrome, après une
revue anatomique rappelant que le muscle pyramidal, plat et pyriforme (d’où son nom en
anglais), va du grand trochanter aux deuxième, troisième et quatrième trous sacrés. Il est
innervé par les rameaux ventraux de S1 et S2 qui se joignent pour former le nerf du pyri-
forme. La jambe en extension, il est principalement un rotateur externe de la hanche ; avec la
jambe fléchie, il est abducteur de la hanche. Le muscle pyriforme est étroitement lié au nerf
sciatique: les rameaux ventraux de L4 à S3 convergent vers le bord inférieur du muscle pour
former le nerf sciatique, qui émerge alors sous le grand foramen sciatique, sous le muscle.
Les études épidémiologiques réalisées sur le PS ne sont guère consistantes, mais il serait
responsable de 6 à 8 % des cas de douleurs lombo-sacrées et de sciatiques aux États-Unis.
Le diagnostic est généralement évoqué devant la présence de douleurs de la fesse avec ou
sans irradiation à la face postérieure de la cuisse, douleurs exacerbées par l’activité physique,
la position assise prolongée ou la marche. L’examen physique peut montrer un endolorisse-
ment à la palpation au niveau de l’échancrure sciatique ou du corps musculaire du muscle
pyramidal. Le muscle peut avoir un aspect de masse en forme de saucisse à la palpation.
Plusieurs manœuvres ont été proposées, entre autres celle de Freiberg (rotation interne
forcée du côté atteint) ou celle de Pace (douleur fessière en abduction en position assise).
L’examen électro-neuromyographique (ENMG) est de peu d’intérêt: il est le plus souvent
normal. Une anomalie du réflexe H a été rapportée par certains auteurs (allongement de
la latence H). Mais c’est vers les examens en imagerie que l’on doit désormais se tourner
pour le diagnostic, et notamment l’IRM, seule à pouvoir visualiser le muscle pyramidal.
Le traitement prometteur paraît être l’injection de toxine botulique directement dans le
muscle. Les résultats semblent très encourageants.
P. Bouche, département de neurophysiologie clinique,
hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris
Commentaire
Même si l’association d’une lésion ulnaire au
SCC est régulièrement rapportée dans la littéra-
ture depuis un article de L.Sedal et al. en 1973,
celle-ci relevait, jusqu’à présent, davantage d’une
comorbidité que d’une relation de cause à effet.
La nouveauté dans ce travail est la fréquence avec
laquelle cette association est suspectée et la corré-
lation avec la sévérité du SCC. Certaines faiblesses
méthodologiques doivent néanmoins être souli-
gnées. Il s’agit d’une étude rétrospective. La taille
des sujets n’est pas prise en compte (la VCS et l’APS
sont pourtant inversement proportionnelles à la
taille). La recherche d’une compression ulnaire au
coude n’est pas systématique. Sur le plan statis-
tique, les coefficients de corrélation restent faibles
et en partie explicables par l’âge des patients. En
conclusion, une étude prospective rigoureuse reste
donc à réaliser pour démontrer l’influence du SCC
sur la conduction du nerf ulnaire au poignet.
Référence bibliographique
Ginanneschi P, Milani P, Rossi A et al. Anomalies of ulnar
nerve conduction in different carpal tunnel syndrome
stages. Muscle Nerve 2008;38:1155-60.
Commentaire
Cet article paraît exhaustif et rappelle les princi-
paux éléments de diagnostic et de traitement de ce
syndrome, qui reste néanmoins assez controversé.
Il s’agit là d’un article de référence, tout du moins
pour le traitement. Le diagnostic repose en fait sur
les manœuvres physiques reproduisant la douleur
et sur l’imagerie, notamment l’IRM. Bien sûr, l’éli-
mination des autres causes est essentielle. Le trai-
tement par injection de toxine botulique semble
très prometteur à condition que le diagnostic soit
suffisamment étayé.
Référence bibliographique
Kirschner JS, Foye PM, Cole JL. Piriformis syndrome,
diagnosis and treatment. Muscle Nerve 2009;40:10-8.

REVUE DE PRESSE
Figure. Biopsie cutanée. A : membre inférieur. B : doigt.
A
B
La Lettre du Neurologue Nerf & Muscle • Vol. XIII - n° 9 - octobre 2009 | 269
La biopsie cutanée : une aide au diagnostic
des neuropathies périphériques
L’auteur, C. Sommer, du département de neurologie de l’université de Würzburg, est une
des pionnières dans la réalisation des biopsies cutanées, permettant ainsi l’exploration des
neuropathies à petites fibres qui, jusqu’à la pratique de telles techniques, échappaient aux
investigations traditionnelles. Publié dans Current Opinion in Neurology (1), son article
passe en revue les différents champs d’application de cette nouvelle technique. Sa réalisa-
tion demande bien sûr des officiants entraînés, aussi bien dans l’acte biopsique
(figure)
que dans la lecture des lames. C’est l’utilisation d’un anticorps dirigé contre un produit
génétique protéinique (PGP) 9,5 qui permet de colorer les fibres nerveuses intradermiques.
Évaluation de la fiabilité diagnostique de la biopsie cutanée. La pratique de la biopsie
cutanée a d’abord été appliquée au diagnostic des neuropathies à petites fibres pour lesquelles
les tests électrophysiologiques de routine étaient normaux. Dans une étude réalisée par l’équipe
de Würzburg sur 99 patients présentant des symptômes cliniques de neuropathie sensitive
douloureuse comparés à 37 volontaires sains, le calcul de la densité en fibre nerveuse intra-
épidermique (IENFD) a montré une sensibilité de 0,77 et une spécificité de 0,79 chez les patients
avec neuropathie à petites fibres seules (2). Chez ceux qui avaient une atteinte associée des
grosses fibres, la sensibilité était de 0,76 et la spécificité de 0,81. La mesure de la surface du
plexus nerveux sous-épidermique augmente la sensibilité à 0,86 pour les neuropathies à petites
fibres et à 100 % pour les neuropathies mixtes. La comparaison de la sensibilité de l’IENFD
avec le testing sensitif quantitatif (QST) a montré, chez les patients avec neuropathie à petites
fibres, une supériorité de 88 % chez 47 % des sujets (3). Ainsi, un QST normal ne permet pas
d’éliminer la présence d’une neuropathie à petites fibres. Une cause traitable a été trouvée
chez 50 % des patients avec neuropathie à petites fibres grâce à la biopsie cutanée (4). Celle-ci
a pu se révéler utile également dans des cas de neuropathie inflammatoire ou de vascularite.
Atteinte des petites fibres, non connue, détectée dans des cas de neuropathies à
grosses fibres (porphyrie, maladie de Kennedy, polyradiculonévrite chronique inflammatoire,
hypothyroïdie). La constatation d’une telle atteinte correspond sans doute à des formes
douloureuses de ces affections.
Pratique de la biopsie cutanée : impact sur la prévention d’une neuropathie de
stade précoce? Chez le singe diabétique, il existe une diminution progressive et rapide
de l’IENFD par rapport aux non-diabétiques en fonction de l’âge. Chez des patients avec
intolérance au glucose, une diète adaptée et la pratique d’un exercice physique entraînent
une augmentation significative de l’IENFD en bonne corrélation avec l’amélioration de la
douleur. La biopsie cutanée, qui est une méthode d’investigation peu invasive, peut être
répétée pour juger de l’évolution d’une neuropathie et des effets de différents traitements,
notamment dans le diabète. Cela a également été utilisé dans le suivi du traitement de la
maladie de Charcot-Marie-Tooth par l’acide ascorbique et chez les patients VIH.
Concordance de la biopsie cutanée avec d’autres méthodes d’évaluation des petites
fibres. De nombreuses méthodes de détection des atteintes des petites fibres ont été
récemment décrites: l’étude microscopique de la cornée chez les sujets diabétiques, les
potentiels évoqués de contact à la chaleur, les potentiels évoqués à la douleur ou au laser
et, enfin, la fluxmétrie au doppler couplée au laser. Toutes ces méthodes nécessitent d’être
étudiées en comparaison avec la biopsie cutanée, avec différents groupes de patients et
de sujets normaux. Peut-être que certaines combinaisons de ces nouvelles méthodes se
révéleront efficaces et adaptées au diagnostic, mais il faudra bien sûr tenir compte des
aspects économiques de telles investigations.
La biopsie cutanée comme étude de la physiopathologie de certaines neuropathies,
notamment dans le diabète. Une réduction de l’expression du VEGF dans la biopsie
cutanée chez le patient diabétique suggère qu’il existe un lien entre l’absence de ce facteur
de croissance, l’hypoxie tissulaire et la neuropathie (5). L’existence de douleurs dans une
neuropathie peut être expliquée par l’atteinte préférentielle des fibres nociceptives C. Ainsi,
leur quantification dans une neuropathie doit donner une bonne indication de la douleur,
avec une réduction de l’IENFD. Dans les neuropathies mixtes, une faible IENFD était associée
à de plus hauts scores de douleur. Il en est de même chez les patients avec polyradiculo-
névrite chronique. Cependant, des douleurs peuvent être présentes chez des sujets avec
IENFD normale ou encore chez ceux avec perte complète des fibres intra-épidermiques.
L’augmentation de la production de cytokine dans la peau de patients avec neuropathie
des petites fibres a été observée dans certains cas et pas dans d’autres, ce qui suggère la
possibilité de sous-groupes différant par leur étiologie et leur physiopathologie.
P. Bouche
Commentaire
Il s’agit donc d’une revue sur les perspectives d’uti-
lisation de la biopsie cutanée dans les neuropathies
périphériques. La phase diagnostique des neuro-
pathies à petites fibres est désormais dépassée.
D’autres horizons s’ouvrent pour cette technique
peu invasive, et notamment pour le suivi des neuro-
pathies (dans le diabète et le prédiabète), dans la
compréhension des mécanismes de la douleur et la
physiopathologie des neuropathies. La pratique de
cette technique nécessite des équipes entraînées
et, jusqu’à présent, seules quelques équipes euro-
péennes l’effectuaient (Italie, Allemagne, Angle-
terre). En France, nous commençons à l’utiliser (6).
Références bibliographiques
1. Sommer C. Skin biopsy as a diagnostic tool. Curr Opin
Neurol 2008;21:563-8.
2. Vickova-Moravcova E, Bednarik E, Dusek L et al. Diagnostic
validity of epidermal nerve fiber densities in painful sensory
neuropathies. Muscle Nerve 2008;37:50-60.
3. Devigili G, Tugnoli V, Penza P et al. The diagnostic criteria
for small fibre neuropathy: from symptoms to neuropatho-
logy. Brain 2008;131:1912-25.
4. De Sousa EA, Hays AP, Chin RL et al. Characteristics
of patients with sensory neuropathy diagnosed with
abnormal small nerve fibres on skin biopsy. J Neurol
Neurosurg Psychiatry 2006;77:983-5.
5. Quattrini C, Tavakoli M, Jesiorska M et al. Surrogate
markers of small fiber damage in human diabetic neuro-
pathy. Diabetes 2007;56:2148-54.
6. Collongues N, Blanc F, Echaniz-Laguna A et al. Confir-
mation of the use of skin biopsy in small-fiber neuropathy.
First results. Rev Neurol 2009;165(3):249-55.

- 2009/09 - AVO3 - FRA - 25056
DÉNOMINATION DU MEDICAMENT : AVONEX 30 microgrammes/0,5 ml (Interféron bêta-1a) solution injectable. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE ET FORME PHARMACEUTIQUE *: Solution injectable - Interféron bêta-1a 30 microgrammes (6 millions d’UI) dans 0,5 ml contenus
dans une seringue préremplie. Solution limpide et incolore. DONNÉES CLINIQUES : • Indications thérapeutiques : AVONEX est indiqué dans le traitement : - Des patients atteints de sclérose en plaques (SEP ) de forme rémittente. Dans les essais cliniques, celle-ci était caractérisée par deux
poussées ou plus survenues au cours des trois années précédentes sans évidence de progression régulière entre les poussées ; AVONEX ralentit la progression du handicap et diminue la fréquence des poussées. - Des patients ayant présenté un seul évènement démyélinisant, accompagné
d’un processus inflammatoire actif, s’il est suffisamment sévère pour nécessiter un traitement par corticostéroïdes par voie intraveineuse, si les diagnostics différentiels possibles ont été exclus et si ces patients sont considérés à haut risque de développer une sclérose en plaques cliniquement
définie. Le traitement par AVONEX doit être interrompu chez les patients développant une forme progressive de SEP.•Posologieetmoded’administration : Le traitement devra être initié par un praticien expérimenté dans le traitement de cette maladie. Adulte : La posologie recommandée
dans le traitement des formes de SEP évoluant par poussées est de 30 microgrammes (0,5 ml de solution) administrés par voie intramusculaire (IM) une fois par semaine (voir « Précautions particulières d’élimination et manipulation »). Aucun bénéfice supplémentaire n’a été observé en
administrant une dose supérieure (60 microgrammes) une fois par semaine. »). A l’instauration du traitement, les patients peuvent commencer avec une dose totale de 30 microgrammes (0,5 ml de solution) ou bien avec approximativement la moitié de la dose une fois par semaine afin de
les aider à s’adapter au traitement ; ensuite, la dose sera augmentée jusqu’à obtention de la dose totale de 30 microgrammes (0,5 ml de solution). Afin d’obtenir une efficacité satisfaisante, une dose de 30 microgrammes (0,5 ml de solution) une fois par semaine devra être atteinte et maintenue
après la période d’augmentation initiale. Il existe un dispositif manuel permettant d’administrer environ la moitié de la dose pour les patients débutant le traitement par AVONEX. Aucun bénéfice supplémentaire n’a été observé en administrant une dose supérieure (60 microgrammes) une fois
par semaine. Enfant et adolescent : Aucune étude formelle clinique ou de pharmacocinétique n’a été conduite chez l’enfant ou l’adolescent. Cependant, des données publiées limitées suggèrent que le profil de sécurité d’AVONEX chez les adolescents âgés de 12 à 16 ans recevant une injection
par voie intramusculaire de 30 microgrammes une fois par semaine, est similaire à celui observé chez les adultes. Il n’existe pas d’information sur l’utilisation d’AVONEX chez l’enfant de moins de 12 ans. Par conséquent, AVONEX ne doit pas être utilisé dans cette population. Sujet âgé : les
études cliniques n’ont pas inclus suffisamment de patients âgés de 65 ans et plus pour permettre de déterminer si cette population répond différemment au traitement que celle des patients plus jeunes. Toutefois, sur la base du schéma d’élimination du principe actif, il n’existe aucune raison
théorique de modifier la posologie chez le sujet âgé. Il convient de changer le site d’injection intramusculaire chaque semaine. Le médecin peut prescrire l’utilisation d’une aiguille de 25 mm de taille 25G pour les patients chez qui cette aiguille est plus appropriée pour l’injection intramusculaire.
Afin de réduire les symptômes pseudo-grippaux associés au traitement par AVONEX, l’administration d’un antalgique antipyrétique avant l’injection et pendant les 24 heures suivant chaque injection est conseillée. Ces symptômes sont habituellement présents pendant les premiers mois de
traitement. A ce jour, la durée totale du traitement n’est pas connue. Les patients devront être examinés au plan clinique après deux ans de traitement et la prolongation du traitement devra être décidée au cas par cas par le médecin traitant. Le traitement devra être interrompu chez les
patients développant une forme chronique progressive de SEP. • Coûtdutraitementjournalier:33,60 Euros. • Contre-indications : - Initiation du traitement pendant la grossesse (voir « Grossesse et Allaitement ») - Patients ayant des antécédents d’hypersensibilité aux interférons ß naturels
ou recombinants ou à l’un des excipients - Patients présentant une dépression sévère et/ou des idées suicidaires (voir « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi » et « Effets Indésirables »). •Misesengardespécialesetprécautionsd’emploi* : AVONEX doit être utilisé avec
prudence chez les patients déprimés. Dépression et idées suicidaires sont connues pour survenir plus fréquemment chez les patients atteints de sclérose en plaques et être associées à l’utilisation des interférons. Il est recommandé aux patients de signaler immédiatement tout symptôme
de dépression et/ou d’idées suicidaires à leur médecin traitant. Prudence en cas d’administration d’AVONEX chez les patients ayant des antécédents d’épilepsie et /ou sous traitement antiépileptique, en particulier si les crises ne sont pas contrôlées de façon satisfaisante par le traitement
antiépileptique. Administration avec prudence et surveillance étroite en cas d’insuffisance hépatique ou rénale sévères et de myélosuppression sévère. Les patients doivent faire l’objet d’une surveillance particulière afin de déceler tout signe d’atteinte hépatique et la prudence est de rigueur
lorsque des interférons sont administrés en même temps que d’autres médicaments connus pour provoquer une atteinte hépatique. Surveillance particulière en cas de maladie cardiaque (angor, insuffisance cardiaque congestive ou arythmie), afin de déceler une aggravation éventuelle de
leur état clinique durant le traitement par AVONEX. L’utilisation des interférons peut entraîner des perturbations des examens biologiques. Des patients sont susceptibles de développer des anticorps contre AVONEX. • Interactions avecd’autresmédicamentsetautres formes
d’interactions* : Aucune étude spécifique d’interaction n’a été réalisée chez l’homme. L’expérience clinique a montré que les patients atteints de SEP peuvent recevoir AVONEX et des corticostéroïdes ou de l’ACTH au cours des poussées. Il convient d’être prudent en cas d’administration
simultanée d’AVONEX avec d’autres médicaments à marge thérapeutique étroite et dont l’élimination dépend largement du cytochrome P-450 (antiépileptiques et certaines classes d’antidépresseurs…). •Grossesseetallaitement* : Les informations sur l’utilisation d’AVONEX pendant la
grossesse sont limitées. Les données disponibles traduisent l’éventualité d’un risque accru d’avortement spontané. L’initiation du traitement est contre-indiquée en cours de grossesse. Les femmes en âge de procréer devront utiliser les moyens contraceptifs appropriés. En l’absence de
données concernant le passage d’AVONEX dans le lait maternel et en raison de la possibilité d’effets indésirables graves chez les nourrissons, interrompre l’allaitement ou le traitement par AVONEX. • Effetssurl’aptitudeàconduiredesvéhiculesetàutiliserdesmachines* • Effets
indésirables* : le plus fréquemment : symptômes pseudo-grippaux tels que myalgies, fièvre, frissons, hypersudation, asthénie, céphalées, nausées ; plus marqués en début de traitement et dont la fréquence diminue avec la poursuite du traitement. Effets indésirables déclarés lors des essais
cliniques et/ou rapportés en post-AMM : Investigations : fréquent : lymphopénie, leucopénie, neutropénie, baisse de l’hématocrite, hyperkaliémie, augmentation de l’urée sanguine ; peu fréquent : thrombopénie ; fréquence indéterminée : perte de poids, prise de poids, anomalies des tests
hépatiques. Affections cardiaques : fréquence indéterminée : Cardiomyopathie, insuffisance cardiaque congestive (voir « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi »), palpitations, arythmie, tachycardie. Affections hématologiques et du système lymphatique : fréquence indéterminée :
pancytopénie, thrombopénie. Affections du système nerveux : très fréquent : céphalée ; fréquent : spasticité musculaire, hypoesthésie ; fréquence indéterminée : symptômes neurologiques, syncope, hypertonie, vertiges, paresthésie, crises d’épilepsie, migraine. Affections respiratoires,
thoraciques et médiastinales : fréquent : rhinorrhée ; rare : dyspnée. Affections gastro-intestinales : fréquent : vomissements, diarrhée, nausées. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : fréquent : éruptions cutanées, hypersudation, contusion ; peu fréquent : alopécie ; fréquence
indéterminée : œdème de Quincke, prurit, érythème vésiculaire, urticaire, aggravation de psoriasis. Affections musculo-squelettiques et systémiques:fréquent : crampes musculaires, cervicalgie, myalgie, arthralgie, douleurs dans les extrémités, lombalgie, raideur musculaire, raideur musculo-
squelettique ; fréquence indéterminée : lupus érythémateux disséminé, faiblesse musculaire, arthrite. Affections endocriniennes : fréquence indéterminée : hypothyroïdie, hyperthyroïdie. Troubles du métabolisme et de la nutrition : fréquent : anorexie. Infections et infestations : fréquence
indéterminée : abcès au site d’injection. Affections vasculaires:fréquent : rougeur du visage ; fréquence indéterminée : vasodilatation. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : très fréquent : syndrome pseudo-grippal, fièvre, frissons, hypersudation ; fréquent : douleur au site
d’injection, érythème au site d’injection, ecchymose au site d’injection, asthénie, douleur, fatigue, malaise, sueurs nocturnes ; peu fréquent : sensation de brûlure au site d’injection ; fréquence indéterminée : réaction au site d’injection, inflammation au site d’injection, cellulite au site d’injection,
nécrose au site d’injection, saignement au site d’injection, douleur thoracique. Affections du système immunitaire : fréquence indéterminée : réaction anaphylactique, choc anaphylactique, réactions d’hypersensibilité (œdème de Quincke, dyspnée, urticaire, éruption, éruption prurigineuse).
Affections hépatobiliaires : fréquence indéterminée : insuffisance hépatique (voir « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi »), hépatite, hépatite auto-immune. Affections des organes de reproduction et du sein : peu fréquent : métrorragie, ménorragie. Affections psychiatriques :
fréquence indéterminée : dépression (voir « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi »), insomnie, suicide, psychose, anxiété, confusion, labilité émotionnelle. • Surdosage* PROPRIÉTÉSPHARMACOLOGIQUES* : • Propriétéspharmacodynamiques* : interférons, code ATC : L03
AB07. • Propriétéspharmacocinétiques*•Donnéesdesécuritépréclinique*•DONNÉESPHARMACEUTIQUES* : •Listedesexcipients* • Incompatibilités* • Durée de conservation : 2 ans. •Précautions particulièresdeconservation: A conserver au réfrigérateur (2°C - 8°C).
NEPASCONGELER. AVONEX peut être conservé à température ambiante (entre 15°C et 30°C) pendant une durée n’excédant pas une semaine. A conserver dans l’emballage extérieur d’origine à l’abri de la lumière. • Natureetcontenudel’emballageextérieur*: Seringue de 1 ml munie
d’un opercule avec sécurité et d’un piston contenant 0,5 ml de solution. • Précautionsparticulièresd’éliminationetmanipulation* : AVONEX est fourni sous forme d’une solution injectable prête à l’emploi, en seringue préremplie. Une fois sorti du réfrigérateur, AVONEX doit être amené à
température ambiante (15°C-30°C) environ 30 minutes avant l’injection. Ne pas utiliser de source externe de chaleur comme, par exemple, de l’eau chaude pour réchauffer AVONEX. Si la solution contient des particules en suspension ou si elle n’est pas limpide et incolore, la seringue préremplie
ne doit pas être utilisée. L’aiguille pour l’injection intramusculaire est fournie. La solution ne contient pas de conservateur. Chaque seringue préremplie contient une seule dose d’AVONEX. Eliminer toute fraction inutilisée. Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la
réglementation en vigueur.• LISTE I • Médicamentsoumisàunesurveillanceparticulièrependantletraitement.Médicamentsoumisàprescriptioninitialeetrenouvellementréservésauxspécialistesenneurologie.TITULAIREDEL’AMM: Biogen Idec Limited, Innovation House,
70 Norden Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY, Royaume-Uni. Information médicale et Pharmacovigilance : N° Vert 0 800 84 16 64.NUMÉROD’AUTORISATIONDEMISESURLEMARCHE:EU/1/97/033/003. •CODECIP: 343 232-6 : solution injectable ; boîte de 4 seringues préremplies
+ 4 aiguilles. •Prix: 940,87 Euros. Remb. Séc. Soc. à 65%. Agréé aux Collectivités. Médicament d’exception et prescription en conformité avec la FIT. DATEDEPREMIEREAUTORISATION/DERENOUVELLEMENTDEL’AUTORISATION:Datedepremièreautorisation:13/03/1997 – Date
dedernierrenouvellementdel’autorisation:13/03/2007 DATEDEMISEAJOURDUTEXTE:12/2008*Pour des informations plus complètes, veuillez consulter la monographie sur le site http://www.emea.europa.eu/. MLR 03/09
FIT AVONEX®, J.O. du 5 avril 2003 : médicament d’exception et prescription en conformité avec la FIT. AVONEX® est remboursé pour les patients ayant présenté un 1er événement démyélinisant accompagné d’un processus inflammatoire
actif, si les diagnostics différentiels ont été exclus et si les critères IRM de dissémination temporo-spatiale définis dans l’avis de la Commission de la Transparence du 18/12/2002 et dans la Fiche d’Information Thérapeutique sont réunis.
AVEX275b_ML.indd 1 23/07/09 17:38:55
REVUE DE PRESSE dirigé par
le Pr P. Bouche
270 | La Lettre du Neurologue Nerf & Muscle • Vol. XIII - n° 9 - octobre 2009
Altération de la sensibilité au cours
des neuropathies motrices multifocales :
étude clinique et électrophysiologique
Dans la pratique quotidienne, il n’est pas rare de considérer comme usuelle l’apparition de
troubles subjectifs sensitifs, sans traduction objective, au cours des neuropathies motrices
multifocales avec blocs de conduction (NMM-BC). Ce glissement phénotypique serait
rapporté dans 20 % des cas de la littérature. Ce qui est plus étonnant est l’évolution,
après plusieurs années, de certaines NMM-BC vers un Multifocal Acquired Demyelinating
Sensory And Motor sensitivity (MADSAM) ou vers une Chronic Inflammatory Demyelina-
ting Polyneuropathy (CIDP). Cet étonnement n’est pas nouveau, puisqu’il fut déjà relaté
dans les années 1988 et 1999, et plus récemment discuté en 2005. Une équipe française
s’est proposée d’étudier cliniquement et électrophysiologiquement l’apparition de cette
atteinte sensitive chez 5 patients, issus d’une série de 11 sujets diagnostiqués NMM-BC
entre novembre 2005 et septembre 2006, afin de déterminer si elle est contemporaine
d’une aggravation de l’atteinte motrice et si les anomalies objectives sont localisées aux
mêmes territoires tronculaires moteurs.

REVUE DE PRESSE dirigé par
le Pr P. Bouche
272 | La Lettre du Neurologue Nerf & Muscle • Vol. XIII - n° 9 - octobre 2009
Les premiers symptômes sensitifs apparaissent entre 1 et 5 ans après le début de la NMM-BC
et concernent dès la première évaluation 3 des 5 patients collectés. Ils se présentent sous
la forme soit de paresthésies dans un territoire tronculaire, soit de brûlure. Ces manifes-
tations positives s’améliorent après les perfusions d’IgIV. Quatre de ces 5 patients ont des
anticorps sériques anti-GM1, un taux de CPK élevé pour 2 d’entre eux et une discrète hyper-
protéinorachie (0,68 g/l). La deuxième évaluation est menée entre 10 mois et 8 ans après la
première. Le handicap moteur s’est aggravé, mais reste sensible aux IgIV. L’atteinte sensitive
se déclare dans la majeure partie des cas (11 fois sur 13) dans les territoires atteints sur le
plan moteur sous forme de douleur, de perte de la sensibilité tactile, avec paresthésies dans
les territoires tronculaires intéressés. Il s’agit rarement de brûlure du pied, de perte de la
sensibilité vibratoire sur les orteils et la cheville. Les troubles sensitifs objectifs intéressent les
territoires qui ont auparavant présenté des anomalies subjectives. Les anomalies objectives
apparaissent entre 5 et 9 ans après le début de la maladie. Sur le plan électrophysiologique,
les potentiels et les vitesses sensitifs sont normaux à la première évaluation. À la seconde,
la somme des amplitudes motrices s’est franchement altérée. L’anomalie la plus fréquente
pour les potentiels sensitifs est la réduction des amplitudes avec très peu de ralentissement
des vitesses. Ces anomalies sensitives intéressent les nerfs ayant des blocs moteurs et une
réduction des amplitudes.
N. Le Forestier,
hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris
Le dosage sérique de la GFAP comme marqueur
de souffrance axonale dans les neuropathies
chroniques : un nouvel outil diagnostique ?
Cette équipe italienne romaine, milanaise et de Chieti-Pescara a procédé, chez 105 patients, au
dosage sérique de la protéine du cytosquelette (Glial Fibrillary Acidic Protein [GFAP]) exprimée
dans les filaments intermédiaires de l’astroglie, dans les cellules de Schwann (CS) immatures
et matures entourant les axones non myélinisés. On sait qu’après une lésion nerveuse, les CS
perdant contact avec les axones en voie de dégénérescence wallérienne montrent une rétro-
modification de leur phénotype vers des CS non productrices de myéline avec augmentation
d’expression de la GFAP. Elles acquièrent de nouveau l’expression de molécules de surface
caractéristiques du développement embryonnaire. Par ailleurs, il est aisément constaté que sur
les nerfs suraux de biopsie de neuropathie axonale, la majorité des CS exprime des filaments
GFAP positifs et ce de façon plus remarquable que dans les neuropathies démyélinisantes. Les
taux de GFAP sont élevés dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) et le sérum en cas de démence,
de traumatisme cérébral, d’accident vasculaire cérébral (AVC) et de sclérose en plaques (SEP).
Il a été également trouvé des taux élevés dans le LCR de patients atteints de syndrome de
Guillain-Barré (SGB) axonal, contrairement aux patients atteints de SGB démyélinisants et aux
sujets contrôles. L’étude rapportée avait pour objectif, d’une part, de doser ces taux dans le
sérum de patients atteints de neuropathies chroniques et, d’autre part, de tenter de trouver
une corrélation du taux avec les sévérités de la perte axonale et du handicap. Les patients
étaient âgés de 15 à 82 ans. Trente souffraient de CIDP, 26 de neuropathie motrice multifocale
(NMM), 30 autres d’une neuropathie axonale chronique sensitivo-motrice (CSMAN) de diverses
origines, et 15 présentaient une amyotrophie musculaire primitive (AMP) ou amyotrophie
spinale, dite variante périphérique de la sclérose latérale amyotrophique. Tous les patients ont
eu une exploration électrophysiologique des 4 membres, 12 des patients CSMAN et 6 des
patients CIDP ont subi une biopsie du nerf sural. Le dosage de la GFAP s’est fait par méthode
ELISA. Les résultats montrent que le taux sérique de GFAP ne dépend pas de l’âge du patient.
Son taux est augmenté dans les CSMAN par rapport aux sujets contrôles, CIDP et NMM.
Commentaire
Il est possible que ces anomalies déterminent une
forme intermédiaire entre NMM-BC et MADSAM,
mais la présence d’anticorps anti-GM1 en fait une
entité à part puisque, exceptionnellement, ces
anticorps existent en cas de MADSAM. L’atteinte
sensitive intéresse les territoires moteurs atteints
et son existence marque une aggravation des para-
mètres moteurs. Le traitement reste les IgIV. Cette
étude s’avère de petite envergure et demande la
poursuite du suivi longitudinal de ces patients.
Référence bibliographique
Lambrecq V, Krim E, Rouannet-Larivière M, Lagueny A.
Sensory loss in multifocal motor neuropathy: a clinical and
electrophysiological study. Muscle Nerve 2009;39:131-6.

REVUE DE PRESSE
La Lettre du Neurologue Nerf & Muscle • Vol. XIII - n° 9 - octobre 2009 | 273
Commentaire
Cette étude mérite d’être confirmée par d’autres
équipes et laboratoires, car les différences en
taux entre CSMAN, AMP et NMM sont fragiles.
Le dosage de GFAP pourrait toutefois entrer, à
moindre frais, non pas tant dans l’arsenal stra-
tégique d’aide au diagnostic des neuropathies
axonales, mais plutôt dans les CIDP aux critères
démyélinisants ténus, et également dans le suivi
longitudinal des patients traités ou non.
Référence bibliographique
Notturno F, Capasso M, Delauretis A et al. Glial fibrillary
acidic protein as a marker of axonal damage in chronic
neuropathies. Muscle Nerve 2009;40:50-4.
À un moindre degré, le taux est plus élevé dans les NMM par rapport aux sujets contrôles,
il n’y a, en revanche, pas de différence entre CIDP et NMM. Tous les taux statistiques sont
à 0,05, soit inférieurs au seuil de significativité. Pour permettre de différencier avec plus
de justesse les CSMAN des CIDP, un taux approprié de GFAP a été fixé à 0,66 avec une
sensibilité de 93 %, une spécificité de 83 %, une valeur prédictive positive (VPP) de 74 %
et une valeur prédictive négative (VPN) de 96 %. En utilisant ce même taux, les NMM sont
distinguées des AMP avec une sensibilité de 87 %, une spécificité de 72 %, une VPP de
43 % et une VPN de 96 %. Par ailleurs, il est mis en évidence une corrélation significative
entre le taux de GFAP et la sévérité de la neuropathie (p < 0,0011), ce qui pourrait en faire
un marqueur de suivi avec ou sans traitement, mais pas de corrélation entre ce taux et le
score de handicap moteur au MRC scale pour les AMP. Pour les cas de CSMAN et de CIDP,
une significativité statistique est trouvée entre le taux de GFAP et les amplitudes cumulées
des potentiels sensitifs (p < 0,0006), mais seulement une tendance d’association entre ce
taux et les amplitudes distales motrices, la perte en fibres sur la biopsie et la dégénérescence
axonale. Les auteurs expliquent cette faillite du dosage par le fait que le taux de GFAP
concerne indirectement l’ensemble des nerfs touchés par la neuropathie tandis que les blocs
sont parfois très distaux et la biopsie ne donne regard que sur un fragment de nerf. Le taux
de GFAP est comparable dans les neuropathies axonales et les AMP. Pour cette dernière,
l’explication pourrait en être les existences de la souffrance axonale par dying back à partir
de la souffrance motoneuronale, d’astrogliose réactionnelle dans la moelle et de dégéné-
rescence a minima de détérioration des faisceaux cortico-spinaux. Comparant les AMP aux
taux plus élévés de GFAP que dans les NMM, les auteurs concluent en proposant ce dosage
pour distinguer les NMM, dont on ne retrouve pas les blocs de conduction, des AMP.
N. Le Forestier
Syndrome des jambes sans repos au cours
des neuropathies périphériques : y a-t-il un risque ?
La prévalence du syndrome des jambes sans repos (SJSR) [RLS des Anglo-Saxons] dans les
populations toutes confondues des États-Unis et d’Europe est approximativement de 10 %.
Plusieurs études ont tendance à montrer des anomalies du système nerveux central, telles
qu’une perte en récepteurs dopaminergiques dans la substance noire pars compacta, des
anomalies de transmission dopaminergique dans le groupe des cellules A11 localisé dans
l’hypothalamus ou encore la faillite du transport du fer du liquide céphalo-rachidien (LCR)
vers le système nerveux central. La neuropathie périphérique est communément listée dans les
causes secondaires de SJSR. Cependant, la prévalence de ce syndrome au sein des neuropathies
est extrêmement variable, allant de 5,2 à 54 % dans la littérature. Cette variabilité peut être
expliquée par l’utilisation de définitions non standardisées des neuropathies et du SJSR, et de
la confusion entre les 2 syndromes étant donné qu’ils partagent certains symptômes. Cette
équipe canadienne a mené une étude systématique de la prévalence du SJSR au sein d’une
cohorte de patients, non déments (pour lire et comprendre la lettre introductive de l’étude,
le consentement et le questionnaire) et vus pour des neuropathies périphériques, en utilisant
une procédure diagnostique en aveugle du terrain dans lequel ce SJSR se développe ou non.
La même détermination est faite auprès de sujets contrôles appariés sur l’âge et le sexe n’ayant
pas de relation génétique avec les patients non déments ni parkinsoniens, non douloureux,
sans SJSR connu et sans neuropathie. Le screening des populations a reposé sur un entretien
téléphonique utilisant un questionnaire qui comportait les critères reconnus et validés par le
groupe international d’étude du SJSR et dont la sensibilité est reconnue de 97 % (Hening et al.
Sleep Med 2008;9:283-9). Cette première étape de confirmation de SJSR convie les personnes
“screenées” positivement à venir être examinées en clinique par un évaluateur aveugle
du profil neurologique. Elles subissent le même questionnaire en direct ou par téléphone.
 6
6
1
/
6
100%