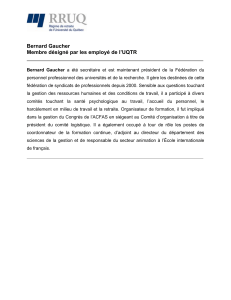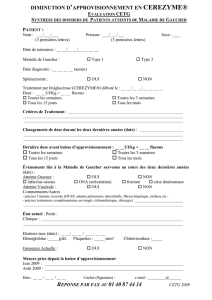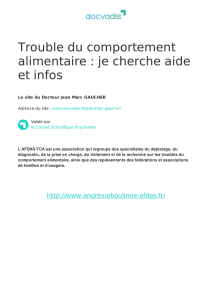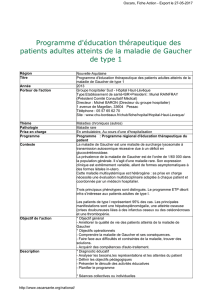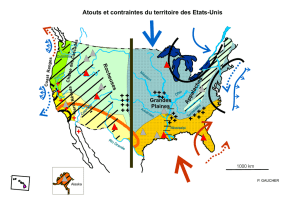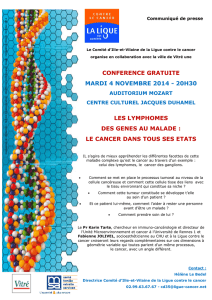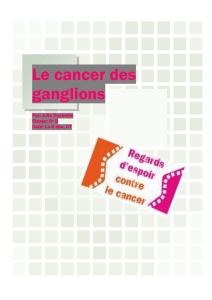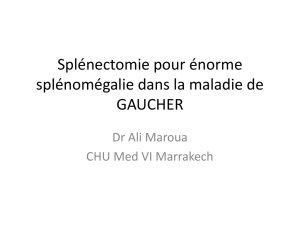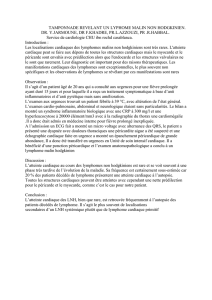Lire l'article complet

175
175
Correspondances en Onco-hématologie - Vol. II - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2007
revue de presse
Coordinateur : N. Milpied
NUCLÉOPHOSMINE RIME-T-IL
AVEC CHÉMOKINES ?
Cet article rapporte un travail fondamental dont
les résultats donnent un nouvel éclairage au
bon pronostic de l’expression cytoplasmique
de la nucléophosmine dans les leucémies
aiguës myéloïdes (LAM).
Il s’agit à l’origine d’un travail de protéomique
visant à identifi er les molécules potentielle-
ment associées à CXCR4. Cette serpentine
à sept passages transmembranaires est le
récepteur de la chémokine CXCL12, égale-
ment appelée stromal cell-derived factor1.
L’interaction de ces molécules joue un rôle
important pendant l’embryogenèse des
systèmes nerveux et cardio-vasculaire. Elle
gouverne aussi la localisation des précurseurs
hématopoïétiques dans la moelle osseuse et
la lymphopoïèse B. Le couple CXCR4/CXCL12
intervient également dans le recrutement
cellulaire aux sites inflammatoires ; acces-
soirement, CXCR4 est aussi utilisé comme
porte d’entrée dans les lymphocytes CD4 par
certaines souches de VIH.
L’immunoprécipitation de diverses formes
de CXCR4 a permis aux auteurs d’identifi er
sept protéines qu’ils ont toutes caractérisées
*
,
tout en se focalisant essentiellement sur la
nucléophosmine.
Les interactions entre CXCR4, les protéines G
et la nucléophosmine sont explorées en détail,
notamment en relation avec les diverses
boucles intracytoplasmiques du récepteur. Les
conséquences de cette liaison sont examinées
au moyen de tests fonctionnels et sont confi r-
mées en inhibant l’expression de la nucléo-
phosmine ou, au contraire, en l’augmentant.
Les résultats indiquent que la nucléophosmine
se lie à CXCR4 quand celui-ci est activé, notam-
ment par la fi xation de CXCL12. Cette liaison
régule la transduction cellulaire et inhibe la
migration.
La nucléophosmine est une protéine nucléo-
laire qui navigue entre cette localisation et le
cytoplasme. Lorsqu’elle est cytoplasmique, elle
intervient dans la régulation du cycle cellulaire
et de l’apoptose ; un travail précédent avait
déjà montré sa propension à se lier alors à
des protéines sous-membranaires. Dans cette
étude, il est démontré que la nucléophosmine
interfère avec la liaison de CXCR4 aux protéi-
nes G qui interviennent dans la transduction
et la migration cellulaire après engagement de
ce récepteur. L’activité chimiotactique est ainsi
inversement proportionnelle à la quantité de
nucléophosmine intracytoplasmique.
Dans les LAM où les mutations entraînent une
accumulation cytosolique de nucléophosmine,
les cellules pourraient ainsi avoir des propriétés
chimiotactiques restreintes et une moindre
capacité à générer un microenvironnement
favorable à leur prolifération.
On peut noter en contrepoint que l’expression
de CXCR4 a été récemment identifi ée comme un
facteur de mauvais pronostic dans les LAM.
M.C. Béné, Nancy
* Variant de la kinectin, mannosyl-oligosaccharide glucosidase,
sous-unité de la CoA dehydrogenase, Hsp70 et Hsp70 cognate,
repressor of estrogen receptor activity
Zhang W, Navenot JM, Frilot NM et al. Association of
nucleophosmin negatively regulates CXCR4-mediated
G protein activation and chemotaxis. Mol Pharmacol
2007;72:1310-21.
EST-IL TOUJOURS D’ACTUALITÉ
DE TRAITER DE MANIÈRE INTENSIVE
LES LAM DES PATIENTS ÂGÉS ?
Chez des patients de plus de 65 ans atteints
de leucémie aiguë myéloïde (LAM), une étude
récente du Groupe français des leucémies aiguës
(ALFA) montrait la supériorité, en termes de
survie globale et de survie sans maladie, d’un
traitement ambulatoire par 6 cures mensuelles de
consolidation par rapport à une chimiothérapie
intensive d’entretien. Les résultats d’une équipe
allemande viennent compléter ces données, les
auteurs déconseillant de proposer une induc-
tion aux patients de plus de 60 ans ayant une
LAM associée à un caryotype défavorable. Leur
conclusion repose sur l’analyse de 160 patients
âgés de plus de 60 ans, parmi lesquels 144
avaient une LAM (72 LAM de novo, 42 secon-
daires à une myélodysplasie et 30 myélodyspla-
sies). Tous les sujets ont eu un caryotype. Les
caryotypes de mauvais pronostic sont défi nis
par plus de trois anomalies chromosomiques
ou une anomalie touchant le chromosome 7. La
chimiothérapie d’induction associait idarubicine
(12 mg/m2 J1-J3) et cytarabine (200 mg/m2 J1-J5)
± tioguanine ou étoposide. Le taux de rémission
complète (RC) est de 49 % pour les patients au
caryotype de mauvais pronostic versus 70 %
pour les autres. La médiane de survie est de
9,5 mois tous patients confondus, mais elle
❏
Nucléophosmine rime-t-il
avec chémokines ?
Est-il toujours d’actualité de
traiter de manière intensive les
LAM des patients âgés ?
La maladie de Gaucher :
une prédisposition
aux hémopathies malignes ?
Confirmation de l’efficacité
des lymphocytes T anti-EBV
dans les lymphoproliférations
postgreffe
Immunothérapie dans les
lymphomes pédiatriques ?

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. II - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2007
176
176
revue de presse
tombe à 4 mois pour le groupe à caryotype de
mauvais pronostic versus 18 mois pour le groupe
à caryotype normal. Une telle différence s’ob-
serve même lorsque les patients ont obtenu une
RC. En effet, le taux de rechute et la médiane de
survie sont respectivement de 59 % et de 19 mois
pour les patients ayant un caryotype normal,
alors que quasiment tous les patients ayant un
caryotype de mauvais pronostic ont rechuté : leur
médiane de survie était de 4 mois. Les auteurs
font remarquer que cette survie est identique
à celle observée chez les patients du registre
de Dusseldörf, qui bénéfi ciaient uniquement
d’un traitement symptomatique. Il est clair que
ces différentes études incitent à reconsidérer la
stratégie thérapeutique dans cette tranche d’âge,
ce d’autant plus que de nouvelles molécules
sont maintenant à notre disposition, comme
les agents déméthylants, alliant effi cacité et
tolérance.
L. Legros, Nice
Gardin C, Turlure P, Fagot T et al. Postremission treat-
ment of elderly patients with acute myeloid leukemia
in fi rst complete remission after intensive induction
chemotherapy: results of the multicenter randomized
Acute Leukemia French Association (ALFA) 9803 trial.
Blood 2007;109(12):5129-35.
Knipp S, Hildebrand B, Kündgen A et al. Intensive
chemotherapy is not recommended for patients aged
>60 years who have myelodysplastic syndromes or acute
myeloid leukemia with high-risk karyotypes. Cancer
2007;110(2):345-52.
LA MALADIE DE GAUCHER :
UNE PRÉDISPOSITION
AUX HÉMOPATHIES MALIGNES ?
La maladie de Gaucher est le désordre lysoso-
mial héréditaire le plus fréquent. Son incidence
est estimée aux États-Unis de 3 à 5/100 000
par an. Elle est caractérisée par un défi cit en
glucocérébrosidase responsable d’une hépa-
tosplénomégalie, de cytopénies, de douleurs
osseuses, etc. Le type I, représentant plus de
90 % des cas, n’est pas associé à une atteinte
neurologique, et est diagnostiqué à tout âge ;
le type II est marqué par une atteinte cérébrale
sévère et précoce, alors que le type III présente
une atteinte neurologique modérée et retardée.
Les types I et III bénéfi cient d’un traitement de
substitution par Cerezyme®.
Depuis les années 1980, la maladie de Gaucher
est présentée comme pouvant augmenter le
❏
❏
risque de myélome multiple (1). Récemment, en
étudiant 2 742 patients du registre international
de la maladie de Gaucher, B.E. Rosenbloom
retrouvait un risque relatif (RR) de myélome
de 5,9, alors que celui des autres cancers ne
semblaient pas augmenter (2).
Afi n de confi rmer ces données, l’équipe de
O. Landgren a étudié les cas de patients atteints
de maladie de Gaucher suivis dans les hôpitaux
américains traitant les vétérans.
Entre juillet 1969 et septembre 1996,
1 525 adultes atteints de la maladie de Gaucher
ont été suivis dans 142 hôpitaux pour vétérans.
Aucun cancer ne devait être diagnostiqué dans
la première année. Le suivi médian était de
plus de 12 ans. L’incidence des cancers a été
comparée à celle observées chez des vétérans
de même âge suivis durant la même période
(832 294 noirs américains et 3 668 983 cauca-
siens). Aucun autre groupe ethnique n’a été
inclus dans cette étude, ni aucune femme.
Résultats. Sur l’ensemble des malades suivis, 137
ont développé un cancer. Si le risque global de
cancer n’est pas augmenté (RR : 0,91), il existe en
revanche une prédisposition aux lymphomes non
hodgkiniens (RR : 2,54), aux mélanomes malins
(RR : 3,07) ainsi qu’aux cancers du pancréas
(RR : 2,37). Seuls deux patients ont présenté un
myélome, ce qui n’a pas permis de confi rmer les
données de R.E. Lee et B.E. Rosenbloom.
Commentaire. Une fois de plus, une large cohorte
confi rme le lien entre la maladie de Gaucher et
l’hémopathie maligne. Le fait qu’il existe une dif-
férence entre les résultats de B.E. Rosenbloom et
ceux présentés ici, l’un mettant en valeur le myé-
lome et l’autre les lymphomes non hodgkiniens,
peut être en partie expliqué par la différence
d’approche des deux auteurs. B.E. Rosenbloom
a étudié le registre international ; celui-ci com-
prend des malades de tout âge, des deux sexes
et d’origines très variées, et les comparaisons
avec des populations de référence sont diffi ciles.
R.E. Landgren a utilisé des populations de même
type en guise de comparaison mais constituées
uniquement d’hommes adultes. Les patients
étant tous des vétérans de l’armée, il est très
probable que l’immense majorité ait présenté
une maladie de Gaucher de diagnostic tardif, un
Gaucher précoce étant généralement incompa-
tible avec la carrière militaire.
Ainsi, un suivi hématologique rapproché des
malades atteints de Gaucher semble justifi é.
La raison de cette prédisposition est encore
fl oue mais la stimulation chronique du système
immunitaire semble en jeu. De même, le rôle
éventuellement préventif du traitement subs-
titutif précoce reste à étudier.
S. Choquet, Paris
1. Lee RE. The pathology of gaucher disease. In:
Desnick RJ. Gaucher disease: a century of delineation
and research. New York: Alan R Liss Inc, 1982:177-217.
2. Rosenbloom BE, Weinreb NJ, Zimran A et al. Gaucher
disease and cancer incidence: a study from the Gaucher
registry. Blood 2005;105:4569-72.
Landgren O, Turesson I, Gridley G et al. Risk of mali-
gnant disease among 1,525 adult male US veterans with
Gaucher Disease. Arch Intern Med 2007;167:1189-94.
CONFIRMATION DE L’EFFICACITÉ
DES LYMPHOCYTES T ANTI-EBV
DANS LES LYMPHOPROLIFÉRATIONS
POSTGREFFE
Les lymphoproliférations post-transplantation
(LPT) sont des complications rares et sévères des
greffes d’organes. En dehors de la baisse initiale
de l’immunosuppression, il n’existe pas de
consensus thérapeutique. Dans le cadre des LPT
Epstein-Barr-virus-positive (EBV+), l’utilisation de
lymphocytes T cytotoxiques (LTC) est séduisante.
Les LTC autologues, activés contre l’EBV, ont
été utilisés essentiellement dans les greffes de
cellules souches hématopoïétiques (CSH). Mais
leur utilisation après greffe d’organe est délicate :
la tumeur peut provenir des cellules du donneur
et donc être HLA incompatible, l’activation des
LTC est diffi cile sous immunosuppresseur, et
l’amplifi cation est longue alors que l’évolution
tumorale est souvent rapide. L’utilisation de LTC
hétérologues (allogéniques) provenant d’une
banque permet de contourner ces écueils. En
2002, T. Haque et al. avaient publié les résultats
préliminaires portant sur les injections de LTC
anti-EBV dans des LPT EBV+ (1).
Il s’agit ici d’une mise à jour des résultats de
cette étude de phase II multicentrique.
La banque de lignées T anti-EBV a été constituée
à partir d’une centaine de donneurs de sang écos-
sais, séropositifs pour l’EBV. Les LCT sont activés
par des cellules irradiées, infectées par l’EBV, et
testées pour une éventuelle autoréactivité.
❏

177
177
Correspondances en Onco-hématologie - Vol. II - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2007
Revue de presse
Les tumeurs doivent être EBV+ et il doit exister
au moins deux homologies HLA A, B ou DR
avec le malade pour sélectionner une lignée.
Les patients sont inclus, soit après échec de la
baisse de l’immunosuppression, avec ou sans
antiviral, soit après au moins une première
ligne de traitement. En moyenne, les patients
ont reçu quatre injections.
Résultats. Au total, 33 patients ont été inclus :
19 après seulement un échec de baisse de l’im-
munosuppression (BIS) avec ou sans antiviral,
un après BIS et radiothérapie localisée, un
après BIS et chirurgie, et 12 après BIS et rituxi-
mab et/ou chimiothérapie. Deux allogreffes de
CSH ont été incluses, toutes deux résistantes
au rituximab ou à la chimiothérapie.
Le taux de réponse est de 63 % à 5 semaines
(36 % de RC) et de 51 % (42 % de RC) à 6 mois.
Deux LPT avec localisations cérébrales et les
deux allogreffes de CSH ont été mises en RC.
Cinq patients sont décédés entre l’inclusion et
la date prévue de la première injection.
Les facteurs prédictifs d’une réponse ont été
le degré d’homologie HLA (p = 0,048) et le
pourcentage de cellules CD4+ injectées, avec
plus de 90 % de réponse au-delà de 5 % de
lymphocytes CD4+ (p = 0,001).
Commentaire. Avec cette série plus étoffée,
l’équipe de T. Haque confi rme la faisabilité et
l’effi cacité des lymphocytes T allogéniques
anti-EBV dans les LPT. Cette méthode permet
d’éviter les longues et incertaines stimula-
tions et amplifi cations des LTC autologues.
On remarquera particulièrement l’effi cacité
de ce traitement dans les allogreffes de CSH,
habituellement sensibles aux thérapies cel-
lulaires, et pour les localisations cérébrales,
classiquement résistantes au rituximab.
Quelques remarques et réserves peuvent toute-
fois être émises.
Le typage HLA de la tumeur n’est pas recher-
ché, or il n’est pas exceptionnel que la tumeur
provienne de cellules du donneur d’organe.
Dans ce cas, les cellules sont mal sélectionnées
et ineffi caces.
Il n’y a aucun détail sur les éventuels rejets
d’organe après injection.
Vingt et un patients ont eu seulement une BIS ;
les antiviraux – a fortiori l’acyclovir, le valganciclo-
vir et le ganciclovir – n’ont aucune effi cacité dans
les LPT et ne peuvent être considérés comme une
ligne thérapeutique. Dans ce contexte, une nette
•
•
•
majorité des patients a été traitée en première
ligne, une indication maintenant reconnue du
rituximab. Le taux de réponse est pour ces malades
de 57 % à 6 mois, dont 47,6 % de RC.
Les 10 patients greffés et traités après échec
de rituximab et/ou de chimiothérapie ont un
taux de réponse de seulement 30 % à 6 mois,
dont 20 % de RC.
Deux patients sont décédés avant injection,
en première ligne, sans avoir reçu de rituxi-
mab, ce qui constitue une attitude diffi cilement
défendable sur le plan éthique.
Il existe en France une étude de phase I/II
similaire, limitée aux patients réfractaires, en
rechute ou en mauvaise réponse après au moins
une première ligne thérapeutique, rendant cette
technique disponible pour nos équipes.
Ainsi, l’utilisation des LTC allogéniques anti-
EBV est prometteuse et doit trouver sa place,
notamment en association.
S.C.
1. Haque T, Wilkie GM, Taylor C et al. Treatment of
Epstein-Barr-virus-positive post-transplantation lympho-
proliferative disease with partly HLA-matched allogeneic
cytotoxic T cells. Lancet 2002;360(9331):436-42.
Haque T, Wilkie GM, Jones MM et al. Allogeneic cyto-
toxic T-cell therapy for EBV-positive post-transplantation
lymphoproliferative disease: results of a phase II multi-
center clinical trial. Blood 2007;110:1123-31.
IMMUNOTHÉRAPIE DANS LES
LYMPHOMES PÉDIATRIQUES ?
Si l’utilisation d’anticorps monoclonaux théra-
peutiques, notamment dirigés contre CD20,
est devenue un standard en onco-hématologie
adulte, cette attitude n’est pas encore complè-
tement adoptée par les pédiatres. Pourtant,
au moins un essai franco-américain est en
cours, comme le rapportent ses auteurs qui
s’interrogent sur d’autres cibles potentielles
de l’immunothérapie dans les lymphomes
de l’enfant. L’étude anatomopathologique
et immunohistochimique rapportée dans ce
travail a ainsi examiné le niveau d’expression
de quatre molécules :
CD25, chaîne alpha du récepteur à l’IL-2 ;
CD52, la petite molécule GPI reconnue par
CAMPATH ;
CD74, la chaîne invariante associée à
l’apprêtement de classe II dans les cellules
présentatrices d’antigène ;
•
•
❏
✔
✔
✔
CD80, molécule de costimulation impliquée
dans la reconnaissance antigénique et l’acti-
vation cellulaire.
La série testée comportait des échantillons
prélévés sur 88 enfants : 25 lymphomes de
Burkitt, 19 lymphomes lymphoblastiques T,
9 lymphomes lymphoblastiques B, 15 lympho-
mes B à grandes cellules et 20 lymphomes
anaplasiques à grandes cellules.
CD25, qui peut être ciblée par une protéine
de fusion associant IL-2 et toxine diphtérique
(denileukin difi tox), apparaît surtout exprimée
sur les cellules de lymphomes anaplasiques,
mais très peu dans les autres cas, y compris
les lymphomes T.
L’expression de CD52 est la plus hétérogène,
même si sa détection était effective dans près
de 99 % des cas testés. Ces résultats diffèrent
de l’étude récente rapportée par Rodig et al. ; les
auteurs s’interrogent sur les raisons techniques
éventuelles de cette discordance, et sur la signifi -
cativité de cette variation d’expression en regard
de l’effi cacité potentielle de l’alemtuzumab.
CD74 est exprimée physiologiquement de façon
très transitoire à la surface des cellules au cours
de l’exportation membranaire des molécules de
classe II chargées de peptide. Cela pourrait être
corrélé à la pénétration rapide des anticorps anti-
CD74 dans les cellules, mais il faut noter que les
marquages montrés dans cet article semblent
essentiellement intracytoplasmiques. Ils concer-
nent exclusivement les lymphomes B testés.
CD80, enfi n, qui peut être ciblée par le galiximab
en vue d’obtenir une apoptose des cellules tumo-
rales, n’est faiblement exprimée que dans une
petite proportion des lymphomes B, et pas du
tout dans les autres cas, ce qui limite la portée
éventuelle de traitements avec cet anticorps.
On peut noter que, dans tous les cas, des marquages
positifs ont été observés sans ambiguïté dans les
cellules réactionnelles non tumorales.
Les auteurs concluent sur la nécessité de
compléter ces études rétrospectives menées
sur des prélèvements inclus en paraffi ne par des
études plus précises en cytométrie de fl ux sur
cellules fraîches. Ils précisent également l’intérêt
potentiel d’immunothérapies ciblées dans les
lymphomes pédiatriques de mauvais pronostic.
M.C.B.
Miles RR, Cairo MS, Satwani P et al. Immunophenotypic
identifi cation of possible therapeutic targets in paedia-
tric non-Hodgkin lymphomas: a children’s oncology group
report. Br J Haematol 2007;138:506-12.
✔
❏
1
/
3
100%