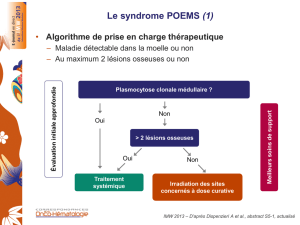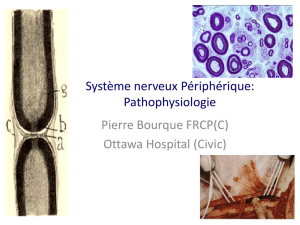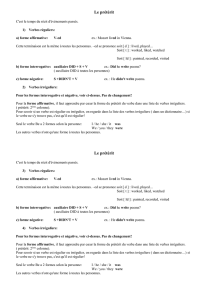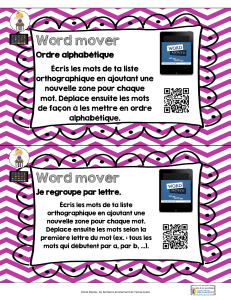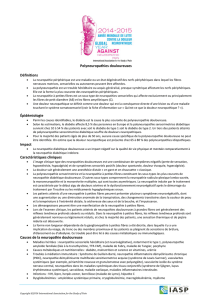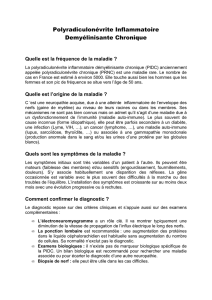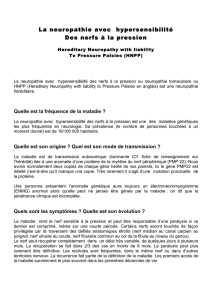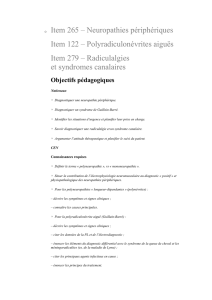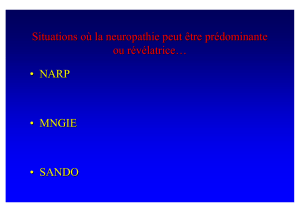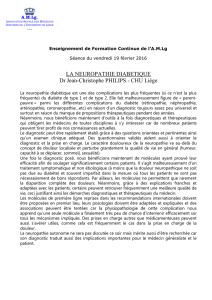Lire l'article complet

La Lettre du Neurologue Nerf & Muscle • Vol. XIII - n° 9 - octobre 2009 | 259
MISE AU POINT
La polyneuropathie
du syndrome POEMS
Polyneuropathy in POEMS syndrome
T. Lenglet*
* Fédération de neurophysiologie
clinique, hôpital de la Pitié-Salpê-
trière, Paris.
Un peu d’histoire
La première description d’un syndrome POEMS a
été rapportée en 1938 par l’Allemand L. Scheinker
à l’issue des données autopsiques d’un patient âgé
de 39 ans et présentant un plasmocytome solitaire
associé à une polyneuropathie sensitivo-motrice et
à des anomalies cutanées (1). La majorité des publi-
cations sont ensuite venues du Japon où l’incidence
du syndrome POEMS serait la plus grande et où il
est encore régulièrement rapporté sous le terme de
syndrome de Crow-Fukase. Ainsi, en 1956, R. Crow
a établi un lien complexe entre la survenue d’une
dyscrasie plasmocytaire et d’une polyneuropathie
à partir de la description de 2 patients qui, outre
des lésions de myélome ostéosclérotique et une
neuropathie, présentaient des symptômes à type de
mélanodermie, d’hippocratisme digital et d’œdèmes
des chevilles (2). Par la suite, plusieurs auteurs ont
insisté sur la surincidence d’une polyneuro pathie
dans le contexte de myélome ostéosclérotique
(environ 50 % des patients) par opposition au
myélome multiple (1 à 8 % des patients), laissant
présager des pathologies distinctes. La survenue de
manifestations systémiques associées à la neuro-
pathie dans le contexte de lésions ostéosclérotiques
a été précisée dans les années 1970 dans une étude
de H. Iwashita et al. portant sur 30 patients (3).
C’est en 1980 que P.A. Bardwick a proposé d’indivi-
dualiser l’entité sous l’acronyme POEMS (polyneu-
ropathie, organomégalie, endocrinopathie, protéine
monoclonale et anomalies cutanées [skin changes]).
Par la suite, les connaissances sur la pathologie ont
essentiellement progressé grâce à l’analyse de trois
grandes séries : celle de T. Nakanishi et al. à propos
de 102 patients japonais, celle progressivement
enrichie à 99 patients de la Mayo Clinic et récem-
ment rapportée par A. Dispenzieri et al., et la série
française de 25 patients de M.J. Soubrier et al. (4-6).
Critères diagnostiques
du syndrome POEMS
Ils sont régulièrement revisités, mais la polyneuro-
pathie y conserve une place de choix. En 1992,
G.D. Miralles et al. avaient souligné la coïncidence
évolutive et pronostique entre une dyscrasie lympho-
plasmocytaire compliquée d’une polyneuropathie et
le syndrome POEMS “complet” selon les critères de
Bardwick (Bardwick PA, Zvaifler NJ, Gill GN et al. Medi-
cine 1980;59[4]:311-22). Ils introduisaient ainsi la
possibilité d’un continuum entre les deux pathologies
et l’existence d’un syndrome POEMS “incomplet” (7).
En 2003, l’étude rétrospective des trois principales
séries a permis à A. Dispenzieri et al. d’établir une liste
de critères diagnostiques censés écarter des diagnos-
tics différentiels hématologiques de type gamma-
pathie monoclonale de signification indéterminée
(MGUS), myélome multiple, maladie de Waldenström
ou encore amylose systémique primaire, et de porter
rapidement le diagnostic de syndrome POEMS.
L’ accent était porté sur la polyneuropathie et la
dyscrasie plasmocytaire, critères majeurs et constants
dont l’association à un signe mineur (parmi les lésions
ostéosclérotiques, la maladie de Castleman, l’organo-
mégalie, les signes cutanés et endocriniens, ou le
syndrome œdémateux) était nécessaire et suffi-
sante pour le diagnostic de syndrome POEMS. Ces
critères diagnostiques ont rapidement été remis en
cause du fait d’une spécificité imparfaite (8), et de
l’ absence de référence au Vascular Endothelial Growth
Factor (VEGF), facteur pathogène caractéristique
du syndrome (cf. Pathogénie de la polyneuropathie,
p. 264) et dont l’élévation est quasi systématique
au cours du syndrome POEMS (9). À partir de ces
données, A. Dispenzieri a tout récemment émis de
nouvelles recommandations (tableau). Désormais, le
diagnostic repose sur l’association indispensable des
deux critères majeurs (polyneuro pathie et dyscrasie

260 | La Lettre du Neurologue Nerf & Muscle • Vol. XIII - n° 9 - octobre 2009
Résumé
plasmocytaire), d’un critère majeur supplémentaire
parmi les lésions ostéosclérotiques, la maladie de
Castleman et l’élévation du VEGF. Un critère mineur
doit enfin également être associé, parmi lesquels
l’organomégalie, l’endocrinopathie, les anomalies
cutanées, le syndrome œdémateux, l’œdème papil-
laire, la thrombocytose ou la polycythémie.
Cela dit, le débat sur les critères diagnostiques n’est
peut-être pas clos, puisqu’il a tout récemment été
rapporté un premier cas de manifestations systé-
miques et cutanées classiques du syndrome POEMS
couplées à une élévation franche du VEGF, mais en
l’absence de polyneuropathie tant d’un point de vue
clinique qu’électrique (10)...
Présentation clinique
de la polyneuropathie,
signe inaugural
du syndrome POEMS
Tenir compte des signes
extraneurologiques
Le syndrome POEMS touche 2 hommes pour
1 femme avec un âge moyen de survenue situé entre
40 et 60 ans (5). Cependant, des sujets jeunes, voire
des adolescents, peuvent être concernés (11). La
polyneuropathie constitue dans l’immense majo-
rité des cas le signe inaugural (4-6). Le neurologue
a donc un rôle clé dans la démarche diagnostique
de syndrome POEMS : c’est lui qui le plus souvent
initiera et orientera le bilan étiologique de cette
polyneuro pathie.
L’installation de la neuropathie est le plus souvent
lente (plusieurs mois), mais elle s’effectue parfois de
façon rapidement progressive sur quelques semaines.
Des débuts sous la forme de poussées rémittentes
isolées ont été exceptionnellement évoqués, mais
ces dernières sont vraisemblablement influencées
par les thérapeutiques employées (12). La neuro-
pathie débute par un déficit sensitif symétrique distal
conjuguant troubles de la sensibilité superficielle
et profonde (ataxie proprioceptive) avec aréflexie,
le tout initialement limité aux membres inférieurs.
Dans notre expérience, les douleurs inaugurales des
pieds à type de brûlures sont fréquemment évoquées
par les patients, alors que A. Dispenzieri et al. consi-
dèrent la neuropathie comme rarement doulou-
reuse (5). Le trouble peut rester durablement sensitif
pur (13), avant de s’associer à un déficit moteur
des membres inférieurs à début symétrique distal.
Un pattern initial proximal de faiblesse motrice n’a
ainsi été qu’exceptionnellement décrit, et parfois
Le syndrome POEMS est un syndrome paranéoplasique rare, secondaire à une dyscrasie plasmocytaire. Il est à
l’origine d’une atteinte multisystémique variable, mais dont la neuropathie périphérique est une manifestation
constante et le plus souvent inaugurale, lui conférant un rôle diagnostique clé. Sa présentation habituelle
est celle d’une polyneuropathie démyélinisante ou axonale et démyélinisante dont les troubles sensitifs
symétriques, puis sensitivo-moteurs débutent et dominent au niveau des membres inférieurs. Elle partage,
tant d’un point de vue clinique qu’électrique, des points communs avec la polyneuropathie inflammatoire
démyélinisante chronique conduisant à de fréquents retards diagnostiques et thérapeutiques. Alors que
l’arsenal de traitements – y compris curatifs – n’a de cesse de s’enrichir, ce retard apparaît préjudiciable
compte tenu du mode évolutif singulier de la polyneuropathie marqué par la survenue, après un délai variable,
d’une perte axonale sévère et rapidement évolutive, responsable d’un handicap fonctionnel irréversible.
Mots-clés
Syndrome POEMS
Polyneuropathie
démyélinisante
chronique
Perte axonale
VEGF
Électroneuro-
myogramme
SUMMARY
POEMS syndrome is a rare
paraneoplastic syndrome
secondary to a plasma cell
dyscrasia in which polyneu-
ropathy is most often the
first symptom, conferring it
a key role for the diagnosis.
It usually presents itself as a
demyelinating or axonal and
demyelinating polyneuropathy
with distal symmetric sensory-
motor disorder beginning
in the lower limbs. It shares
some clinical and electrical
characteristics with chronic
inflammatory demyelinating
polyneuropathy leading to
frequent misdiagnosis. Delayed
treatments are yet harmful as
polyneuropathy associated with
POEMS symptoms is marked by
the occurrence, after a variable
phase, of a severe axonal loss
responsible for a permanent
functional disability.
Keywords
POEMS syndrome
Chronic demyelinating
polyneuropathy
Axonal loss
Electrodiagnosis
Tableau. Critères diagnostiques en vigueur pour le diagnostic de syndrome POEMS (34).
Critères majeurs 1. Polyneuropathie
2. Gammapathie monoclonale (chaîne légère lambda)
3. Lésions ostéosclérotiques
4. Maladie de Castleman
5. Élévation du VEGF
Critères mineurs 6. Organomégalie (splénomégalie, hépatomégalie ou adénomégalie)
7. Syndrome œdémateux (œdèmes des membres inférieurs, épanchement pleural ou ascite)
8. Endocrinopathie (surrénales, thyroïde, hypophyse, gonades, parathyroïdes, pancréas)
9. Signes cutanés (mélanodermie, hypertrichose, angiomes gloméruloïdes, acrocyanose, ongles blancs)
10. Œdème papillaire
11. Thrombocytose/polycythémie
Autres signes Hippocratisme digital, amaigrissement, hyperhydrose, hypertension artérielle pulmonaire,
événements thrombotiques, diarrhée, hypovitaminose B12
Associations possibles Arthralgies, cardiomyopathie (dysfonction systolique), fièvre
Le diagnostic repose sur (1 + 2) + (au moins 1 critère parmi 3 à 5) + (au moins 1 critère parmi 6 à 11).

Figure. Exemples de manifestations cliniques dont l’association à une polyneuropathie
doit faire évoquer l’hypothèse d’un syndrome POEMS.
A. Œdèmes des membres inférieurs. B. Lipo-atrophie faciale. C. Angiomes gloméruloïdes
sous la forme d’une “efflorescence de taches rubis”. D. Hypertrichose visible sur les
phalanges et la face antérieure des genoux.
(Remerciements au Dr J.C. Corvol pour les illustrations).
A
C
B
D
La Lettre du Neurologue Nerf & Muscle • Vol. XIII - n° 9 - octobre 2009 | 261
MISE AU POINT
attribué à une myopathie inflammatoire aspéci-
fique d’évolution favorable avec le traitement du
syndrome POEMS, ou à une imprégnation corti-
sonique prolongée (14). En l’absence de traitement,
l’évolution se fera progressivement vers une atteinte
des 4 membres pouvant aller jusqu’à la tétraplégie.
L’atteinte des nerfs crâniens (si l’on exclut la
survenue fréquente d’un œdème papillaire) n’a été
que très rarement rapportée (4), de même que celle
du système nerveux autonome (15). En revanche,
la survenue d’une insuffisance respiratoire restric-
tive ne serait pas inhabituelle et devrait faire l’objet
d’un dépistage systématique (16). Celle-ci pourrait
en effet rendre compte d’une fragilité respiratoire
particulière des patients présentant un syndrome
POEMS vis-à-vis de thérapeutiques agressives telles
que l’autogreffe.
Il convient d’étendre cette description clinique aux
données de l’étude du liquide céphalo-rachidien
(LCR). Elle met constamment en évidence une
hyperprotéinorachie sans cellule modérée dépassant
exceptionnellement 3 g/l (17), ce qui contribue à
orienter vers un diagnostic erroné de polyradiculo-
névrites inflammatoires démyélisantes chroniques
(PIDC).
La prise en compte par le praticien des éléments
extraneurologiques du syndrome POEMS est
ainsi d’une importance capitale dans l’optique de
favoriser la rapidité du diagnostic. Au moment de
leur première consultation pour la neuropathie, la
majorité des patients présentent en effet des signes
cliniques de syndrome POEMS, dont certains tels
que les œdèmes des membres inférieurs, la lipo-
atrophie faciale dans un contexte d’amaigrissement,
l’angiomatose gloméruloïde spécifique du syndrome
POEMS (18), ou encore l’hypertrichose sont à la
fois d’identification facile et fortement évocateurs
du diagnostic (figure). Le simple interrogatoire
indique parfois la préexistence de lésions osseuses
condensantes ou d’une gammapathie monoclonale
indiquant la réalisation rapide d’un bilan systémique.
Présentation électrique
de la polyneuropathie :
2 patterns distincts
À partir des critères dérivés de ceux de l’AAN et
appliqués à 13 patients vus dans le service entre
1989 et 2004, nous avons pu distinguer deux présen-
tations électrophysiologiques de la neuropathie du
syndrome POEMS (19). La plus fréquente est une
polyneuropathie mixte axonale et démyélinisante
chronique (deux tiers des cas), et la seconde une
polyneuropathie démyélinisante chronique (un tiers
des cas). Ces 2 patterns électrophysiologiques, sans
être précisément décrits, sont évoqués dans des
proportions semblables dans la série de M.J. Soubrier
et al. (6).
La polyneuropathie démyélinisante se caractérise par
une démyélinisation marquée (vitesse de conduc-
tion tronculaire [VCT] médiane : 30 m/s). Celle-ci
s’avère relativement homogène sur le nerf et d’un
nerf à l’autre. S’y associent parfois des aspects de

262 | La Lettre du Neurologue Nerf & Muscle • Vol. XIII - n° 9 - octobre 2009
La polyneuropathie
du syndrome POEMS
MISE AU POINT
dispersion temporelle, signes d’une désynchroni-
sation des potentiels d’action secondaire à une
hétérogénéité des vitesses de conduction au sein
des fibres et probablement en rapport ici avec un
processus de démyélinisation et de remyélinisa-
tion chronique. Cette forme de la neuropathie ne
s’associe, en général, qu’à peu de manifestations
extraneurologiques du syndrome POEMS, ce qui
contribue à en rendre le diagnostic difficile.
La polyneuropathie mixte se caractérise par une
démyélinisation nettement plus modérée (VCT
médiane : 41 m/s), volontiers plus hétérogène d’un
nerf à l’autre et le long du nerf, et rarement associée
à la mise en évidence de blocs de conduction. Ces
derniers siègent essentiellement dans les segments
les plus proximaux des nerfs, ce qui expliquerait que,
dans les séries publiées où l’étude de conduction
étagée est limitée aux segments distaux, ils soient
considérés comme exceptionnels, voire absents
(20, 21).
Diagnostics différentiels
Le contexte de l’apparition très lentement progres-
sive d’un déficit distal moteur et sensitif à tous les
modes couplé à une polyneuropathie franchement
démyélinisante et homogène peut parfois faire envi-
sager le diagnostic de neuropathie de type Charcot-
Marie-Tooth (CMT), dans une forme démyélinisante
de révélation tardive (CMT de type 1). Malgré tout,
l’absence d’antécédents familiaux, le caractère
douloureux de la neuropathie et, d’un point de vue
électrophysiologique, la mise en évidence d’aspects
de dispersion temporelle et/ou de blocs de conduc-
tion et la relative préservation des potentiels sensitifs
sont autant d’éléments de nature à remettre en cause
un diagnostic soupçonné de CMT.
Dans notre expérience cependant, le diagnostic
différentiel le plus souvent évoqué au stade d’une
première évaluation clinico-électrophysiologique est
celui d’une PIDC associée ou non à une gammapathie
monoclonale “de signification indéterminée” ou,
plus exceptionnellement, d’une forme subaiguë de
syndrome de Guillain-Barré. Concernant la PIDC, il
s’agit là aussi d’une neuropathie diffuse sensitivo-
motrice touchant les 4 membres, présentant des
critères de démyélinisation en électrophysiologie
et s’associant à une hyperprotéinorachie. Néan-
moins, sur le plan clinique, la PIDC se caractérise,
dans sa forme la plus habituelle, par une atteinte
motrice proximale plus que distale qui prédomine sur
les troubles de la sensibilité, plus majoritairement
de type proprioceptif. La difficulté à distinguer la
neuropathie du syndrome POEMS et la PIDC provient
essentiellement de la grande variabilité de présen-
tation des PIDC (22). En effet, à côté de la forme
la plus commune, il existe également des formes
sensitives, paresthésiantes et ataxiantes qui peuvent
ressembler à la neuropathie du POEMS dans sa phase
débutante. De la même façon, des formes avec une
répartition distale du déficit sensitivo-moteur sont
connues. Ainsi, lorsque la neuropathie du syndrome
POEMS se présente d’un point de vue électrique dans
sa forme démyélinisante, présentation au cours de
laquelle les signes extraneurologiques sont rares,
elle impose le diagnostic de PIDC. Dans notre expé-
rience, et dans le contexte de polyradiculonévrite
subaiguë ou chronique, les éléments principaux
devant éventuellement orienter le diagnostic vers
une neuropathie du syndrome POEMS sont :
– la répartition distale et initialement limitée aux
membres inférieurs des signes cliniques ; l’existence
de douleurs ;
– une perte axonale précoce ;
– une résistance aux immunoglobulines intra-
veineuses (Ig i.v.) ou aux échanges plasmatiques
(e.p.) ;
– l’existence d’une chaîne légère lambda monoclo-
nale ou d’autres éléments cliniques du syndrome
POEMS qui indiquent un bilan systémique.
Présentation histologique
de la neuropathie
Quelle place pour la biopsie de nerf ?
Les données histologiques confirment le plus souvent
l’association d’une atteinte axonale avec démyé-
linisation primitive. L’étude en microscopie élec-
tronique peut objectiver des fragments de myéline
non compacte, caractéristiques de la neuropathie
du syndrome POEMS et absents dans le cadre des
PIDC (23). Leur signification semble mal connue et ils
sont inconstants. S’y associent un épaississement des
membranes basales des capillaires et un important
œdème endoneural (24). Enfin, il n’est pas observé
d’aspect de démyélinisation secondaire à l’invasion
de la fibre nerveuse par des cellules macrophagiques,
caractéristique des PIDC.
Si l’on se place dans le cas de figure habituel où
la présentation clinique et électrophysiologique
initiale de la neuropathie fait évoquer une PIDC et
que l’on s’en tient aux recommandations en vigueur
pour la recherche d’une pathologie associée (25),

264 | La Lettre du Neurologue Nerf & Muscle • Vol. XIII - n° 9 - octobre 2009
La polyneuropathie
du syndrome POEMS
MISE AU POINT
la biopsie de nerf paraît rarement indiquée. En effet,
la recherche systématique d’une gammapathie
monoclonale associée à la neuropathie conduira
en cas de positivité à un bilan systémique permettant
le plus souvent de remplir les critères diagnostiques
de syndrome POEMS. Il existe cependant des cas
complexes où la confirmation d’une prolifération
lymphoplasmocytaire indispensable au diagnostic de
syndrome POEMS peut initialement faire défaut (26).
La biopsie nerveuse, si elle comprend une étude en
microscopie électronique, peut contribuer dans ces
circonstances à orienter le diagnostic.
Histoire naturelle
de la polyneuropathie
En l’absence de traitement, la neuropathie du
syndrome POEMS se caractérise chez la majorité des
patients par une évolutivité en deux phases. Au cours
de la première phase, dont la durée très variable peut
aller jusqu’à plusieurs mois, la sympto matologie
est dominée par un trouble sensitif peu évolutif.
Si l’examen électrophysiologique est effectué dans
cette période, il met en évidence une polyneuropa-
thie démyélinisante pure ou associée à une perte
axonale limitée avec peu de dénervation active
en détection, et les signes extraneurologiques de
syndrome POEMS apparaissent peu nombreux. La
seconde phase est caractérisée par une “acutisa-
tion” avec installation rapide d’un déficit sensitivo-
moteur ascendant couplé sur le plan électrique à
une perte axonale sévère et franchement évolutive.
Parallèlement, les manifestations systémiques du
syndrome POEMS se multiplient. Pour un certain
nombre de patients, la première phase est “absente”
avec l’installation d’emblée, rapide et linéaire du
trouble neurologique qui rend le retard diagnostique
et thérapeutique d’autant plus préjudiciable.
Pathogénie
de la polyneuropathie
La pathogénie du syndrome POEMS reste mysté-
rieuse. Son association aux pathologies lympho-
prolifératives et sa possible disparition après
traitement radical d’un plasmocytome font évoquer
l’hypothèse d’un phénomène paranéoplasique médié
par un agent produit par des plasmocytes anormaux.
Il en découlerait une élévation de cytokines pro-
inflammatoires (IL-1b, TNFα et IL-6) conduisant à
une activation du VEGF. Ce dernier est un facteur
de prolifération angiogénique et d’augmentation de
la perméabilité vasculaire, actuellement considéré
comme le principal facteur pathogène de l’affec-
tion. En 1998, O. Watanabe rapportait ainsi l’élé-
vation spécifique du VEGF dans le sérum de 7 des
10 patients atteints de syndrome POEMS versus
aucun des sujets contrôles qu’il s’agisse de sujets
sains, atteints de PIDC, d’un syndrome de Guillain-
Barré ou d’autres pathologies neurologiques (27).
Par la suite, son augmentation était retrouvée dans
la quasi totalité des 74 observations publiées dans
lesquelles le dosage avait été effectué. Il est vrai-
semblable que l’élévation du VEGF rende compte
de la survenue de l’organomégalie, du syndrome
œdémateux, des hémangiomes gloméruloïdes, et
qu’il constitue également un régulateur de diffé-
renciation ostéoblastique (28).
La polyneuropathie dans le syndrome POEMS décou-
lerait, elle aussi, directement des propriétés du VEGF.
En effet, une altération de la barrière sang-nerf –
conséquence de l’hyperperméabilité microvasculaire
– et un trouble de coagulation microvasculaire, tous
deux induits par l’élévation du VEGF, seraient à l’ori-
gine de l’atteinte neurologique. Récemment, M. Scar-
lato et al. ont pu démontrer, à partir de l’étude
histologique de nerfs de 11 patients, un lien entre
le taux sérique de VEGF et son expression sur le nerf
au niveau de l’endothélium vasculaire, mais égale-
ment des cellules de Schwann, ne participant pas à
la formation de myéline (29). L’élévation du VEGF
était également corrélée à l’importance de la proli-
fération et de l’hypertrophie des cellules endothé-
liales des vaisseaux de l’endonèvre, conduisant à leur
occlusion et ainsi à l’aggravation neurologique. Dans
cette étude, le VEGF constituait un facteur pronos-
tique, puisqu’un taux inférieur à 1 500 pg/ml avant
traitement était associé à une meilleure réponse
thérapeutique. Il existait également une corrélation
inverse entre les taux de VEGF et d’érythropoïétine
(EPO). La production de VEGF est sous la dépendance
d’un facteur de transcription dont une sous-unité α
est induite par l’hypoxie (30). Il est plausible que,
au-delà d’un certain seuil d’occlusion vasculaire,
l’hypoxie induite provoque un “emballement” de
la production de VEGF et contribue localement à
l’exacerbation de l’œdème endoneural et à l’aggra-
vation rapide des lésions neurologiques.
Le mécanisme de l’atteinte neurologique n’est cepen-
dant peut-être pas univoque et, s’il est vraisemblable
que des taux élevés de VEGF conduisent systéma-
tiquement à une micro-angiopathie thrombotique
endoneurale responsable de la gravité du tableau
neurologique, il n’est pas exclu que d’autres méca-
 6
6
 7
7
1
/
7
100%