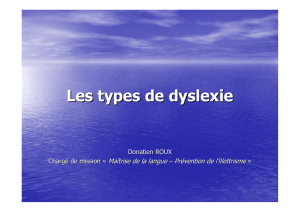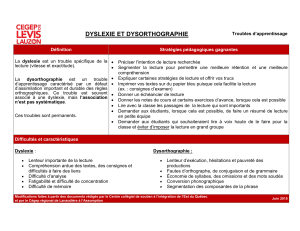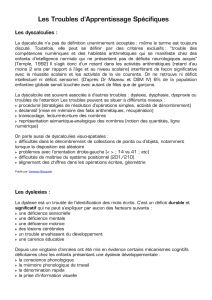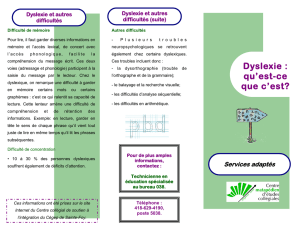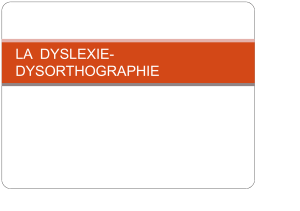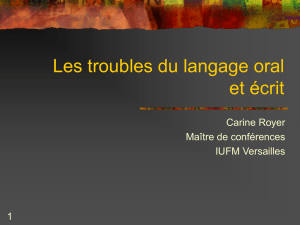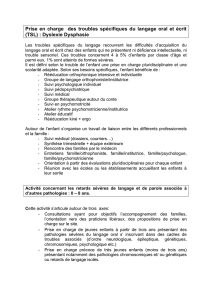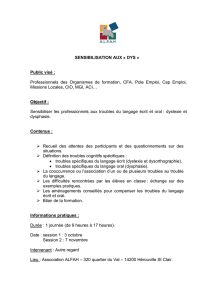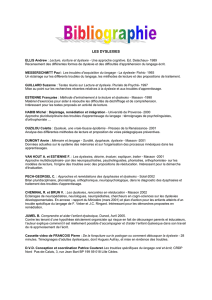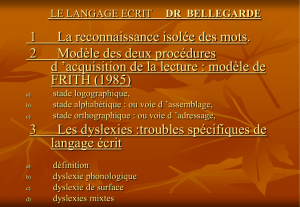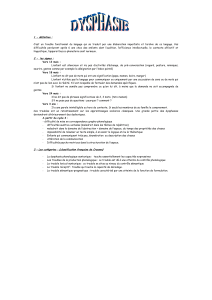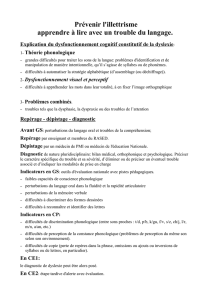Lire l'article complet

Les troubles du langage oral
Quand y a-t-il pathologie du
langage, comment dépister un tel
trouble ?
Le langage est constitué d’un versant
réceptif comportant la compréhension
lexicale, sémantique ou grammaticale
ainsi que la perception de la parole,
dont la discrimination des sons
proches (le “cra” de crapaud et le
“dra” de drapeau) et la métaphonologie
(conscience que la parole peut être
découpée en unités : la phrase en mots,
le mot en syllabes [lavabo : la-va-bo]
ou en phonèmes [l-a-v-a-b-o]). Le ver-
sant expressif comporte l’évocation
lexicale et les systèmes phonologique,
syntaxique, sémantique et pragma-
tique. Les études longitudinales du
développement normal du langage
montrent qu’avant 3 ans-3 ans et demi,
les systèmes phonologique et syn-
taxique se développent très différem-
ment d’un enfant à l’autre (1), pour
aboutir finalement à cet âge à un
niveau comparable chez tous les
enfants. Silva (2) a effectué la princi-
pale enquête épidémiologique pros-
pective sur une population d’environ
1000 enfants de 3 ans. Elle a montré
que 7 % de ces enfants présentaient un
déficit, soit de l’expression, soit de la
compréhension, soit des deux asso-
ciées. En outre, le suivi longitudinal
montre la signification réelle d’un tel
déficit, puisque près de 40 % de la
population déficitaire aura, à 7 ans et
demi, soit un déficit du langage oral,
soit du langage écrit, soit une défi-
cience mentale. C’est peu dire que la
politique médicale du “ça s’arrangera”
n’a pas de sens, même si tout déficit à
cet âge n’a pas forcément une signifi-
cation définitivement pathologique.
La signification d’un déficit du lan-
gage oral est très différente selon qu’il
s’agit d’un déficit modéré et isolé, ou
isolé et sévère, ou situé dans un
contexte pathologique débordant le
langage.
Le souci pratique de repérer ou de
dépister tôt les troubles du langage
afin d’agir efficacement a conduit au
développement d’outils cliniques qui
permettent d’apprécier le niveau de
langage d’un enfant en référence à une
population normale. Le questionnaire
de Chevrie-Müller (ANAE, 75017
Paris [3]) et l’OPL 3 (Ortho-Éditions,
62330 Isbergues) permettent de repé-
rer les troubles dès l’âge de 3 ans.
L’ERTL 4 (4), l’ERTLA 6 (Com-
Medic, 54500 Vandœuvre) et la batte-
rie mise au point par Zorman et
Jacquier-Roux (Cogni Sciences,
38100 Grenoble) s’adressent égale-
ment à une seule tranche d’âge (res-
pectivement 4 et 5-6 ans). La BREV,
plus complète et soigneusement éva-
luée (Kiosque production, 75013 Paris
[5, 6]), permet un examen sommaire
des fonctions verbales, non verbales,
de l’attention, de la mémoire et des
apprentissages chez les enfants de 4 à
9 ans, afin de dépister ceux qui
seraient porteurs d’un déficit et d’en
préciser le profil. Ces batteries ne sont
pas des outils formels de diagnostic.
Les enfants suspects doivent alors être
testés de façon conventionnelle par un
bilan orthophonique lorsque le déficit
langagier est isolé ou, de façon plus
complète, lorsque le déficit ne
concerne pas uniquement le langage.
e langage oral est le principal
outil de communication. C’est
un système symbolique qui
s’élabore en interaction étroite
avec l’intelligence et la pensée. Son
développement nécessite donc des
fonctionnements cognitif, psychique
et sensoriel adéquats et harmonisés.
L’environnement socioculturel joue éga-
lement un rôle important. Un trouble
du développement du langage peut
donc avoir plusieurs significations,
d’où l’importance de savoir le dépister
et diagnostiquer le cadre dans lequel il
se situe.
L’apprentissage du langage écrit
constitue l’un des principaux objectifs
de l’école primaire. La fréquence des
dyslexies dysorthographies est évaluée
entre 3 et 10 % des enfants d’âge sco-
laire. Elles représentent une des
grandes causes de l’échec scolaire et,
faute de prise en charge correcte, elles
peuvent conduire à l’illettrisme. Elles
génèrent chez ces enfants et leurs
familles une grande souffrance liée à la
situation d’échec et à l’insuffisance,
dans notre pays, de la mise en œuvre
de solutions pédagogiques et rééduca-
tives .
L
* Catherine Billard est médecin
des hôpitaux, neurologue, pédiatre
et neuropsychologue. Elle a consacré
son activité clinique, d’enseignement
et de recherche à la lutte contre les
troubles spécifiques et sévères des
apprentissages de l’enfant. Elle dirige
une unité hospitalo-universitaire dans le
service de neuropédiatrie de l’hôpital
de Bicêtre, où sont pratiqués le diagnostic,
l’évaluation et la prise en charge
de ces déficits. Elle travaille également
à la création d’un partenariat étroit
en réseau ville-hôpital, avec les repré-
sentants de l’Éducation nationale
et les professionnels libéraux assurant
les soins. Enfin, sa recherche clinique
a contribué à améliorer le dépistage
de ces troubles, et ses liens avec
la recherche fondamentale à en assurer
les soins.
Plate-forme : troubles du langage II
85
Act. Méd. Int. - Neurologie (4) n° 3, avril 2003
Les troubles de l'apprentissage
du langage chez l’enfant
C. Billard*
Plate-forme

Déficits secondaires et primitifs
du langage
La première démarche devant un
trouble du développement du langage
est de différencier les déficits secon-
daires des déficits spécifiques. Dans
les déficits secondaires, le trouble du
développement du langage oral peut
être expliqué par une autre pathologie.
Le retard mental en est la cause la plus
fréquente et les compétences verbales
doivent toujours être comparées aux
compétences non verbales. En cas de
doute sur les compétences non ver-
bales, l’intelligence non verbale doit
être mesurée par un test psycho-
métrique (W1PPSI ou WISC). Une
surdité, une paralysie des organes de
la voix, une infirmité motrice céré-
brale sont également responsables de
troubles secondaires du langage oral.
Les troubles de la communication, en
particulier les troubles envahissants du
développement, se présentent aussi
comme un trouble du développement
du langage oral associé à un trouble
des communications visuelle et tactile.
Enfin, les carences psychoaffectives et
socioculturelles profondes peuvent
également entraîner un déficit du
développement du langage oral. Les
troubles spécifiques (ou primitifs) du
langage oral se définissent, au
contraire, comme les troubles ne s’ex-
pliquant pas par un des grands cadres
pathologiques évoqués. Les retards de
langage et les dysphasies de dévelop-
pement sont les deux cadres de ces
troubles spécifiques du développe-
ment du langage oral.
Du retard de langage aux dysphasies
de développement
Les dysphasies de développement se
définissent comme un trouble du
développement du langage oral sévère,
spécifique, structurel, durable, perdu-
rant bien au-delà de 6 ans, tandis que
les retards de langage se caractérisent
par un langage se développant avec
délai, mais en suivant les étapes habi-
tuelles et se normalisant avant ou
autour de 6 ans. Dans les deux cadres,
le trouble du langage oral est spéci-
fique. Sans que l’on dispose de
chiffres épidémiologiques formels, on
estime que les retards sont de loin les
plus fréquents et que les dysphasies
sont rares (0,5 à 1 % des enfants).
La symptomatologie des retards de
langage est caractérisée par un déficit
isolé de la production phonologique,
syntaxique et éventuellement de l’évo-
cation lexicale. La production phono-
logique est simplifiée (élision :
“voitu” pour “voiture” ; inversion des
groupes consonantiques : “carpo”
pour “crapaud”). La cible est recon-
naissable. Les phrases sont aussi sim-
plifiées avec des articles supprimés,
des verbes non conjugués et des
formes immatures (“à le garçon” pour
“au garçon”). Le langage s’étaye sur
celui de l’adulte et les formes incor-
rectes sont progressivement rempla-
cées par les formes correctes. Le voca-
bulaire est éventuellement pauvre.
La symptomatologie des dysphasies
de développement est caractérisée par
des signes communs quasi constants et
par une grande diversité du déficit du
langage oral qui conditionne la diver-
sité des prises en charges et du pro-
nostic (6). Le trouble du langage oral
touche toujours l’expression du lan-
gage, qui reste inintelligible pour l’en-
tourage, bien au-delà de 6 ans. Il
affecte toujours, mais à un degré et
sous une forme variables, la phono-
logie et la structure de la syntaxe. S’il
existe une simplification, comme dans
le retard de langage, il existe aussi des
signes de déviance du langage,
comme des complexifications (“pala-
papluie” pour “parapluie”), des pro-
ductions longtemps loin de la cible
(“ani” pour “parapluie”), de nom-
breuses approches phonémiques (“ra”,
“rami”, “rapi”, puis “radis”), et des
paraphasies sémantiques (“fourchette”
pour “cuillère”), ou phonémiques
(“raladateu” pour “radiateur”). Les
productions ne sont jamais stabilisées,
et les formes très pathologiques
coexistent longtemps avec les formes
simplifiées ou normales, témoignant
Plate-forme : troubles du langage II
86
C
aroline, à 4 ans, parle mal. La passation
de la BREV montre que ses compé-
tences en graphisme, raisonnement spatial,
résolution de labyrinthes, discrimination,
attention visuelle et calcul sont normales.
Son niveau de compréhension syntaxique
est également normal, mais sa production
phonologique, la qualité de son évocation
lexicale et la structure de ses phrases sont
bien inférieures aux - 2 écarts-types des
enfants de son âge. À 5 ans elle aborde la
grande section de maternelle avec un lan-
gage qui reste encore modérément et spéci-
fiquement déficitaire sur le plan de la pro-
duction. Un bilan formel de langage
confirme un niveau de production phono-
logique et syntaxique à - 3 écarts-types des
enfants de son âge. Après 20 séances de
rééducation orthophonique, le langage se
normalise. Ses acquisitions scolaires seront
normales.
Caroline présente un retard
de langage typique
➧
S
téphane est le second d’une fratrie de
quatre. Deux de ses sœurs n’ont aucun
trouble des apprentissages tandis que sa
sœur cadette est suivie pour un retard de
langage. Son père, deux de ses oncles et
tantes ainsi que sa grand-mère paternelle
parlent peu, mal et sont illettrés. Stéphane a
un développement moteur et relationnel
normal, mais à 3 ans, il n’a aucune expres-
sion de langage. À 5 ans, son langage est
limité à une dizaine de mots intelligibles
sans phrase. À 7 ans, après deux grandes
sections de maternelle, le langage reste
quasi inintelligible. Il n’apprendra pas à lire
malgré deux cours préparatoires. Stéphane
sera orienté vers une structure pour enfants
dysphasiques où il apprendra à lire avec une
dysorthographie sévère mais sans difficultés
majeures en mathématiques. Il réintégrera
un collège d’éducation spécialisée, passera
son CAP de menuisier. Stéphane est devenu
un adulte au langage encore réduit, avec
une persistance de difficultés phono-
logiques et syntaxiques n’entravant plus
l’intelligibilité.
L’histoire de Stéphane est une
histoire caractéristique de dys-
phasie de développement
➧
Plate-forme

de l’absence de conscience des formes
usuelles de notre langue. Les struc-
tures syntaxiques erronées (“on a vu le
cheval qu’attendait bientôt”) coïnci-
dent avec les simplifications à
1’extrême (“cheval attendre bientôt”)
et les morphèmes indifférenciés (“na
poule na pond na zœufs”). Sur le ver-
sant réceptif, l’atteinte est infiniment
variable. Tous les enfants présentent, à
des degrés divers, un trouble de la per-
ception des sons pourtant normale-
ment entendus (discrimination de
sons : “canif” et “caniche”). La com-
préhension lexicale et syntaxique est
le plus souvent discrètement défici-
taire, mais mieux préservée que l’ex-
pression. Les troubles du langage écrit
sont quasi constants. La gravité de
l’atteinte du langage et son profil ne
sont pas fixés d’un enfant à l’autre ni
parfois chez un même enfant au cours
de son évolution. Cette grande diver-
sité explique la nécessité absolue, au-
delà des grandes règles, de faire des
projets thérapeutiques individuels,
régulièrement fondés sur la sympto-
matologie rigoureusement évaluée, à
un moment précis. Actuellement, tous
les auteurs s’entendent pour différen-
cier les dysphasies d’expression (de
loin les plus fréquentes, où le trouble
touche avant tout les versant expressif
du langage) et les dysphasies récep-
tives, rares mais plus graves (où l’at-
teinte touche à la fois de façon
majeure les versants réceptif et expres-
sif). La diversité tient aussi à la gravité
très variable du déficit, certains
enfants, contrairement à d’autres,
étant encore quasiment inintelligibles
à 10 ans. Sur 14 enfants dysphasiques
revus à 1’âge adulte : 4restent diffici-
lement inintelligibles, 2 ont un lan-
gage oral quasi normal et les 8 autres
présentent des séquelles d’intensité
variable.
On peut résumer le problème de l’étio-
logie des dysphasies en disant qu’elle
reste mystérieuse et multifactorielle,
même si les particularités du cerveau
du dysphasique et les facteurs géné-
tiques sont actuellement décrits (7).
L’ e xistence de formes familiales avec
un arbre généalogique évoquant une
transmission autosomique dominante
est actuellement bien admise (même si
elle ne rend pas compte de la majorité
des dysphasies) et un gène, appelé
“speech 1”, situé en 7q31, a été isolé
dans une large famille de déficit sévère
de la programmation phonologique.
Les données neuropathologiques de
Galaburda (8), puis plusieurs études
morphométriques et en imagerie fonc-
tionnelle, suggèrent l’absence de l’asy-
métrie usuelle du planum temporal et
l’existence d’hétérotopies neuronales
comme témoin d’un cerveau “singu-
lier” (9). Les hypothèses épileptiques
(10) qui feraient des dysphasies des
formes précoces de syndrome de
Landau-Kleffner ne semblent pas se
confirmer, en tout cas pour la majorité
des cas, et les anomalies paroxystiques
intercritiques retrouvées chez un enfant
dysphasique sur trois n’en sont pas la
cause directe, mais plutôt l’expression
du trouble de maturation cérébrale, lui-
même responsable de la dysphasie.
Les troubles spécifiques
des apprentissages
du langage écrit
Les dyslexies dysorthographies ont
également une définition à la fois pré-
cise et insuffisamment précise. Elles
se caractérisent par un trouble signifi-
catif du développement du langage
écrit (décalage de 18 à 24 mois entre
l’âge de lecture et l’âge chrono-
logique), qui ne peut être expliqué ni
par une déficience mentale, ni par des
carences pédagogique, éducative, psycho-
affective ou socioculturelle, ni par un
trouble sensoriel, ni par une patho-
logie neurologique ou psychiatrique
authentifiée. C’est-à-dire qu’elles doi-
vent être différenciées des troubles des
apprentissages multiples liés à une
déficience mentale, ou multiples et
complexes sans déficience. Il existe
plusieurs types de dyslexie qui néces-
sitent des programmes de rééducation
très différents.
Les liens entre langage oral et
langage écrit : des troubles du
développement du langage oral a
l’illettrisme, une réaction en chaîne
qu’il est aujourd’hui possible
d’enrayer
La fréquence de l’illettrisme représente
entre 4 et 10 % des jeunes adultes de
sexe masculin. Il s’agit donc d’un pro-
blème de société de première impor-
tance. Si l’illettrisme est principale-
ment lié aux difficultés socio-
culturelles, la dyslexie de développe-
ment est enfin reconnue comme une
de ses étiologies. Une enquête récente
témoigne que près de 20 % des jeunes
en grande situation de précarité socio-
professionnelle ont, en fait, toutes les
caractéristiques de la forme la plus
fréquente de dyslexie de développe-
ment : la dyslexie phonologique (11).
D’où l’importance d’un dépistage pré-
coce des troubles du langage oral et
écrit, débouchant sur une action
appropriée.
Les déficits du développement du lan-
gage oral sont très fortement prédictifs
d’un déficit ultérieur en lecture.
Menyuk (12) a suivi prospectivement
trois populations d’enfants diagnosti-
qués à 5 ans comme porteurs d’un
retard de langage ou d’une dysphasie,
en comparaison d’une population
contrôle d’anciens prématurés. La
quasi-totalité des enfants dyspha-
siques étaient à 8 ans mauvais lec-
teurs, versus 25 % des retards de lan-
gage et environ 10 % seulement pour
les anciens prématurés. La littérature
de ces dernières années s’est intéres-
sée aux liens entre la perception de la
parole et l’apprentissage du langage
écrit et suggère un trouble fondamen-
tal du traitement de la parole, commun
aux dyslexies et aux déficits du lan-
gage oral, accessible à un entraîne-
ment intensif. Les capacités métapho-
nologiques à 5-6 ans sont également
prédictives des compétences ulté-
rieures en lecture, et un entraînement
dès cet âge permet d’améliorer ces
dernières. La psychologie cognitive a
permis d’en préciser alors les straté-
Plate-forme : troubles du langage II
87
Act. Méd. Int. - Neurologie (4) n° 3, avril 2003
Plate-forme

gies déficitaires portant sur la voie
d’assemblage et les techniques de
rééducation efficaces. Cela souligne la
nécessité de suivre les apprentissages
en langage écrit de tout trouble du lan-
gage, même guéri.
La dyslexie dysorthographie et les
différents sous-types
Si la dyslexie est particulièrement fré-
quente chez les enfants ayant présenté
un trouble du langage oral, elle peut se
manifester après le CP, alors que rien
ne la laissait prévoir
Son diagnostic est fait sur l’existence
d’un décalage significatif entre l’âge
de lecture et l’âge chronologique, avec
des stratégies de lecture perturbées,
alors que le niveau intellectuel et le
plus souvent le niveau en calcul sont
normaux. Même si la dyslexie
entraîne souvent un retentissement
psychoaffectif lié à l’échec scolaire, il
n’y a pas de troubles psychopatholo-
giques plus profonds. La dysortho-
graphie (figure 1) est constante chez
les enfants dyslexiques, mais elle peut
aussi être isolée à la suite d’une dys-
lexie guérie. Les progrès de la psycho-
logie cognitive ont permis de démon-
trer l’existence de différents
sous-groupes de dyslexies caractéri-
sés par des déficits différents.
Les modèles : l’enfant apprenti
lecteur et le lecteur habile
Le modèle de Frith, même s’il est trop
simpliste, rend bien compte de la
pathologie. L’acquisition de la lecture
évoluerait en 3 stades. Le stade logo-
graphique est caractérisé par une
reconnaissance des mots de l’environ-
nement (comme le prénom, “maman”,
“Coca-Cola®”, etc.) et sur la présence
de lettres saillantes. Ce vocabulaire
visuel est évidemment limité. Pour
aborder des mots nouveaux, l’enfant
doit absolument mettre en place les
règles de la correspondance entre les
lettres (graphèmes) et les sons (pho-
nèmes), caractéristiques du second
stade dit alphabétique. L’enfant
apprend alors à segmenter le mot dans
ses différentes unités (lavabo : 3 syl-
labes la/va/bo, 6 phonèmes l/a/v/a/b/o);
il peut alors lire un logatome comme
“mati”, “picrado”). En revanche, il
continuera à faire des erreurs pour cer-
taines graphies contextuelles (“tion”
de “révolution” lu “tion” et non
“sion”), et pour la lecture des mots
ambigus (“transiger” sera lu “transsi-
ger” et non “tranziger”). L’acquisition
du dernier stade orthographique est
donc indispensable à la lecture fluente.
L’enfant accède à la lecture directe,
visuosémantique pour les mots connus
qui font partie de son stock lexical et
peut alors lire correctement les mots
irréguliers ou ambigus (“femme” ou
“tabac”), puisqu’il les identifie sur la
correspondance entre leur aspect
visuel et leur sens. Il ne fera plus les
erreurs de lecture logographique
(“femme” assimilé à un mot visuelle-
ment proche, comme “ferme”). Il ne
fera plus non plus les erreurs de lec-
ture alphabétique qui conduisaient à
régulariser les mots (“femme” lu
“fème”). Ce stade orthographique se
développe dès 7-8 ans et est complète-
ment acquis à 9 ans, âge auquel l’en-
fant est un lecteur habile capable
d’identifier correctement tous les
mots, qu’ils soient courts ou longs,
réguliers ou irréguliers, concrets ou
abstraits, fréquents ou rares, connus
ou inconnus, grâce aux “deux voies”.
La première voie lexicale, ou lexico-
sémantique ou par adressage, lui per-
met d’identifier rapidement les mots
dont la forme écrite est connue. La
seconde voie non lexicale, analytique
ou par assemblage, lui permet de lire
les mots dont la forme écrite est incon-
nue. Elle est beaucoup plus longue.
Ces deux voies partent de l’analyse
visuelle du mot écrit et convergent
ensuite vers un système de mémoire
temporaire appelé le “buffer phoré-
mique” qui permet de préparer l’accès
au lexique phonologique de sortie ou
réponse orale. La stratégie utilisée par
un enfant pour identifier un mot écrit
sera appréciée en comparant les scores
de lecture de différents items (mots
réguliers ou irréguliers, logatomes,
mots fréquents, rares, courts ou longs)
et par le temps de latence pour lire le
mot beaucoup plus rapide en lecture
lexicale que non lexicale (figure 2).
La forme la plus fréquente est la dys-
lexie phonologique, caractérisée par
les difficultés d’acquisition du stade
alphabétique et donc d’accès à la voie
d’assemblage. Ce sont les formes
observées après les troubles du lan-
gage oral : leur prise en charge néces-
sitera un travail intensif sur la percep-
tion de la parole et sur la voie
Mots inconnus
(“picrado”)
Segmentation :
pi/cra/do
Conversion en lettres
et en sons
Assemblage
Accès au sens
Analyse visuelle des mots écrits
Buffer phonémique : lexique phonologique de sortie
Mots connus
(“livre”)
Lexique orthographique
d’entrée
Accès au sens
Figure 2. Modèle à deux voies de l’identi-
fication des mots écrits.
Plate-forme : troubles du langage II
88
Figure 1. Orthographe phonétique. Des
erreurs de segmentation de mots, de fusion
ou des découpage erronés sont liés à une
mauvaise conscience des mots, de leurs
limites, de leur nature. La persistance à un
âge avancé de toutes les erreurs de cette
dictée signe la dysorthographie.
Plate-forme

Plate-forme : troubles du langage II
89
Act. Méd. Int. - Neurologie (4) n° 3, avril 2003
d’assemblage en s’aidant de codes
(gestes Borel, syllabes en couleur ou
sémantisées, etc.). Dans cette forme,
le stock lexical de mots écrits per-
mettant de les aborder par la voie
d’adressage, est souvent très limité et
nécessite aussi sa constitution en
rééducation pour permettre une lec-
ture rapide accédant au sens, et une
orthographe d’usage correcte. Il existe
d’autres formes de dyslexie : les dys-
lexies de surface sont, au contraire des
précédentes, caractérisées par des dif-
ficultés d’accès à la voie d’adressage.
La lecture se fait donc uniquement par
assemblage, lente et en déchiffrant.
Les formes mixtes où les deux straté-
gies sont déficitaires existent aussi.
Elles sont particulièrement graves et
rendent compte des enfants non lec-
teurs en fin de primaire. Les dyslexies
visuo-attentionnelles, souvent asso-
ciées à un trouble déficitaire de l’at-
tention, se caractérisent par des prises
d’indice visuel insuffisantes, aussi
bien dans la lecture des non-mots,
mots réguliers ou irréguliers. L’intérêt
de ces sous-types est de définir la
nature de la rééducation et de la péda-
gogie qui seront totalement diffé-
rentes. La dysorthographie accom-
pagne la dyslexie et perdure souvent,
même chez les enfants devenus de
bons lecteurs. Dans les dysortho-
graphies phonologiques, la transcrip-
tion des sons en lettres est à l’origine
de nombreuses confusions, alors que la
dysorthographie de surface est avant
tout lexicale (figure 3). L’orthographe
grammaticale est déficitaire dans tous
les cas. La rééducation des dyslexies
doit être précoce (sans attendre les
2ans de décalage de la définition), le
plus souvent intensive (3 fois par
semaine) et, surtout, précisément
adaptée au trouble de l’enfant.
L’évaluation de l’efficacité de cette
rééducation doit être précise pour
réorienter les objectifs. Le grand
drame des enfants dyslexiques en
France est lié à l’absence d’harmoni-
sation pédagogie-rééducation. Un
enfant dyslexique de 8 ans non lecteur
ou de 10 ans pauvre lecteur, dans le
système ordinaire, passe dix heures de
français par semaine qui ne lui sont
pas adaptées, voire ne lui servent à
rien... Cette situation a récemment
ému les pouvoirs publics. Certaines
techniques modernes de rééducation,
comme l’entraînement phonologique
intensif par CD, sont en cours d’éva-
luation. On peut penser qu’elles seront
bénéfiques, mais elles ne seront pas la
solution “réparatrice” et ne concerne-
ront pas tous les enfants dyslexiques à
chaque phase de leur évolution.
Réferences
1. Le Normand MT. Modèles psycho-
linguistiques du développement du lan-
gage. In : C. Chevrie Muller et J. Narbona
(eds). Le langage de l’enfant. Paris : édi-
tions Masson (2e éd), 1999 : 28-43.
2. Silva PA, Mc Gee R, Williams SM.
Developmental language delay from 3 to
7 years and its significance for low intelli-
gence and reading difficulties at age 7.
Dev Med Child Neurol1983 ; 25 : 783-93.
3. Chevrie-Muller C, Goujard J, Simon
AM, Dufouil C. Questionnaire “Langage
et communication”. Observation pour
l’enseignant en petite section de mater-
nelle. Paris : Les cahiers pratiques
d’ANAE-PDG Communication, l994.
4. Alla F, Guillemein F, Colombo MC et al.
Valeur diagnostique de l’ERTL4 : un test
de repérage des troubles du langage chez
l’enfant de 4 ans. Arch Fr Pédiatr 1998 ;
5: 1082-8.
5. Billard C, Gillet, Galloux A et al. La
BREV : une batterie clinique d’évaluation
des fonctions cognitives. Résultats chez
500 enfants normaux. Arch Fr Pédiatr
2000 ; (suppl. 7) : 128s-130s.
6. Gérard CL. L’enfant dysphasique.
Paris : éditions Universitaires, 1991.
7. Billard C, Toutain A, Loisel ML et al.
Genetic basis of developmental dysphasia:
report of eleven familial cases in six fami-
lies. Genetic Counceling 1994 ; 5 : 23-33.
8. Galaburda AM, Sherman GF, Rosen GD
et al. Developmental dyslexia : four conse-
cutive patients with cortical abnormalities.
Ann Neurol 1985 ; 18 : 222-33.
9. Billard C. Électrophysiologie, imagerie
cérébrale : applications dans les patho-
logies du langage chez l’enfant. In : C.
Chevrie-Muller et J. Narbona (eds). Le
langage de l’enfant, aspects normaux et
pathologiques. Paris : éditions Masson,
1996 : 184-98.
10. Habib M. Dyslexie : le cerveau singu-
lier. Marseille : éditions Solal, 1997.
11. Delahaie M, Billard C, Calvet C et al.
Dyslexie de développement et illettrisme.
Un exemple d’évaluation. Santé publique
1998 ; 10 : 369-83.
12. Menyuk P, Chesuik M, Liebergott JW.
Predicting reading problems in at-risk
children. J Speech Hearing Res 199l ; 34 :
893-903.
13. Tallal P, Miller S, Bedi G et al.
Language comprehension in language-
learning impaired children with acousti-
cally modified speech. Science 1996 ;
271 : 81-4.
14. Valdois S. Les dyslexies développemen-
tales. In : S. Carbonel, P. Gillet, Martory et
S. Valdois (eds). Approche cognitive des
troubles de la lecture et de l’écriture chez
l’enfant et chez l’adulte. Marseille : édi-
tions Solal, 1996 : 137-52.
Figure 3. Camille, 10 ans, dysorthographie lexicale.
Plate-forme
1
/
5
100%