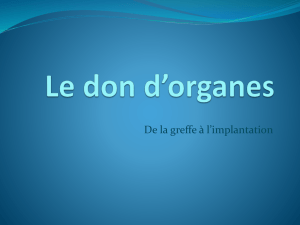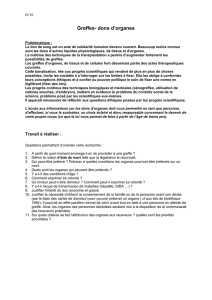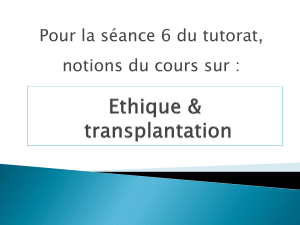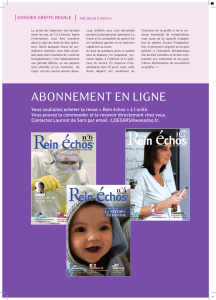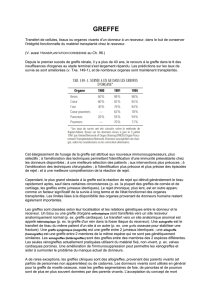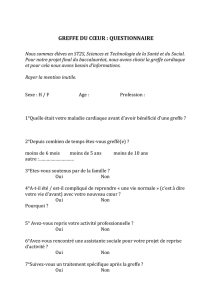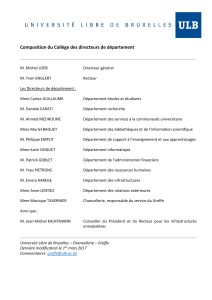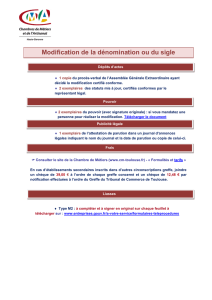thématique d Infections transmises

dossier
tmiqu
Le Courrier de la Transplantation - Volume VIII - n
o 2 - avril-mai-juin 2008
82
Infections
transmises
par le greon
Coordinateur :
Y. Calmus
Le recours à des donneurs présentant un risque infectieux
pour le receveur (donneurs porteurs de marqueurs viraux de
l’hépatite B ou C) a été rendu possible en 2005, de manière
dérogatoire et sous la forme de protocoles rédigés par un
groupe d’experts, mandatés par l’Afssaps. Le nombre de greffons
supplémentaires apporté par les greffes dérogatoires a permis
l’accès à la greffe pour 360 malades. L’information à délivrer
au patient en attente d’une greffe est délicate et complexe, et
nécessite une bonne maîtrise des données de la littérature et
des protocoles édictés par l’Afssaps concernant les critères
d’inclusion, les mesures prophylactiques ou les modalités de suivi.
L’implication des sociétés savantes concernées et les informa-
tions délivrées par l’évaluation rigoureuse devraient permettre
de mieux déterminer les prols de receveurs “bénéciaires”
de ce type de greffe, plus particulièrement en cas de donneur
VHC+, promouvoir ces protocoles et diffuser l’information sur
les recommandations qui l’entourent.
Use of donors carrying an infectious risk for the recipient (donors
with serologic markers for hepatitis B or C) has been possible
since 2005, in a derogatory manner following protocols written
by a group of experts called on by the AFSSAPS. The number of
supplemental harvested organs brought by this measure has allowed
transplantation of 360 patients. The information about those organs
that has to be given to the patient is complex and delicate, and
needs an excellent knowledge of the current medical literature as
well as of the protocols written for these transplantations, including
the inclusion criteria, the prophylactic measures to be taken and the
necessary follow-up. The input of the medical societies involved and
the informations coming from the follow-up of such transplanted
patients should allow to better dene the proles of the patients
beneting most from this type of organs, most notably organs
from HCV-positive donors, raise the number of patients concerned
by this procedure and nally allow for a wider information of the
procedure for both patients and physicians.
RÉsUmÉ SUmmaRy
Recommandations :
quelle information pour le futur receveur ?
Recommendations: which information for the future
recipient?
C. Antoine*●
* Service de néphrologie, hôpital Saint-Louis, Paris.
“CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ”
DU RECEVEUR, NOTAMMENT EN CAS
DE GREFFE DÉROGATOIRE
L’information au patient est un exer-
cice difcile, et il est important pour le
malade de pouvoir accéder à la connais-
sance des conditions de réalisation de
sa greffe. La formalisation de cette
information soulève beaucoup d’inter-
rogations : pourquoi ? quand ? où ? qui ?
quoi ? et comment ? Ces questions sont
l’essence même du principe éthique du
consentement éclairé (tableau).
LE CONSENTEMENT
ET LES PROTOCOLES “DÉROGATOIRES”
Ces protocoles permettent le recours à
des donneurs présentant un risque infec-
tieux pour le receveur (donneur porteur
de marqueurs viraux de l’hépatite C
[VHC+] ou de l’hépatite B [AcHBc+]).
C’est une extension du dispositif de 1997
mis en place du fait de la pénurie d’or-
ganes, pour l’instant à titre dérogatoire.
Ces protocoles émanent de recomman-
dations d’un groupe d’experts mandatés
par l’Afssaps (Décret n° 2005-1618 du
21 décembre 2005 relatif aux règles de
sécurité sanitaire portant sur le prélè-
vement et l’utilisation des éléments et
CT N°2 2008.indd 82 30/06/08 18:35:07

dossier
tmiqu
Le Courrier de la Transplantation - Volume VIII - n
o 2 - avril-mai-juin 2008
83
produits du corps humain et modiant le
code de la santé publique [partie régle-
mentaire] ; avis Afssaps du 11 mars 2006
[JO 11 mars 2006]).
POURQUOI ?
Pour permettre l’accès à ces déroga-
tions, un dispositif réglementaire tran-
sitoire a été mis en place en vue de
procéder à l’évaluation de ce type de
greffes. Dans tous les cas, le patient
doit être préalablement informé et
doit donner son accord sur la possibi-
lité de recevoir un greffon porteur de
marqueur(s) viral(aux) ou bactérien(s)
[VHB, VHC et syphilis]. Il doit égale-
ment bénécier d’une prise en charge
thérapeutique et d’un suivi post-greffe
appropriés, comportant un suivi sérolo-
gique, biochimique et éventuellement
histologique.
La loi du 22 avril 2005 consacre la
prééminence du consentement du
patient, disposant de la manière la plus
nette que : “Toute personne prend, avec
le professionnel de santé, compte tenu
des informations et des préconisations
qu’il fournit, les décisions concernant
sa santé. Le médecin doit respecter la
volonté de la personne après l’avoir
informée des conséquences de son
choix. […] Aucun acte médical, ni aucun
traitement, ne peut être pratiqué sans
le consentement libre et éclairé de la
personne et ce consentement peut être
retiré à tout moment”.
Le patient est donc partenaire à part
entière de la prise de décision de rece-
voir une greffe dérogatoire.
OÙ, QUI ET QUAND ?
Cette information est délivrée lors de la
ou des consultations pré-transplantation
aussi bien pour les nouveaux inscrits que
pour ceux déjà inscrits lors de la parution
des textes législatifs. Cette disposition
implique de reconvoquer les patients,
soit près de 6 000 patients pour la seule
liste d’attente en greffe rénale, volume
qui explique en partie le nombre peu
important d’inclusions.
L’information est délivrée aux patients
répondant aux critères d’inclusion et
capables de recevoir l’information. Cette
information doit être conrmée en pré-
opératoire, notamment s’il s’agit d’un
protocole dérogatoire, et doit porter sur
le statut sérologique et virologique du
donneur de greffon ainsi que sur l’impact
de ce type de greffe. C’est en principe
le médecin de l’équipe de greffe qui
doit délivrer l’information, mais il est
souhaitable que celle-ci soit connue et
relayée par les médecins du réseau de
soins pré- et post-greffe.
COMMENT ?
DE LA COMPLEXITÉ ACCRUE
DES PROPOSITIONS THÉRAPEUTIQUES
Les informations prodiguées doivent
permettent de prendre une décision
éclairée. Pour ce faire, il est bien sûr
nécessaire de sortir du discours scienti-
que, ce qui n’est pas toujours simple :
“Une information utilisant toutes les
ressources de la communication scien-
tique et culturelle doit pouvoir faire
prendre conscience de l’intérêt de la stra-
tégie, sans qu’une attitude de chantage
ne soit exercée”. Tout cela sans aggraver
l’anxiété du patient, en lui laissant un
délai de réexion et en l’informant de
son droit de revenir sur sa décision.
DE LA NOTION DE BÉNÉFICE/RISQUE
Le rapport entre le risque potentiel de
transmission et le bénéce de la greffe
est très difficile à appréhender. Le
contexte est celui de la pénurie d’or-
ganes avec la mortalité en liste d’attente
pour les organes vitaux et les délais
d’attente prolongés pour la greffe rénale.
Il existe des contraintes logistiques de
temps (ischémie) et de performance
des examens microbiologiques qui ne
permettent pas de pouvoir caractériser
le risque au moment de la greffe.
Le risque infectieux potentiel survient
dans un contexte de receveurs “fragi-
lisés” par l’insufsance terminale d’or-
gane puis par l’immunosuppression,
mais aussi d’amélioration majeure des
prophylaxies et des traitements curatifs
anti-infectieux (efcacité attendue des
traitements).
QUELLES INFORMATIONS ?
Si l’on se réfère à l’avis du CCNE
(Comité consultatif national d’éthique),
une information est “l’expression de
faits ou d’opinions explicités de façon
apparemment objective, fondés sur un
savoir porté par une personne, mais qui
s’adressent à la subjectivité d’une autre
personne. Une information ne peut donc
jamais être purement objective, car la
subjectivité de l’émetteur et celle du
récepteur interagissent dans le processus
de communication et modient en perma-
nence les conditions de l’échange”.
Ainsi, tout ou une partie se résume au
degré de connaissance et de conviction
du transplanteur sur le sujet.
Un des arguments ayant conduit à
l’élaboration de ces recommanda-
tions, et devant être pris en compte
Tableau. Les principes éthiques qui ont conduit au concept de “consentement éclairé”,
d’après P. Le Coz. Petit traité de la décision médicale, Édition Seuil.
Principe d’autonomie Principe de bienfaisance Principe de non-malfaisance
Devoir de valoriser la capacité du
patient de décider par lui-même et
pour lui-même, ce qui suppose qu’il
soit informé en connaissance de cause
et qu’il ne subisse pas de coercition.
Accomplir un bien en faveur du
patient = rééchir sur les bénéces
possibles, en termes de qualité de
vie, qu’est susceptible de lui apporter
la transplantation.
Devoir du médecin de ne pas exposer
le malade au risque de subir un mal
qui ne serait pas la contrepartie du
rétablissement de sa santé primum
non nocere hippocratique.
CT N°2 2008.indd 83 30/06/08 18:35:07

dossier
tmiqu
Le Courrier de la Transplantation - Volume VIII - n
o 2 - avril-mai-juin 2008
84
dans l’information, est l’augmentation
potentielle du nombre de greffes et donc,
à l’échelon du patient en attente, une
diminution de sa durée d’attente.
Effectivement, entre janvier 2006 et
septembre 2007, le protocole dérogatoire
pour le VHB a permis le prélèvement
de 171 donneurs porteurs de l’AcHBc+
isolé ou associé à l’Ac anti-HBs et
360 greffes dont :
255 greffes rénales (71 %), soit + 5 %
de greffes ;
81 greffes hépatiques (23 %), soit
+ 4,4 % de greffes ;
14 greffes cardiaques (4 %), soit + 2 %
de greffes ;
8 greffes pulmonaires, 1 greffe cœur-
poumon, soit + 2,5 % de greffes ;
1 greffe de la face.
L’information sur le ou les risques est
plus délicate. Il s’agit non seulement de
maîtriser les données proliques de la
littérature médicale dans ce domaine,
mais aussi de connaître les recommanda-
tions concernant les critères d’inclusion
et les modalités de traitement et de suivi
✓
✓
✓
✓
✓
imposés dans le texte réglementaire qui
ont pour objectif, certes l’évaluation de
cette pratique, mais surtout l’évaluation
du risque réel et sa prévention.
Il existe en tout 24 protocoles déro-
gatoires pour organes et tissus. Ils se
déclinent pour la greffe d’organes en
12 protocoles de qualification et de
suivi des receveurs avec 10 protocoles
pour l’hépatite B (5 communs au cœur,
poumons et reins et 5 pour le foie) et
2 protocoles concernant l’hépatite C.
Jusqu’en avril 2007, la proposition d’un
greffon porteur d’AcHBc+ était possible
pour tous les receveurs à l’exception de
ceux qui s’y étaient opposés et avaient
été déclarés comme tel dans la base de
données CRISTAL gérée par l’Agence
de la biomédecine. Depuis avril 2007,
pour les organes thoraciques et hépati-
ques, et depuis juin 2007 pour la greffe
rénale, un enregistrement de l’accord
volontaire du receveur sur CRISTAL
est obligatoire. Cet enregistrement a
d’emblée été rendu obligatoire pour le
protocole dérogatoire VHC+.
LES MESURES PROPHYLACTIQUES
PROTOCOLE DE SURVEILLANCE
POST-GREFFE
L’objectif est de déterminer le risque de
transmission, l’évolution de l’hépatite et
les conséquences sur la survie du greffon.
Les données de la surveillance devraient
nous apporter les éléments nécessaires à
une prise de décision plus éclairée.
La surveillance post-greffe consiste à
rechercher et à quantier la charge virale
du donneur en rétrospectif.
Il y a également tout un protocole de
suivi virologique et histologique spéci-
que au statut sérologique du couple
receveur/donneur.
Si cette surveillance n’est pas pratiquée
de façon correcte, l’évaluation des résul-
tats en sera affectée, faisant prendre le
risque que les autorités de santé remet-
tent en cause ce dispositif au-delà du
21 décembre 2009.
Contenu de l’information :
◆ Les critères d’inclusion des receveurs
◆ Le risque de contamination
◆ Le fait que le risque réel ne soit pas
connu au moment de l’information
initiale ni au moment de la greffe
(virémie, génotype)
◆ Les risques encourus par les greffons
concernés par les protocoles
dérogatoires
◆ Les possibilités de prise en charge
thérapeutique (traitement à vie, etc.)
◆ Le protocole de suivi post-greffe
(virologique, sérologique et
histologique)
◆ Le fait que le futur receveur reste
toujours candidat pour un greffon
issu d’un donneur non porteur des
marqueurs viraux
◆ La possibilité de se rétracter à tout
moment
Protocoles dérogatoires : les critères
d’inclusion
◆ Greffons VHC+ :
• ciblés sur les receveurs virémiques,
ARN-VHC+ (recherche de virémie
datant de moins de 6 mois) ;
• histologie hépatique de référence et
génotype connu.
◆ Greffons AcHBc+ :
• Ac anti-HBc+ isolé ou associé
à l’Ac anti-HBs+ ;
• à l’exclusion des donneurs porteurs
de l’Ag HBs ;
• concerne tous les receveurs ;
• vaccination anti-VHB systématique
des receveurs naïfs ;
• non recommandée en cas d’échec
de la vaccination.
◆ Pour les donneurs vivants : avant le
prélèvement, consultation obliga-
toire du collège d’experts “donneurs
vivants”, animé par l’Agence de la
biomédecine et présidé par le Pr S. Pol.
L’avis du comité est ensuite transmis
au comité “donneurs vivants”, qui
examine la situation et la motivation
du donneur.
Protocoles de l’Afssaps
◆ Protocoles de soins spécifiques en
pré- et post-transplantation en cas de
donneur AcHBc+ isolé ou associé à
l’anti-HBs, stratié selon :
• le statut sérologique du receveur (taux
d’Ac anti-HBs protecteur) ;
• la présence d’ADN du VHB chez le
donneur.
◆ Prise en charge thérapeutique :
• maintien du titre d’anti-HBs supérieur
à 100 UI/l par immunoprophylaxie
par Ig anti-HBs ;
• antiviraux si nécessaire, seuls ou en
association ;
• tentative de (re)vaccination à distance
de la greffe.
CT N°2 2008.indd 84 30/06/08 18:35:07

dossier
tmiqu
Le Courrier de la Transplantation - Volume VIII - n
o 2 - avril-mai-juin 2008
85
L’évaluation réalisée par l’Agence de la
biomédecine et exigée dans les textes
réglementaires souligne les difcultés
d’appropriation par les cliniciens des
critères d’inclusion, des différentes
déclinaisons prophylactiques et du suivi
pour les greffes dérogatoires. Cette
évaluation requiert que les modalités
et le calendrier de suivi des patients
inclus dans ces protocoles dénis par
l’Agence de la biomédecine soient
strictement respectés par les équipes
médicales.
Exemple du protocole dérogatoire
pour le VHB
Le bilan du 1er janvier 2006 au
24 septembre 2007 montre qu’il manque
environ 36 % des suivis sérologiques.
Onze pour cent des greffes rénales
dérogatoires ont été réalisées chez des
receveurs naïfs alors que les textes règle-
mentaires ne le prévoient qu’en cas de
menace vitale. Chez 3 patients AcHBc-
et AcHBs- ayant reçu un greffon hépa-
tique de donneurs AcHBc+ et AcHBs+,
le suivi a montré une séroconversion
AgHBs+. Du fait de la méconnaissance
du protocole dérogatoire par l’équipe
de suivi, ces patients n’ont pas reçu de
traitement prophylactique. Par ailleurs,
le suivi révèle une séroconversion
potentielle anti-HBC+ chez 4 patients,
2 greffes pulmonaires, une greffe rénale
et une greffe hépatique et l’absence de
séroconversion AgHBs+ chez les rece-
veurs AcHBc+ en prégreffe.
L’examen de la liste d’attente a surtout
montré qu’un nombre important de
patients n’avaient pas été inclus alors
qu’ils répondaient aux critères sérolo-
giques d’inclusion.
Exemple du protocole dérogatoire
pour le VHC
Le bilan en 2006 montre qu’il y a eu
23 donneurs VHC+ non prélevés faute de
candidats à la greffe en attente. Parmi les
4 donneurs AcVHC+ prélevés, 3 étaient
virémiques et ont donné lieu à 8 greffes
(4 greffes hépatiques, 3 greffes rénales,
1 greffe cardiaque). Le suivi post-greffe
(seuls 4 suivis de receveurs étaient
disponibles) a révélé, certes sur un
petit nombre de cas, la domination du
génotype du donneur sur celui du rece-
veur et l’absence d’hépatite aiguë. Ces
données sont extraites du bilan d’activité
des protocoles dérogatoires présenté par
le Dr F. Pessione, de la direction médi-
cale et scientique de l’Agence de la
biomédecine.
Le faible nombre de patients inclus
dans ce protocole a vraisemblablement
une explication multifactorielle : baisse
importante de la prévalence de cette
infection dans la population des patients
dialysés, meilleure efcacité du traite-
ment antiviral mais aussi probablement
des interrogations des praticiens quant
à l’impact sur la survie des patients et
l’évolution de l’hépatopathie, de l’uti-
lisation d’un greffon VHC+ chez un
receveur virémique VHC+.
Le recours à des greffons porteurs de
marqueurs sérologiques du VHC est en
place depuis longtemps dans d’autres
pays européens et outre-atlantique. Les
données de la littérature sont plutôt
favorables en termes d’amélioration
d’accès à la greffe et de résultats mais
restent parfois difciles à interpréter,
avec des résultats contradictoires, quant
à l’évolution de la maladie hépatique
en cas d’infection virale C et avec une
inconnue de poids sur le long terme,
notamment en cas de surinfection par
un génotype VHC différent de celui
du receveur. La littérature ne rapporte
que des données sur le court ou moyen
terme, avec une définition souvent
imprécise de la population étudiée
donneurs-receveurs, en particulier vis-
à-vis de leur statut virémique pour le
VHC.
CONCLUSION
Le nombre de greffons supplémentaires
apportés par les greffes dérogatoires est
important dans le contexte de pénurie
(5,7 % des greffes en 2007 pour les déro-
gations VHB+).
L’information qui doit être délivrée au
patient en attente de greffe est délicate et
complexe et nécessite de bien maîtriser
les protocoles édictés par l’Afssaps,
aussi bien pour les critères d’inclusion
que dans l’administration des mesures
prophylactiques ou dans les modalités
de suivi, dans le but d’identier et de
prévenir le risque infectieux potentiel.
Les protocoles prophylactiques sont
synthétiques et gagneraient certainement
en lisibilité si les mesures thérapeutiques
étaient argumentées et détaillées. Beaucoup
de cliniciens sont encore très hésitants vis-
à-vis de la balance bénéce-risque, notam-
ment en cas de greffon VHC+.
Les sociétés savantes impliquées dans
l’activité de transplantation et les infor-
mations délivrées par l’évaluation rigou-
reuse de ces protocoles faite par l’Agence
de la biomédecine devraient permettre
de mieux déterminer les prols des rece-
veurs “bénéciaires” de ce type de greffe,
plus particulièrement en cas de donneur
VHC+, de promouvoir ces protocoles, de
diffuser l’information sur les recomman-
dations qui l’entourent et peut-être même
de proposer une notice d’information
commune destinée aux patients.
Les protocoles dérogatoires doivent être
évalués et suivis régulièrement et rigou-
reusement pour alimenter le contenu de
l’information et poursuivre ce type de
greffe.
Il serait intéressant d’étendre cette réexion
aux donneurs porteurs d’autres marqueurs
viraux – HTLV+, par exemple. ■
CT N°2 2008.indd 85 30/06/08 18:35:08
1
/
4
100%