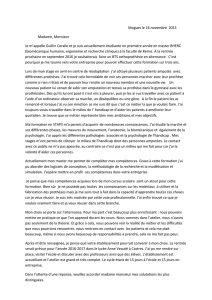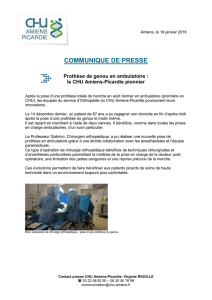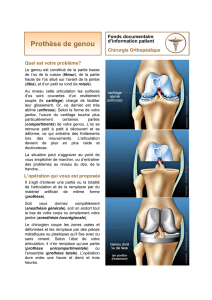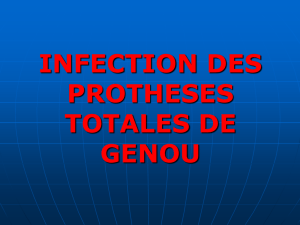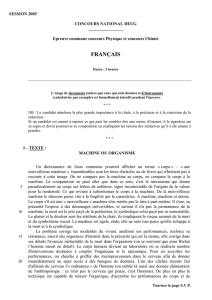Lire l'article complet

18 | La Lettre du Rhumatologue • N° 350 - mars 2009
MISE AU POINT
Complications
des prothèses de genou
Complications of knee arthroplasties
F. Canovas*, W. Hebrard*, A. Largey*
L
e taux de survie des prothèses totales de genou
est d’environ 95 % à 10 ans et 90 % à 15 ans,
avec 95 % de résultats excellents et 90 % de
résultats très bons. Ils témoignent d’un certain
nombre de complications à moyen et long terme
des prothèses de genou, qui imposent une nouvelle
opération. Ces chiffres ne tiennent pas compte des
complications médicales qui peuvent avoir des
conséquences sur la qualité de vie ni des compli-
cations telles qu’une ecchymose, un hématome ou
une désunion superficielle, qui n’ont aucune consé-
quence sur le résultat fonctionnel de la prothèse. Le
taux de mortalité aux États-Unis après pose d’une
prothèse de genou en première intention est de
0,28 % en 2004, et les comorbidités ont nettement
augmenté pendant la dernière décennie (1). Nous
ne traiterons pas des complications médicales, qui
ne sont pas spécifiques aux prothèses de genou,
mais qui restent toujours d’ actualité, du fait d’une
population de plus en plus âgée, aux facteurs de
risque augmentés.
Les complications des prothèses de genou peuvent
être envisagées selon la chronologie des événe-
ments. On peut ainsi différencier les complications
per opératoires des complications postopératoires,
qui elles-mêmes peuvent être scindées en compli-
cations précoces, dans les 3 semaines qui suivent
l’intervention chirurgicale, semi-tardives, entre
3 semaines et 2 ans, et tardives, après 2 ans. Dans la
mesure où une complication peropératoire peut avoir
des conséquences variables dans le temps et où une
complication peut être révélée dans un délai variable,
il ne semble pas pertinent de retenir l’ordre chrono-
logique pour traiter des complications des prothèses
de genou. Dans une série continue de 1 795 prothèses
totales de genou de première intention, Neyret
retrouve 69 complications per opératoires (3,8 %) :
fissures et fractures autour du genou (n = 40), fragi-
lisations du tendon poplité (n = 11), fragilisation du
ligament collatéral médial (n = 10), fragilisation du
ligament patellaire sans rupture (n = 6), fragilisation
du tendon quadricipital (n = 1) et plaie de l’artère
poplitée ayant entraîné une ischémie subaiguë de
la jambe (n = 1) [2].
Les prothèses de genou regroupent les prothèses
totales de genou (PTG) et les prothèses partielles,
telles que les prothèses unicompartimentales (PUC)
internes et externes et les prothèses fémoro-patel-
laires. S’il existe des complications communes aux
différents types de prothèse de genou, telles que
l’ infection, il est néanmoins préférable d’envisager
séparément les complications des PTG et des
prothèses partielles, car il existe des complications
spécifiques à chaque type d’implant.
Avant d’envisager les complications des prothèses de
genou, il faut insister sur la douleur qui est le maître-
symptôme. Toute prothèse douloureuse doit être
suspecte d’une complication, la douleur étant parfois
l’unique révélateur clinique, y compris dans les infec-
tions qui peuvent être larvées. Il faudra alors entre-
prendre une démarche diagnostique pour trouver la
cause de la douleur, qui s’ appuiera en premier lieu
sur la clinique (interrogatoire et examen clinique)
et sur certains examens complémentaires tels que
les examens biologiques, la radiographie standard,
la ponction articulaire au moindre doute septique,
le scanner et la scintigraphie.
Les complications
des prothèses totales de genou
Les complications mécaniques
Il faut distinguer les complications mécaniques des
infections sur prothèse.
* UAM chirurgie de la hanche,
du genou et chirurgie du pied, ortho-
pédie 3, pôle os et articulation, hôpital
Lapeyronie, CHU de Montpellier.

Figure 1. Descellement aseptique d’une prothèse totale de genou.
La Lettre du Rhumatologue • N° 350 - mars 2009 | 19
Points forts
Dans une série de 69 reprises de PTG non infec-
tées, M. Bonnin et al. retrouvent 30 descellements,
14 laxités, 11 raideurs du genou, 6 complications
patellaires et 8 PTG douloureuses (3).
Le descellement prothétique
◆
Il est toujours en rapport avec l’usure du plateau en
polyéthylène. Les débris d’usure du polyéthylène
vont entraîner la formation de granulomes inflam-
matoires autour de la prothèse, engendrant ainsi
une lyse osseuse périprothétique qui est respon-
sable de la mobilisation des pièces prothétiques. La
disparition complète du polyéthylène entraîne un
contact métal-métal, responsable d’une métallose
qui aggrave le descellement prothétique. C’est en
général une complication tardive des PTG, quel que
soit l’implant utilisé. Une malposition prothétique,
notamment dans le plan frontal (persistance d’un
varus ou d’un valgus), un défaut d’équilibrage liga-
mentaire ou, dans le cadre des prothèses respectant
le ligament croisé postérieur (LCP), une subluxation
postérieure par fragilisation du LCP, sont des facteurs
qui favorisent l’usure mécanique du polyéthylène et
donc le descellement prothétique. Toute anomalie
de positionnement prothétique, quelle qu’en soit
la cause, aura des répercussions sur la longévité de
la prothèse.
Enfin, il peut exister des descellements relativement
précoces – notamment avec les PTG sans ciment,
par défaut d’ostéointégration de la prothèse –, qui
sont souvent très difficiles à mettre en évidence,
les modifications scintigraphiques étant à ce stade
extrêmement fréquentes. La douleur est souvent
le seul signe clinique. La radiographie confirme
fréquemment le diagnostic, qui impose la reprise
chirurgicale (figure 1).
L’instabilité prothétique
◆
Elle siège dans le plan frontal, que ce soit du côté
médial ou latéral, et a des conséquences fonction-
nelles majeures. On peut rapprocher des instabilités
les subluxations postérieures du tibia sur le fémur
par faillite du LCP avec les PTG conservant le LCP
qui peuvent aboutir à une véritable luxation en cas
de faillite complète du LCP. Les instabilités frontales
sont le plus souvent rencontrées avec des PTG peu
contraintes, qui ont besoin d’un plan ligamentaire
médial et latéral d’excellente qualité afin d’obtenir
un bon équilibrage ligamentaire. L’insuffisance liga-
mentaire peut être présente avant l’implantation
de la PTG, en cas de gonarthrose post-traumatique
après entorse grave du genou, ou survenir en cas de
release ou de libération ligamentaire excessive lors de
la mise en place de la prothèse. L’instabilité décrite
à l’interrogatoire par le patient, associée à la laxité
clinique, permet d’en faire le diagnostic. La reprise
chirurgicale s’impose dans la plupart des cas, avec
la mise en place d’une prothèse contrainte (le plus
souvent) ou d’une prothèse postéro-stabilisée.
Les complications fémoro-patellaires
◆
Outre les complications peropératoires, que nous
ne détaillerons pas et qui peuvent avoir des consé-
quences fonctionnelles sévères, notamment en cas
de rupture du ligament patellaire, les complications
patellaires restent actuellement redoutées par les
chirurgiens orthopédistes, tant par leur fréquence
que par les difficultés de leur traitement.
La fracture de la patella est souvent en rapport avec
son amincissement excessif. La reprise chirurgicale
s’impose notamment en cas de descellement de l’im-
plant rotulien. Le clunk syndrome est retrouvé dans
certaines prothèses postéro-stabilisées. Il correspond
à un nodule fibreux situé au bord supérieur de la
Mots-clés
Prothèse articulaire
Prothèse de genou
Complications
des prothèses
Infection articulaire
Les prothèses totales de genou donnent de très bons résultats à 10-15 ans. »
Il faut distinguer les complications mécaniques des infections sur prothèse.
»
Les infections sont les complications les plus graves et nécessitent un traitement médical et chirurgical.
»
Les complications mécaniques des prothèses totales comportent le descellement, l’instabilité prothétique
»
et les complications fémoro-patellaires.
Les principales complications mécaniques des prothèses unicompartimentales sont le descellement par usure,
»
la détérioration du compartiment opposé et celle du compartiment fémoro-patellaire.
Keywords
Joint arthroplasty
Knee arthroplasty
Arthroplasty complications
Joint infection

Figure 2. Douleur sur prothèse totale de genou avec bascule
rotulienne.
20 | La Lettre du Rhumatologue • N° 350 - mars 2009
Complications des prothèses de genou
MISE AU POINT
patella, qui, au cours de la flexion, s’invagine entre
le fémur et la patella et, lors de l’extension, se réduit
brutalement, entraînant un claquement audible et
douloureux. Son traitement repose sur l’exérèse du
nodule fibreux sous arthroscopie ou à ciel ouvert. On
peut rapprocher du clunk syndrome les fibroses du
bord supérieur de la patella qui sont responsables de
craquements – le plus souvent indolores, mais qui
sont source d’inquiétude pour les patients.
La luxation fémoro-patellaire et les subluxations
fémoro-patellaires sont parmi les complications
les plus graves des PTG. Elles résultent d’un
mauvais alignement de l’appareil extenseur avec
une augmentation de l’angle Q. Le genu valgum,
voire une dysplasie fémoro-patellaire préexistante,
doivent être considérés comme des facteurs de
risque de ce type de complication. Le diagnostic
est clinique en cas de luxation, tandis que l’inci-
dence fémoro-patellaire (figure 2), voire le scanner,
permettent de faire le diagnostic de subluxation.
Parfois, une simple bascule de la patella – entraî-
nant un conflit entre le bord latéral de la patella
et le carter fémoral – peut être responsable d’un
syndrome douloureux. L’origine de cette bascule
est souvent un mauvais positionnement de l’im-
plant fémoral dans le plan horizontal, par défaut de
rotation externe du carter fémoral. Le traitement
de ce type de complication fémoro-patellaire est
difficile. S’il est des cas où un simple geste sur les
parties molles est suffisant, notamment en cas de
lâchage de la suture de l’aileron rotulien médial, la
plupart du temps, le remplacement de la prothèse
s’impose, afin de replacer correctement le carter
fémoral sous la patella et/ ou de corriger un défaut
de rotation du plateau tibial.
La raideur du genou
◆
Si un flessum de 10° est parfaitement tolérable, la
raideur en flexion l’est nettement moins, dans la
mesure où la gêne fonctionnelle est importante,
notamment à la montée et à la descente des
escaliers. Il faut noter que les raideurs en flexion
s’accom pagnent souvent d’un syndrome doulou-
reux, du fait de la traction exercée sur l’appareil
extenseur au cours de la flexion. Avec les prothèses
actuellement mises sur le marché, on peut consi-
dérer qu’une flexion inférieure à 110° est synonyme
de raideur. Quelle que soit l’origine de la raideur,
il faut insister sur l’importance de la rééducation
postopératoire. En cas de raideur préopératoire, il
n’est pas rare d’observer une limitation articulaire,
du fait de la fibrose des espaces de glissement.
Parfois, elle est en rapport avec une insuffisance
de libération articulaire peropératoire, notamment
dans les cas où la rétraction de l’appareil exten-
seur n’a pas fait l’objet d’un traitement spécifique
(Judet). En cas de mobilité normale du genou en
préopératoire, la raideur peut être en rapport avec
une insuffisance de prise en charge postopératoire,
à une mauvaise gestion de l’espace fémoro-tibial
ou à un encombrement excessif de l’espace anté-
rieur fémoro-patellaire (surdimensionnement de
l’implant fémoral).
En cas de raideur postopératoire survenant sur un
genou parfaitement mobile en préopératoire, et sans
anomalie prothétique, il ne faut pas hésiter à réaliser
une mobilisation du genou sous anesthésie générale
dans les plus brefs délais, c’est-à-dire entre le premier
et le troisième mois postopératoire, qui permet de
récupérer la plupart du temps une mobilité parfai-
tement fonctionnelle du genou prothétique. Dans

La Lettre du Rhumatologue • N° 350 - mars 2009 | 21
MISE AU POINT
les autres cas, on peut être amené à effectuer une
libération chirurgicale sous arthroscopie, voire à ciel
ouvert en cas de nécessité. En dernier recours, le
remplacement de la prothèse peut être envisagé avec
arthrolyse et libération de l’appareil extenseur, si cela
est nécessaire. Quoi qu’il en soit, les reprises de PTG
pour raideur donnent les moins bons résultats.
L’infection
L’infection représente une complication rare mais
sévère des prothèses articulaires. Elle compromet
fortement le résultat fonctionnel de cette inter-
vention de pratique quotidienne, engendrant une
morbidité et une surmortalité importantes, dont
une partie est liée à la nécessité d’une hospitalisa-
tion prolongée.
La fréquence des infections sur prothèses de
genou, qui varie de 0,5 à 5 % selon les séries, est
plus élevée que dans la chirurgie prothétique de la
hanche (4). Quand on sait qu’il se pose aujourd’hui
environ 50 000 PTG par an en France, on imagine les
conséquences socio-économiques de cette compli-
cation.
L’infection sur prothèse demeure une complication
redoutée, nécessitant une prise en charge multidis-
ciplinaire, impliquant le chirurgien, l’infectiologue,
l’anesthésiste et le microbiologiste (5).
Classification
◆
La contamination de la prothèse survient soit durant
la période périopératoire, soit par voie hématogène
ou par contiguïté à partir d’un foyer adjacent. La
classification des infections sur prothèse actuelle-
ment admise distingue :
les infections postopératoires précoces, dans le
➤
mois suivant l’intervention ;
les infections tardives, d’évolution chronique,
➤
évoluant depuis plus de 4 semaines ;
les infections aiguës hématogènes, avec la
➤
survenue brusque de manifestations cliniques sur
une prothèse jusque-là asymptomatique.
Diagnostic
◆
Le diagnostic des infections précoces et des infec-
tions aiguës hématogènes est en règle générale
facile avec un tableau clinique et biologique bruyant,
contrairement à celui des infections chroniques,
où le tableau est le plus fréquemment celui d’une
prothèse douloureuse. Une prothèse restée doulou-
reuse depuis sa mise en place sans intervalle libre
est fortement évocatrice.
Le diagnostic microbiologique est souvent difficile. Il
faut insister sur la nécessité absolue de réaliser des
prélèvements de qualité, obtenus lors d’une inter-
vention ou par ponction du foyer (6). Il faut proscrire
les écouvillonnages de plaies, pratiqués sans contrôle
médical. La positivité de tels prélèvements, le plus
souvent due à une contamination du prélèvement,
risque d’engager la responsabilité du chirurgien de
façon inappropriée, motivant une antibiothérapie
inadaptée et masquant par ailleurs les résultats
d’éventuels prélèvements profonds ultérieurs. Les
prélèvements doivent être étudiés par un laboratoire
rompu à la recherche de ce type d’infection, avec
des cultures prolongées. Ces prélèvements condi-
tionnent toute la thérapeutique ultérieure.
Traitements
◆
Le traitement doit toujours être chirurgical et
médical. Les différentes stratégies proposées
sont le nettoyage chirurgical avec maintien de la
prothèse, le changement en un ou deux temps de
la prothèse (7).
Le lavage-débridement de la prothèse, associé à une
antibiothérapie, peut être envisagé s’il s’agit d’une
infection détectée rapidement après la contamina-
tion périopératoire ou hématogène. En effet, le taux
d’échec augmente avec le délai de prise en charge,
classiquement dépassé après 3 semaines.
Le changement de la prothèse peut se faire en un
ou deux temps. Ce choix repose sur les habitudes de
chaque équipe, la réalisation d’études comparatives
étant méthodologiquement difficile, puisque de
nombreux facteurs conditionnent le résultat (type
de germe, terrain, délai de prise en charge, qualité
du débridement chirurgical, etc.). On propose clas-
siquement :
le changement en deux temps dans les situations
➤
où l’infection est due à un germe multirésistant,
lorsqu’il s’agit d’une récidive septique ou s’il existe
des dégâts osseux ;
le changement en un temps en cas d’infection
➤
bactériologiquement documentée avant l’interven-
tion, sans germe multirésistant, sans destruction
osseuse, et si l’excision chirurgicale est considérée
de bonne qualité.
En cas de changement en deux temps (figure 3),
un espaceur sera mis en place pendant la durée
de l’intervalle libre, associé à une antibiothérapie
adaptée au germe. Une fenêtre thérapeutique de
15 jours est classiquement réalisée avant la mise
en place de la nouvelle prothèse, pour permettre la
réalisation de nouveaux prélèvements et l’adaptation
de l’antibiothérapie (8).

Figure 3. Reprise de prothèse totale de genou en deux temps.
Figure 4. Descellement d’une prothèse
uni compartimentale.
22 | La Lettre du Rhumatologue • N° 350 - mars 2009
Complications des prothèses de genou
MISE AU POINT
Les complications
des prothèses partielles
Les prothèses unicompartimentales
Les résultats à long terme des PUC se rapprochent
actuellement des résultats des prothèses totales
de genou (9). Outre les complications communes
aux prothèses de genou, telles que l’infection, les
complications les plus fréquentes des PUC sont le
descellement par usure mécanique (figure 4) et
la détérioration du compartiment opposé ou du
compartiment fémoro-patellaire. Tous les auteurs
insistent sur l’hypo correction de la déformation,
afin d’éviter une usure précoce du compartiment
opposé, ce qui nécessite une parfaite maîtrise tech-
nique et une sélection draconienne des patients,
les complications intervenant selon la majorité des
auteurs soit à cause d’erreurs techniques, soit en
raison d’une contre-indication de la PUC. Parmi les
contre-indications des PUC, il faut retenir les mala-
dies inflammatoires, l’absence de LCA fonctionnel,
un flessum > 15°, une déviation axiale > 15° (surtout
en cas de surpoids), une arthrose fémoro-patellaire
avérée, et enfin l’échec d’une ostéotomie préalable
en l’absence d’hypocorrection franche (10).
Les prothèses fémoro-patellaires
Les complications après la pose d’une prothèse
fémoro-patellaire sont de deux types.
Premièrement, la dégradation progressive du
➤
ou des compartiments fémoro-tibiaux, notamment
en cas d’anomalie de l’axe fémoro-tibial, est rela-
tivement fréquente, dans la mesure où l’indication
de prothèse fémoro-patellaire est posée chez des
patients âgés. La reprise chirurgicale avec mise en
place d’une PTG est parfaitement justifiée ;
deuxièmement, les complications liées à l’im-
➤
plant fémoro-patellaire sont représentées par le
descellement, l’usure du bouton patellaire, et par
la bascule et/ ou la subluxation de la patella, qui
peuvent nécessiter, en fonction de la symptoma-
tologie, une reprise chirurgicale (11). Les résultats
des prothèses fémoro-patellaires, qui sont aléatoires
dans le temps, doivent être mis en parallèle avec ceux
des PTG, qui sont beaucoup plus constants. ■
1. Memtsoudis SG, Gonzales Della Valle A, Besculides MC et
al. Trends in demographics, comorbidity profiles, in-hospital
complications and mortality associated with primary knee
arthroplasty. J Arthroplasty 2008;14[Epub ahead of print].
2. Pinaroli A, Servien E, Lustig S et al. Causes d’échec des
arthroplasties totales de genou dans une série continue
de 1 795 PTG de première intention. Rev Chir Orthop
1993;(Suppl. 7):81-2.
3. Bonnin M, Deschamps G, Neyret P et al. Revision in non-
infected total knee arthroplasty: an analysis of 69 consecu-
tive cases. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot 2000;
86:694-706.
4. Leone JM, Hanssen AD. Management of infection at
the site of a total knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Am
2005;87A:2336-48.
5. Tsukayama DT, Goldberg VM, Kyle R. Diagnosis and mana-
gement of infection after total knee arthroplasty. J Bone
Joint Surg Am 2003;85(Suppl. 1):75-80.
6. Bauer T, Piriou P, Lhotellier L et al. Résultats des chan-
gements de prothèse de genou pour infection. À propos de
107 cas. Rev Chir Orthop 2006;92:692-700.
7. Burnett SJ, Kelly MA, Hanssen AD et al. Technique and
timing of two-stage exchange for infection in TKA. Clin
Orthop 2007;464:164-78.
8. Haleem AA, Berry DJ, Hanssen AD. Mid-term to long-term
followup of two-stage reimplantation for infected total knee
arthroplasty. Clin Orthop 2004;428:35-9.
9. Wood JE Jr. Unicompartmental knee arthroplasty. Current
Opinion in Orthopedics 2006;17:139-44.
10. Cartier P, Epinette JA, Deschamps G et al. Prothèse
unicompartimentale de genou. In: Cahier d’Enseignement
de la SOFCOT. Paris : Elsevier, 1998;65.
11. Ackroyd CE, Newman JH. Patello-femoral arthroplasty
fifteen years experience with 326 cases. J Bone Joint Surg
Br 2005;87B(suppl. 3):338.
Références bibliographiques
1
/
5
100%