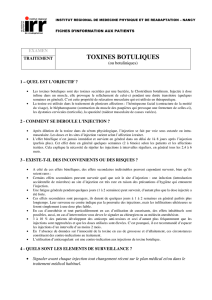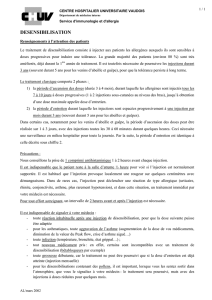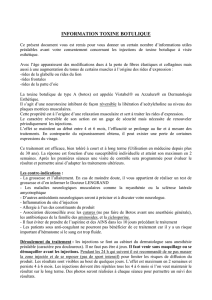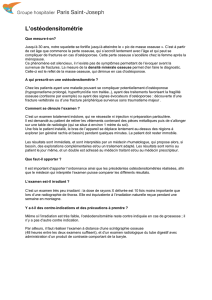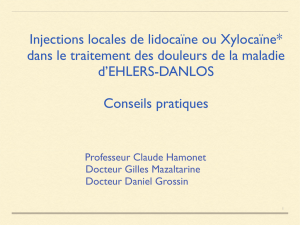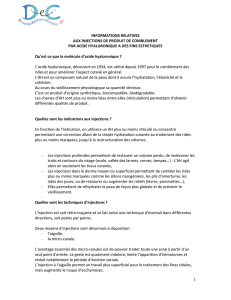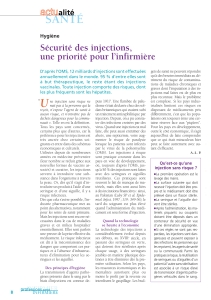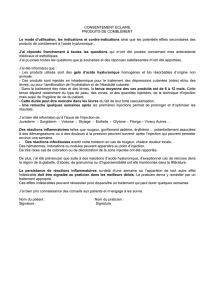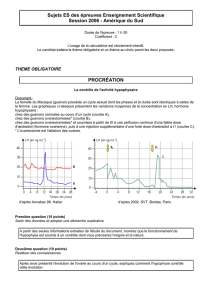Q U E S T I O N S / R...

QUESTIONS/RÉPONSES
43
La Lettre du Rhumatologue - n° 264 - septembre 2000
?
?
Nous souhaitons que cette rubrique favorise les échanges. Faites-nous parvenir vos critiques, vos questions.
Les auteurs et/ou le comité de rédaction y répondront.
Ma question concerne deux arthrites micro-
cristallines à microcristaux de pyrophosphate
de calcium survenues après des injections
d’acide hyaluronique effectuées récemment
chez deux de mes malades qui présentaient une
gonarthrose évoluée associée à une chondro-
calcinose articulaire. Je voudrais savoir si cette
complication est fréquente et si la chondrocal-
cinose doit être une contre-indication aux injec-
tions d’acide hyaluronique.
Il faut d’abord rappeler que la fréquence des réactions dites
inflammatoires (épanchement, douleur) au décours d’une
injection intra-articulaire d’acide hyaluronique (AH) est esti-
mée à 2,7 % par injection, soit 7 % par patient, pour ce qui
est des trois injections d’hylane GF-20.
La première question concerne la fréquence de cet effet indé-
sirable. Quelques observations de la littérature ont fait état
de poussées de chondrocalcinose articulaire (CCA) au décours
(dans les 12 à 48 heures) de l’injection intra-articulaire d’AH,
toutes rapidement résolutives sous AINS. Dans tous les cas, il
existait des microcristaux lors de la ponction, alors qu’il
n’existait une chondrocalcinose radiologique que dans deux
des quatre cas publiés. Trois crises sont survenues sous Hyal-
gan®et une sous Synvisc®. Une autre observation a été rap-
portée récemment (ACR 1999). La fréquence exacte est impos-
sible à déterminer sur ces quelques observations ponctuelles.
La littérature la sous-estime très probablement, car, comme
dans votre expérience, un certain nombre de praticiens ont
déjà observé cet effet secondaire.
Cet effet secondaire peut survenir au décours de la première
injection, voire après plusieurs injections. Une seule obser-
vation fait état de crises itératives chez un même patient.
Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer un tel
effet : baisse du pH intra-articulaire, le geste de l’injection
lui-même libérant des microcristaux, diminution de la clai-
rance des cristaux, injection de substances tensioactives. L’hy-
pothèse la plus séduisante tient compte de la présence de phos-
phates dans la préparation du produit qui pourrait, en
modifiant le taux local de calcium, favoriser les crises de CCA.
La seconde question, qui est de savoir si on peut pratiquer une
injection d’AH sur un genou présentant une CCA radiolo-
gique, a été abordée récemment par V. Daumen-Legré et al.
(Marseille). Il s’agit d’une étude ouverte prospective portant
sur 30 genoux (26 patients) avec une CCA radiologique (et
parfois antérieurement symptomatique) ayant bénéficié de
cinq injections de sodium hyaluronate. À la suite des 150 injec-
tions d’AH, la fréquence des réactions locales était de 7,3 %
(gonalgies transitoires ou réactions hydarthrodiales légères ;
n=6 patients), sans aucune crise d’arthrite. Par conséquent,
dans cette étude, la fréquence des réactions inflammatoires
n’est pas plus élevée que celle rapportée dans les études
incluant des genoux sans CCA. La présence d’une CCA ne
retentit pas, par ailleurs, sur le bon résultat clinique.
Il semble donc possible de réaliser une injection d’acide hya-
luronique, y compris en présence d’un liseré de CCA sur un
genou à infiltrer.
Néanmoins, il nous semble raisonnable d’exclure les patients
avec une CCA “active” ayant, dans un passé récent, fait d’au-
thentiques crises d’arthrite microcristalline.
X. Chevalier
Un de mes patients atteint d’une polyarthrite
sévère est actuellement bien équilibré par 15 mg
de méthotrexate par semaine en injection i.m.
La voie
i.m.
a été adoptée car la même posolo-
gie s’était avérée insuffisante par voie orale. Ce
patient vient de bénéficier de la mise en place
d’une deuxième prothèse de hanche, et le chi-
rurgien déconseille vivement les injections
i.m.
Peut-on injecter le méthotrexate par voie sous-
cutanée ?
Bien que seules les voies orale, intramusculaire et intravei-
neuse soient mentionnées dans le Vidal
®
,plusieurs publications
font état d’une biodisponibilité satisfaisante du produit après
administration sous-cutanée, comparable à celle de la voie
intramusculaire. La tolérance semble également correcte, per-
mettant même au malade de réaliser lui-même ses injections.
Vous pouvez donc sans problème proposer à votre patient de
faire ses injections de méthotrexate par voie sous-cutanée, pour
éviter qu’une éventuelle infection de prothèse ne soit imputée
aux injections intramusculaires. Il faut cependant rappeler
qu’une injection de 15 mg de méthotrexate représente un
volume assez important pour un usage par voie sous-cutanée.
T. Schaeverbeke

La Lettre du Rhumatologue - n° 264 - septembre 2000
44
QUESTIONS/RÉPONSES
?
?
?
On connaît les effets de la sédentarité sur la
masse osseuse. Que penser d’une activité phy-
sique très intense? Il s’agit d’une femme de
57 ans, ménopausée depuis l’âge de 56 ans, sous
THS, n’ayant jamais eu de troubles des règles,
sans facteur de risque pour l’ostéoporose et dont
la masse osseuse est très basse au col fémoral et
au rachis (– 3,52 et – 4,26 DS). Elle pratique un
sport qui consiste à marcher très rapidement sur
de longues distances : 100 à 300 km par semaine !
L’exercice physique intense provoque une augmentation de la
densité osseuse globale mais plus forte sur les segments sque-
lettiques sollicités par le sport en cause. Ainsi, chez le joueur
de tennis de bon niveau, on observe une importante augmen-
tation de la densité osseuse de l’avant-bras du côté dominant,
qui peut atteindre 20 % par rapport à l’autre avant-bras. Chez
les marathoniens, la densité osseuse est particulièrement éle-
vée sur les membres inférieurs, en particulier les tibias et les
fémurs. Les circonstances sportives au cours desquelles la den-
sité osseuse n’augmente pas sont, d’une part, la natation et,
d’autre part, les activités physiques si intenses qu’elles provo-
quent une aménorrhée chez les jeunes filles (jeunes danseuses,
jeunes gymnastes). Chez votre patiente, âgée de 56 ans, méno-
pausée, et qui bénéficie d’un traitement hormonal substitutif,
une activité intense de marche à pied ne peut avoir que des effets
favorables sur la densité osseuse fémorale et rachidienne et sur
le risque de fracture ostéoporotique. Par contre, en raison du
kilométrage élevé, le risque de fracture de contrainte (méta-
tarsiens, tibias) est réel, mais pas directement lié à l’existence
d’une ostéopénie (même si celle-ci peut constituer un facteur
favorisant). La survenue d’une fracture de fatigue dépend sur-
tout des conditions de réalisation de l’activité sportive : acti-
vité intense chez un coureur ou un marcheur novice et mal pré-
paré ; changement brutal des programmes d’entraînement ;
reprise trop rapide du sport après une période de trêve pro-
longée ; modification de la surface d’entraînement (sol plus
dur) ; présence de troubles statiques des membres inférieurs ou
d’une chaussure inadaptée, car trop rigide.
Chez cette patiente, le kilométrage hebdomadaire peut paraître
important, mais il est comparable à celui des marathoniens de
bon niveau qui courent habituellement 100 à 200 km par
semaine. De plus, les contraintes exercées par la marche à pied
sont trois fois moins importantes, même à allure rapide, que
celles occasionnées par la course de fond. Il paraît donc rai-
sonnable de laisser cette patiente continuer son activité phy-
sique dans les conditions actuelles, en maintenant le traitement
hormonal substitutif, en prescrivant une supplémentation en cal-
cium et en vitamine D, et en assurant des apports alimentaires
suffisants, en particulier sur les plans glucidique et protidique.
E. Legrand
La gastrotoxicité des AINS est-elle augmentée
par l’infection à Helicobacter pylori ?
Le rôle de l’infection à Helicobacter pylori dans la survenue
des symptômes digestifs et des lésions gastroduodénales liés
à la prise d’AINS n’est pas établi. Il n’existe actuellement pas
de données pour considérer que l’éradication de cette bacté-
rie soit susceptible d’améliorer la tolérance digestive des
AINS. Ainsi, la recherche systématique de H. pylori chez les
patients devant prendre des AINS est inutile. En revanche,
l’éradication est justifiée en cas d’ulcère (en particulier de
siège duodénal) apparaissant sous AINS, même si elle ne per-
met pas de réduire le risque de récidive ulcéreuse lié à la pour-
suite ou à la reprise du traitement anti-inflammatoire .
C. Bailly
Que proposer, dans le respect de l’AMM, à un
homme de 60 ans atteint d’une ostéoporose pri-
mitive avec complications fracturaires ?
L’ostéoporose masculine fait l’objet d’un regain d’intérêt ces
dernières années, avec des travaux intéressants du point de vue
épidémiologique et physiopathologique. Il manque cependant
de grandes études contrôlées sur le plan thérapeutique, pour
lequel cette affection reste orpheline. Un travail récent avait
été présenté l’an dernier, évaluant, de façon randomisée contre
placebo sur deux ans, l’effet de l’alendronate 10 mg/j sur plus
de 240 hommes d’un âge moyen de 63 ans avec une ostéopo-
rose définie par un antécédent de fracture ostéoporotique ou
un T-score au col inférieur à – 2. Tous les patients recevaient
une supplémentation vitamino-calcique.
Un gain significatif en densité osseuse est observé sur le site
lombaire et le site fémoral dans le groupe alendronate. Les frac-
tures vertébrales radiologiquement visibles sont moins fré-
quentes dans le groupe alendronate que dans le groupe placebo
(3,1 % versus 8,1 %), mais sans que cette différence atteigne le
seuil de la significativité statistique. Le pourcentage de frac-
tures non vertébrales est identique dans les deux groupes.
Cette étude ne suffira certainement pas à modifier les AMM
actuelles des bisphosphonates dans le traitement de l’ostéo-
porose, qui sont restreints à l’indication d’ostéoporose post-
ménopausique avec épisodes fracturaires.
La prescription actuelle des bisphosphonates dans l’indica-
tion d’ostéoporose masculine doit donc théoriquement être
accompagnée de la mention NR.
D. Wendling
1
/
2
100%