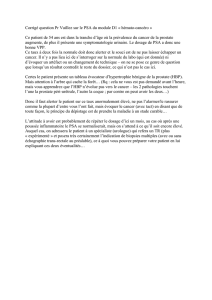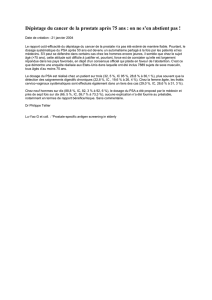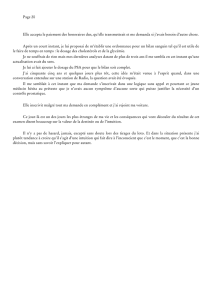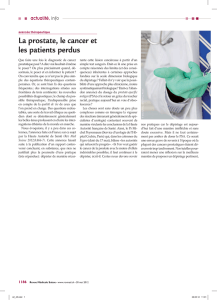REVUE GÉNÉRALE avéré significativement meilleur que celui du taux de PSA.

REVUE GÉNÉRALE
Actualités dans le cancer de la prostate
S. Oudard et al. ont publié, dans le Bulletin du Cancer (1), un
article général sur les principales questions d’actualité concer-
nant la biologie (HER2, Akt, ERK), le dépistage, les traite-
ments locaux, l’importance de la définition des patients à haut
risque en utilisant la vélocité du PSA prédiagnostic pour mieux
appréhender les tumeurs pouvant justifier un traitement adju-
vant, le moment le plus approprié de la radiothérapie et de
l’hormonothérapie complémentaire (précoce ou différée) et la
meilleure connaissance de l’histoire naturelle du cancer hor-
mono-indépendant. Celle-ci est basée sur le modèle pronos-
tique de Schulman, qui prend en compte le nadir du PSA post-
hormonothérapie (inférieur ou égal ou supérieur à 0,5 ng/ml),
le temps de doublement du PSA (inférieur ou supérieur ou égal
à 6 mois), le temps jusqu’à la rechute biologique (inférieur ou
égal ou supérieur à 7 mois). L’article fait surtout le point sur la
prise en charge thérapeutique des formes hormonorésistantes,
et en particulier sur la nouvelle place du docétaxel et des nou-
velles associations en perspective avec les traitements ciblés,
mais aussi d’approches d’immunothérapie (vaccins, anticorps),
et sur la possibilité d’instaurer ces traitements à des phases
plus précoces de la maladie. Cette synthèse peut servir de bon
état des lieux avant d’aborder les nouvelles données rapportées
en 2005.
BIOLOGIE
Signatures d’anticorps pour la détection précoce du cancer
de la prostate
À partir d’une bibliothèque de phages exprimant à leur surface des
peptides dérivés de tissus de cancers prostatiques, X. Wang et al.
(2) ont développé des signatures anticorps utilisant une technique
de micro-arrays dirigés contre un panel de 22 peptides pour
essayer d’améliorer la détection précoce des cancers de la pros-
tate. L’évaluation, réalisée sur 119 sérums de patients et ceux de
138 contrôles, a montré une spécificité de 88,2 % (IC95 : 0,78-
0,95) et une sensibilité de 81,6 % (IC95 : 0,70-0,95) pour distinguer
le groupe cancer du groupe témoin. Le pouvoir de distinction s’est
avéré significativement meilleur que celui du taux de PSA.
IGF-1-IGFBP-3
On constate que le taux d’IGF-1 n’est pas corrélé à un risque de
cancer de la prostate, alors qu’une augmentation des taux circu-
lants d’IGFBP-3 est associée à une réduction modeste du risque
dans l’étude rapportée par C. Chen (3).Celle-ci comparait
174 prélèvements réalisés 1 à 9 ans avant le diagnostic de cancer
(3,4 ans en moyenne) à 174 contrôles sans cancer de la prostate.
Association perte allélique 16q23.2 et meilleur pronostic
dans les cancers de haut grade
La perte d’hétérozygotie (LOH) en 16q23.2 est un événement
précoce et fréquent dans les cancers de la prostate, qui semble
lié au développement et à la progression tumorale. L’étude de
l’équipe de O. Cussenot (4), réalisée sur 61 tumeurs ayant fait
l’objet d’une prostatectomie, a montré que 16q23.2 LOH était
un facteur pronostique indépendant dans les tumeurs de haut
grade, suggérant que cette région chromosomique pourrait
contenir un gène impliqué dans la progression tumorale.
Les ostéoblastes dans les métastases osseuses des cancers
prostatiques
Se référer à la revue générale de Nature Review Cancer (5)
pour mieux connaître les interactions entre les ostéoblastes et
les cellules cancéreuses métastatiques afin d’anticiper le déve-
loppement des traitements ciblés de demain.
PRÉVENTION
Prévention par le finastéride.
Estimation de l’impact sur la mortalité
L’impact potentiel de l’essai de prévention par le finastéride Pros-
tate Cancer Prevention Trial (PCPT) est controversé car, si les
résultats montrent une réduction de 24,8 % de la prévalence de
cancer de prostate sur la durée de l’étude, il a été retrouvé une
augmentation du taux de tumeurs de haut grade (Gleason 8-10)
parmi les cancers diagnostiqués (11,9 % versus 5 %). En construi-
sant des estimations prenant en compte ces données, J.M. Unger et
al. (6) ont cependant pu calculer que l’utilisation du finastéride en
clinique pourrait se traduire par un impact majeur sur la mortalité.
Cancer de la prostate
Prostate cancer
●
P. Beuzeboc*
* Département d’oncologie médicale, Institut Curie, Paris.
312
La Lettre du Cancérologue - Volume XIV - n° 6 - novembre-décembre 2005
RÉTROSPECTIVE 2005

AINS et aspirine
Une prise régulière et prolongée de plus de 5 ans d’AINS ou
d’aspirine pourrait entraîner une réduction modérée du
risque de cancer de la prostate (RR respectivement de 0,82,
IC95 : 0,71-0,94, et de 0,85, IC95 : 0,73-0,99). C’est la conclu-
sion d’une vaste étude sur 70 144 patients, publiée par
E.J. Jacobs (7).
DÉPISTAGE
Survie des cancers de la prostate. Données des registres suédois
Pour décider de l’intérêt du dépistage, il est nécessaire de
déterminer la mortalité spécifique et la survie d’une population
qui n’est pas dépistée. G. Aus et al. (8) ont utilisé les données
prospectives et complètes des registres de trois régions consti-
tués de 8 887 patients présentant un cancer de la prostate dia-
gnostiqué entre 1987 et 1999. Avec un suivi médian de
80 mois, 5 873 patients (66,1 %) étaient décédés, dont 2 595 de
leur cancer (44,2 %). L’âge médian au moment du décès était
de 80 ans. Si le taux de mortalité spécifique apparaît important,
les auteurs insistent a contrario sur la durée de 15 ans pour
qu’il atteigne un taux de 56 %.
Valeurs du PSA aux États-Unis :
implications du choix du seuil de normalité
Certains ont proposé de baisser le seuil de normalité de 4 ng/ml
à 2,5 ng/ml pour augmenter le nombre de cancers dépistés.
D’après les données de la National Health and Nutrition Exa-
mination Survey (NHANES), approximativement 1,5 million
d’Américains âgés de 40 à 69 ans auraient un PSA > 4 ng/ml.
Si l’on baissait le seuil à 2,5 ng/ml, 1,8 million de plus présen-
teraient une valeur anormale (entre 60 et 70 ans, 17 % des
hommes ont un PSA > 2,5 ng/ml et 5,7 % au-dessus de
4ng/ml). Pour les hommes de plus de 70 ans, les chiffres cor-
respondants seraient de 1,5 et 1,2 million. H.G. Welch et al. (9)
ont conclu que fixer le seuil à 2,5 serait un non-sens ; cela dou-
blerait le nombre d’hommes qui justifieraient une biopsie.
Résultats à 10 ans des quatre études pilotes randomisées de
dépistage de Rotterdam qui ont précédé l’étude européenne
ERSPC
Sur 2 367 patients randomisés, à 10 ans, F.H. Schroder (10) a
rapporté 12 décès spécifiques dans le bras contrôle (n = 1 204)
versus 3 dans le bras dépisté (n = 1 163). Le faible effectif ne
permet pas d’analyse statistique.
Individualiser les intervalles entre les contrôles de PSA
dans le dépistage
À partir des 5 855 patients de l’étude randomisée suédoise de
dépistage, dont 539 (9,2 %) ont présenté un cancer de la pros-
tate avec un recul médian de 7,6 ans, G. Aus et al. (11) ont pu
recommander de faire seulement un dosage tous les 3 ans pour
des taux initiaux de PSA inférieurs à 1 ng/ml.
C’est ce que confirment aussi les données de Rotterdam sur
42 376 patients randomisés (12) dans l’étude européenne de
dépistage. Le risque de progression du PSA au-delà de 3 ng/ml
lors du deuxième screening à 4 ans dépend du seuil de PSA
lors du premier contrôle. Il était respectivement de 0,9 %,
9,3 % et 48,6 % pour des PSA initiaux inférieurs à 1, de 1 à 1,9
et de 2 à 2,9 ng/ ml.
DIAGNOSTIC
Apport de l’IRM endorectale et de l’imagerie
par spectroscopie en résonance magnétique
Elles permettent de diriger de nouveaux prélèvements en cas
de biopsies négatives chez des patients à haut risque.
L’imagerie continue à faire d’importants progrès, et ces nou-
velles techniques contribueront sans doute dans le futur à
l’identification de zones tumorales pour améliorer le rende-
ment des biopsies, comme le laissent supposer les premières
données (13).
PROSTATECTOMIE
Prostatectomie radicale versus watchful waiting
La mise à jour dans le New England Journal of Medicine de
l’étude randomisée suédoise (14) a montré avec un recul de
8,2 ans que la prostatectomie radicale réduisait le risque de
métastases (p = 0,004), de progression locale (p < 0,001), de
décès spécifique (p = 0,01) et de mortalité globale [p = 0,04],
avec 83 décès dans le groupe opéré (n = 347) versus 106 dans
le groupe watchful waiting (n = 348).
Prostatectomies radicales extrapéritonéales par cœlioscopie :
expérience de l’Institut Montsouris sur 600 cas
Le temps opératoire moyen a été de 173 minutes, les pertes
sanguines moyennes de 380 cc, le taux de transfusion de
1,2 %, les taux de complications majeures et mineures de
2,3 % et 9,2 %, le taux de reprise chirurgicale de 1,7 %, la
durée d’hospitalisation de 6,3 jours (15). Les stades pT2 et
pT3 représentaient respectivement 72 % et 28 %. Le taux de
marges positives était de 17,7 %. Avec un suivi moyen de
12 mois, 84 % des patients étaient continents ; les taux
d’érections et de rapports sexuels postopératoires étaient de
64 % et 43 % chez les patients sexuellement actifs en pré-
opératoire ayant bénéficié d’une préservation nerveuse bila-
térale.
Mortalité et complications majeures dans le mois suivant
la prostatectomie
S.M.H. Alibhai et al. (16) ont examiné ces données dans une
population de 11 010 hommes prostatectomisés dans l’Ontario
entre 1990 et 1999 et ont rapporté 53 patients décédés (0,5 %)
et 2 246 patients (20,4 %) ayant présenté une ou plusieurs
complications à 30 jours. Les comorbidités étaient un facteur
prédictif plus fort que l’âge.
Le toucher rectal n’est plus nécessaire dans la surveillance
des patients prostatectomisés
Avec un PSA indétectable, comme le montre l’enquête de
B.J. Chaplin (17) sur une série de 1 118 patients.
313
La Lettre du Cancérologue - Volume XIV - n° 6 - novembre-décembre 2005
TUMEURS UROLOGIQUES

Identification des patients à risque d’échec biologique
“cliniquement signifiant” après prostatectomie
À partir d’une cohorte de 1 011 patients prostatectomisés au
Barnes-Jewish Hospital de Saint Louis inclus dans une étude
prospective entre 1989 et 2002 (18), une vélocité du PSA supé-
rieure à 2 ng/ml/an (p = 0,001) et un score de Gleason à 7
(p = 0,006) ou 8-10 (p = 0,003) à la biopsie ont été significati-
vement associés à un temps de doublement postopératoire de
moins de 3 mois. Un PSA inférieur à 10 ng/ml (p = 0,005), une
tumeur non palpable (p = 0,001) et une vélocité préopératoire
n’excédant pas 0,5 ng/ml/an (p = 0,03) ont été associés à un
temps de doublement supérieur à 12 mois ou à l’absence de
récidive biologique (la plupart de ces patients ont un PSA qui
ne dépasse pas 0,25 ng/ml après un suivi médian de 3,6 mois).
Facteurs prédictifs de mortalité spécifique
après prostatectomie radicale ou radiothérapie
À partir d’une base de données de 8 669 patients, P. Zhou et al.
(19) ont évalué, dans une série de 1 159 patients traités par
prostatectomie (n = 498) ou par radiothérapie (n = 661) pour
un cancer de la prostate localisé et en échec biologique, la
valeur prédictive pour la mortalité spécifique de facteurs précé-
demment identifiés pour le temps jusqu’à métastases, tels que
le temps de doublement du PSA (PSA-DT) post-thérapeutique,
le score de Gleason, l’intervalle jusqu’à échec biologique. Un
PSA-DT de moins de 3 mois après prostatectomie (HR : 54,9,
IC95 : 16,7-180) ou après radiothérapie (HR : 12,8 %, IC95 : 7-
23,1) ainsi qu’un score de Gleason de 8-10 après radiothérapie
(HR : 6,1, IC95 : 3,4-10,7) sont significativement associés à la
mortalité spécifique.
Pour les patients avec un PSA-DT inférieur à 3 mois versus
supérieur ou égal à 3 mois, les taux de mortalité spécifique à
5ans après prostatectomie sont de 31 % (IC95 : 17 %-45 %)
versus 1 % (IC95 : 0-2 %), ceux après radiothérapie de 75 %
(IC95 : 59 %-92 %) et 35 % (IC95 : 24 %-47 %) respectivement
en cas de Gleason supérieur ou égal à 8 et inférieur ou égal à 7,
versus 15 % (IC95 : 0,8 %-28 %) et 4 % (IC95 : 1 %-6 %). Ces
paramètres devraient être pris en compte pour sélectionner les
patients à inclure dans des protocoles randomisés évaluant
l’intérêt d’une hormonothérapie associée ou non à une chimio-
thérapie.
Valeur prédictive pour la survie sans récidive à 10 ans
après prostatectomie totale du nomogramme de Kattan
La validation à 10 ans du nomogramme postopératoire de Kattan
à partir des données de deux cohortes indépendantes de
1782 patients (MSKCC) et de 1 357 patients (Cleveland Clinic
Foundation) pour prédire la survie sans récidive (définie par
une élévation du PSA, une progression clinique, une radiothé-
rapie postopératoire plus de 12 mois après la prostatectomie ou
l’initiation d’un traitement sytémique) a montré la robustesse
du modèle prédictif (20), avec un bon index de concordance.
Rappelons qu’il tient compte de la date de la prostatectomie,
des marges chirurgicales, de l’extension extracapsulaire, de
l’envahissement des vésicules séminales, de l’atteinte gan-
glionnaire, du score de Gleason initial, du score de Gleason
secondaire et du PSA préopératoire. Dans cette étude, les pré-
dictions ont été ajustées à l’utilisation de la radiothérapie adju-
vante. Il est possible de calculer ce risque de récidive sur www.
nomograms.org. Notons qu’aucun marqueur biologique, et en
particulier l’expression de la signature moléculaire, ne s’est
montré supérieur ou n’a permis d’améliorer la valeur prédic-
tive de ce nomogramme (21).
Obésité, prise de poids et risque de rechute biologique après
prostatectomie
Des facteurs environnementaux pourraient modifier l’évolu-
tion. Une étude prospective réalisée au MD Anderson Cancer
Center (22), concernant 526 patients traités entre 1992 et
2001, a montré que les patients obèses ayant un index de
masse corporelle (IMC) supérieur ou égal à 30 kg/m2au dia-
gnostic ont un taux de récidive plus élevé que les non-obèses
(p = 0,07). Par ailleurs, ceux qui étaient obèses à 40 ans
avaient un risque beaucoup plus élevé (p = 0,001). En étude
multivariée, un IMC plus élevé et un score de Gleason supé-
rieur ou égal à 7 restaient des paramètres pronostiques indé-
pendants. Les hommes ayant une prise de poids supérieure à
1,5 kg/an entre 25 ans et le diagnostic rechutaient plus rapi-
dement (17 mois versus 39 mois, p = 0,005). L’introduction
de l’obésité dans des nomogrammes augmentait leur valeur
prédictive dans cette étude. Ces données renforcent celles
déjà rapportées montrant une association entre obésité,
formes plus avancées et formes plus agressives.
AUTRES TRAITEMENTS DES FORMES LOCALISÉES
Qualité de vie à long terme après prostatectomie,
radiothérapie externe et curiethérapie
Dans l’enquête initiale du Ann Harbor, les patients qui avaient
fait l’objet d’une évaluation de la qualité de vie après un temps
médian de 2,6 ans après traitement à visée curative ont été
recontactés 4 ans plus tard avec une médiane de 6,2 ans (23).
Sur les 964 patients éligibles, 709 (73,5 %) ont complété leur
questionnaire. Dans quatre domaines (symptômes urinaires
obstructifs ou irritatifs, incontinence urinaire, troubles diges-
tifs, impuissance), des différences significatives par rapport au
groupe témoin étaient notées pour au moins un domaine.
Durant cet intervalle de quatre ans, les troubles post-prostatec-
tomie sont restés relativement stables. En revanche, les
troubles spécifiques retentissant sur la qualité de vie ont conti-
nué à évoluer pour les patients traités par curiethérapie et
radiothérapie externe.
Étude randomisée canadienne (24) comparant implant
d’iridium + radiothérapie externe à une radiothérapie externe
Cent quatre patients avec une tumeur T2 ou T3 M0 ont été
traités : 51 par curiethérapie (35 Gy) + radiothérapie
(40 Gy), 53 par radiothérapie (66 Gy). Avec un suivi médian
de 8,2 ans, 29 % ont présenté une rechute biologique ou cli-
nique avec l’association, versus 61 % avec la radiothérapie
seule. On peut seulement conclure que la dose de 66 Gy est
insuffisante.
314
La Lettre du Cancérologue - Volume XIV - n° 6 - novembre-décembre 2005
RÉTROSPECTIVE 2005

HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound) dans le traitement
des cancers localisés
Les résultats récents de l’étude multicentrique européenne
et de A. Gelet et al. basée sur 242 patients avec un suivi de
plus d’un an montre que l’HIFU (ou Ablatherm®) représente
une alternative pour traiter des cancers localisés bien diffé-
renciés ou moyennement différenciés avec un PSA inférieur
ou égal à 15 ng/ml chez des patients non candidats à une
prostatectomie radicale, obèses ou présentant des comorbi-
dités qui rendent l’intervention plus difficile (25). Un des
avantages de la technique est de pouvoir être répétée en cas
de récidive et d’éviter des complications urinaires. L’HIFU
a aussi pu être utilisée en cas de récidive locale après radio-
thérapie.
Elle a fait l’objet de recommandations de l’AFU.
Impact d’un délai dans la mise en route de la radiothérapie
sur la rechute biologique
Les données sont contradictoires. Dans l’expérience du Dana
Farber Cancer Institute de Boston (26), à partir d’une série de
460 patients (240 à haut risque), le délai affecte négativement
la survie pour les tumeurs à haut risque quand il est supérieur à
2,5 mois, mais pas les tumeurs à bas risque. En revanche, dans
celle du Fox Chase Cancer Center de Philadelphie (27), qui
repose sur 1 322 patients analysés selon 4 intervalles
(< 3 mois, 3-6 mois, 6-9 mois, > 9 mois), il n’a pas été retrouvé
d’influence pronostique du délai, et ce même avec le choix
d’un délai médian de 3,1 mois en considérant le groupe à mau-
vais pronostic.
Hormonothérapie adaptée au risque et escalade de dose
en radiothérapie 3D
Le groupe italien GICOR (28) a, entre décembre 1999 et
octobre 2001, traité 416 patients par escalade de dose en
radiothérapie 3D en adaptant l’hormonothérapie en fonction
du risque : radiothérapie seule pour 181 patients à bon pro-
nostic, hormonothérapie néoadjuvante pendant 4 à 6 mois,
poursuivie durant la radiothérapie pour 75 patients à risque
intermédiaire, et hormonothérapie néoadjuvante et adjuvante
2ans après la radiothérapie pour les patients à haut risque.
Après un suivi de 36 mois, le taux de survie sans récidive est
de 74 % pour tous les patients (respectivement de 80 %,
73 %, 79 % pour les trois groupes). En fonction de la stratifi-
cation en groupe de traitement, le bénéfice d’une dose plus
élevée de radiothérapie était significatif pour les patients à
faible risque (p = 0,009), mais aussi pour ceux à risque élevé
(survie sans récidive biologique à 5 ans de 63 % pour des
doses inférieures à 72 Gy, versus 84 % pour celles supé-
rieures ou égales à 72 Gy, p = 0,003).
Intérêt de la radiothérapie postopératoire pour les tumeurs
avec des marges positives ou pT3
Les résultats de la première étude contrôlée EORTC 22911 ont
été publiés par M. Bolla dans le Lancet (29). Cinq cent trois
patients ont été randomisés dans le bras wait and see, et 502
ont été traités par radiothérapie immédiate (60 Gy en
6semaines) après prostatectomie. Avec un suivi médian de
5ans, en analyse en intention de traiter, la survie sans progres-
sion biologique était significativement améliorée dans le bras
radiothérapie (74 %, IC98 : 68,7-79,3 %, versus 52,6 %, IC98 :
46,6-58,5 %), ainsi que la survie sans progression clinique
(p = 0,0009) et le taux de rechute locale (p < 0,0001). Il faudra
attendre les données en survie globale.
Suppression androgénique adjuvante et radiothérapie versus
radiothérapie seule.
Mise à jour des résultats de l’étude RTOG 85-31 (30)
Les patients présentant une tumeur T3 N+ étaient éligibles.
Dans le premier groupe, la goséréline était débutée la dernière
semaine de la radiothérapie et poursuivie indéfiniment ; elle
n’était débutée qu’à la rechute dans le deuxième groupe. Entre
1987 et 1992, 997 patients ont été randomisés. À 10 ans, le
taux de survie est significativement en faveur du bras hormo-
nothérapie adjuvante (49 % versus 39 %, p = 0,002), ainsi que
le taux de rechute locale (23 % versus 38 %, p < 0,001) et
l’incidence des métastases (24 % versus 39 %, p < 0,001) [30].
Plus spécifiquement, les 173 patients de cette étude qui présen-
taient un envahissement ganglionnaire histologique ont fait
l’objet d’une publication particulière (31). Soixante-quinze ont
été traités par radiothérapie seule et 98 par radiothérapie et dépri-
vation androgénique immédiate. Les données initiales avec un
suivi médian de 4,9 mois avaient montré une différence signifi-
cative en termes de contrôle biologique, de contrôle local et de
métastases à distance, mais pas de survie globale. Avec un recul
médian de 6,5 ans pour tous les patients (9,5 ans pour les
patients en vie), l’association d’une hormonothérapie immédiate
en analyse multivariée a montré un impact significatif sur la sur-
vie globale (p = 0,03), l’échec spécifique (p = 0,014), la progres-
sion métastatique (p = 0,0005), et les contrôles biologiques aux
limites de 1 ng/ml et de 4 ng/ml (p < 0,0001 pour les deux).
FORMES RÉCIDIVANTES
Faudra-t-il modifier les critères de l’ASTRO de l’échappement
biologique après radiothérapie ?
À partir des données poolées de neuf institutions (32) sur
4839 patients avec une tumeur T1-2 traitée par radiothérapie
externe entre 1986 et 1995 (> 60 Gy), 3 définitions pour pré-
dire un échec à distance ont montré une sensibilité et une spé-
cificité supérieures à celles des critères de l’ASTRO (respecti-
vement 55 % et 68 %) : un PSA supérieur à nadir + 3 ng/ml
(76 % et 72 %), un PSA supérieur à nadir + 2 ng/ml (72 % et
70 %), deux augmentations successives d’au moins 0,5 ng/ml
(69 % et 73 %). L’augmentation des doses de radiothérapie
était associée à un nadir plus bas du PSA, à un temps plus long
jusqu’au nadir, ainsi qu’à une amélioration des survies sans
récidive biologique ou clinique (33).
Histoire naturelle du rising PSA chez les patients
non métastatiques hormonorésistants
M.R. Smith et al. (34), à partir du groupe placebo de
210 patients inclus dans un essai avorté pour essayer d’évaluer
315
La Lettre du Cancérologue - Volume XIV - n° 6 - novembre-décembre 2005
TUMEURS UROLOGIQUES

les effets du zolédronate sur le délai d’apparition des méta-
stases osseuses, ont rapporté que 33 % des patients avaient
développé des métastases osseuses dans les 2 ans. La médiane
de survie sans métastases osseuses était de 30 mois. Un taux de
PSA supérieur à 10 ng/ml (RR = 3,18, IC95 : 1,74-5,8,
p<0,001) et la vélocité du PSA étaient deux facteurs prédictifs
indépendants d’un délai plus court jusqu’à l’apparition de la
première métastase osseuse, mais aussi d’une diminution de la
survie globale.
Nadir de PSA et mortalité spécifique des patients traités
par hormonothérapie lors de la progression biologique après
prostatectomie ou radiothérapie
Un nadir de PSA supérieur à 0,2 ng/ml après 8 mois de dépri-
vation androgénique est significativement associé à la mortalité
spécifique, comme l’a montré A.J. Stewart (35) dans l’étude
multiparamétrique d’une cohorte de 747 patients en échec bio-
logique avec scintigraphie osseuse normale après chirurgie
(n = 486) ou radiothérapie (n = 261) [p < 0,0001]. Un temps de
doublement du PSA (PSA-DT) pré-hormonothérapie inférieur
à 3 mois et un score de Gleason élevé (8-10) représentent éga-
lement deux facteurs pronostiques majeurs (p = 0,002 et
p=0,0001).
Ces données pourraient servir de rationnel à l’initiation d’une
étude de phase III d’hormonothérapie plus ou moins docétaxel.
Récidives locales symptomatiques après radiothérapie
Elles sont peu fréquentes : elles représentent 3,4 % (33 patients
sur 964) de la série du MD Anderson publiée par D. Leibovici
(36), mais 8,3 % si l’on ne considère que les patients en progres-
sion biologique. Il s’agit en règle générale de sous-types histo-
logiques agressifs. Le stade clinique initial, le score de Gleason,
le taux initial de PSA sont également des facteurs prédictifs.
Chirurgie de rattrapage des récidives locales volumineuses
après prostatectomie
L’équipe du MD Anderson a rapporté l’expérience de 5 cas,
dont 4 traités par exentérations pelviennes, deux d’entre eux
survivant sans symptômes à 26 et 56 mois (37).
Expérience à long terme du traitement hormonal intermittent
lors de la rechute biologique après prostatectomie
Il faut attendre les données des études randomisées pour valider
scientifiquement la place du traitement hormonal intermittent.
L’équipe de Cochin (38) a publié les résultats, avec un suivi
médian de 92 mois après le début de l’hormonothérapie (36-
176 mois), d’une série de 57 patients. Le traitement initial fai-
sait appel à un anti-androgène seul, maintenu trois mois après
l’obtention d’un taux indétectable. Le traitement hormonal était
repris à un seuil de PSA de 4 ng/ml et suspendu lors de l’obten-
tion d’un chiffre en dessous de 1 ng/ml. Durant le suivi, 38,6 %
des patients ont nécessité le recours à un agoniste de la LH-RH
pour non-réponse à l’anti-androgène seul et 15,8 % ont présenté
une progression métastatique. Le taux de mortalité spécifique a
été de 12,3 %, le temps médian entre l’initiation de l’hormono-
thérapie et le décès par cancer de 86 mois.
Hormonothérapie immédiate ou différée à l’apparition des
symptômes : résultats de l’étude randomisée SAKK 08/88 (39)
Entre février 1988 et février 1992, 197 patients nouvellement
diagnostiqués, asymptomatiques, non candidats à un traitement
curatif et d’un âge médian de 76 ans (56-86 ans) ont été rando-
misés entre pulpectomie immédiate et pulpectomie différée.
Les deux groupes étaient bien équilibrés aux plans biologique
et clinique (67 % de T3-T4, 20 % de N+). Une castration diffé-
rée a été nécessaire chez seulement 58 % des patients du
groupe 2. Pour les autres patients, le traitement a été débuté
avec un intervalle médian de 3,2 ans. Il n’a été retrouvé aucune
différence en termes de survie globale (p = 0,96). Il faut noter
qu’en plus des effets de déprivation hormonale, le taux
d’hémoglobine était significativement plus bas dans le groupe
hormonothérapie immédiate. Les auteurs ont conclu que, dans
une population très âgée, il n’y avait pas de preuve de l’intérêt
d’un traitement immédiat, mais qu’il aurait fallu analyser la
qualité de vie. P.C. Walsh a commenté ces résultats dans le
Journal of Urology (40).
L’avantage d’une hormonothérapie immédiate en termes de sur-
vie spécifique ou globale n’est pas prouvé pour des sujets à bas
risque, comme l’a rappelé une table ronde d’experts européens
(41). De même, chez ces patients, il faut prendre en compte les
effets secondaires d’une castration ou d’une monothérapie par
anti-androgènes (accidents cardiovasculaires, gynécomastie).
Néanmoins, l’utilisation des agonistes de la LH-RH à un stade
localisé précoce a progressé de façon majeure ces dernières
années. Les bases de données SEER sur 100 274 cancers de
prostate diagnostiqués montrent une augmentation, avec un taux
passant de 3,7 % en 1991 à 30,9 % en 1999 (42).
Le PSA peut-il servir de marqueur prédictif de la survie pour
la survie des cancers de prostate métastatiques traités par
hormonothérapie?
L. Collette et al. (43) ont tenté de répondre à cette question à
partir des données individuelles concernant 2 161 patients trai-
tés dans des études randomisées comparant bicalutamide et cas-
tration et utilisant une approche méta-analytique de la réponse,
de la normalisation, du temps jusqu’à progression et des
mesures longitudinales du PSA. Le faible degré d’association
entre PSA et survie globale dans cette étude indique que les
effets des traitements hormonaux sur la survie ne peuvent être
prédits avec une précision suffisante pour avoir une validation
statistique. En pratique, des effets non nuls des traitements ne
pourraient être prédits qu’en présence d’un important effet sur
le temps jusqu’à progression du PSA pour servir de base à une
accélération de l’enregistrement d’une drogue dans cette situa-
tion. D’autres critères plus puissants doivent être recherchés, se
focalisant, par exemple, sur la cinétique du PSA, sur des mar-
queurs plus spécifiques ou sur une combinaison de marqueurs.
EFFETS SECONDAIRES DE L’HORMONOTHÉRAPIE
Risque fracturaire lié à la déprivation androgénique
À partir des données SEER sur 50 613 patients diagnostiqués
entre 1992 et 1997 (44), le taux de fractures chez les patients
316
La Lettre du Cancérologue - Volume XIV - n° 6 - novembre-décembre 2005
RÉTROSPECTIVE 2005
.../...
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%