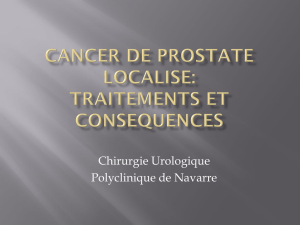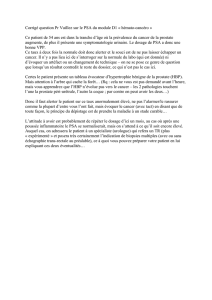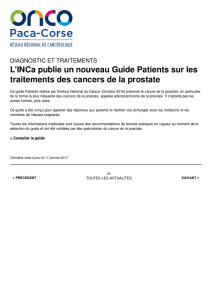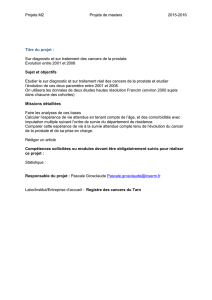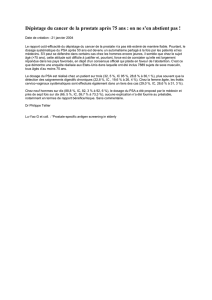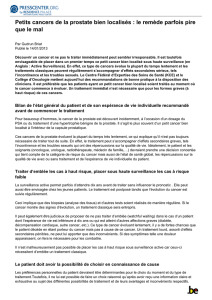La prostate, le cancer et les patients perdus

1186 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
30 mai 2012
actualité, info
La prostate, le cancer et
les patients perdus
Que faire une fois le diagnostic de cancer
prostatique posé ? A dire vrai faudrait-il même
le poser ? Ou plus précisément quand, dé-
sormais, le poser et en informer le patient ?
On conviendra que ce n’est pas la plus sim-
ple des équations thérapeutiques con tem-
po rai nes. Or, ce sont bien là des questions
fréquentes ; des interrogations situées aux
frontières de trois continents : les nouvelles
possibilités diagnostiques ; le champ du pos-
sible thérapeutique ; l’indispensable prise
en compte de la qualité de vie de ceux que
l’on prend en charge. Des questions redou-
tables, une sorte de travail éthique au quoti-
dien dont se désintéressent généralement
les belles âmes professant en chaire les inter-
rogations éthérées de la morale en marche.
Nous évoquions, il y a peu dans ces co-
lonnes, l’annonce faite en France sur ce sujet
par la Haute Autorité de Santé (Rev Med
Suisse 2012;8:866-7). Cette annonce faisait
suite à la publication d’un rapport contro-
versé concluant, en substance, que rien ne
justifiait plus la poursuite d’une pratique
(très répandue) : dépister de manière récur-
rente cette lésion cancéreuse à partir d’un
simple test sanguin. Etait-ce là une prise en
compte raisonnée des limites (et des consé-
quences) inhérentes à certaines approches
fondées sur la seule dimension biologique
du dépistage ? Fallait-il n’y voir que la possi-
bilité d’une approche plus clinicienne, moins
systématiquement biologique ? Etait-ce l’aban-
don annoncé du dosage du prostate-specific
antigen (PSA) et le retour en grâce du toucher
rectal, pratique aujourd’hui en voie d’obso-
lescence ?
Les choses sont sans doute un peu plus
complexes comme en témoigne la vigueur
des réactions (émanant généralement de spé-
cialistes d’urologie) contestant souvent de
manière virulente les conclusions de la Haute
Autorité française de Santé. Ainsi, le Pr Mi-
chel Peyromaure (Service d’urologie de l’Hô-
pital Cochin, Paris) qui, dans les colonnes du
Figaro (daté du 17 mai), blâme «les autorités
qui refusent le progrès». «Si l’on veut guérir
le cancer de la prostate avec le moins d’effets
indésirables possibles, il faut continuer à le
dépister, écrit-il. Certes nous devons revoir
nos pratiques car le dépistage est aujour-
d’hui fait d’une manière irréfléchie et sans
doute excessive. Mais il ne faut certaine-
ment pas arrêter de doser le PSA. Ce serait
une erreur grave de revenir à l’époque où la
plupart des cancers prostatiques étaient dé-
couverts trop tardivement. Nos tutelles pour-
raient mener une réflexion sur la meilleure
manière de proposer un dépistage pertinent,
avancée thérapeutique
LDD alvimann/morguefile
© istockphoto.com/Terry J Alcorn
42_45.indd 1 29.05.12 11:01

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
30 mai 2012 1187
efficace et peu coûteux. Elles préfèrent ne
pas s’engager et maintenir une position ré-
trograde.»
Nul ne sait si les hautes autorités sani-
taires françaises lisent ou non Le Figaro ; et là
n’est sans doute pas la priorité. L’urgence
réside en revanche dans la diffusion de mes-
sages pédagogiques éclairés à tous ceux qui
sont directement concernés au premier chef
par les cancers localisés de la prostate ; ceux
qui, patients et praticiens, se demandent s’il
faut ou non traiter. Et qui se demandent
comment choisir au mieux entre surveil-
lance, chirurgie ou radiothérapie ; confron-
tés qu’ils sont à une évolution naturelle que
l’on sait être souvent peu défavorable. C’est à
eux que répondent les rédacteurs (collectifs
et toujours anonymes) du mensuel Prescrire
dans la livraison datée de mai.1
Comme toujours cette réponse est formu-
lée après synthèse des publications dispo-
nibles à l’échelon international sur ce sujet ;
en l’espèce de 2000 à janvier 2012. Et cette
réponse comporte l’essentiel de ce que les
patients sont en droit de savoir dès lors que
le diagnostic de cancer prostatique localisé a
été porté et qu’ils en sont informés. Rappe-
lons qu’en l’absence de traitement d’emblée,
chez les patients ayant une atteinte d’un
seul lobe, un score histologique de Gleason
m 7 et un taux de PSA m 20 ng/ml, le risque
de mourir de ce cancer est l 0,5% par an.
Chez les patients ayant une tumeur plus
étendue, un cancer peu différencié (score de
Gleason L 7) ou un taux élevé de PSA, ce
risque est de l’ordre de 4% par an.
Dans ce contexte, les rédacteurs de Pres-
crire établissent deux cas de figure.
Cancers à risque faible (ou intermé-
diaire) d’évolution défavorable
Chez les patients ayant par ailleurs un
état de santé dégradé avec une espérance de
vie de moins d’une dizaine d’années le ris-
que de mourir de ce cancer est très faible.
Mieux vaut donc ne pas les exposer aux ef-
fets indésirables d’un traitement dont ils ne
tireront peu ou pas de bénéfices. «Chez les
autres patients il n’y a pas, début 2012, de
donnée d’évaluation comparative de fort ni-
veau de preuves pour guider les choix de
traitement, assure Prescrire. La surveillance
sans traitement initial est une option : sans
traitement d’emblée, le risque de mourir de
ce cancer est de l’ordre de 5% ou moins dans
les dix années qui suivent le diagnostic.»
La prostatectomie totale ? Elle a (dans un
essai) réduit la mortalité toutes causes con-
fondues de patients âgés de moins de 65 ans
en évitant un décès par cancer de la prostate
pour environ dix patients opérés et suivis
pendant treize ans. A long terme, environ
75% des hommes opérés souffrent de trou-
bles de l’érection (versus environ 50% en
cas de surveillance avec traitement différé).
Ces troubles sont nettement atténués par un
inhibiteur de la phosphodiestérase de type
5 (50% des cas versus 15% avec un placebo).
La prostatectomie totale entraîne une incon-
tinence urinaire chez 12 à 25% des patients.
La radiothérapie externe ? Dilemme : elle
est peut-être moins efficace que la prostatec-
tomie totale en termes de réduction de la
mortalité mais semble à l’origine de moins
de troubles de l’érection et de moins d’in-
continences urinaires. Rectite radique chez
15% des patients. Il ne semble pas, d’autre
part, certain que la curiethérapie soit aussi
efficace que la radiothérapie externe en ter-
mes de réduction de la mortalité. En revan-
che, c’est le traitement qui «expose le moins
aux risques de troubles de l’érection et d’in-
continence urinaire». Enfin, «un traitement
hormonal prolongé, utilisé seul, n’a pas sa
place en traitement des cancers localisés de
la prostate».
Cancers à risque élevé d’évolution
défavorable
Ce cas de figure correspond à l’envahis-
sement des deux lobes (stade T2c) ou quand
le cancer est peu différencié (score de Gleason
L 7) ou quand le taux de PSA est L 20 ng/ml.
Dans ce cas, «un traitement sem ble en gé-
néral justifié». Dilemme : «la prostatectomie
totale est une option envisagée mais son ef-
ficacité en termes de survie n’est démontrée
que chez les patients atteints d’un cancer lo-
calisé de meilleur pronostic»… Enfin, «la
radiothérapie externe associée à un traite-
ment hormonal pendant six mois est une
autre option souvent proposée», conclut Pres-
crire. Elle n’a pas fait l’objet de comparaison
directe avec la chirurgie.
Ce sont là les principaux éléments d’in-
formation permettant d’associer les patients
au choix d’une stratégie de traitement. La
question reste entière de savoir s’il faut sys-
tématiquement les associer ? Et si non, sur
quels critères on peut ou non les associer à
ce qui les concerne très directement. Peut-
être, faut-il conclure qu’il revient au prati-
cien (ou à l’équipe de praticiens) de décider
en son âme et conscience de la meilleure
conduite à tenir. Comme avant la médecine
fondée sur les preuves ? Peut-être bien.
Jean-Yves Nau
jeanyves.nau@gmail.com
1 Traiter (ou non) les cancers localisés de la prostate.
Prescrire 2012;32:362-8.
LDD alvimann/morguefile
42_45.indd 2 29.05.12 11:01
1
/
2
100%