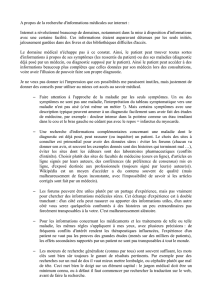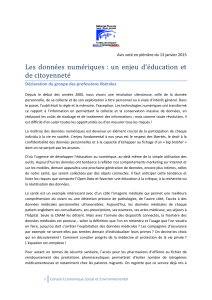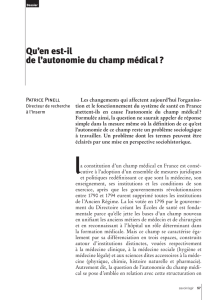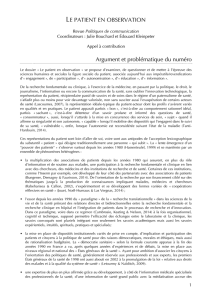L’ Errare◆humanum◆est,◆ perseverare◆diabolicum 1

616 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XIX - n° 10 - décembre 2010
VIE PROFESSIONNELLE
Errare◆humanum◆est,◆
perseverare◆diabolicum1
É. Caumes*
1
Citation latine attribuée à Sénèque
(4 av. JC – 65 apr. JC) mais formulée
antérieurement par Tite-Live, Cicéron
et Augustin d’Hippone.
* Rédacteur en chef de La Lettre de
l’Infectiologue, professeur à la faculté
de médecine de la Pitié-Salpêtrière,
université Pierre-et-Marie-Curie,
service des maladies infectieuses et
tropicales.
L’
erreur est humaine, malheureusement. Mais
quand l’erreur est médicale, les malades en
sont victimes. Pourquoi ? Comment ? Que
faire ? Il n’y a pas beaucoup d’éléments de réflexion
dans la littérature. Pour essayer d’avancer, je vais
partager quelques expériences personnelles (parfois
douloureuses, toujours instructives), vécues au cours
des trente dernières années, au gré de différentes
époques, comme responsable d’erreurs médicales
mais aussi comme victime, témoin ou expert auprès
des tribunaux.
L’erreur médicale :
un sujet tabou
On n’en parle pas ou si peu. On ne connaît pas son
importance, sa fréquence, ses conséquences. L’erreur
médicale n’est souvent pas enseignée à la faculté, ou
alors à une place négligeable par rapport à d’autres
“maladies” beaucoup moins fréquentes. Et aucune
revue, à ma connaissance, ne comporte de rubrique
dévolue à l’erreur médicale. La hiérarchie est quant à
elle mal à l’aise. En général, l’administration, quand
elle est informée, prend acte sans aller au-delà. Entre
collègues, nous avons aussi du mal à trouver notre
voie entre nos propres erreurs, difficilement assu-
mées, et celles des autres, trop facilement couvertes
par la déontologie médicale.
Pourtant, nous apprenons probablement plus de nos
erreurs que de nos succès. Il est aussi essentiel de
reconnaître nos erreurs, pour qu’elles ne se repro-
duisent pas. En effet, en dehors de rares circons-
tances, nos malades sont heureusement solides et
peuvent se remettre d’une erreur médicale si celle-ci
est bien réparée. Mais ils se remettront difficilement
d’un enchaînement d’erreurs médicales, ou de la
correction d’une erreur par une autre erreur, ou de
l’entêtement d’un médecin à ne pas reconnaître
son erreur.
Et il y a malheureusement aussi des erreurs qui ne
pardonnent pas, notamment dans une discipline
comme les maladies infectieuses : tout retard de
traitement adapté, dans le cas d’une infection sévère,
se paie en séquelles (neurologiques, perte de fonc-
tion ostéoarticulaire, amputation, etc.) voire de vie
humaine.
L’erreur médicale envisagée
de quatre points de vue
différents
Responsable
Je vais commencer par le plus difficile, “mes” erreurs.
Comme la plupart d’entre nous (certains n’en font
jamais…), j’ai fait de graves erreurs médicales (je
ne parlerai pas ici des petites, sans conséquence
sérieuse pour le malade). J’ai le souvenir précis de
deux d’entre elles.
La première, au début de mon externat, dans un
service (pas très réputé) de gastroentérologie. C’était
ma première semaine en tant qu’externe. On m’a
demandé de faire une ponction d’ascite à un vieux
cirrhotique. Ignorant la technique et non encadré,
j’ai fait la ponction dans l’hypochondre droit (c’est-à-
dire dans le foie hypertrophié) au lieu de la faire dans
l’hypochondre gauche. En voyant l’aiguille battre au
rythme du pouls et du sang en sortir à chaque pulsa-
tion, j’ai rapidement compris l’erreur qui aura “accé-
léré la fin” de ce pauvre patient, également atteint
d’un cancer du foie en phase terminale. C’étaient
les paroles de consolation de mon interne, irres-
ponsable, adressées à un apprenti médecin effondré.
La deuxième a eu lieu au cours de mon premier
semestre d’internat, aux urgences d’un “grand”
hôpital parisien, un samedi matin où j’étais bien seul,
là encore non encadré. Je suis arrivé à 9 heures pour
prendre mes fonctions. Dans le couloir, sur un bran-
card, gisait Albert ou Alfred, un “SDF bien connu”
de ce service qui, selon la responsable, “cuvait sa
cuite”. Il était arrivé dans la nuit, n’avait pas été vu
par l’interne de garde que l’on n’avait pas dérangé
“pour ça” et devait dégriser tranquillement, “comme
d’habitude”. La matinée a été tellement chargée que
je n’ai pas eu le temps de m’en occuper, d’autant que

La Lettre du Cancérologue • Vol. XIX - n° 10 - décembre 2010 | 617
VIE PROFESSIONNELLE
j’étais tout seul, les malades s’enchaînant les uns à
la suite des autres. Et puis à 13 heures, au moment
de partir, l’infirmière est entrée affolée dans le sas de
consultation. Monsieur A. était mort sur son bran-
card en plein milieu des urgences, probablement
d’une hémorragie digestive. Il n’a pas été autopsié.
Et je ne suis toujours pas à l’abri d’une erreur médi-
cale ; je n’y serai qu’une fois que je n’exercerai plus.
Victime
Malheureusement, le fait d’être médecin ne nous
épargne pas le fait d’être malade. Et comme dit
l’adage, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés,
même si, avec l’expérience du temps, je pense que
ce proverbe ne s’applique pas forcément à notre
métier. Au contraire, j’ai tendance à croire que nous
sommes mieux traités et pris en charge que le reste
de la population. Mais il est vrai que nous sommes
peut-être plus négligents par rapport à notre santé.
J’ai eu la malchance de souffrir d’une maladie très
rare (1 cas par an et par million d’habitants), le genre
de maladies dites “orphelines” qui doivent être prises
en charge par des spécialistes dans des centres de
référence. Dès le départ, l’affaire a été mal engagée
du fait d’une erreur de diagnostic radiologique. Cette
erreur initiale de diagnostic a été corrigée dès la
première intervention chirurgicale par l’évidence
macroscopique, facilement confirmée par l’histo-
logie. Mais elle a été suivie par des erreurs de prise en
charge, peut-être chirurgicales (je n’ai pas la compé-
tence pour juger) mais certainement médicales
par l’administration de médicaments aujourd’hui
délaissés tant ils faisaient plus de mal que de bien.
Cela a duré jusqu’à ce que je sois adressé, après
plusieurs années d’errance thérapeutique, à la seule
personne/équipe qui connaissait cette maladie à
Paris. Depuis quelque temps, je suis donc bien pris
en charge.
Le seul reproche que je fais finalement à ces méde-
cins et chirurgiens est d’avoir attendu tout ce temps
avant de prendre cette décision intelligente, celle
qu’ils auraient dû prendre dès le début s’ils avaient
été conscients des limites de leur compétence.
Témoin
Malheureusement, je suis toujours témoin d’erreurs
médicales, des petites le plus souvent, parfois des
grosses. Peut-être ai-je une sensibilité exacerbée à
ce sujet. Ou alors est-ce le fait de se retrouver en
haut d’un système pyramidal ou dans un service très
spécialisé qui fait que vous récupérez les malades
ayant erré de médecins en médecins avec des patho-
logies difficiles ou rares. Mais je suis loin d’en être
certain. J’ai bien l’impression que c’est fréquent. C’est
en tout cas à évaluer précisément par des études
rigoureuses. Les circonstances de l’erreur médicale
sont souvent les mêmes : le malade a été vu par un
médecin, non compétent ou débordé, isolé, sans
encadrement polyvalent et de qualité. C’est toujours
l’occasion de dire tout le bien (pour combien de
temps encore ? à la lumière des réformes actuelles)
de notre système médical (hospitalier universitaire),
système pyramidal qui permet la correction des
erreurs par le junior ou par le senior, qui encourage
l’échange entre médecins d’expériences différentes
et qui multiplie les occasions de rectifier nos erreurs.
Mais je reste stupéfait, parfois, des coûts engendrés
par l’incompétence médicale, non seulement pour
le malade mais aussi pour la société. Car la Sécurité
sociale rembourse des examens complémentaires
superflus, des traitements inefficaces, des chirur-
gies inutiles (appendicectomie de circonstance par
exemple…). Cela continue de m’interpeller. D’autant
que parfois, il suffit d’en avoir vu un cas dans sa vie
pour savoir tout de suite ce dont il s’agit. Et de régler
le problème avec un seul examen complémentaire
(approprié) et un seul traitement (adapté). Pour
prendre un exemple très classique, dans ma spécia-
lité, combien de giardiases vues au retour de voyage
et ayant “bénéficié” de diverses endoscopies (hautes
et basses) et examens biologiques sanguins (aussi
nombreux qu’inutiles et remboursés) avant d’envi-
sager un simple examen parasitologique des selles.
Expert
De temps à autre, au gré de ma disponibilité et de
mon intérêt pour le sujet, je suis sollicité pour des
expertises médicales, expériences passionnantes
mais chronophages. Les deux dernières expertises
ont abouti à des décisions discutables qui illustrent
bien la complexité du sujet.
La première concernait une infection nosocomiale
ostéoarticulaire précoce à S. aureus. Le diagnostic
n’avait pas été fait, ni même évoqué initialement,
tant par le service des urgences de l’hôpital local que
par le chirurgien qui avait opéré. Le retard diagnos-
tique aggravé par une antibiothérapie inadaptée et
d’autres péripéties ont fini par aboutir à une arthro-
dèse. Le patient a finalement été condamné à payer
les frais de justice !

UN PEU PLUS…
www.edimark.fr - Les Lettres, Les Correspondances, Les Courriers, Les Images, Les Pages de la Pratique Médicale
…PRÈS DE VOUS
La Lettre
du Cancérologue
Correspondances
en Onco-Urologie
Correspondances
en Onco-Hématologie
NOUS FAISONS DE VOS SPÉCIALITÉS NOTRE SPÉCIALITÉ

La Lettre du Cancérologue • Vol. XIX - n° 10 - décembre 2010 | 619
VIE PROFESSIONNELLE
Dans un autre cas, il s’agissait d’une septicémie à
streptocoque avec toxic strep syndrome, compliquant
une endométrite du post-partum, la fameuse fi èvre
puerpérale, autrefois si fréquente dans les suites de
couches avant l’arrivée de l’eau de Javel. Il est bon ici
de rappeler l’histoire d’Ignace Semmelweis (1818-
1865), chirurgien et obstétricien hongrois, considéré
comme le père de l’hygiène hospitalière et le précur-
seur de l’antisepsie des mains. L’utilisation de l’eau
de Javel, pour désinfecter les mains des chirurgiens
avant les accouchements, à partir de mai 1847, a
fait chuter dans son hôpital le taux de mortalité par
fi èvre puerpérale des mères en post-partum de 12 %
à 2,4 % puis à 1,3 %. Un grand classique des maladies
infectieuses, donc. Mais c’est l’“expert”, soutenant
que le streptocoque, responsable de cette infection,
avait plutôt été transmis par son mari lors de rela-
tions sexuelles orogénitales avant l’accouchement,
qui a été écouté. Et la patiente a été déboutée de
sa demande de conciliation amiable.
Gérer l’erreur médicale
Les solutions à ce mal qu’est l’erreur médicale
peuvent être déduites des histoires racontées.
Au-delà des facteurs humains (sur lesquels nous
reviendrons), il existe aussi des facteurs d’erreurs
médicales qui sont propres à notre système de
soins. Et on peut craindre, à la lumière de la réforme
actuelle, qu’ils se multiplient. Ils feront alors le
bonheur des experts judicaires comme des avocats
qui gagneront bien mieux leur vie que les médecins,
comme aux États-Unis, modèle pour certains !
Individuellement
La première étape est de reconnaître l’erreur et de
comprendre les mécanismes qui y ont conduit. Ce
n’est pas toujours évident. On observe deux attitudes
possibles. Les uns acceptent. Les autres réfutent,
parfois point par point, avec une mauvaise foi abra-
cadabrantesque. L’erreur doit ensuite être corrigée.
Le patient doit si nécessaire en être informé sous
peine d’une perte de confi ance. Enfi n, il faut être
encore plus attentif au risque d’une autre erreur.
Collectivement
Les erreurs doivent faire l’objet de réunions avec
l’équipe soignante pour partager, trouver les dysfonc-
tionnements de la chaîne décisionnelle et y remé-
dier. Elles résultent souvent de divers facteurs : un
isolement médical, un défaut d’encadrement, un
manque de dialogue, un grain de sable dans la chaîne
décisionnelle, une insuffi sance (parfois de la suffi -
sance) médicale, une incohérence fonctionnelle,
une absence de direction.
Les erreurs ont souvent lieu le week-end ou pendant
les vacances, le pire étant les week-ends pendant les
vacances. Et ce n’est pas un hasard. Il y a un manque
d’encadrement patent pendant ces périodes. Notre
système médical est excellent pour la formation
dans le sens qu’il met à l’épreuve des malades les
médecins assez tôt dans leur cursus. Mais ils doivent
être encadrés par des juniors et des seniors qui
doivent donc être disponibles pour cela.
Prévenir l’erreur médicale
Connaître les erreurs classiques
Certaines erreurs classiques doivent être connues
et enseignées : “un train peut en cacher un autre”,
“avoir la syphilis et le bureau de tabac” ou, autre-
ment dit, une maladie peut être associée à (ou en
cacher) une autre. Parfois, il peut s’agir d’une maladie
rarissime, d’une complication évolutive inhabituelle,
d’une interaction médicamenteuse inattendue, d’un
effet indésirable mal connu. Il ne faut pas non plus
attribuer au “psychosomatique” des symptômes
relevant d’une maladie organique, tout en sachant
que c’est parfois un art bien diffi cile de différencier les
choses, et que cela nécessite souvent une débauche
d’examens complémentaires inutiles. Un autre piège
classique, chez de tels patients, est de savoir recon-
naître l’événement médical au sein de la cohorte des
symptômes fonctionnels habituels de ce malade.
Modestie, disponibilité, compétence
Les erreurs médicales résultent aussi de certains
défauts propres à chacun d’entre nous. Le médecin
se doit donc d’avoir certaines qualités.
Mon Maître (en certains domaines), Marc Gentilini,
avait pour habitude, quand il accueillait les internes,
de leur demander quelle était, à leurs yeux, la qualité
fondamentale d’un médecin. Cela marchait bien. Les
internes se faisaient avoir à chaque fois. “La compé-
tence, Monsieur !” Et lui de leur répondre : “Non, la
Modestie, avec un grand M”. Effectivement, une
des qualités fondamentales d’un médecin est d’être
conscient des limites de ses compétences. “Savoir
ce que l’on sait, savoir ce que l’on ne sait pas, c’est
savoir véritablement” (Confucius, 551-479 av. JC).

620 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XIX - n° 10 - décembre 2010
VIE PROFESSIONNELLE
Et la deuxième qualité d’un médecin ? “La compé-
tence, Monsieur !”. Non (toujours pas), et il répon-
dait : “la Disponibilité avec un grand D”. Quand il
y avait, parmi ces nouveaux internes, un major de
l’internat, non conscient qu’il devait aussi sa place
à la chance, il commençait à se demander dans quel
service il allait débarquer. Pourtant, la disponibi-
lité est aussi d’une importance majeure dans notre
métier pour écouter, examiner, discuter, expliquer,
reconsidérer un jugement, redresser une erreur.
L’écoute est aussi fondamentale. Il faut savoir
entendre le malade qui bien souvent apporte le
diagnostic. Fred Siguier (1909-1972), le père de la
médecine interne en France, disait : “Je suis spécia-
lisé en interrogatoire (des malades)”. Ceci rejoint
la formule de William Osler (1849-1919), médecin
canadien et père de l’apprentissage clinique au lit du
malade : “Si vous écoutez attentivement le patient,
il vous donnera le diagnostic”. Et dans notre pratique
quotidienne, cela reste encore souvent vrai, surtout
à l’époque d’Internet. Nous devons toujours écouter
attentivement nos patients : ils nous donnent
souvent le diagnostic.
La disponibilité nous permet aussi de garder le
respect des malades et des familles, en cas de
problèmes. Une erreur médicale sera d’autant mieux
acceptée par le patient et sa famille qu’ils sentiront
que le médecin référent est resté disponible et à
l’écoute. Cela permettra aussi au médecin, respon-
sable de ses actes, de mieux l’assumer.
Mais il est à craindre que cette disponibilité soit
de plus en plus réduite. Car ce n’est, à l’heure de la
T2A, pas “rentable” d’être disponible, pour écouter,
examiner, expliquer. Il est beaucoup plus “rentable”
(apparemment pour la société, pas pour le malade)
de multiplier les examens complémentaires inutiles
et remboursés par la Sécurité sociale.
Et la troisième qualité d’un médecin ? Timidement,
certains des nouveaux internes (ils n’étaient plus
très nombreux à encore oser) essayaient encore
la “compétence”. Et alors, il leur répondait avec
un grand sourire : “Oui, la compétence, mais avec
un petit c”. C’était son côté provocateur. Car il est
quand même nécessaire d’être compétent dans notre
métier, et il vaut mieux l’être avec un grand C.
Une formation à enrichir
Il nous faut donc aussi nous interroger sur la
qualité des médecins que nous formons, comme
sur les compétences pédagogiques des ensei-
gnants. Une formation seulement fondée sur les
sciences est-elle la plus adaptée pour sélectionner
les hommes modestes, disponibles et compétents
qui nous soigneront demain ? La sélection par la
biophysique et les mathématiques formerait-elle
de meilleurs médecins que la philosophie ou les
sciences sociales, voire l’histoire ou la psycho-
logie ? Il y a certainement des choses à revoir. Et
certains doyens y réfléchissent d’ailleurs. L’histoire
de la médecine (celle d’Ignace Semmelweis, par
exemple), la psychologie, la philosophie, l’éthique
devraient être (ré)introduites dans l’enseignement,
histoire de sélectionner, de nouveau, des médecins
philosophes autant que des médecins scientifiques.
La contribution à l’impact factor serait certes plus
modeste, mais la qualité humaine des médecins en
serait certainement meilleure (il nous faut encore
croire que la médecine reste un art, même si elle
se sert de la science et de la technique [formule
volée à Iradj Gandjbakhch]).
Une fonction à revoir
Enfi n, on nous demande actuellement beaucoup trop
de choses : consulter, encadrer, enseigner, adminis-
trer, lire, chercher, publier et, maintenant, fi nancer.
Il est temps de reconnaître que faire tout ceci en
même temps n’est pas possible.
Il est temps d’adapter en conséquence notre système
médical et éducatif si nous ne voulons pas, à notre
tour, être victime un jour d’erreurs médicales. ■
208 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XI - n° 6 - novembre-décembre 2008
MISE AU POINT
Claudie Damour-Terrasson
et toute l’équipe éditoriale vous souhaitent
une très belle fin d’année 2010
au fil de nos pages papier et numérique
Claudie Damour-Terrasson
et toute l’équipe éditoriale vous souhaitent
une très belle fin d’année 2010
au fil de nos pages papier et numérique
au fil de nos pages papier et numérique
une très belle fin d’année 2010
une très belle fin d’année 2010
et toute l’équipe éditoriale vous souhaitent
au fil de nos pages papier et numérique
au fil de nos pages papier et numérique
au fil de nos pages papier et numérique
1
/
5
100%