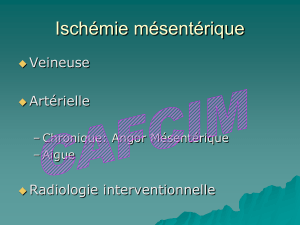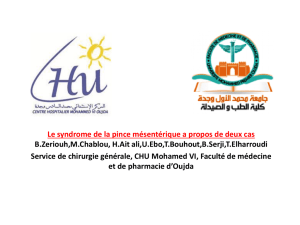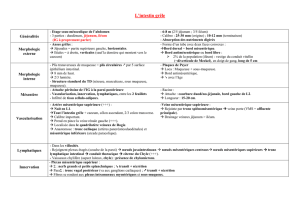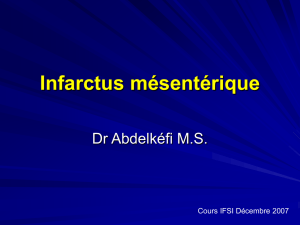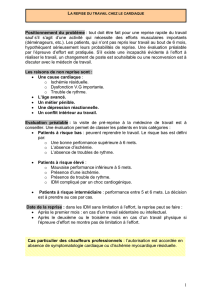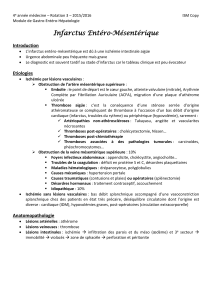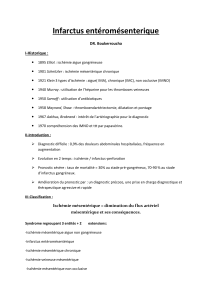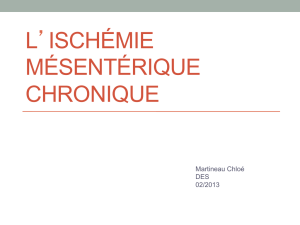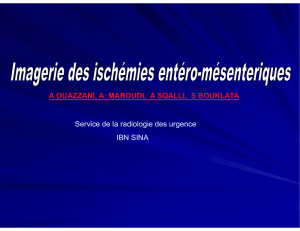Générer un fichier PDF

JFR 2008 - Ischémie mésentérique : éléments sémiologiques radiologiques
Mis à jour le 13/08/2010 par
SFR
P Otal
Issu du quotidien des JFR'08
-
Mardi 28 Octobre
L'ischémie mésentérique est une pathologie fréquente, aux étiologies variées et dont les conséquences
peuvent aller de la simple altération transitoire de l'activité intestinale à la nécrose transmurale. Du fait
de l'augmentation de la longévité, les personnes âgées sont particulièrement exposées à cette menace
vitale. Un diagnostic précoce est crucial en raison de l'évolution rapide vers l'infarcissement. Malgré les
avancées médicales diagnostiques et thérapeutiques, la morbidité et la mortalité restent élevées. En
effet, les aspects cliniques et radiologiques sont peu spécifiques et présentent de nombreuses
similitudes avec d'autres pathologies digestives. Alors que l'angiographie a fait longtemps partie de
l'algorithme diagnostique d'une ischémie mésentérique, les avancées les plus récentes de la
tomodensitométrie (TDM) en ont fait désormais la modalité d'exploration de choix.
La majorité des ischémies mésentériques sont de nature occlusive, avec une prédominance de l'étiologie
artérielle sur la veineuse. Les causes artérielles sont dominées par les embolies (environ 50 % des cas),
d'origine cardiaque pour la plupart, les embols se bloquant généralement sur des branches de division
moyennes ou distales de l'artère mésentérique supérieure. Les thromboses artérielles (25 % des cas)
concernent généralement l'origine des artères mésentériques, dans un contexte d'athérosclérose. Outre
l'oblitération de la lumière artérielle, la pression sanguine artérielle et le développement préalable d'une
éventuelle circulation collatérale conditionnent la sévérité des lésions digestives, au point que
l'occlusion d'une des artères mésentériques peut ne pas entraîner d'infarcissement si la collatéralié est
suffisamment développée.
L'ischémie mésentérique non occlusive (environ 20 % des cas) est la traduction d'une vasoconstriction
splanchnique, plus souvent secondaire à un bas débit (incompétence cardiaque, état de choc,
septicémie, déshydratation, hypotension, chirurgie abdominale ou cardiaque) qu'à un médicament
(digoxine, cathécholamine, vasopressine...) ou une drogue (cocaïne) vasoconstrictrice.
Les thromboses veineuses sont plus rares (5 % des cas d'ischémie mésentérique), elles sont parfois
peu symptomatiques mais peuvent également être létales, elles sont favorisées par l'hypertension
portale, les foyers inflammatoires abdomino
-
pelviens, la chirurgie abdominale, les traumatismes, les
pathologies cardiaques ou rénales, la contraception orale, les états d'hypercoagulabilité. La veine
mésentérique supérieure est concernée dans la majorité des cas.
Des causes beaucoup plus rares méritent d'être connues : occlusion intestinale, dissections, néoplasies,
traumatismes, radiothérapie. Les vascularites ont pour particularité de concerner des sujets
relativement jeunes et de pouvoir toucher des segments digestifs épargnés par les formes habituelles
d'ischémie du fait de la richesse de la collatéralité : estomac, dudodénum, rectum.
Les symptômes cliniques sont aspécifiques, participant au retard diagnostique. La discordance entre
l'importance des douleurs et la pauvreté de l'examen clinique est classique. Les informations
biologiques (gazométrie, leucocytes) sont peu contributives.
Les performances de l'abdomen sans préparation souffrent d'une sensibilité et d'une spécificité
médiocres, la séméiologie se limitant généralement à un iléus, les classiques images en empreinte de
pouce et l'écartement des anses par épaississement pariétal étant rarement visualisées, a fortiori la
pneumatose pariétale et l'aéroportie. Même en cas d'occlusion vasculaire proximale (qui n'est pas la
plus fréquente), l'apport de l'échographie reste limité par la distension aérique digestive. Quant à
l'angiographie, du fait des progrès considérables de l'angioscanner, ses indications se limitent, à l'heure
actuelle, aux cas où la suspicion d'ischémie mésentérique non occlusive est très forte, dans la
perceptive d'un traitement vasodilatateur in situ, sous réserve de l'absence de signe de gravité,
notamment péritonéal.
La TDM a l'avantage d'apporter des éléments sémiologiques concernant d'une part les vaisseaux, d'autre
part les structures digestives. La difficulté majeure réside dans l'absence de spécificité de la plupart des
signes, le diagnostic reposant alors sur une combinaison d'éléments. La complexité de l'analyse
sémiologique impose un protocole d'acquisition rigoureux : un passage SPC permet de rechercher du
sang frais dans les vaisseaux et dans la paroi du tube digestif, les paramètres d'acquisition de la phase
artérielle chercheront à optimiser la qualité des reconstructions angiographiques, le temps veineux est
essentiel car il apporte la plupart des éléments concernant la paroi du tube digestif.
Les anomalies vasculaires (Fig. 1 et 2) sont d'autant plus faciles à mettre en évidence qu'elles sont plus
proximales, les embols distaux peuvent être manqués, malgré l'amélioration de la résolution spatiale
des scanners récents, et la constatation d'infarctus hépatiques, spléniques ou rénaux sera utile pour
redresser le diagnostic. Lorsqu'elles sont abondantes, les calcifications athéromateuses proximales
peuvent gêner la détection d'un thrombus.
Parmi les anomalies pariétales, le signe le plus fréquemment noté est l'épaississement, résultant d'une

infiltration oedémateuse, hémorragique et/ou inflammatoire. Il est habituel dans les atteintes coliques
(où peut intervenir également une surinfection) et les formes veineuses d'atteinte grêlique (Fig. 2), plus
rare, voire inhabituel, dans les atteintes grêliques d'origine artérielle. Il est plus fréquent dans les
formes réversibles que dans les nécroses transmurales. Le rehaussement pariétal est variable : majoré
dans les thromboses veineuses, les formes non occlusives (Fig. 3) ou après revascularisation, son
absence est plus spécifique mais peu fréquemment visible. Même la pneumatose pariétale et ses
corollaires, l'aéromésentérie et l'aéroportie (Fig. 4), ne sont pas totalement spécifiques La distension
des anses n'est pas simplement liée à l'ileus, y participent également les lésions ischémiques
musculaires et nerveuses, elle peut conduire à la méconnaissance d'un épaississement pariétal.
L'infiltration du mésentère et l'épanchement liquidien intrapéritonéal sont des constatations fréquentes,
notamment dans les thromboses veineuses (Fig 2), mais non spécifiques puisque rencontrées
également dans des processus inflammatoires, infectieux ou néoplasiques.
Le diagnostic d'ischémie non occlusive est parfois difficile en imagerie du fait de l'absence de signe
spécifique. L'intestin de choc doit être distingué de l'œdème diffus de la paroi de l'intestin grêle
accompagnant une hypertension centrale par réanimation agressive dans un contexte traumatique.
Lorsque la suspicion clinique d'ischémie non occlusive est très forte, certains auteurs recommandent
l'angiographie en première intention, car elle seule peut mettre en évidence de façon fiable l'absence
d'obstruction vasculaire, les sténoses diffuses et le moindre rehaussement de la paroi du tube digestif.
L'atteinte colique a quelques particularités : rarement de nature occlusive, le plus souvent réversible,
elle est segmentaire, avec deux sites préférentiels, l'angle gauche et le sigmoïde, et peut évoluer sur le
mode sténosant.
Radiologie
Hôpital de Rangueil, Toulouse
Fig. 1 : Ischémie mésentérique massive par embol
mésentérique supérieur d'origine cardiaque : interruption
brutale de l'opacification de l'artère mésentérique
supérieure, seule la paroi de la première anse jéjunale est
rehaussée.
Fig. 2 : Ischémie mésentérique segmentaire par thrombose veineuse. Patient porteur
d'un déficit en protéine S, antécédent ancien de thrombose proximale de la veine
mésentérique supérieure qui n'apparaît pas reperméabilisée. Episode aigu de douleurs
abdominales en rapport avec une thrombose veineuse distale, responsable d'un
épaississement pariétal et d'une infiltration de la graisse mésentérique.
Fig. 3 : Ischémie mésentérique diffuse non obstructive en
rapport avec un choc septique : épaississement pariétal
global, grêlique et colique, d'aspect hyperémié.
Fig. 4 : Aéromésentérie et aéroportie dans un contexte d'ischémie mésentérique
(reconstruction minIP).
1
/
2
100%