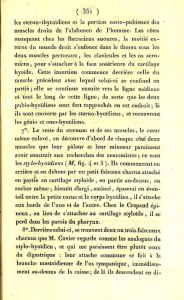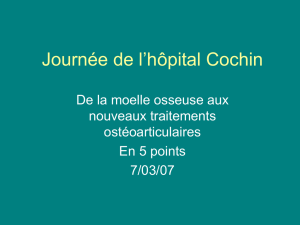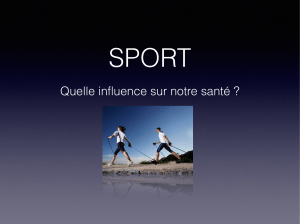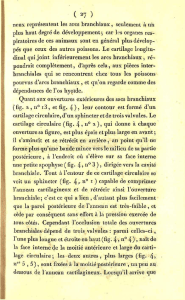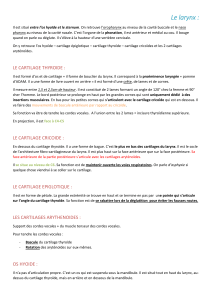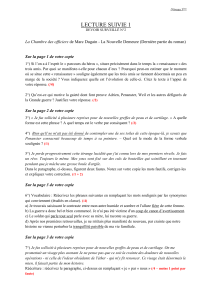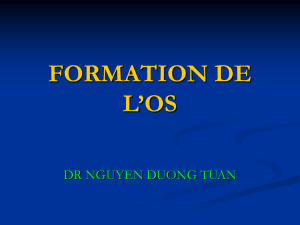R Résumés de la littérature Soulever chaque jour des charges lourdes

La Lettre du Rhumatologue - n° 297 - décembre 2003
18
REVUE DE PRESSE
Résumés de la littérature
L’exposition régulière et prolongée aux vibrations
(conduite d’automobiles, de cars, d’engins, d’hélico-
ptères...) constitue classiquement un des facteurs de risque de sur-
venue de lombalgies. Cette notion provient d’études épidémio-
logiques réalisées essentiellement en milieu industriel, et non de
populations générales. De plus, l’importance relative de ce fac-
teur de risque par rapport à celui du port de charges lourdes n’a
pas été évaluée dans les études antérieures.
Pour évaluer ce rapport, un questionnaire a été adressé par cour-
rier à un échantillon de 22 194 hommes et femmes représentatifs
de la population anglaise entre 1997 et 1998 pour mener une étude
transversale.
Les antécédents de lombalgie (au cours de l’année précédente),
le statut tabagique, la taille, la fréquence des céphalées, les sen-
sations de stress et/ou de fatigue, l’exposition à des vibrations au
travail ou ailleurs, le port régulier de charge de plus de 10 kg ont
été enregistrés.
L’exposition aux vibrations a été évaluée en détail de façon qua-
litative et quantitative. Un équivalent dose journalière d’exposi-
tion aux vibrations a été calculé pour chaque patient. L’exposi-
tion au risque a été évaluée sur la semaine précédente. L’analyse
a été limitée aux sujets ayant rapporté une exposition sur la der-
nière semaine, typique et représentative de leur activité.
La lombalgie a été définie comme une douleur lombaire ayant
duré au moins un jour pendant l’année précédente. Les douleurs
survenues pendant la grossesse ou les règles ou pendant un épi-
sode fébrile ne devaient pas être prises en compte. La sciatique
était définie comme une douleur irradiant sous le genou. La per-
tinence de ce questionnaire sur la lombalgie avait été validée anté-
rieurement.
Les associations entre les lombalgies et, d’une part, l’exposition
aux vibrations, d’autre part des activités de soulèvement, ont été
explorées par régression logistique. Les analyses ont été ajustées
sur la consommation de tabac et la fréquence de la sensation de
stress et de fatigue, puisque ces deux facteurs avaient aussi une
influence sur la survenue des lombalgies et celle des sciatiques.
Sept mille trois cent onze dossiers étaient exploitables.
La prévalence de la lombalgie était plus fréquente chez les
hommes (de 43,3 % à 57,4 % selon l’âge) que chez les femmes
(de 34,3 % à 47,9 %).
La prévalence de la sciatique était, chez les hommes, de 4,0 % à
19,7 % selon l’âge, et chez les femmes de 3,1 % à 23,2 %.
L’analyse statistique a utilisé un modèle de régression logistique.
Une association statistiquement et cliniquement significative a
été retrouvée entre des activités quotidiennes de soulèvement de
charges de plus de 10 kg et la survenue de lombalgies (ratio de
prévalence à 1,3 ; IC95 : 1,3-1,4 pour les hommes – 1,4 ; IC95 :
1,3-1,6 pour les femmes) et de sciatiques (ratio de prévalence à
1,7 ; IC95 : 1,4-2,0 pour les hommes – 1,7 ; IC95 : 1,4-2,1 pour les
femmes).
L’association entre l’exposition aux vibrations et la lombalgie est
présente, mais très faible (ratio de prévalence de l’ordre de 1,1 ;
IC95 : 1,0-1,2) ; elle est absente pour la sciatique. Aucun “effet
dose” vibration n’a été mis en évidence.
Soulever chaque jour des charges lourdes de plus 10 kg expose-
rait donc plus à la lombalgie et à la sciatique qu’une exposition
régulière aux vibrations. Toutefois, pour la sciatique, le fait de
conduire un véhicule poids lourd industriel augmente très nette-
ment le risque.
Selon les auteurs, les résultats de cette large enquête, en dépit de
ces biais méthodologiques, doivent contribuer à orienter les poli-
tiques de prévention au regard de l’importance de ces deux fac-
teurs de risque sur la pathologie rachidienne.
M. Marty, Créteil
Soulever chaque jour des charges lourdes
de plus de 10 kg expose plus à la lombalgie
et à la sciatique qu’une exposition régulière aux vibrations
The relative of whole body vibration and occupational
lifting as risk factors for low back pain.
Palmer KT, Griffin MJ, Syddall B, Pannett B, Cooper C,
Coggon D
l
Occup Environ Med 2003 ; 60 : 715-21.

La Lettre du Rhumatologue - n° 297 - décembre 2003
19
REVUE DE PRESSE
La leptine est un petit polypeptide codé par le gène de l’obé-
sité (ob), qui régule l’alimentation et d’autres processus
physiologiques comme l’homéostasie lipidique, la sécrétion d’in-
suline ou la croissance osseuse. L’association obésité-arthrose est
observée aux articulations des membres inférieurs, mais aussi aux
mains, où le rôle mécanique de la surcharge pondérale ne peut être
incriminé. Afin d’évaluer la contribution de la leptine dans la phy-
siopathologie de l’arthrose, une équipe nancéenne a dosé les taux
de leptine dans le liquide synovial et dans le cartilage de onze
patients arthrosiques (1). Les prélèvements faits en peropératoire
(prothèse totale de genou ou arthroscopie) montrent la présence
de leptine dans le liquide articulaire de ces patients arthrosiques
et des taux corrélés à l’indice de masse corporelle. L’expression
de leptine par les chondrocytes, peu importante dans le cartilage
sain (témoins), était importante dans le cartilage arthrosique et
dans les ostéophytes et corrélée à la sévérité
de la maladie et à la
production de facteurs de croissance (IGF-1
et TGFß1). Forts de
cette observation, les auteurs ont ensuite étudié l’effet in vivo de
la leptine sur les chondrocytes de rat, observant que l’adipocyto-
kine stimulait la synthèse des facteurs de croissance sus-cités dans
le cartilage, avec augmentation de production d’ARN messager
de la leptine et de protéoglycanes.
La leptine semble donc être augmentée dans le cartilage arthro-
sique, mais on ne sait pas encore si cette augmentation est un bien
ou un mal (2). Si la leptine est un facteur anabolique, soit direct,
soit par ses effets observés sur la production d’IGF-1 et TGFß1,
alors sa production accrue pourrait être le reflet d’un phénomène
de réparation cartilagineuse. Si, en revanche, la leptine est indi-
rectement responsable de la production d’oxyde nitrique (NO)
par les chondrocytes, comme cela a été rapporté récemment (3),
elle pourrait en fait être délétère pour le cartilage.
Le rôle de la leptine dans la physiopathologie de l’arthrose est
plus que probable, mais il reste maintenant à préciser.
T. Pham, Marseille
Rôle de la leptine dans la physiopathologie de l’arthrose
1. Evidence for a key role of leptin in osteoarthritis.
Dumond H, Presle N, Terlain B et al.
l
Arthritis Rheum
2003 ; 48 : 3118-29.
2. Systemic and local regulation of articular cartilage
metabolism : where does leptin fit in the puzzle ?
Loeser RF
l
Arthritis Rheum 2003 ; 48 : 3009-12.
3. Synergistic induction of nitric oxide synthase type II :
in vitro effect of leptin and interferon
γ
in human chon-
drocytes and ATDC5 chondrogenic cells.
Otero M, Gomez Reino JJ, Gualillo O
l
Arthritis Rheum
2003 ; 48 (2) : 404-9.
Il est bien établi qu’une fracture vertébrale prévalente est
un facteur de risque important de fractures vertébrales ulté-
rieures. Le type et la localisation des fractures le sont également,
comme le montre ce travail issu des données de l’étude euro-
péenne EPOS. Dans cette étude multicentrique, 3 100 hommes
et 3 500 femmes ont eu une radiographie du rachis dorsal et lom-
baire de profil à 3,8 ans d’intervalle en moyenne. Le risque de
fracture vertébrale incidente augmentait avec le nombre de frac-
tures prévalentes, avec un risque relatif (RR) de 3,2 (2,1-4,8) pour
une fracture prévalente, 9,8 (6,1-15,8) pour 2 fractures préva-
lentes et 23,3 (15,3-35,4) pour 3 fractures et plus. Le risque frac-
turaire était différent selon le niveau de la fracture prévalente,
avec un RR plus élevé de T5 à T7 (4,6, 2,9, 2,3) et de L1 à L3
(2,5, 2,1, 2,4). Le risque fracturaire variait également en fonction
de la distance par rapport à la fracture vertébrale initiale. Ainsi,
les vertèbres les plus proches avaient un risque accru de fracture
avec un RR de 7,7 (5,6-10,5) si elles se situaient à trois vertèbres
ou moins, de 4 (2,6-6) si elles étaient plus éloignées. Il n’y avait
pas de différence dans le risque fracturaire entre une vertèbre
biconcave, cunéiforme ou en galette (RR = 3,7, 3,4 et 4,4) (clas-
sification de McCloskey-Kanis). En analysant les diminutions de
hauteur (≥20 %) de la partie antérieure (A), moyenne (M) ou
postérieure (P), le risque fracturaire n’était pas augmenté en cas
de diminution A + P ou M + P ; en revanche, les sujets A + M
avaient un RR de 5,9 (4,1-8,6) de fracture incidente, A + M + P
de 3 (1,8-4,9), M seule de 3,3 (2,3-4,8) et A seule de 1,9 (1-3,4).
La sévérité de la fracture (algorithme de McCloskey-Kanis) aug-
mentait le risque de fracture prévalente avec un RR compris entre
2,2 et 10,9. Il n’y avait pas de différence entre les femmes et les
hommes pour ces facteurs de risque.
Discussion. Si la recherche d’une fracture vertébrale doit faire
partie de l’évaluation du risque fracturaire, sa localisation, son
aspect et sa sévérité ont également leur importance.
P. Guggenbuhl, Rennes
La fracture vertébrale sous toutes les coutures
Characteristics of a prevalent vertebral deformity pre-
dict subsequent vertebral fracture : results from the
European Prospective Osteoporosis Study (EPOS).
Lunt M, O’Neill TW, Felsenberg D et al. and the
European Prospective Osteoporosis Study Group
l
Bone
2003 ; 33 :
505-13
.
.../...

La Lettre du Rhumatologue - n° 297 - décembre 2003
21
REVUE DE PRESSE
.../...
La gonarthrose souffre d’un manque d’outils d’évaluation
structurale. La technique d’évaluation du cartilage utilisée
en pratique courante est la mesure indirecte de sa hauteur, via la
mesure de l’interligne articulaire radiologique. Cependant, l’ab-
sence de corrélation radioclinique fait défaut.
À l’avenir, la mesure du volume cartilagineux en IRM 3D pour-
rait devenir un outil utile d’évaluation du cartilage.
Deux articles récents se sont intéressés à ce nouvel outil :
3Le premier rapporte l’étude des différences de volume de car-
tilage du genou en fonction de la taille, de l’âge, du sexe, et de la
taille des os dans une population de 372 personnes, dont moins
de 20 % étaient arthrosiques (1). Toutes avaient bénéficié d’un
examen clinique, d’une radiographie des genoux et d’une IRM
3D avec mesure du volume du cartilage tibial interne, tibial
externe et de la rotule. Cette étude transversale montre que les
hommes ont un volume cartilagineux aux trois sites significati-
vement plus important que les femmes. Cette différence reste
significative après ajustement en fonction de la taille, du poids,
la dimension des os et de l’activité physique, même si elle semble
être modulée par la taille et la dimension des os. Cette différence
entre les deux sexes, observée quelle que soit la tranche d’âge
étudiée, est encore plus marquée au-delà de 50 ans, suggérant une
accélération de la “perte cartilagineuse” après la ménopause.
3Le second rapporte l’étude au genou du volume du cartilage
tibial, fémoral et patellaire en fonction de la symptomatologie
dans un échantillon de 133 femmes, en postménopause (2). Les
auteurs ont mis en évidence une corrélation négative significa-
tive entre la symptomatologie (WOMAC) et le volume cartila-
gineux de la rotule. En d’autres termes, cette étude suggère que
l’altération du volume de cartilage patellaire est associée à la dou-
leur et à l’altération de la fonction. Le volume cartilagineux tibial
et fémoral n’était pas corrélé à la clinique. Il est regrettable qu’une
mesure de l’interligne radiologique n’ait pas été parallèlement
évaluée.
Dans ces deux études, la reproductibilité de la mesure du volume
du cartilage par l’IRM 3D était satisfaisante, laissant envisager
de nouvelles perspectives dans l’évaluation de la gonarthrose et
dans la compréhension de sa physiopathologie.
T. Pham, Marseille
L’IRM en trois dimensions pour mieux comprendre la gonarthrose
1. Sex differences in knee cartilage volume in adults :
role of body and bone size, age and physical activity.
Ding C, Cicuttini F, Scott F, Glisson M, Jones G
l
Rheumatology (Oxford) 2003 ; 4 : 1317-23.
2. The association of cartilage volume with knee pain.
Hunter DJ, March L, Sambrook PN
l
Osteoarthritis
Cartilage 2003 ; 11 : 725-9.
Les cervicalgies sont très fréquentes, particulièrement chez
les femmes ; au cours de la vie, près de 70 % des adultes
en auront au moins une fois dans leur vie.
Le but de cette étude était de comparer l’efficacité d’un pro-
gramme d’entraînement musculaire dynamique, d’une part, et
d’un programme de relaxation, d’autre part, au simple maintien
des activités quotidiennes chez des femmes travaillant et pré-
sentant des cervicalgies chroniques.
Trois cent quatre-vingt-treize femmes de 30 à 60 ans, travaillant
dans des bureaux et présentant une cervicalgie chronique (plus
de 12 semaines d’évolution), ont reçu pour une durée de 6 mois
l’un des trois traitements suivants :
– entraînement musculaire dynamique (135 patientes) : les
muscles des régions cervicales et scapulaires ont été développés
par la pratique d’exercices réguliers avec des haltères, associés à
des exercices d’étirements musculaires ;
– entraînement relaxation (128 patientes) : différentes techniques
de relaxation ont été enseignées aux patientes.
– maintien des activités ordinaires et des techniques de relaxa-
tion habituelles (130 patientes), ce groupe étant considéré comme
le groupe contrôle.
Pour les deux premiers groupes, les patientes étaient entraînées
par un kinésithérapeute trois fois par semaine (séance d’une demi-
heure) pendant 12 semaines, puis à raison d’une séance par
semaine pendant 6 mois. Tous les cotraitements étaient autorisés
dans les trois groupes.
Les patientes ont été évaluées à 3, 6 et 12 mois par des évalua-
teurs en aveugle du traitement reçu. Les critères d’évaluation
Entraînement musculaire dynamique, relaxation
ou maintien des activités quotidiennes : pas de différence
d’efficacité au cours de la cervicalgie chronique chez les femmes

La Lettre du Rhumatologue - n° 297 - décembre 2003
22
étaient la douleur cervicale (échelle de 0 à 10), l’incapacité fonc-
tionnelle (score de 0 à 80), l’appréciation subjective concernant
la capacité à travailler, la mobilité cervicale, la force musculaire,
les arrêts de travail, et la proportion de patientes guéries (auto-
appréciation).
Les trois groupes de patientes n’étaient pas différents à l’inclu-
sion sur les principaux paramètres cliniques. Quatre-vingt-neuf
pour cent et 87 % des patientes ont été revues à 6 et 12 mois
respectivement. L’ensemble des cotraitements était faible dans
les trois groupes.
Aucune différence statistiquement significative n’a été mise en
évidence entre les trois groupes pour la douleur cervicale, l’in-
capacité fonctionnelle ou les arrêts de travail, et ce à 3, 6 et
12 mois. Les deux groupes “entraînements” rapportent une
meilleure réponse subjective et une meilleure amélioration de
leur mobilité cervicale que le groupe contrôle. Mais ces diffé-
rences restent modérées. Globalement, l’état de l’ensemble des
patientes s’améliore au cours du temps.
Les auteurs concluent qu’un programme d’entraînement muscu-
laire dynamique et un programme de relaxation ne donnent pas
de meilleurs résultats que le simple maintien des activités quoti-
diennes chez des femmes travaillant et présentant des cervical-
gies chroniques.
Ces résultats sont plutôt en accord avec les données antérieures
de la littérature. Le nombre important de patientes incluses et la
qualité méthodologique de l’essai devraient permettre d’en tirer
des conclusions pratiques. Les causes complexes et individuelles
des cervicalgies expliquent probablement ces résultats.
M. Marty, Créteil
REVUE DE PRESSE
Effectiveness of dynamic muscle training, relaxation
training, or ordinary activity for chronic low back pain :
randomised controlled trial.
Viljanen M, Malmivaara A, Uitti J et al.
l
Br Med J 2003 ;
327 : 475-9.
.../...
Le pamidronate a montré son efficacité dans le traitement
de la dysplasie fibreuse (DF) sur les douleurs et la pro-
gression radiologique. L’évolution de la densité minérale osseuse
(DMO) sous traitement a été moins étudiée. Dans cette étude,
7 patients ont été suivis au cours du traitement par pamidronate
(60 mg/j, 3 jours consécutifs tous les 6 mois) ; tous recevaient un
apport de calcium et de vitamine D. Il s’agissait de 6 femmes et
d’un homme, d’âge compris entre 15 et 43 ans. Six femmes en
bonne santé, appariées pour l’âge, ont servi de contrôle. Une éva-
luation radiographique et de la DMO en DEXA (en analysant les
différentes sous-régions de la mesure corps entier) a été faite avant
traitement et à 12 mois ; les patients avaient un examen clinique
et une évaluation des marqueurs du remodelage osseux tous les
3 mois. Deux des patients n’ont reçu qu’une seule cure au lieu
des deux pour des raisons personnelles, mais ont pu être analy-
sés. Les douleurs ont diminué dès l’évaluation du 3emois chez
6 patients sur 7. Les radiographies étaient inchangées à 12 mois.
Un seul patient a eu un épisode d’hypocalcémie transitoire et
asymptomatique après la première perfusion. Les taux de phos-
phatases alcalines osseuses étaient augmentés chez tous les malades ;
ils ont diminué significativement de – 43 % sous traitement mais
n’étaient normalisés que chez un seul patient. Les CTX urinaires
étaient élevées chez 4 patients ; elles ont diminué de – 63 % en
moyenne après un an de traitement. La DMO corps entier était
comparable à celle des témoins à l’inclusion. En revanche, au
niveau des sous-régions, il y avait une diminution moyenne de
– 11,8 % de la DMO des segments dysplasiques par rapport aux
segments controlatéraux du même patient, alors qu’elle était de
– 0,7 % chez les témoins (p < 0,02). Chez tous les patients, il y
avait une différence d’au moins – 6 % au niveau d’un des seg-
ments osseux atteints. Les diminutions les plus importantes cor-
respondaient aux segments osseux les plus sévèrement atteints
sur les radiographies. Après un an de traitement, l’augmentation
des différentes régions était en moyenne de + 6,8 % (p < 0,02) ;
l’augmentation controlatérale (côté sain) était de + 2,6 %
(p < 0,05). L’augmentation était plus importante au niveau des
membres supérieurs et du rachis. La DMO corps entier avait aug-
menté de 3,3 % (p < 0,02).
Discussion. La mesure de DMO des segments osseux atteints par
la DP semble intéressante pour le suivi de l’évolution sous trai-
tement par pamidronate. Des différences significatives sont
constatées dès un an de traitement, alors que le délai est plus long
sur les radiographies (au moins deux ans). Les marqueurs de
remodelage osseux pourraient guider la thérapeutique, notam-
ment la fréquence des cures chez les patients pour qui ils restent
élevés.
P. Guggenbuhl, Rennes
La dysplasie fibreuse sous surveillance
Effect of intravenous pamidronate on bone markers
and local bone mineral density in fibrous dysplasia.
Parisi MS, Oliveri B, Mautalen C
l
Bone 2003 ; 33 :
582-8.
1
/
4
100%