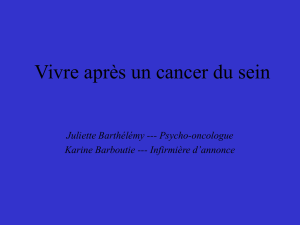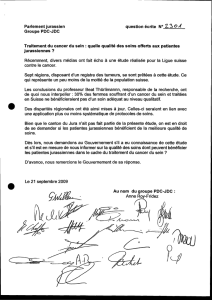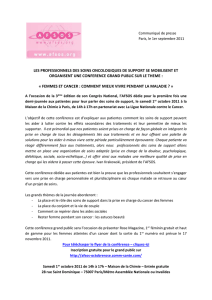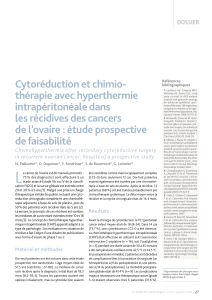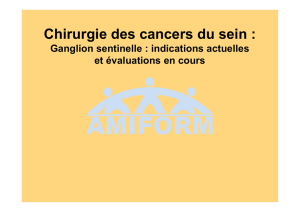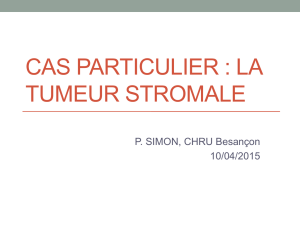Splénectomie dans les tumeurs ovariennes DOSSIER Splenectomy in ovarian carcinoma

10 | La Lettre du Gynécologue • n° 354 - septembre 2010
Quoi de neuf en onco-gynécologie ?
DOSSIER
Splénectomie
dans les tumeurs ovariennes
Splenectomy in ovarian carcinoma
L.M. Boutoux*, C. Uzan*, S. Gouy*, P. Pautier*, C. Lhommé*, C. Haie-Meder*,
C. Balleyguier*, P. Duvillard*, P. Morice*
C
hez les patientes souffrant de tumeur
ovarienne avancée, la survie est améliorée
par l’exérèse complète des lésions visibles (1,
2). Lors de chirurgie de cytoréduction pour tumeur
maligne de l’ovaire, la splénectomie est peu fréquente.
Sa réalisation peut se justifier cependant lorsque la
carcinose est floride à l’étage sus-mésocolique. Les
complications postopératoires spécifiques sont de
deux ordres (3) : thromboemboliques (secondaires
à la thrombocytose réactionnelle et dominées par
l’embolie pulmonaire) et infectieuses. Les germes
incriminés dans les infections postsplénectomie sont
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae et
Neisseria meningitidis. La prise en charge est préven-
tive et s’appuie sur la triple vaccination.
Les premières séries de splénectomies réalisées en cours
de chirurgie carcinologique de l’ovaire rapportent que la
réalisation du geste est raisonnable quand il est néces-
saire, car il ne grève pas la morbidité postopératoire
(4-8). Nos objectifs étaient d’étudier la rentabilité
histologique du geste, les suites opératoires et la
prévention des infections postsplénectomie chez les
patientes splénectomisées au cours de la chirurgie
carcinologique de l’ovaire.
Matériel et méthode
Cinquante-huit patientes splénectomisées pour
tumeur maligne de l’ovaire dans le service de chirurgie
générale et cancérologique de l’institut Gustave-
Roussy entre le 1er janvier 1995 et le 30 mars 2008
ont été colligés rétrospectivement. Tous les dossiers
ont été discutés en comité pluridisciplinaire de gyné-
cologie pelvienne et l’indication opératoire a été posée
de manière collégiale. La splénectomie a été réalisée
soit au cours d’une chirurgie de cytoréduction initiale,
dite “debulking” (chirurgie première ou intervallaire),
soit pour suspicion de récidive locale. Conformément
aux recommandations, le but de l’opérateur était
de réaliser une chirurgie d’exérèse complète (hysté-
rectomie non conservatrice avec curage pelvien
et lombo-aortique, omentectomie infragastrique
et résection de toutes les lésions macroscopiques
visibles).
Pour chaque patiente, l’âge, le type, le grade et le
stade tumoral ont été relevés. Pour chaque interven-
tion, on a répertorié les gestes associés, notamment
une résection digestive ou une résection de coupole
diaphragmatique, le motif de la splénectomie (suspi-
cion d’atteinte de la capsule, du hile ou du paren-
chyme ou splénectomie d’hémostase) et le reliquat
tumoral en fin d’intervention. L’anatomopathologie
de la pièce de splénectomie a été analysée. L’étude
des suites opératoires a été fondée sur la durée de
l’hospitalisation, le séjour en unité de soins intensifs
supérieur à 48 h ou le transfert en réanimation, et
sur l’existence ou non d’une transfusion sanguine. Les
complications immédiates (événement survenu
dans les 30 premiers jours postopératoires) ou
tardives (événement survenu après le premier mois
postopératoire) ont été cotées selon la classification
de Clavien-Dindo (9). La vaccination postopératoire
systématique, préconisée par un protocole de service,
a également été évaluée.
Résultats
Sur les 58 patientes splénectomisées, 42 splénec-
tomies (72 %) ont été réalisées au cours d’une
chirurgie radicale (debulking), dont 13 (32 %) lors
d’une chirurgie initiale et 29 (50%) lors d’une
chirurgie d’intervalle (22 [38 %] après 3 cures de
chimiothérapie et 7 [12 %] après 6 à 9 cures). Seize
splénectomies (28 %) ont été réalisées dans le cadre
de la récidive à distance d’une chirurgie ayant été
considérée comme optimale. Dans 10 cas sur 16, il
* Institut Gustave-Roussy, 39, rue
Camille-Desmoulins, 94805 Villejuif.
Références
bibliographiques
1. Eisenkop SM, Friedman RL, Wang
HJ. Complete cytoreductive surgery
is feasible and maximizes survival in
patients with advanced epithelial
ovarian cancer: a prospective study.
Gynecol Oncol 1998;69(2):103-8.
2. Eisenkop SM, Spirtos NM,
Friedman RL, Lin WC, Pisani AL,
Perticucci S. Relative influences
of tumor volume before surgery
and the cytoreductive outcome on
survival for patients with advanced
ovarian cancer: a prospective study.
Gynecol Oncol 2003;90(2):390-6.
3. Benoist S. Median and long-term
complications of splenectomy. Ann
Chir 2000;125(4):317-24.
4. Deppe G, Zbella EA, Skogerson
K, Dumitru I. The rare indication
for splenectomy as part of cytore-
ductive surgery in ovarian cancer.
Gynecol Oncol 1983;16(2):282-7.
5. Malfetano JH. Splenectomy
for optimal cytoreduction in
ovarian cancer. Gynecol Oncol
1986;24(3):392-4.
6. Sonnendecker EW, Guidozzi F,
Margolius KA. Splenectomy during
primary maximal cytoreductive
surgery for epithelial ovarian cancer.
Gynecol Oncol 1989;35(3):301-6.
7. Gemignani ML, Chi DS, Gurin
CC, Curtin JP, Barakat RR. Splenec-
tomy in recurrent epithelial
ovarian cancer. Gynecol Oncol
1999;72(3):407-10.
8. Ramirez PT, Dos Reis R. Splenec-
tomy in patients with advanced or
recurrent ovarian cancer: open and
laparoscopic surgical techniques
and clinical outcomes. Gynecol
Oncol 2007;106(1):12-5.
9. Dindo D, Demartines N, Clavien
PA. Classification of surgical compli-
cations: a new proposal with evalua-
tion in a cohort of 6 336 patients
and results of a survey. Ann Surg
2004;240(2):205-13.

La Lettre du Gynécologue • n° 354 septembre 2010 | 11
Résumé
existait une forte suspicion radiologique de récidive
splénique.
L’âge moyen des patientes était de 53,02 ans
(± 14,35). Quarante-six patientes (79,31 %) étaient
porteuses d’un adénocarcinome de l’ovaire. Les carac-
téristiques cliniques et histologiques de la population
étudiée sont regroupées dans le tableau I.
Parmi les 42 patientes ayant eu un debulking, 27
(64,28 %) ont subi une pelvectomie postérieure et 30
(71,42 %) une résection de coupole diaphragmatique.
La nature du geste chirurgical associé à la splénec-
tomie est précisée dans le tableau II.
Trois splénectomies d’hémostase (5,17 %) ont été
réalisées (1 lors d’une récidive et 2 lors d’un debulking).
Cinquante-cinq splénectomies ont été réalisées
pour suspicion peropératoire d’atteinte tumorale :
suspicion d’atteinte du hile splénique (adénopathie
ou nodule tumoral) chez 25 patientes (43,10 %),
suspicion d’atteinte capsulaire chez 18 patientes
(13,79 %) et suspicion d’atteinte parenchymateuse
chez 12 patientes (20,68 %). Dans tous les cas, on a
observé : un taux de 86,63 % de corrélation positive
entre la suspicion clinique et l’atteinte histologique ;
un taux de 93,33 % lors de la chirurgie pour récidive ;
et un taux de 80 % lors de la chirurgie de debulking
(tableau III, figures 1 à 6).
La durée moyenne d’hospitalisation a été de 18,36
jours (± 16,88 jours). Dix-sept patientes (29,31 %)
ont nécessité un séjour en réanimation supérieur à
48 heures. Trente-trois patientes (56,89 %) ont été
transfusées (culots globulaires) au cours de l’hos-
pitalisation, dont 30 (51,72 %) en périopératoire.
Quarante-huit patientes (82,75 %) ont présenté une
thrombocytose (plaquettes supérieures à 400 000/ml)
lors des 21 premiers jours postopératoires, dont 10
(17,24 %) avec une thrombocytose majeure supérieure
à 1 million. Vingt-sept patientes (46,55 %), dont 21
(50 %) issues du sous-groupe debulking, ont présenté
des complications postopératoires immédiates ; les
complications étaient graves (morbidité de grades 3,
4 et 5) pour respectivement 31 % et 33 %.
Parmi les 17 patientes ayant présenté des complica-
tions majeures, 7 ont eu une complication pulmo-
naire (4 épanchements pleuraux gauches nécessitant
un drainage, 1 pneumopathie nosocomiale avec
hospitalisation en réanimation, 1 pneumothorax, 1
rupture diaphragmatique). Parmi elles, 3 patientes
ont présenté une fistule pancréatique se manifestant
par une collection sous-phrénique gauche néces-
sitant un drainage (2 radiologiques, 1 chirurgical).
Une patiente est décédée des suites de l’interven-
tion (rupture diaphragmatique sur une plaie pleurale
compliquée d’une péritonite stercorale au quatrième
jour postopératoire). Les données relatives aux suites
et aux complications postopératoires figurent dans
les tableaux IV et V.
Quarante-sept patientes (81,03 %) ont reçu la vacci-
nation antipneumoccocique et antiméningococcique
Cette étude rétrospective ayant inclus 58 patientes atteintes de cancer de l’ovaire visait à étudier la place de
la splénectomie et à obtenir un reliquat tumoral macroscopique nul. La splénectomie au cours de la chirurgie
de cytoréduction initiale, dite
“debulking”
pour cancer de l’ovaire est fréquente et d’incidence croissante. Les
complications spécifiques sont rares et ne grèvent pas les suites opératoires. Le rendement histologique est
satisfaisant. Les mesures préventives des infections postsplénectomies sont simples et facilement applicables
à l’échelle d’un service. La réalisation d’une splénectomie à des fins carcinologiques au cours de la chirurgie
du cancer de l’ovaire semble raisonnable pour les suites opératoires, et rentable sur le plan histologique.
Tableau I. Caractéristiques de la population étudiée.
Debulking
(n = 42) Récidive (n = 16) Total (n = 58)
Âge
Moyenne
Médiane
53,47
57,00
51,75
56,00
53,02
56,50
n (%) n (%) n (%)
Histologie
Adénocarcinome 37 (88,09) 9 (56,25) 46 (79,31)
Autres :
Tumeur de la granulosa
Tumeur
borderline
Tératome
Tumeur carcinoïde
Tumeur de Brenner maligne
5 (11,9)
1
2
2
0
0
7 (43,75)
4
0
1
1
1
12 (20,68)
5
2
3
1
1
Grade des adénocarcinomes
1
2
3
Non renseigné
6 (16,21)
10 (27,02)
15 (40,54)
6 (16,21)
0
1 (11,11)
5 (55,55)
3 (33,33)
6 (13,04)
11 (23,91)
20 (43,47)
9 (19,56)
Stade FIGO initial
Précoce
IIIc
IV
Non renseigné (non épithélial)
0
31 (73,8)
9 (21,42)
2 (4,76)
2 (12,5)
3 (18,75)
5 (31,25)
6 (37,5)
2 (3,44)
34 (58,62)
14 (24,13)
8 (13,79)
Tableau II. Nature du geste chirurgical.
Debulking
(n = 42) Récidive (n = 16) Total (n = 58)
Résections associées
Pelvectomie postérieure
Résection digestive autre
Résection de coupole
Curage pelvien
Curage lombo-aortique
27 (64,28)
11 (26,19)
30 (71,42)
24 (57,14)
23 (54,76)
1 (6,25)
2 (12,50)
5 (31,25)
1 (6,25)
2 (12,50)
28 (48,27)
13 (22,41)
35 (60,34)
25 (43,10)
25 (43,10)
Résidu macroscopique
Nul
< 1 cm
≥ 1 cm
34 (80,95)
4 (9,52)
4 (9,52)
14 (87,5)
0
2 (12,5)
48 (82,75)
5 (8,6)
5 (8,6)
Mots-clés
Splénectomie
Cancer de l’ovaire
Keywords
Splenectomy
Ovarian carcinoma

12 | La Lettre du Gynécologue • n° 354 - septembre 2010
Quoi de neuf en onco-gynécologie ?
DOSSIER
Discussion
La splénectomie semble se justifier en termes de gain
de survie (10) et on observe qu’elle est plus de plus
en fréquemment réalisée, ce qui soulève la question
de sa crédibilité histologique. Les séries traitant des
splénectomies au cours de la chirurgie pour cancer
de l’ovaire traitent peu de corrélation histologique.
Seul Morris, en 1991, aborde la rentabilité histolo-
gique de la splénectomie (11) : dans une série de 45
splénectomies réalisées entre 1970 et 1989, il observe
une corrélation positive de 75 %. Dans notre série,
le taux de corrélation histologique positive est de
86,63 % au total, de 80 % dans le groupe debulking
et de 93,33 % dans le groupe récidive. Parmi les 8
patientes du groupe debulking ayant eu une splénec-
tomie pour suspicion d’atteinte tumorale infirmée
par l’anatomopathologie, 3 étaient réalisées au
cours d’une chirurgie d’emblée et 5 au cours d’une
chirurgie d’intervalle. On suppose que l’appréciation
de la nature carcinomateuse des lésions est plus diffi-
cile lorsqu’il s’agit d’une chirurgie d’intervalle, car les
lésions peuvent être confondues avec une fibrose
séquellaire postchimiothérapie. Les 12 patientes ayant
eu une splénectomie pour suspicion d’atteinte paren-
chymateuse ont toutes une histologie positive ; 10 ont
effectivement une infiltration du parenchyme et 2 ont
uniquement une atteinte capsulaire sans infiltration.
Dans le groupe récidive, une seule patiente a eu une
splénectomie pour suspicion peropératoire d’atteinte
tumorale avec un diagnostic histologique définitif
négatif. Il s’agissait d’une récidive de l’hypochondre
gauche d’une tumeur de la granulosa. La récidive était
accolée à la rate sans l’infiltrer ; la splénectomie était
cependant nécessaire à l’exposition. Au final, le rende-
ment histologique est satisfaisant et valide la pratique
de la splénectomie à visée de réduction tumorale au
moindre doute.
La mortalité postopératoire est de 2 et 17 % selon les
études (6, 12-16) [tableau VII]. Dans notre étude, une
patiente est décédée (2 %) des suites de l’interven-
tion. L’étude de la littérature en termes de complica-
tions sévères est délicate, car chaque auteur définit
différemment ce qu’il considère comme “morbidité
majeure”. On observe selon les études des chiffres
disparates, allant de 19 % (21/112) pour Magtibay (16)
à 50 % (9/18) pour Nicklin (12). Dans notre étude,
près d’un tiers des patientes (29 %) présente des
complications sévères précoces et 10 % présentent
des complications sévères tardives. Compte tenu des
gestes associés et notamment des résections diges-
tives, ces résultats semblent cohérents et homo-
gènes avec la littérature.
Tableau III. Concordance clinique et histologique des lésions spléniques supposées.
Suspicion clinique
d’atteinte
splénique
Histologie
positive/négative
Corrélation
positive
Debulking
(42)
Récidive (16)
Total (58)
40
15
55
32/8
14/1
46/9
80 %
93,33 %
86,63 %
Tableau V. Complications.
Complications
Debulking
(n = 42) Récidive (n = 16) Total (n = 58)
Immédiates (premier mois)
Non
Oui
Grade de morbidité
1
2
3
4
5
21 (50)
21 (50)
1
8
3
9
-
10 (62,5)
6 (37,5)
-
1
-
4
1
31 (53,44)
27 (46,55)
1
9
3
13
1
N (%) N (%) N (%)
Tardives
Non
Oui
Grade de morbidité
1
2
3
4
5
27 (64,28)
15 (35,71)
-
11
3
1
-
13 (81,25)
3 (18,75)
-
1
-
1
1
40 (68,96)
18 (31,03)
12
3
2
1
Tableau IV. Suites opératoires.
Debulking
(n = 42) Récidive (n = 16) Total (n = 58)
Durée d’hospitalisation
(jours)
Moyenne
Médiane
19,40 (± 18,64)
13,5 (7-115)
15,62(± 11,05)
10,5 (8-49)
18,36 (± 16,88)
13 (7-115)
N (%) N (%) N (%)
Réanimation*
Non
Oui
30 (71,42)
12 (28,57)
11 (68,75)
5 (31,25)
41 (70,69)
17 (29,31)
Transfusion
Non
Oui
Non renseigné
11 (26,19)
29 (69,04)
2 (4,76)
12 (75)
4 (25)
-
23 (39,65)
33 (56,89)
2 (3,44)
Thrombocytose**
Non (plaquettes < 400 000/ml)
Oui
400 000 à 600 000
600 000 à 1 million
> 1 million
Non renseigné
3 (7,14)
37 (88,09)
8
20
9
2 (4,76)
2 (12,5)
11 (68,75)
4
6
1
3 (18,75)
5 (8,62)
48 (82,75)
12
26
10 (17,24)
5 (8,62)
Antiagrégant
Oui
Non
Non renseigné
8 (19,05)
33
1
3 (18,75)
13
-
11 (18,96)
46
1
postopératoire préconisée dans le service. Une
patiente a bénéficié de la vaccination en préopératoire.
Les mesures préventives des infections postsplénec-
tomies sont regroupées dans le tableau VI.

La Lettre du Gynécologue • n° 354 septembre 2010 | 13
DOSSIER
Figure 1. Rate normale (pulple blanche, pulpe rouge, capsule). Figure 2. Nodule intraparenchymateux.
Figure 3. Réaction fi broblastique postchimiothérapie. Figure 4. Nodule du hile.
Figure 5. Adénopathie hilaire métastatique. Figure 6. Section splénique et pancréatique.

14 | La Lettre du Gynécologue • n° 354 - septembre 2010
Quoi de neuf en onco-gynécologie ?
DOSSIER
La thrombocytose transitoire des splénectomies
au cours de la chirurgie carcinologique pelvienne
de l’ovaire n’est pas à haut risque de complication
thromboembolique (3). Dans notre série, 83 % des
patientes ont eu une thrombocytose, mais seules
17 % avaient un taux de plaquettes supérieur à
1 million. De plus, la thrombocytose est majoritai-
rement transitoire. Le traitement préventif repose
sur l’administration d’antiagrégants plaquettaires
à faible dose. Cependant, la durée et les moda-
lités de ce traitement sont très variables dans la
littérature. En pratique, le traitement préventif
(Aspégic® 100 mg par jour) peut être proposé si
la thrombocytose est importante (supérieure à
600 000 plaquettes/ml) et persistante (au-delà de
30 jours). Dans notre étude, ce traitement a été
prescrit à moins de 20 % des patientes. Une patiente
a eu une complication thromboembolique (throm-
bose veineuse profonde) ; son taux maximum de
685 000 plaquettes/ml avait régressé spontané-
ment, ne nécessitant pas d’antiagrégants.
Les recommandations de bonne pratique pour la
prévention des infections graves chez les patients
hypospléniques ou aspléniques éditées en 2007 par
le Comité de lutte contre les infections nosocomiales
(CLIN) de l’institut Gustave-Roussy propose une
vaccination systématique contre pneumocoque,
Haemophilus et méningocoque. Idéalement, cette
vaccination doit être réalisée avant l’opération,
au plus tard 15 jours avant une splénectomie
programmée. Lorsque la splénectomie n’a pas été
programmée, ce qui est le cas le plus fréquent, il
faut vacciner entre le dixième et le quatorzième jour
postopératoire. Seuls deux auteurs rapportent des
taux vaccinaux postsplénectomie, qui sont proches
de 60 % (13, 16) [tableau VIII]. Dans notre étude,
nous observons que plus de 80 % des patientes ont
bénéficié de la vaccination postopératoire. Les 5
patientes n’ayant pas été vaccinées ont été opérées
avant 2007 (4 avant 2002). On constate donc que
la mise en place des recommandations à l’échelle de
l’établissement a participé à la systématisation de
la prise en charge. En revanche, bien que la splénec-
tomie soit souvent prévisible, notamment lors des
chirurgies pour récidive, une seule patiente a été
vaccinée en préopératoire.
Conclusion
La splénectomie au cours d’une chirurgie de debulking
pour cancer de l’ovaire est en elle-même peu morbide.
Ses complications sont dominées par le risque de
fistule pancréatique avec d’éventuels retentissements
pulmonaires. Sa réalisation se justifiant en termes de
survie, et le rendement histologique étant satisfaisant,
nous pensons que toute suspicion peropératoire d’at-
teinte splénique devrait conduire à la splénectomie,
d’autant plus que sa réalisation pose rarement un réel
problème chirurgical pour une équipe entraînée. Enfin,
le geste doit être encadré de protocoles précis afin
de prévenir les risques infectieux postsplénectomie.
La vaccination préopératoire systématique semble
difficile compte tenu de la chronologie des décisions,
mais les mesures postopératoires, dominées par l’édu-
cation de la patiente et la triple vaccination, sont
indispensables. ■
Tableau VI. Vaccination systématique de la patiente splénectomisée.
Vaccination
Debulking
(n = 42) Récidive (n = 16) Total (n = 58)
Oui
Non
Non renseigné
Préopératoire
34 (80,95 %)
4
4
-
13 (81,25 %)
1
1
1
47 (81,03 %)
5
5
1
Tableau VII. Morbidité et mortalité postopératoires.
Auteur Année n Mortalité Morbidité
Majeure
Pan-
créatite
Durée moyenne
d’hospitalisation
Sonnendecker et al. 1989 6 1 (17 %) - - -
Nicklin et al. 1994 18 - 9 (50 %) 4
(22 %) -
Chen et al. 1999 35 1 (3 %) 9 (26 %) 2 (6 %) 13,5 (4-99)
Bilgin et al. 2005 13 1 (8 %) - - -
Eisenkop et al. 2006 49 1 (2 %) 11 (22 %) 0 16,1 (7-62)
Magtibay et al. 2006 112 6 (5 %) 21 (19 %) 0
Étude IGR 2008 58 1 (2 %) 17 (29 %) 3 (5 %) 18,36 (±16,88)
Tableau VIII. Vaccination.
Auteur Année n Vaccination Préopératoire
Chen et al. 1999 35 5
Magtibay et al. 2006 112 63 % 1
Étude IGR 2008 59 47 (81 %) 1
Références
bibliographiques
10. Eisenkop SM, Spirtos NM,
Friedman RL, Lin WC, Pisani AL,
Perticucci S. Relative influences
of tumor volume before surgery
and the cytoreductive outcome
on survival for patients with
advanced ovarian cancer: a
prospective study. Gynecol Oncol
2003;90(2):390-6.
11. Morris M, Gershenson DM,
Burke TW, Wharton JT, Cope-
land LJ, Rutledge FN. Splenec-
tomy in gynecologic oncology:
indications, complications,
and technique. Gynecol Oncol
1991;43(2):118-22.
12. Nicklin JL, Copeland LJ,
O’Toole RV, Lewandowski
GS, Vaccarello L, Havenar LP.
Splenectomy as part of cytore-
ductive surgery for ovarian carcinoma. Gynecol Oncol 1995;58(2):244-7.
13. Chen LM, Leuchter RS, Lagasse LD, Karlan BY. Splenectomy and surgical cytoreduction for ovarian
cancer. Gynecol Oncol 2000;77(3):362-8.
14. Bilgin T, Ozerkan K, Ozan H. Splenectomy in cytoreductive surgery for advanced ovarian cancer. Arch
Gynecol Obstet 2005;271(4):329-31.
15. Eisenkop SM, Spirtos NM, Lin WC. “Optimal” cytoreduction for advanced epithelial ovarian cancer: a
commentary. Gynecol Oncol 2006;103(1):329-35.
16. Magtibay PM, Adams PB, Silverman MB, Cha SS, Podratz KC. Splenectomy as part of cytoreductive
surgery in ovarian cancer. Gynecol Oncol 2006;102(2):369-74.
1
/
5
100%