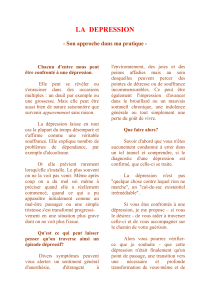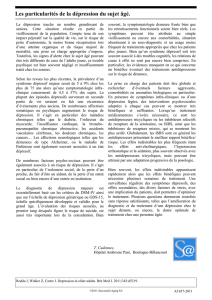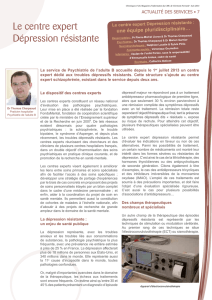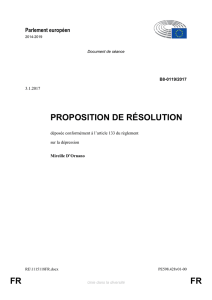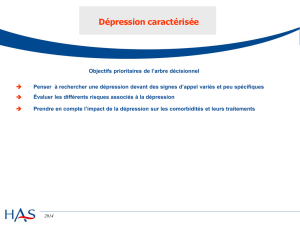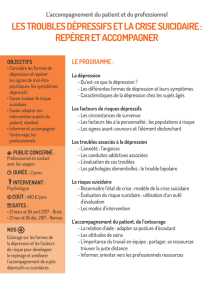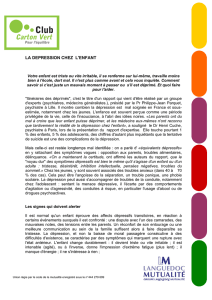Handicap et dépression dans les affections neurologiques chroniques évolutives M

L
a prise en compte des relations entre handicap et dépres-
sion n’est pas au premier plan de la pratique clinique
courante en neurologie. Or, leur co-occurrence majore le
retentissement sur le bien-être subjectif des patients et des familles.
Après avoir redéfini ces deux concepts, à titre d’exemple, nous trai-
terons des relations entre handicap et dépression dans la sclérose
en plaques (SEP), la maladie d’Alzheimer (MA) et la sclérose
latérale amyotrophique (SLA).
HANDICAP ET DÉPRESSION
La question des relations entre handicap et dépression nécessite de
définir chacune de ces notions. L’Organisation mondiale de la santé
a proposé, en 1980, un premier modèle conceptuel du handicap avec
la CIDIH (The International Classification of Impairments, Disabi-
lities and Handicaps),selon laquelle la maladie crée une déficience
ou un dysfonctionnement organique qui, à son tour, crée une incapa-
cité, expression de la déficience, conduisant à un désavantage situa-
tionnel (familial, social, professionnel) définissant le handicap.
Ce modèle a été révisé par la Classification internationale du fonc-
tionnement [CIF, OMS 2001] (1),qui substitue à une classifica-
tion en termes de “conséquences de la maladie” une classification
des “composantes de la santé”. Ainsi, la déficience n’entraîne
MISE AU POINT
La Lettre du Neurologue - vol. IX - n° 8 - octobre 2005 263
* Professeur de psychologie, université Paris-VIII, UFR de psychologie,
Saint-Denis, et fédération de neurologie, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris.
** Professeur de psychologie, université Paris-Descartes,
institut de psychologie, Boulogne.
Handicap et dépression dans les affections neurologiques
chroniques évolutives
Handicap and depression in chronic progressive neurological diseases
●M. Montreuil*, C. Bungener**
■Symptomatologie dépressive fréquente, épisode dépressif
majeur moins fréquent.
■La notion de handicap prend en compte l’interaction indi-
vidu/environnement.
■Recouvrement entre symptômes dépressifs et symptômes
neurologiques.
■Retentissement important sur la qualité de vie subjective
des patients.
■Le lien entre dépression et troubles cognitifs n’est pas
toujours linéaire.
■Prise en charge globale du patient et des familles.
■Outils d’évaluation de la dépression et du handicap pas
assez spécifiques.
Mots-clés : Handicap – Dépression – Évaluation – Prise en
charge.
POINTS FORTS
POINTS FORTS
The relationship between handicap and depression is not
enough taken into account in clinical neurological prac-
tice. However many studies have shown their impact on
the patient’s and family’s quality of life. In neurological
diseases, depressive symptoms are more frequent than
a caracterised major depressive episode as defined by
DSM-IV. This depressive symptomatology is often difficult
to identify because of the similarities between some
depressive and some neurological clinical signs. The two
concepts of handicap and depression will be defined, and
we will illustrate their relationship in three neurological
diseases: multiple sclerosis, Alzheimer’s disease and
amyotrophic lateral sclerosis. Handicap and depression
evaluation tools are not specific to the definitions of the
concept nor to the specificities of the diseases. In order to
compensate their weakness, the subjective quality of life
should be assessed systematically. Finally, a multidisci-
plinary approach should be proposed to both the patients
and their family.
Keywords: Handicap – Depression – Evaluation – Taking
care.
SUMMARY
SUMMARY

MISE AU POINT
La Lettre du Neurologue - vol. IX - n° 8 - octobre 2005
264
pas systématiquement d’incapacité, qui à son tour n’engendre pas
forcément de handicap. Le fonctionnement correspond au versant
positif de l’interaction individu/environnement opposé au handi-
cap, versant négatif : “Le fonctionnement est un terme générique
qui se rapporte aux fonctions organiques, aux activités de la per-
sonne et à la participation au sein de la société ; de même, han-
dicap sert de terme générique pour désigner les déficiences, les
limitations d’activités ou les restrictions de participation”. La CIF
dresse aussi la liste des facteurs environnementaux qui peuvent être
en interaction avec tous ces schémas. L’originalité de l’évaluation
d’une personne, en termes de fonctionnement, c’est qu’elle permet
de préciser les limitations d’activité, les restrictions de participation,
les obstacles, mais aussi les facteurs environnementaux matériels et
humains qui sont source de soutien, appelés aussi “facilitateurs”.
En France, selon l’article L.114 du texte de loi voté à l’Assemblée
nationale en décembre 2004, “constitue un handicap, le fait pour
une personne de se trouver, de façon durable, limitée dans ses
activités ou restreinte dans sa participation à la vie en société,
en raison de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique,
sensorielle, mentale ou psychique”. Le handicap s’analyse essen-
tiellement dans l’interaction entre l’individu et son environne-
ment. Il désigne les limitations d’activité et les restrictions de par-
ticipation sur le plan social.
DÉPRESSION
Bien que les classifications internationales de l’OMS préconisent
de diagnostiquer les problèmes de santé à partir de la CIM-10
(Classification internationale des maladies, 10erévision), le recours
au DSM-IV pour le diagnostic d’un épisode dépressif majeur est
le plus fréquent. En effet, dans les critères obligatoires retenus
par la CIM, un item fortement induit par l’état somatique appa-
raît, à savoir “réduction de l’énergie ou augmentation de la
fatigabilité”.
Selon les critères du DSM-IV (APA, 1996),le patient doit présen-
ter au moins cinq des neufs symptômes listés ci-dessous, depuis une
période d’au moins quinze jours, avec la présence obligatoire des
paramètres 1 et 2. Ces symptômes doivent induire une souffrance
significative ou une altération du fonctionnement. Ils ne sont pas dus
à un autre trouble, ni aux effets d’une substance ou à un deuil :
1) humeur dépressive,2) diminution de l’intérêt ou du plaisir,
3) perte ou gain significatif de poids, 4) insomnie ou hypersomnie,
5) agitation ou ralentissement, 6) perte de l’énergie ou fatigue,
7) sentiment de dévalorisation ou culpabilité, 8) diminution de
l’aptitude à penser, se concentrer ou prendre des décisions,
9) pensées récurrentes de mort.
L’épisode dépressif majeur, le syndrome dépressif ou la dépression
sont des synonymes pour exprimer une perturbation de l’humeur
dans le sens de la tristesse. L’humeur dépressive n’est pas une
simple tristesse, il s’agit d’une véritable douleur morale, qui peut
conduire à des idées de mort, et les conduites suicidaires sont fré-
quentes. Le pessimisme imprègne l’ensemble de la vie du déprimé.
Il porte sur les événements actuels et futurs. L’humeur dépressive
s’exprime également sur le plan comportemental, notamment au
niveau de la mimique et de la motricité. Le faciès est triste, figé,
inexpressif, et l’ensemble des gestes exprime le découragement
et l’abattement. Le patient se décrit comme indifférent aux choses
agréables ; on parle alors d’anhédonie. Chez la majorité des dépri-
més, cette anhédonie s’accompagne d’une hypersensibilité aux
choses désagréables, d’irritabilité, et parfois d’impulsivité. Mais
dans d’autres cas, l’anesthésie affective est totale et le patient ne
ressent plus rien, ni plaisir, ni déplaisir. Il n’est plus capable
d’éprouver des émotions. Il n’exprime qu’un désintérêt total pour
tout ce qui l’entoure, on parle alors d’émoussement affectif. Le
ralentissement, psychique et moteur, s’accompagne d’une sensa-
tion d’immense fatigue appelée asthénie. L’asthénie dépressive
représente une gêne importante pour le malade. Elle est plus
importante le matin et elle n’est pas améliorée par le repos. Elle
rend toute activité pénible. Le ralentissement cognitif se traduit
par des idées appauvries, laborieuses, voire absentes, et par une ten-
dance à la rumination mentale. Aucune élaboration n’est possible,
les réponses sont laconiques. Le patient se plaint de troubles de
la concentration, de l’attention, et de la mémoire.
HANDICAP ET DÉPRESSION
DANS LES AFFECTIONS NEUROLOGIQUES
Dans le cas de maladies neurologiques, le tableau clinique que
nous venons de décrire est souvent moins caractéristique. En effet,
les épisodes dépressifs majeurs sont relativement rares, mais la
présence de symptômes dépressifs est très fréquente. La tristesse
n’est pas toujours au premier plan. L’intrication entre les symp-
tômes dépressifs et ceux imputables à la maladie elle-même rend
le diagnostic difficile. Aussi, assiste-t-on fréquemment à une
méconnaissance de la symptomatologie dépressive qui n’est pas
prise en charge. La présence d’une telle symptomatologie engendre
une perte d’autonomie avec désinvestissement des activités. Elle
peut majorer les troubles somatiques et cognitifs et elle a un reten-
tissement sur la qualité de vie des patients, mais aussi sur celle
de leur entourage. Lorsqu’on s’intéresse aux travaux publiés dans
la littérature, la prévalence de la dépression dans les troubles neuro-
logiques varie de 5 % à 90 % ! Ces divergences s’expliquent par
la variabilité des critères retenus, les stades d’évolution des patients,
les outils utilisés (hétéroquestionnaires ou autoquestionnaires),
qui dans leur grande majorité n’ont pas été construits spécifi-
quement pour des patients atteints d’une maladie neurologique.
Toutefois, un consensus semble se dégager pour admettre que
l’on assiste le plus souvent à une symptomatologie dépressive,
mais plus rarement à un véritable épisode dépressif. Deux interpré-
tations, non exclusives, sont proposées pour expliquer la surve-
nue de troubles dépressifs. Sur le plan psychologique, il s’agirait
de la réaction à la maladie neurologique et à ses conséquences,
telles que la peur de la perte d’autonomie et la prise de conscience
des troubles physiques et/ou cognitifs. Sur le plan neurobiologique,
les processus physiopathologiques de l’atteinte neurologique inter-
fèreraient avec les mécanismes responsables de la survenue d’un
état dépressif. Les conséquences aboutissent à un handicap du fait
d’un retentissement social des déficiences et des incapacités.

La Lettre du Neurologue - vol. IX - n° 8 - octobre 2005 265
Les études récentes établissent un lien entre dépression et handi-
cap évalué par l’EDSS. Elles viennent contredire la littérature
internationale antérieure à 1999 en ce qui concerne la relation sta-
tistique entre la dépression et la sévérité du handicap (8).
Dépression et forme de la maladie
S’il n’y a pas de corrélation entre dépression et handicap dans les
15 études rapportées par Even avant 1999, à l’exception de 3, il
est actuellement nécessaire de différencier les formes de SEP pour
établir la réalité du lien, et de développer les recherches longitudi-
nales. En effet, il apparaît que la dépression et les troubles cogni-
tifs sont plus fréquents dans les formes secondairement progres-
sives que dans les deux autres formes de la maladie (9). Deux
explications sont proposées : la charge lésionnelle à l’IRM serait
supérieure dans les formes secondairement progressive et le stress
serait plus important face à la nouvelle modalité d’évolution de
la maladie.
HANDICAP ET DÉPRESSION
DANS LA MALADIE D’ALZHEIMER
Dans la littérature consacrée à la MA, l’analyse du handicap porte
essentiellement sur l’évaluation des activités de la vie quoti-
dienne (IADL). Les troubles de l’humeur font partie des troubles
“non cognitifs” ou “comportementaux”. Dans cette pathologie,
la présence d’une symptomatologie dépressive est extrêmement
fréquente, mais il ne s’agit que rarement de véritables épisodes
dépressifs majeurs. Forsell et al. (10) proposent de distinguer
deux types de symptômes dépressifs. Le premier réunit la perte
d’intérêt, le ralentissement psychomoteur, la perte d’énergie, les
troubles de la concentration et de la pensée et correspondrait
essentiellement à un trouble de la motivation. Le deuxième réunit
la dysphorie, les troubles de l’appétit, un sentiment de culpabilité
et des idées de suicide et correspondrait davantage à un trouble
dépressif. Nous avons mis en évidence la présence d’un émous-
sement affectif (manque d’initiative et de réactivité affective,
anhédonie et ralentissement psychomoteur) chez des patients
atteints de MA (11). Ce profil émotionnel est à rapprocher, d’une
part, des symptômes du premier type ou du trouble de la motiva-
tion et, d’autre part, du concept d’apathie, très souvent mentionné
dans la MA. La symptomatologie dépressive est plus fréquente
en début de maladie, lorsque la détérioration est légère ou modé-
rée (12). Elle semble être en lien avec la prise de conscience des
difficultés cognitives, des changements dans la vie quotidienne
et avec la peur de la perte d’autonomie.
HANDICAP ET DÉPRESSION
DANS LA SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE
Dans la SLA, la relation entre handicap et dépression est peu
étudiée. Le profil émotionnel des patients diffère complètement des
deux pathologies précédentes. En effet, les premières descriptions
Dépression Atteinte neurologique
Perte d’énergie Fatigabilité
Désinvestissement Incapacités fonctionnelles
Ralentissement Ralentissement
Troubles de la concentration et de la mémoire Troubles cognitifs
Troubles du sommeil Troubles du sommeil
Troubles de l’appétit Diminution de l’appétit
Tableau. Recouvrement des symptômes dépressifs et des symptômes
d’origine neurologique.
HANDICAP ET DÉPRESSION
DANS LA SCLÉROSE EN PLAQUES
Dans la SEP qui touche l’adulte jeune, les altérations physiques,
sensorielles et psychiques incluant les dimensions cognitives et
émotionnelles, sont fréquentes. Elles entraînent, parfois à court
terme mais plus généralement à moyen et long terme, une restriction
dans les activités et la participation à la vie sociale, en particulier
les loisirs et la vie professionnelle. Au cours de la SEP, la préva-
lence de la dépression sur la vie entière est de 50 à 60 %. Parmi les
déterminants de la dépression de la SEP, il est actuellement diffi-
cile de préciser la part revenant aux limitations motrices et senso-
rielles, aux troubles cognitifs, à la fatigue ainsi qu’aux facteurs de
personnalité dans l’adaptation à la maladie. Siegert et al. (2) pro-
posent une revue actualisée de la littérature sur dépression et SEP.
De nombreuses questions sont abordées : les relations avec les
lésions du système nerveux central (SNC), avec l’anxiété, le suicide,
la fatigue, les troubles cognitifs, les variables psycho-sociales, et avec
les traitements par interféron. Le lien spécifique avec le handicap
n’est pas traité. Cependant, les auteurs déplorent l’absence d’une
évaluation systématique des troubles de l’humeur en pratique
courante et, par conséquent, les carences dans le traitement spéci-
fique de la dépression chez les patients souffrant de SEP.
Pour Shawaryn et al. (3),la sévérité de la maladie en termes de
score à l’Expended Disability Status Scale (EDSS de Kurtzke) et
la rapidité de traitement de l’information à la PASAT sont corrélées
à la dépression. D’autres études constatent une corrélation entre les
troubles dépressifs et la perception subjective d’un déficit cogni-
tif (4). Lynch et al. (5) montrent que la dépression est en lien avec
l’EDSS, mais aussi avec l’incertitude quant au devenir, le sentiment
d’espoir et les stratégies défensives étant centrées sur l’émotion.
Lobentanz et al. (6) étudient l’influence du handicap, de la dépres-
sion, de la fatigue et du sommeil sur la qualité de vie. L’EDSS, la
fatigue et le sommeil ont une incidence uniquement sur les dimen-
sions physiques de la qualité de vie, alors que la dépression est le
principal facteur prédictif de toutes les dimensions de la qualité de
vie. Chwastiak et al. (7) analysent, chez 739 patients, les relations
entre les symptômes dépressifs (Center for Epidemiologic Stu-
dies Depression Scale, CES-D Scale) et la sévérité de la maladie
(EDSS). Les scores de dépression augmentent avec l’aggravation
de la maladie. Les paramètres fonctionnels de l’EDSS sont signi-
ficativement associés aux symptômes dépressifs quels que soient
l’âge, le niveau d’éducation et l’ancienneté de la maladie. Les
symptômes cognitifs à l’EDSS sont les plus fortement corrélés à
la symptomatologie dépressive.

MISE AU POINT
La Lettre du Neurologue - vol. IX - n° 8 - octobre 2005
266
psychologiques (1947) soulignent l’attitude étonnement “gaie”
des patients. Certains auteurs ont parlé de stoïcisme alors que
d’autres ont évoqué une attitude de déni. Les rares travaux rappor-
tent des scores faibles de dépression tout au long de l’évolution
de la maladie. Lorsqu’ils sont présents, les symptômes dépressifs
ne sont liés ni au temps écoulé depuis le diagnostic, ni au degré de
handicap (évalué par l’Amyotrophic lateral Sclerosis Functional
Rating Scale,ALS-FRS), ni à la progression de la maladie (13).
Bien que les plus grandes difficultés auxquelles les patients doi-
vent faire face soient la perte de la parole, la perte de la mobilité
et le mauvais pronostic, il semble que leur bien-être subjectif et
leur qualité de vie dépendent largement de la qualité du support
social de l’entourage. Nos travaux montrent que les difficultés
psychologiques (symptômes dépressifs, émoussement affectif,
déni) sont plus importantes dans les mois qui suivent l’annonce
du diagnostic, et cela d’autant plus que l’atteinte est déjà sévère
au moment de cette annonce.
CONCLUSION
Sur un plan méthodologique, une critique essentielle peut être faite,
d’une part, à l’étude de la dépression qui repose essentiellement
sur l’utilisation d’échelles non spécifiques, peu ou pas validées
dans les maladies neurologiques telles que GHQ, MADRS, BDI,
HDRS, SDS, etc., à l’absence d’évaluation systématique de
l’anxiété et, d’autre part, aux outils de référence qui évaluent le
handicap (dans la SEP : l’EDSS ; dans la MA : l’IADL ; dans la
SLA : ALS-FRS). Ces outils cliniques analysent essentiellement
des déficiences et/ou des incapacités, mais ne constituent pas à
proprement parler une évaluation du handicap. Pour pallier les
faiblesses des investigations en termes de handicap, il semble judi-
cieux d’adjoindre une évaluation de la qualité de vie subjective,
cela afin de mieux connaître les répercussions des dysfonction-
nements sur la vie du patient et de son entourage, dans les domaines
physique, fonctionnel, cognitif, psychologique-existentiel et
social. Les domaines cités correspondent aux grandes dimensions
qui explorent la qualité de vie d’un individu, selon les critères de
l’OMS.
Il est nécessaire que les symptômes dépressifs soient identifiés et
pris en charge. En effet, leur prise en compte par un traitement
adapté permet d’améliorer la qualité de vie des patients en rédui-
sant les aggravations fonctionnelles somatiques et cognitives et,
par conséquent, le retentissement sur la vie relationnelle.
À cet effet, des consultations multidisciplinaires (assurées par un
neurologue, un psychologue et/ou un neuropsychologue, un assis-
tant social, un médecin de médecine physique et de réadaptation,
un kinésithérapeute, un orthophoniste, etc.) tendent à se dévelop-
per dans le cadre hospitalier. Un autre intérêt de ce type de consul-
tation est d’inclure l’entourage familial et de détecter et de prévenir
leur propre souffrance psychique, qui se manifeste fréquemment
par un épisode dépressif majeur. À cet égard, les différentes asso-
ciations de malades et de familles apportent un soutien social essen-
tiel à différents moments de la maladie. Les études montrent que
toutes les formes d’accompagnement sont une aide pour le patient
et sa famille afin de maintenir une qualité de vie optimale.
■
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1.
Organisation mondiale de la santé. Classification internationale du fonction-
nement, du handicap et de la santé (CIF). Genève, 2001.
2.
Siegert RJ, Abernethy DA. Depression in multiple sclerosis: a review. J Neurol
Neurosurg Psychiatry 2005;76:469-75.
3.
Shawaryn MA, Schiaffino KM, LaRocca NG et al. Determinants of health-rela-
ted quality of life in multiple sclerosis: the role of illness intrusiveness. Mult Scler
2002;8(4):310-8.
4.
Maor Y, Olmer L, Mozes B. The relation between objective and subjective
impairment in cognitive function among multiple sclerosis patients – the role of
depression. Mult Scler 2001;7(2):131-5.
5.
Lynch SG, Kroencke DC, Denney DR. The relationship between disability and
depression in multiple sclerosis: the role of uncertainty, coping and hope. Mult
Scler 2001;7(6):411-6.
6.
Lobentanz IS, Asenbaum S, Vass K et al. Factors influencing quality of life in
multiple sclerosis patients: disability, depressive mood, fatigue and sleep. Acta
Neurol Scand 2004;110(1):6-13.
7.
Chwastiak L, Ehde D, Gibbons L et al. Depressive symptoms and severity of
illness in multiple sclerosis: epidemiologic study of a large community sample. Am
J Psychiatr 2002;159:1862-8.
8.
Even C, Laffite C, Etain B et al. Les déterminants de la dépression dans la SEP.
Revue de la littérature. L’Encéphale 1999;25:78-85.
9.
Bakshi R, Shaikh ZA, Miletich RS et al. Fatigue in multiple sclerosis and its
relationship to depression and neurologic disability. Mult Scler 2000;6:181-5.
10.
Forsell Y, Jorm AF, Fratiglioni L et al. Application of DSM III-R criteria for
major depressive episode to elderly subjects with and without dementia. Am J
Psychiatry 1993;150:1199-202.
11.
Bungener C, Jouvent R, Derouesné C. Affective Disturbances in Alzheimer’s
Disease. J Am Geriatr Soc 1996;44:1066-71.
12.
Zubenko GS, Zubenko WN, McPherson S et al. A collaborative study of the
emergence and clinical features of the major depressive syndrome of Alzheimer’s
disease. Am J Psychiatry 2003;160:857-66.
13.
Rabkin JG, Wagner GJ, Del Bene M. Resilience and distress among amyo-
trophic lateral sclerosis patients and caregivers. Psychosom Med 2000;62(2):271-9.
I. Les critères obligatoires pour le diagnostic de
dépression du DSM-IV sont mieux adaptés aux affec-
tions neurologiques que ceux de la CIM-10.
II. Le terme handicap désigne les déficiences phy-
siques.
III.L’EDSS de Kurtzke n’est pas une échelle de handicap.
AUTO-ÉVALUATION
AUTO-ÉVALUATION
Résultats : 1 : vrai ; II : faux ; III : vrai.
1
/
4
100%