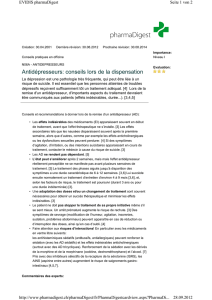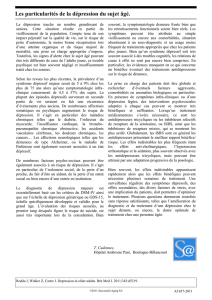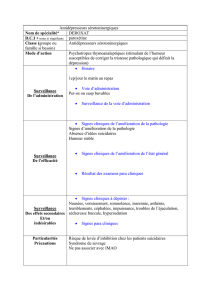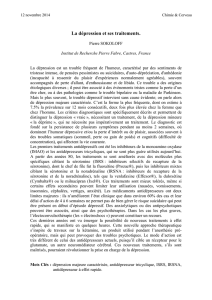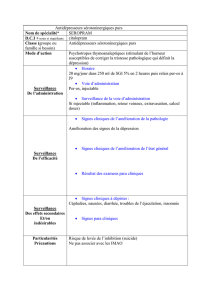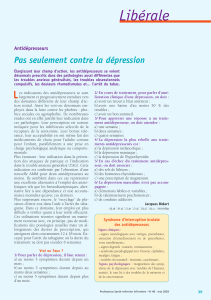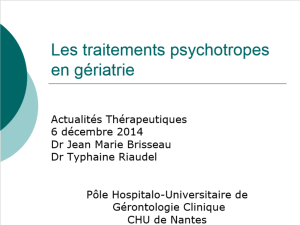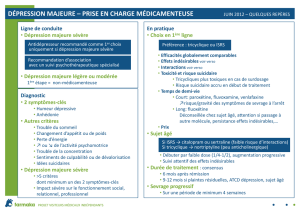M i s e a u ...

Act. Méd. Int. - Psychiatrie (15), n° 215, décembre 1998
3886
Mise au point
Les troubles dépressifs :
une pathologie chronique
◆Rappelons tout d’abord quelques
chiffres afin de mieux souligner l’am-
pleur du problème. Les états dépres-
sifs, qui peuvent survenir à tout âge,
sont l’une des formes les plus fré-
quentes de maladie mentale. Les dif-
férentes études épidémiologiques
donnent une prévalence dans la popu-
lation générale qui, sur la vie entière,
oscille autour de 16 % (1). Les
dépressions affectent plus souvent les
femmes que les hommes, avec un rap-
port homme/femme qui est de 1/2
(exception faite des formes bipo-
laires). On observe une augmentation
séculaire dans la prévalence des
dépressions, qui sont beaucoup plus
fréquentes parmi les sujets nés après
la dernière Guerre mondiale qu’avant.
Les causes profondes de cette tendan-
ce ne sont pas connues (effet de pério-
de, de cohorte,…). Les dépressions
sont à l’origine de la majorité des sui-
cides (15 % des déprimés meurent
ainsi) et représentent la 8ecause de
décès dans la population générale.
Elles sont aussi associées à une mor-
bidité et à une mortalité accrues par
différentes affections somatiques (2).
Elles sont l’une des principales causes
d’incapacité dans le monde. Bref, il
s’agit là d’un problème majeur de
santé publique, et l’extrapolation des
chiffres pour l’an 2020 montre que les
dépressions vont engendrer des
besoins croissants en termes de santé
publique.
◆Bien que la plupart des travaux
soient focalisés sur l’épisode dépressif
majeur, l’épidémiologie a mis en évi-
dence non seulement la forte prévalen-
ce des dépressions, mais aussi leur
nature chronique et résistante au traite-
ment. Ainsi, les derniers résultats de la
Collaborative Study of the
Psychobiology of Depression (CDS)
attestent de cette forte propension à la
récidive. Le pourcentage cumulé de
récidives est élevé parmi les malades
en phase de rémission, 15 % et 22 %
après respectivement 6 mois et 1 an
d’évolution asymptomatique. Dix ans
après la rémission, 75 % de ceux qui
ont récupéré rechutent (1). Deux fac-
teurs sont associés à cette tendance de
manière très significative. La comor-
bidité joue un rôle important : compa-
Cet article fait partie d’un programme d’information d’Organon et de Riom Laboratoires-CERM,
édité par Help Medical.
Approche pharmacologique des échecs
aux traitements antidépresseurs
Patrick Rogue*
* Centre de Neurochimie, CNRS, Strasbourg.
La dépression, une maladie
chronique qui représente l’une
des principales causes d’incapa-
cité dans le monde, va engendrer
des besoins croissants en termes
de santé publique dans les
années à venir. De nombreux
antidépresseurs sont aujourd’hui
disponibles. Pourtant, ces molé-
cules présentent des limites et de
réels inconvénients. Ainsi, les
attentes des cliniciens par rap-
port à de nouveaux produits effi-
caces et bien tolérés sont vives.
Comment satisfaire cette espé-
rance et être innovant aujour-
d’hui dans ce domaine ? Une
stratégie originale très promet-
teuse pour développer de nou-
veaux antidépresseurs plus effi-
caces et mieux tolérés consiste à
antagoniser à la fois les récep-
teurs α2-noradrénergiques et les
récepteurs sérotoninergiques
5HT2 et 5HT3, sans bloquer les
récepteurs sérotoninergiques 5HT1A.
Les techniques actuelles de la
recherche pharmacologique per-
mettent le développement de
telles molécules.
Depression, a chronic disease
and a leading cause of
disability worldwide, will genera-
te increasing needs in terms of
public health in the coming
years.Many antidepressants are
now available. However, these
molecules present real limitations
and disadvantages. Thus there
are great expectations on the
part of the clinician for more effi-
cient drugs that are better tolera-
ted. How can we satisfy such
hopes and innovate in this
domain today? One original and
most promising strategy for deve-
loping new antidepressants that
are more efficient and better tole-
rated involves antagonizing both
α2-noradrenergic and 5HT2 and
5HT3 serotonergic receptors,
without blocking 5HT1A seroto-
nergic receptors. The technology
now available in pharmacologi-
cal research allows the develop-
ment of such molecules.
Psych. 12/98 • XPress 23/04/04 11:58 Page 3886

3887
rées aux dépressions primaires, les
rechutes lors de dépressions secon-
daires à une autre affection psychia-
trique sont encore plus fréquentes
(35 % et 67 % respectivement). Le
nombre d’épisodes antérieurs est sur-
tout déterminant : plus il est élevé,
plus la probabilité de rechute est gran-
de (73 % chez les patients avec 3 ou
plus épisodes antérieurs) et plus la
durée des intervalles libres diminue.
◆La CDS confirme aussi la tendance à
l’évolution chronique de la dépression
unipolaire. Ainsi, seulement 54 %,
70 %, 81 %, 88 % et 93 % des dépri-
més parviennent à une rémission après
respectivement 6 mois, 1 an, 2 ans, 5
ans et 10 ans d’évolution (1). Deux ans
après le début de l’épisode dépressif,
19 % des patients restent donc dépri-
més, et plus d’un patient sur 10 restera
dans cet état pendant plus de 5 ans.
Parmi les facteurs de risque, c’est la
durée de l’épisode dépressif qui est le
meilleur indice du temps nécessaire
pour obtenir la rémission. Le DSM-IV (3)
distingue en fait 2 types de dépressions
chroniques : la dépression majeure
chronique (≥2 ans de durée) et la
dépression double (épisode dépressif
majeur survenu au décours d’une pério-
de de dysthymie ayant persisté au mini-
mum 2 ans). En tout, ces troubles
concernent environ un tiers des dépri-
més. Les déprimés chroniques sont des
patients très handicapés, avec des diffi-
cultés dans toutes les sphères (famille,
relations socioprofessionnelles, sexua-
lité, loisirs et qualité de vie en général).
Ces difficultés peuvent persister jus-
qu’à 2 ans après la fin du dernier épisode
dépressif (4). Ces patients apparais-
sent plus handicapés que les hyperten-
dus ou les diabétiques par exemple. La
dépression doit donc être considérée
comme une maladie chronique, au
même titre que les affections soma-
tiques prolongées.
Avant la résistance, l’observance
◆L’idée que les dépressions chroniques
seraient par essence résistantes au trai-
tement s’est avérée fausse. Différentes
études cliniques ont montré en effet que
les antidépresseurs peuvent être efficaces
dans les dépressions majeures chroniques
ou récidivantes. Cette notion a eu bien sûr
des conséquences significatives sur la
conduite du traitement et sur la prophy-
laxie. Les attitudes dans ce domaine ont
beaucoup évolué ces dernières années.
Jusqu’au milieu des années 1980, il
paraissait souhaitable de maintenir les
patients sous antidépresseurs 4 à 6 mois
seulement, avant d’arrêter progressive-
ment le traitement. Aujourd’hui, dans le
cas des dépressions majeures unipolaires
récidivantes, un traitement d’entretien de
3 à 5 ans est préconisé (voire prolongé à
vie selon certains auteurs). C’est là un élé-
ment supplémentaire qui milite en faveur
de l’introduction de nouveaux antidépres-
seurs plus efficaces et mieux tolérés que
ceux actuellement disponibles.
◆Malgré la souffrance qu’elles occasion-
nent, malgré leur impact économique
considérable, et le fait qu’elles réagissent
au traitement par antidépresseurs, les
dépressions chroniques restent sous-dia-
gnostiquées et sous-traitées (5). Par
exemple, 60 % des patients qui présentent
un épisode dépressif majeur persistant de
manière chronique depuis plus d’un an ne
reçoivent pas ou peu de traitement. Il en
est de même pour 50 % des patients dont
la dépression dure au moins 2 ans (1). Si
la dernière décennie a vu une augmenta-
tion considérable des connaissances dans
le domaine de la dépression, nous
sommes encore loin d’une prise en charge
satisfaisante du problème. Il y a diffé-
rentes raisons à cela, dont certaines
concernent le praticien (diagnostic insuf-
fisant, relations médecin-malade compli-
quées, prescription de traitements non
pharmacologiques seuls, sous-dosage lié à
la crainte des effets secondaires). Le
patient peut aussi contribuer, malgré lui, à
son propre malheur. En effet, il est surpre-
nant de constater que de nombreux
patients déprimés préfèrent endurer leur
calvaire en silence plutôt que de consulter.
La crainte de la stigmatisation qui reste
attachée à la maladie mentale explique en
partie cette attitude. Cependant, il semble
que le facteur déterminant soit le senti-
ment que les traitements disponibles pré-
sentent trop d’inconvénients.
◆Des arguments analogues expliquent
les arrêts spontanés du traitement anti-
dépresseur par les malades et la non-
observance. L’observance du traite-
ment est une conduite dont le détermi-
nisme est multifactoriel. Interviennent
ici les facteurs d’ordre sociologique (la
dépression reste stigmatisée), ou bien
dépendant du praticien et de la manière
dont il gère l’interruption spontanée
(l’attitude de certains confrères est par-
fois défensive ; ils ressentent l’arrêt
comme une disqualification qui les
empêche d’adopter une contre-attitude
efficace) ou encore liés à la maladie
(absence fréquente de rechute immé-
diatement après l’arrêt de l’antidépres-
seur, influence de la personnalité,
comorbidité autre, rôle de la chronici-
té). Les facteurs liés au traitement
jouent aussi un rôle important. Ils sont
eux-mêmes complexes. Des études ont
montré que les arrêts prématurés, qui
surviennent précocement après l’ins-
tauration d’un traitement antidépres-
seur, sont souvent en relation avec la
survenue d’effets secondaires significa-
tifs. En revanche, les interruptions plus
tardives le seraient moins et seraient
plutôt liées à l’intensité de l’épisode qui
a motivé la mise en route du traitement.
Bref, l’observance est un objectif
essentiel à toutes les phases du traite-
ment, et il est clair que de nouveaux
antidépresseurs sont nécessaires; ils
devront être au moins aussi efficaces
que les molécules déjà disponibles et
mieux tolérés, de telle sorte que les
patients seront moins enclins à les
interrompre.
Psych. 12/98 • XPress 23/04/04 11:58 Page 3887

Act. Méd. Int. - Psychiatrie (15), n° 215, décembre 1998
3888
Mise au point
La résistance au traitement :
un phénomène complexe
◆Il apparaît pourtant que la santé de
nombreux patients déprimés ne s’amé-
liore pas dans les délais prévus, même
après prescription d’un traitement anti-
dépresseur réputé efficace. En effet, si
classiquement les troubles affectifs sont
réputés de pronostic relativement favo-
rable, seulement 60 à 70 % des
malades pourront tolérer et seront
améliorés par l’antidépresseur pres-
crit en première intention. De nom-
breux déprimés (30 % environ, mais
jusqu’à 50 % selon certaines études)
présentent soit une intolérance au traite-
ment, soit un échec partiel ou total à
l’essai médicamenteux initial (6). Près
de 10 % d’entre eux resteront déprimés
malgré de multiples interventions. Les
patients qui nécessitent plusieurs tenta-
tives sont appelés résistants ou réfrac-
taires au traitement.
◆Le concept de dépression résistante
est d’apparition relativement récente (7).
Il existe un certain flottement séman-
tique dans ce domaine. Habituellement,
le terme est réservé aux dépressions évo-
luant depuis moins de deux ans, la for-
mule appropriée au-delà de cette durée
étant non plus celle de “dépression résis-
tante” mais de “dépression chronique”.
Un patient déprimé peut donc être résis-
tant au traitement sans souffrir de
dépression chronique.
Quoi qu’il en soit, dans l’idée de résis-
tance, la notion essentielle est que le
patient appelé réfractaire ait pu bénéfi-
cier d’un traitement adéquat. Cela sup-
pose donc que soit défini le concept de
traitement adéquat auquel la dépression
résiste. Il s’agit là bien entendu d’une
préoccupation ancienne ; dès 1974,
l’OMS avait distingué résistance relative
(non-réponse à un traitement inadé-
quat) et résistance absolue (résistance
malgré un traitement approprié). Par la
suite, de nombreuses autres définitions
ont été proposées, dans lesquelles l’im-
portance de la dose prescrite est géné-
ralement soulignée. La durée du traite-
ment doit aussi être suffisante. En pra-
tique, la notion de résistance absolue
implique l’absence d’amélioration chez
un patient qui recevrait la dose maxi-
male non toxique de manière prolon-
gée, par exemple 300 mg/jour* d’imi-
pramine ou 200 mg/jour de sertraline
durant 8 semaines (6). Plus récemment,
certains auteurs ont préconisé l’adop-
tion d’une définition consensuelle qui
prendrait en compte différents para-
mètres : diagnostic (critères d’inclusion
et d’exclusion) ; évaluation de la répon-
se (échelles) ; posologie ; durée (pro-
blème des répondeurs lents) ; nombre
d’essais adéquats nécessaire avant
d’évoquer la non-réponse ; compliance.
◆Les causes de la résistance aux trai-
tements antidépresseurs sont multiples.
Différents facteurs ont été identifiés qui
contribuent au problème de la résistance
aux antidépresseurs : facteurs d’ordre
socio-démographique (pauvreté, âge,
genre, car la résistance aux antidépres-
seurs serait relativement plus fréquente
chez les femmes) ; rôle de la pérennisation
des facteurs de stress ; type de dépression
et sa sévérité (par exemple, il n’y a tou-
jours pas de traitement consensuel pour
les dépressions brèves récurrentes). La
personnalité du déprimé influence aussi la
réponse aux antidépresseurs (8, 9), bien
que la manière dont s’exerce cet effet soit
très difficile à préciser. Le nombre d’épi-
sodes dépressifs antérieurs est essentiel. Il
apparaît aussi que les facteurs liés au trai-
tement jouent un très grand rôle (6).
Les causes pharmacologiques de la
résistance : le problème de l’efficacité
Aucune molécule connue n’est efficace
chez tous les patients.
◆En ce qui concerne les IMAO (inhi-
biteurs de la monoamine oxydase), les
inconvénients bien connus (hyperten-
sion artérielle induite par la tyramine
notamment) des molécules de la pre-
mière génération (non sélectifs et irré-
versibles) ont sérieusement restreint
leur utilisation. Et, si une nouvelle
génération est apparue (IMAO réver-
sibles ou RIMA, tels que la brofaromi-
ne ou le moclobémide) qui n’a pas ces
inconvénients, leurs avantages au plan
de l’efficacité sont discutés. Les anti-
dépresseurs tricycliques ont long-
temps représenté le traitement de base
de l’épisode dépressif. Notons toutefois
que le problème des doses optimales
pour ces molécules n’est pas entière-
ment résolu.
◆Qu’en est-il des ISRS (inhibiteurs
sélectifs de la recapture de la sérotonine) ?
Le développement de cette classe d’an-
tidépresseurs a été inspiré par la théorie
monoaminergique des dépressions. Les
cliniciens et les chercheurs souhaitaient
essentiellement obtenir des composés
plus spécifiques et ainsi mieux tolérés.
Pour ce faire, ils ont parié sur la séroto-
nine, car le système sérotoninergique
était supposé être plus directement
impliqué dans la régulation de l’hu-
meur que la noradrénaline. Le premier
ISRS commercialisé fut la zimelidine
en 1981, qui a été retirée par la suite en
raison d’effets secondaires (syndrome
de Guillain-Barré). D’autres ISRS (flu-
voxamine, fluoxétine, paroxétine, cita-
lopram et sertraline) ont été commer-
cialisés depuis. Pourtant, plusieurs
investigateurs, lors d’études contrôlées
multicentriques, ont obtenu des résul-
tats qui indiquent que les ISRS sont
moins efficaces que les tricycliques
(10, 11).
◆Dans les dépressions d’intensité
modérée, l’efficacité des différents
antidépresseurs semble comparable ; et
c’est dans le contexte de la dépression
sévère que le problème de l’efficacité
revêt toute sa signification. Certaines
* La posologie maximale recommandée par
l’AMM dans la dépression est de 150 mg/jour.
Psych. 12/98 • XPress 23/04/04 11:58 Page 3888

3889
molécules sont réputées plus efficaces
que d’autres. En particulier, il est admis
par de nombreux praticiens que les tri-
cycliques sont les molécules les plus
efficaces pour traiter les dépressions
sévères. Il y a moins d’unanimité
concernant l’utilisation des ISRS chez
ce type de patients. Ainsi, une stratégie
courante dans ce genre de situation est
d’utiliser un tricyclique et d’augmenter
les doses pour favoriser l’amélioration
clinique. Ce type d’approche suppose
implicitement l’existence d’une rela-
tion dose-effet démontrée, qui autorise-
rait l’ajustement des posologies afin
d’optimiser la réponse thérapeutique.
Pourtant, il existe peu de données qui
permettraient d’étayer le bien-fondé de
cette démarche. Si l’existence d’une
relation dose-effet est effectivement
démontrée pour plusieurs antidépres-
seurs tricycliques, l’augmentation de la
dose se heurte ici au problème de la
tolérance et des effets secondaires et
toxiques, qui souvent empêche l’ex-
pression de la relation dose-effet. D’un
autre côté, les ISRS ont tendance à
induire moins d’effets secondaires ;
mais, notamment dans le cas de la
fluoxétine, de la paroxétine et de la ser-
traline, la courbe dose-effet est relative-
ment plate. Cela est probablement lié
au fait que l’effet inhibiteur sur la
recapture de la sérotonine est d’emblée
maximal (12, 13).
◆Une autre question, tout aussi impor-
tante, a trait au délai d’action. L’effet
thérapeutique des antidépresseurs, y
compris dans le cas des ISRS, est retar-
dé. L’une des principales hypothèses
avancée pour expliquer ce délai d’ac-
tion prolongé implique les autorécep-
teurs 5HT1A somatodendritiques. Les
ISRS, par exemple, augmentent la dispo-
nibilité synaptique de la sérotonine dont
la conséquence est l’activation de plu-
sieurs récepteurs sérotoninergiques.
Cette augmentation de la concentration
locale de sérotonine est aussi observée
au niveau des corps cellulaires des neu-
rones des noyaux du raphé, où la séro-
tonine stimule les autorécepteurs séro-
toninergiques 5HT1A inhibiteurs
somatodendritiques qui régulent les
décharges neuronales. Par conséquent,
l’activité des cellules sérotoninergiques
est freinée, du moins en début de traite-
ment. L’apparition de l’effet bénéfique
sur l’humeur après deux semaines de
traitement serait contemporaine de la
désensibilisation de ces autorécepteurs
5HT1A (14).
Plusieurs stratégies ont été proposées
pour accélérer la réponse aux antidé-
presseurs. Par exemple, les effets de
l’agrypnie sont immédiats, et la photo-
thérapie agit dans des délais beaucoup
plus courts que les antidépresseurs. En
ce qui concerne les approches pharma-
cologiques, certains auteurs ont préconi-
sé l’association pindolol-ISRS.
L’utilisation du pindolol pour potentiali-
ser l’action des ISRS serait justifiée par
le fait qu’il s’agit d’un antagoniste mixte
5HT1A-sérotoninergique/ß-noradréner-
gique. L’utilisation d’un antidépresseur à
action sélective mixte sérotoninergique
et noradrénergique semble représenter
ici une alternative intéressante.
Les atouts de l’action duelle
◆Au plan neurobiologique, il est deve-
nu clair qu’il n’est plus possible d’envi-
sager séparément les systèmes noradr-
énergique et sérotoninergique. Ils inter-
agissent de manière intime, et cette
interaction semble fondamentale pour
la dépression. L’interaction entre les
systèmes noradrénerqique et sérotoni-
nergique représente une cible privilé-
giée pour les traitements antidé-
presseurs.
◆De nombreux résultats obtenus chez
les malades confirment la notion que
l’efficacité des antidépresseurs est
accrue par une “double action”, à la
fois sur le système sérotoninergique
et le système noradrénergique (15,
16). Par exemple, l’administration d’α-
méthyl-paratyrosine, qui interrompt la
synthèse de la noradrénaline, entraîne
des rechutes chez les déprimés.
Plusieurs études ont montré que les
inhibiteurs sélectifs de la recapture de la
noradrénaline ont aussi un potentiel anti-
dépresseur. L’association des effets sélec-
tifs sur chacun des deux systèmes paraît
donc clairement avantageuse. Néanmoins,
l’inhibition à la fois de la recapture de la
sérotonine et de la recapture de la
noradrénaline ne représente pas néces-
sairement la solution optimale pour par-
venir à cette double action. D’autres
approches semblent intéressantes (blocage
sélectif de la recapture de la sérotonine
associé à l’antagonisme des récepteurs
α2-noradrénegiques présynaptiques,
dont la stimulation bloque la libération
de certains neurotransmetteurs).
Les causes pharmacologiques de la
résistance : le problème des effets
indésirables
◆Les antidépresseurs tricycliques
posent avant tout le problème de l’im-
portance des effets indésirables qu’ils
peuvent entraîner. Les arrêts de traite-
ment prématurés sont une cause majeure
d’échec avec ces dérivés. Les effets
secondaires anticholinergiques sont
bien connus. La cardiotoxicité des tri-
cycliques et les effets hypotenseurs le
sont aussi.
◆La nouvelle génération d’ISRS se
caractérise surtout par des progrès
importants en termes de tolérance et de
sécurité : ils n’induisent pas d’effets
anticholinergique, cardiotoxique ou
hypotenseur. Cependant, ils ne sont pas
dénués d’inconvénients. Les effets
indésirables les plus courants sont les
troubles gastro-intestinaux (nausées,
vomissements, diarrhées). Ces effets
seraient plus fréquents avec certains
ISRS que d’autres, mais en fait ils les
concernent tous. Il en est de même pour
Psych. 12/98 • XPress 23/04/04 11:58 Page 3889

Act. Méd. Int. - Psychiatrie (15), n° 215, décembre 1998
3890
Mise au point
l’irritabilité et la tendance à l’insomnie,
autres types d’effets indésirables sou-
vent observés avec les ISRS. A noter
que la majorité des antidépresseurs ont
tendance à inhiber le sommeil para-
doxal (REM) (17), alors que les antago-
nistes 5HT2 ont l’effet inverse.
Les dysfonctionnements sexuels,
notamment la baisse de la libido, sont
habituels lors de la dépression. La plu-
part des antidépresseurs disponibles
induisent des dysfonctionnements
sexuels (ou aggravent les dysfonction-
nements existants) chez bon nombre de
patients. Il s’agit d’un effet secondaire
particulièrement gênant, qui peut
conduire à l’arrêt prématuré du traite-
ment. On mesure là les conséquences
délétères de ce genre d’effet indési-
rable. Il est évident qu’un antidépres-
seur “idéal” ne doit pas présenter ce
type d’inconvénient.
◆La sérotonine exerce ses multiples
actions par le biais de plusieurs types
de récepteurs sérotoninergiques postsy-
naptiques, et les effets secondaires sont
la conséquence de la stimulation exces-
sive par la sérotonine de tous les récep-
teurs sérotoninergiques. Ainsi, c’est la
stimulation des récepteurs 5HT2 et
5HT3 qui est associée aux effets
secondaires de type anxiété/agitation,
insomnie, dysfonctionnement sexuel et
troubles gastro-instestinaux. En effet,
chez l’animal, la stimulation des récep-
teurs 5HT2 et 5HT3 est associée à des
phénomènes de ce type. Cela explique
leur apparition avec les ISRS.
D’autres inconvénients ont été signalés
avec les ISRS. Par ailleurs, des acci-
dents ont été décrits lorsque les ISRS
sont associés aux IMAO, avec décès
rapide par hyperthermie (18). Une
période de sevrage doit donc impérati-
vement être respectée si l’on souhaite
changer un traitement par un ISRS en le
relayant par un IMAO. Cette phase
dépend de la demi-vie de l’ISRS en
question (pour la fluoxétine, cette
période de “washout” doit atteindre
cinq semaines).
La question des interactions
médicamenteuses
◆Une autre question que se posent les
cliniciens dans leur pratique quotidien-
ne en prescrivant des antidépresseurs
concerne les interactions pharmacoci-
nétiques avec d’autres médicaments.
Les interactions médicamenteuses sont
soit de type pharmacodynamique (liées
à des actions au niveau des mêmes
cibles), soit de type pharmacocinétique
(un médicament interfère avec l’ab-
sorption, le transport, la distribution ou
le métabolisme d’un autre médica-
ment). Ces dernières sont les plus
importantes, en particulier les interac-
tions pharmacocinétiques au niveau du
métabolisme hépatique. La plupart des
psychotropes sont en effet éliminés de
l’organisme au moyen de transforma-
tions (oxydations et déméthylations)
catalysées par le système du cytochro-
me P450 du foie (réactions de phase I).
Ce système est composé de 12 familles
d’isoenzymes. Il existe à ce niveau une
grande variabilité interindividuelle,
variabilité qui repose essentiellement
sur le polymorphisme génétique des
enzymes de la famille des cytochromes
P450. Six isoformes semblent plus
importantes pour le praticien, chacune
étant codée par des gènes distincts
(CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19,
CYP2D6, CYP2E1 et CYP3A4) (19).
L’expression de ces gènes peut être
modifiée par des facteurs environne-
mentaux. Ainsi, certains cytochromes
sont inductibles, ce qui s’accompagne
d’une accélération de la biotransforma-
tion. Inversement, certains cytochromes
peuvent être inhibés. Le médicament
est donc soit substrat, soit inhibiteur de
l’enzyme. Lorsque plusieurs médica-
ments empruntent la même voie de bio-
transformation, il existe donc un risque
d’interactions médicamenteuses avec
possibilité de modification de l’effica-
cité clinique, voire d’intolérance. Les
interactions médicamenteuses causées
par l’induction ou l’inhibition du cyto-
chrome P450 représentent une partie
très importante des interactions phar-
macocinétiques.
◆Le système du cytochrome P450 du
foie joue un rôle capital dans le méta-
bolisme des ISRS, qui interagissent et
sont métabolisés par différentes isoen-
zymes. De plus, le système du cyto-
chrome P450 hépatique est à l’origine
de la majorité des interactions médi-
camenteuses avec les ISRS (19).
Ainsi, la paroxétine et la fluoxétine sont
des inhibiteurs puissants d’une isofor-
me, le CYP2D6, et la fluvoxamine est
un inhibiteur très puissant du CYP1A2.
Ces ISRS sont donc susceptibles de
proposer des interactions avec les médi-
caments métabolisés par les isoen-
zymes dont ils inhibent l’activité en cas
d’association (neuroleptiques, anti-
arythmiques). Par conséquent, cer-
taines associations avec les ISRS sont à
manier avec prudence, voire contre-
indiquées, ou imposent le recours à la
surveillance des concentrations plasma-
tiques.
◆Par ailleurs, les conséquences de
l’inhibition à long terme du système
des cytochromes P450 ne sont pas
connues. Or des traitements prolongés
sont nécessaires, ce qui impose la pru-
dence dans le maniement à long terme
des ISRS.
◆Le comportement pharmacociné-
tique est lui aussi un paramètre impor-
tant à considérer lors du développement
des antidépresseurs. La biodisponibilité
orale d’un médicament est limitée avant
tout par le métabolisme hépatique. En
effet, tout médicament administré par
voie orale est résorbé au niveau de la
Psych. 12/98 • XPress 23/04/04 11:58 Page 3890
 6
6
1
/
6
100%