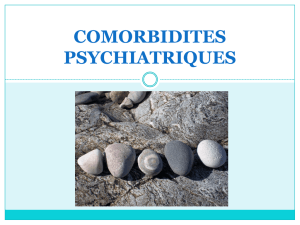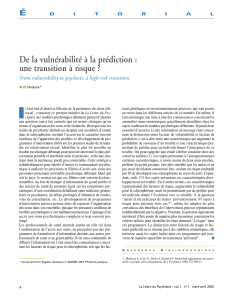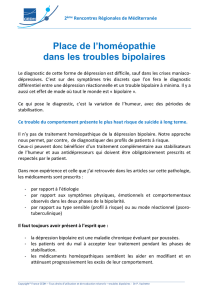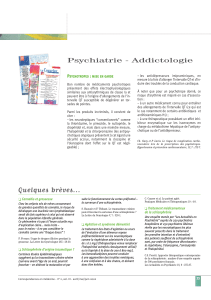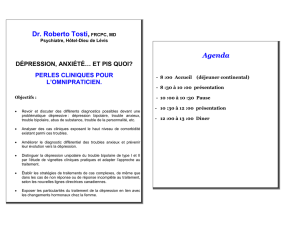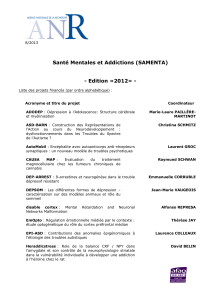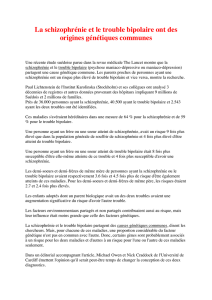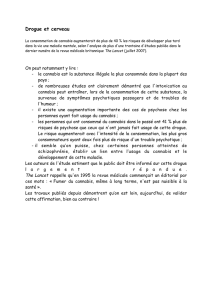ACTUALITÉS SCIENCES // Coordonnées par E. Bacon

74 | La Lettre du Psychiatre • Vol. VII - n° 3 - mai-juin 2011
ACTUALITÉS
SCIENCES
Coordonnées par E. Bacon
(clinique psychiatrique, Strasbourg)
// European Psychiatry
// Archives of General Psychiatry
// American Journal of Psychiatry
// Schizophrenia Research
// Journal of Psychiatry Research
// Nature Neuroscience
Influences des intérêts
corporatistes et politiques
sur les modèles de maladies
mentales dans l’évolution
du DSM
New York (États-Unis)
Le
Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorder
[DSM]), dont la
première édition a paru en 1952, est un guide
de référence essentiel pour la classification
des troubles mentaux. Il est utilisé dans de
nombreuses disciplines ayant trait aux soins de
santé mentale. C’est un document en constante
évolution et la parution de la dernière version,
le DSM-5, est prévue pour 2013. Dans un article
récent, B. Pilecki et al. ont mis en perspective
le développement du modèle médical de la
maladie mentale prôné par le DSM. Soulignant
les connexions entre ce modèle et les intérêts
des entreprises pharmaceutiques et des puis-
sances politiques, ils ont montré quel effet ce
modèle a eu sur les diverses révisions et les
développements du DSM. Dès ses premières
rédactions, le DSM a été fondé, au moins impli-
citement, sur un modèle médical de la maladie
mentale. Dans un tel modèle, les individus,
“malades mentaux” ou “perturbés”, sont
considérés comme présentant une maladie qui
se manifeste par des symptômes particuliers
entraînant en général dysfonctionnement et
détresse. Par conséquent, la maladie mentale
fait partie intégrante d’un paradigme normatif
– qui identifie les écarts par rapport à la norme,
ou “santé mentale”– comme constituant un
trouble mental. Ces écarts par rapport à la
norme sont caractérisés par des types défi-
nissables de pensées, de sentiments et de
comportements qui sont eux-mêmes ensuite
interprétés comme appartenant à différentes
classes de troubles. Ce processus de différen-
ciation est analogue à celui qui fait que, par
exemple, un rhume viral se distingue d’une
infection bactérienne. Bien que les rédacteurs
successifs du DSM aient tenté de se fonder sur
des preuves scientifiques, les facteurs poli-
tiques et économiques ont aussi façonné leur
conceptualisation de la maladie mentale. Les
puissances économiques et institutionnelles
ont renforcé l’utilisation du DSM comme
modèle médical dans la compréhension de
la psychopathologie. Force est de constater,
cependant, que les preuves scientifiques d’un
modèle médical ont du bon et du mauvais, et
que les démonstrations en faveur d’autres types
de conceptualisations ont fait l’objet de bien
moins d’attention. Le modèle médical permet
de faire des diagnostics fiables et présente
de nombreux avantages et intérêts pour les
psychiatres, les chercheurs ainsi que pour les
industries pharmaceutiques et les industries de
la santé. Selon les auteurs de cette analyse, il
serait important de développer des modèles
théoriques et conceptuels qui permettraient, en
retour, le développement de taxonomies fiables
et valides du point de vue des syndromes. Cela
pourrait ensuite nourrir une science de la
maladie mentale qui correspondrait plus étroi-
tement aux taxonomies des autres sciences
et qui tempérerait la puissance des intérêts
économiques et politiques dans les disciplines
de la santé mentale. Une telle analyse est parti-
culièrement pertinente aujourd’hui, alors que
la publication de la nouvelle révision du DSM
est encore à l’état de projet et que le champ
de la psychiatrie va tenter de comprendre et
d’intégrer les modifications proposées par le
manuel dans le traitement, la théorie et la
recherche.
>
Pilecki BC, Clegg JW, McKay D. The influence of corporate
and political interests on models of illness in the evolution of
the DSM. Eur Psychiatry 2011;26:194-200.
Relation entre âge paternel
tardif et risque
de schizophrénie : une nouvelle
approche permet de démêler
les risques en fonction
de la biographie paternelle
Aarhus (Danemark)
En 2001, D. Malaspina et al. ont démontré
l’existence d’une relation entre l’âge paternel
et la survenue d’une schizophrénie dans
la descendance. À l’époque, les chercheurs
avaient avancé l’hypothèse selon laquelle des
mutations de novo dans les cellules séminales
paternelles pourraient être responsables de
cette association. En effet, plus l’âge du père
est élevé au moment de la conception, plus les
taux de mutation de novo augmentent. On peut

La Lettre du Psychiatre • Vol. VII - n° 3 - mai-juin 2011 | 75
cependant distinguer deux catégories de pater-
nités tardives. Certains hommes ont conçu des
enfants à des âges divers, dont certains à un âge
avancé. D’autres ont eu leur premier enfant à un
âge avancé. Si l’on définit la paternité tardive
par l’âge du père au moment où il a eu son
premier enfant, cet âge est constant pour tous
les enfants du même père, indépendamment
de l’âge réel du père lors de la conception des
enfants suivants. Une hypothèse alternative à
celle relative aux mutations de novo liées à l’âge
avancé du père au moment de la conception
consiste à considérer que ce sont les facteurs
conduisant à une première paternité tardive
qui seraient à l’origine de la prédisposition à
la schizophrénie dans la descendance. À ce
jour, on ne disposait d’aucune preuve tangible
en faveur de l’une ou de l’autre hypothèse. Si
les mutations de novo sont responsables, un
âge paternel plus élevé lors de la conception
devrait amener une augmentation du risque
de schizophrénie. Inversement, si c’est l’âge
du père au moment du premier enfant qui est
responsable, on devrait constater une associa-
tion entre le risque de schizophrénie et l’âge
paternel élevé au premier enfant. Une étude
destinée à distinguer ces deux origines éven-
tuelles a été menée au Danemark, pays qui
dispose de registres très complets concernant
la population. L’étude a porté sur 2,2 millions de
personnes nées entre 1955 et 1992, qui ont été
suivies jusqu’au premier diagnostic de schizo-
phrénie, le cas échéant (entre 1970 et 2007).
Dans cette population, 14 211 individus ont
développé une schizophrénie. Les résultats
confirment que, globalement, un âge paternel
élevé est associé à un risque accru de schizo-
phrénie. Toutefois, les chercheurs ont constaté
que, lorsqu’on prenait en compte l’âge du père
au moment de la naissance du premier enfant,
le risque de schizophrénie chez les enfants ne
dépendait pas de l’âge paternel au moment de
la conception des enfants suivants. En revanche,
le risque de schizophrénie augmentait significa-
tivement avec l’augmentation de l’âge du père
au moment de son premier enfant. Le paramètre
important ne paraît donc pas être l’âge du père à
la conception, mais plutôt une paternité initiale
tardive. Ces observations excluent l’hypothèse
de la responsabilité des mutations de novo liée
au vieillissement des cellules séminales pater-
nelles. En revanche, elles sont compatibles avec
l’hypothèse selon laquelle ce sont les facteurs
liés à un âge élevé du géniteur au moment de sa
première paternité, et non à l’âge en soi du père,
qui seraient responsables de l’association entre
paternité tardive et risque de schizophrénie.
Les recherches ultérieures devraient donc se
focaliser sur l’élucidation des facteurs associés
à une primo-paternité tardive.
>
Malaspina D, Harlap S, Fennig S et al. Advancing paternal
age and the risk of schizophrenia. Arch Gen Psychiatry
2001;58(4):361-7.
>
Petersen L, Mortensen PB, Pedersen CB. Paternal age at
birth of first child and risk of schizophrenia. Am J Psychiatry
2011;168(1):82-8.
Schizophrénie liée à l’âge
paternel tardif : s’agit-il
d’uneforme spécifique
de la schizophrénie ?
New York (États-Unis)
La schizophrénie se caractérise par une grande
hétérogénéité, qui concerne tant les symptômes
que le décours de la pathologie et les profils
cliniques. Cette hétérogénéité complique l’inter-
prétation des résultats de la recherche et freine
la découverte de nouveaux traitements. Une
partie de la variabilité des symptômes et des
caractéristiques de la maladie pourrait trouver
son explication dans la présence de sous-
groupes, qui différeraient de par leur étiologie
et les perturbations neurobio logiques sous-
jacentes. Un âge paternel avancé a été associé
à un risque plus élevé de schizophrénie dans
la descendance. Certaines études ont suggéré
que la schizo phrénie liée à l’âge paternel tardif
pourrait constituer une variante particulière de
la pathologie, qui présenterait des spécificités
en termes de symptômes, de profil cognitif, de
métabolisme cérébral, d’effets de sexe et de
rythme cardiaque. Toutefois, pour le moment,
on ne sait pas encore très clairement si une
caractéristique quelconque de l’hétérogénéité
de la schizo phrénie peut être attribuée à l’âge
paternel tardif. Pour explorer cette possibilité,
des chercheurs new-yorkais ont mis en œuvre
une approche fondée sur une analyse spéci-
fique de groupement. La méthode de
k-means
clustering
consiste en une analyse de partition
spécifique qui, en cas d’importante variabilité
de nombreux facteurs, permet de générer des
groupes indépendants partageant des caracté-
ristiques communes. Elle a déjà été utilisée en
psychiatrie pour examiner l’hétérogénéité des
symptômes, les réponses aux antipsychotiques et
les symptômes cognitifs. Les auteurs se sont foca-
lisés sur un certain nombre de facteurs clés des
variables démographiques, cliniques et cognitives,
et olfactives. Ils ont effectué une série d’analyses
dans le but d’identifier des groupes comportant
un nombre élevé de cas de schizophrénie liée à
l’âge paternel tardif. Ils ont ainsi pu identifier
deux groupes qui présentaient des caractéris-
tiques spécifiques. La première analyse a révélé
un groupe contenant 83 % de cas de schizoph-
rénie liée à l’âge paternel tardif, dans lequel les
patients étaient caractérisés par des différences
significatives entre les scores de capacités intel-
lectuelles verbale et de performance. Les âges
moyens paternels et maternels étaient respecti-
vement de 41 et de 33 ans. La seconde analyse
a révélé un groupe contenant 71 % de cas de
schizophrénie liée à l’âge paternel tardif, comp-
tant une proportion élevée de femmes (93 %)
et un âge précoce d’apparition de la psychose
(17,2 ans). Ces résultats renforcent les observa-
tions antérieures, qui suggéraient que les cas de
schizophrénie liée à l’âge paternel tardif diffèrent
des autres variantes de la psychopathologie. Ils
confirment que les processus génétiques et micro-
biologiques à l’origine de cette forme particulière
de schizophrénie sont probablement différents de
ceux valant dans les autres cas. Cette méthode
semble particulièrement prometteuse pour établir
le phénotype spécifique de la schizophrénie liée
à l’âge paternel tardif et pour élaborer des hypo-
thèses novatrices qui permettront le développe-
ment d’approches cliniques spécifiques, adaptées
aux particularités de cette population de patients.
>
Lee H, Malaspina D, Ahn H et al. Paternal age related schizo-
phrenia (PARS): latent subgroups detected by k-means clustering
analysis. Schizophr Res 2011;128(1-3):143-9.
Anomalies des interneurones
hippocampiques dans le trouble
bipolaire
Nashville et Boston (États-unis)
Le trouble bipolaire est à ce jour encore relati-
vement peu étudié, en dépit de son effet impor-
tant sur la santé des patients qui en souffrent.
Pour preuve, dans les publications référencées

76 | La Lettre du Psychiatre • Vol. VII - n° 3 - mai-juin 2011
ACTUALITÉS
SCIENCES
depuis 1980 sur PubMed, on relève huit fois plus
d’articles indexés par le terme “schizophrénie”
que par “trouble bipolaire” ! Cette différence
trouve peut-être son origine dans l’hypothèse
forte, émise par E. Kraepelin, selon laquelle la
schizophrénie serait un trouble structurel, alors
que le trouble bipolaire n’aurait pas de subs-
trat neuronal. Cette hypothèse est désormais
remise en question par des études post mortem,
de génétique et de neuro-imagerie. Ainsi, des
observations post mortem ont rapporté une
baisse de densité et une diminution de l’expres-
sion génique des interneurones hippocampiques.
Toutefois, en neuro-imagerie, les études, des
variations de volume et du fonctionnement de
l’hippocampe n’ont permis d’aboutir à aucune
conclusion nette. Une étude post mortem
mettant en œuvre des outils stéréologiques
et des analyses immunocytochimiques fournit
des arguments complémentaires en faveur de
l’existence de perturbations de l’hippocampe
dans le trouble bipolaire. Des chercheurs améri-
cains ont analysé les hippocampes entiers de
14 patients et de 18 sujets témoins ayant été en
bonne santé, âgés de 18 à 86 ans. Des tranches
d’hippo campe, réalisées à 2,5 mm d’intervalle,
ont été marquées avec des anticorps, notam-
ment contre la somatostatine et la parvalbumine
et l’ARN messager (ARNm) a été extrait des
tissus fixés. Les résultats révèlent des anoma-
lies marquées des interneurones hippocam-
piques chez les patients bipolaires. En effet, si
le nombre total de neurones de l’hippocampe
chez les patients et les témoins ne différait pas,
le groupe de patients présentait cependant une
diminution du volume des couches cellulaires
non pyramidales et dans le secteur de la corne
d’Ammon. En outre, une diminution de 40 % des
interneurones marqués à la somatostatine, une
baisse de 30 % des interneurones marqués à la
parvalbumine et des taux plus faibles d’ARNm
de la somato statine, de la parvalbumine, et
de l’acide glutamique décarboxylase1 ont
été constatés chez les patients. Cette étude
confirme donc l’existence d’altérations spéci-
fiques des interneurones hippocampiques chez
les patients souffrant de troubles bipolaires,
altérations susceptibles d’entraîner des dysfonc-
tionnements cérébraux.
>
Konradi C, Zimmerman EI, Yang CK et al. Hippocampal inter-
neurons in bipolar disorder. Arch Gen Psychiatry 2011;68:
340-50.
L’exercice physique modéré
améliore les paramètres
dedépression des patients
souffrant d’une dépression
sévère résistant au traitement
Porto et Minho, Portugal
La dépression sévère est une condition complexe,
multifactorielle et multigénétique dont la patho-
physiologie, tout comme celle des autres troubles
psychiatriques, est toujours peu connue, voire
ne l’est pas. Du fait du manque d’informations
concernant les mécanismes sous-jacents, les
approches thérapeutiques de la dépression
sévère sont principalement symptomatiques,
mais leur but n’en reste pas moins d’obtenir
une rémission complète. Malgré l’utilisation
de combinaisons de stratégies thérapeutiques,
les taux de rémission restent faibles, et plus de
60 % des patients remplissent les critères de la
dépression résistant au traitement. Un certain
nombre de stratégies non pharmacologiques
ont donc été envisagées en tant que théra-
pies complémentaires, notamment l’exercice
physique, la luminothérapie et la privation de
sommeil. L’exercice physique a déjà montré des
résultats encourageants, comme alternative
thérapeutique, dans d’autres troubles dépres-
sifs. C’est une thérapie peu coûteuse, bénéfique
à la santé, et qui améliore le bien-être général.
Toutefois, il convient de vérifier d’abord comment
les diverses populations cliniques vivant dans
des environnements différents réagissent aux
programmes. Cette étude a évalué l’effet sur la
dépression et les paramètres de fonctionnement
d’un programme d’exercices d’intensité modérée
utilisé comme adjuvant à la pharmacothérapie,
chez des patients souffrant de dépression
sévère résistant au traitement pharmacologique.
Parmi 150 patients ayant consulté une clinique
psychiatrique de Porto entre septembre 2009
et mars 2010 pour cause de dépression sévère,
45 présentaient une dépression sévère résistant
au traitement (9 à 15 mois de traitement sans
bénéfice apparent) ; 33 d’entre eux ont été inclus
dans l’étude. Ils ont été répartis en 2 groupes :
le premier groupe, de 11 patients, a continué à
suivre les traitements pharmacologiques usuels,
cependant que, pour les 22 patients du second
groupe, des exercices d’aérobic s’ajoutaient à
la pharmacothérapie habituelle. Le programme

La Lettre du Psychiatre • Vol. VII - n° 3 - mai-juin 2011 | 77
des exercices consistait en une promenade de
35 à 45 minutes au départ du domicile, 5 jours
par semaine, pendant 12 semaines. Une des
promenades hebdomadaires était effectuée au
gymnase de l’hôpital et surveillée par un profes-
seur de gymnastique. À la fin de l’étude, aucun
des participants du groupe témoin n’a présenté de
réponse positive au traitement pharmacologique
ou de rémission. Au même moment, le groupe
réalisant des exercices a montré une amélioration
de tous les paramètres de dépression et de fonc-
tionnement, et ce à la fois par rapport aux valeurs
de référence et au groupe contrôle de patients
simplement médiqués. Ainsi, 21 % des partici-
pants dans le groupe des exercices ont présenté
une réponse positive et 26 % une rémission. Il
semble donc qu’un exercice physique d’inten-
sité modérée puisse constituer une aide et un
complément bénéfique dans la dépression sévère
résistant au traitement. Le suivi de ces patients
est en cours et devrait permettre de déterminer si
les effets positifs de l’exercice perdurent au-delà
de la fin du programme d’activités physiques.
>
Mota-Pereira J, Silverio J, Carvalho S, Ribeiro JC, Fonte D,
Ramos J. Moderate exercise improves depression parameters
in treatment-resistant patients with major depressive disorder.
J Psychiatr Res 2011 ; sous presse.
Addiction, contexte et cortex :
certains neurones du cortex sont
susceptibles d’inhiber la rechute
de consommation d’héroïne
(chez le rat)
Baltimore (États-Unis)
Une étude récente publiée dans le prestigieux
journal
Nature Neuroscience
a identifié un réseau
neuronal qui serait responsable de la rechute de la
consommation d’héroïne induite par le contexte.
La toxicomanie est une maladie chronique récur-
rente caractérisée par une compulsion à recher-
cher et à consommer de la drogue, une perte du
contrôle de la consommation de substances et
l’émergence d’un état émotionnel négatif lors
des périodes d’abstinence. Les taux de rechute
sont très élevés chez les toxicomanes en cas de
tentative d’arrêt. Ces rechutes ont des causes
diverses. La réexposition au contexte environ-
nemental préalablement associé à la drogue est
notamment susceptible de déclencher un désir
puissant de la drogue et de provoquer une rechute.
J.M. Bossert et al., en utilisant une approche phar-
macogénétique novatrice et élégante, ont iden-
tifié chez le rat une sous-population de neurones
spécifiques éparpillés dans le cortex préfrontal
ventromédian qui sont activés par le contexte
environnemental associé à l’héroïne, et cette acti-
vation est susceptible de précipiter la rechute de
la consommation d’héroïne liée au contexte. Dans
un modèle murin de rechute de la consommation
d’héroïne induite par le contexte, des chercheurs
de l’Institut national américain de toxicomanie
ont identifié un petit groupe de neurones dans
le cortex préfrontal ventromédian qui forment
des ensembles neuronaux codant pour les asso-
ciations apprises entre les contextes associés à
l’héroïne et la récompense par l’administration
d’héroïne. En inactivant sélectivement cette petite
population de neurones (recrutés lorsqu’ils sont
exposés au contexte associé à l’héroïne), les
chercheurs ont observé une atténuation de la
rechute de la consommation d’héroïne induite
par le contexte. En outre, les résultats suggèrent
que le réseau neuronal qui médiatise la rechute
dans la consommation d’héroïne diffère de celui
par l’intermédiaire duquel survient la rechute dans
la consommation de cocaïne. Cette observation
constitue une étape importante dans la compré-
hension des mécanismes neurobiologiques de la
rechute de consommation de drogue. L’étude plus
approfondie de cet ensemble de neurones, situés
dans une structure cérébrale cruciale pour la prise
de décision, pourrait conduire à l’identification
des personnes vulnérables à la dépendance, ainsi
qu’au développement de nouvelles stratégies pour
le traitement de la toxicomanie.
>
Bossert JM, Stern AL, Theberge FR et al. Ventral medial
prefrontal cortex neuronal ensembles mediate context-induced
relapse to heroin. Nat Neurosci 2011;14(4):420-2.
>
George O, Koob GF. Craving, context and the cortex. Nat
Neurosci 2011;14(4):409-10.
Risque de survenue
et de persistance de symptômes
psychotiques à la suite
de l’usage prolongé de cannabis
Maastricht (Pays-Bas), Londres (Royaume-
Uni), Bâle (Suisse), Dresde et Munich
(Allemagne)
Pour la plupart des individus, l’expression
de phénomènes psychotiques infracliniques
est transitoire et ne progresse jamais vers la
maladie psychotique chronique. Toutefois, des
expériences psychotiques pourraient devenir
anormalement persistantes, selon le degré
d’exposition à des facteurs de risque supplémen-
taires de type environnemental, et se convertir
en trouble chronique. Par ailleurs, le cannabis
est la drogue illicite la plus couramment utilisée
au monde, en particulier par les adolescents.
L’usage du cannabis est souvent associé à la
maladie mentale, notamment aux troubles
psychotiques. La consommation de cannabis
est considérée comme une cause possible de
précipitation dans la psychopathologie, en inter-
action avec des susceptibilités génétiques et
d’autres facteurs de risque environnementaux.
Cependant, reste à savoir si l’association entre
le cannabis et la psychose est causale, ou si ce
sont les expériences psychotiques précoces qui
amènent certains sujets à utiliser le cannabis
comme automédication. On ne peut obtenir de
réponse à cette question que si la consomma-
tion de cannabis est étudiée en relation avec
l’incidence de troubles psychotiques ultérieurs.
Il s’agit donc d’examiner de façon longitudinale
la relation éventuelle entre le cannabis et la
psychose.
Des chercheurs européens se sont attelés à
cette tâche et ont cherché à déterminer si la
consommation de cannabis à l’adolescence
pouvait augmenter les risques de survenue et
la persistance de symptômes psychotiques. Ils
ont analysé les données d’une cohorte alle-
mande provenant de la région de Munich. Dans
le cadre de cette étude, 1 923 individus de la
population générale, âgés de 14 à 24 ans au
début de la recherche, ont été suivis pendant
10 ans. Les sujets qui avaient préalablement
traversé des expériences psychotiques ont
été exclus de l’étude. La consommation de
cannabis et les symptômes psychotiques
ont été évalués à trois reprises : au début de
l’étude, après 3 ans et demi (T2), et au bout
de 8,4 ans (T3). Les chercheurs ont constaté
que, pour les sujets n’ayant pas consommé
de cannabis avant le début de l’étude mais
en ayant consommé à quelques reprises entre
celui-ci et T2, les risques d’incidents psycho-
tiques entre T2 et T3 étaient plus élevés. De
plus, un usage continu de cannabis entre le
début de l’étude et T2 augmentait le risque de
symptômes psychotiques persistants. L’asso-
ciation entre la consommation de cannabis

78 | La Lettre du Psychiatre • Vol. VII - n° 3 - mai-juin 2011
ACTUALITÉS
SCIENCES
et le risque de signes psychotiques était
indépendante du statut socio-économique,
de l’usage d’autres drogues, du statut rural
ou urbain et des traumatismes vécus dans
l’enfance. Les résultats ne montrent pas d’effet
d’auto médication pour le cannabis, puisque
les expériences psychotiques n’avaient pas
d’effet prédictif sur la consommation ultérieure
de cannabis. La consommation de cannabis à
long terme est donc bien un facteur de risque
de développement de symptômes psychotiques
incidents. Prolongée, elle pourrait augmenter
le risque de survenue d’un trouble psychotique
en influant sur la persistance des symptômes.
Des chercheurs du même groupe ont observé,
avec la même cohorte, que la vie et l’éducation
en milieu urbain étaient susceptibles d’aug-
menter la vulnérabilité aux effets psychomimé-
tiques du cannabis consommé ultérieurement
au cours de l’existence.
>
Kuepper R, van Os J, Lieb R, Wittchen HU, Höfler M, Henquet
C. Continued cannabis use and risk of incidence and persistence
of psychotic symptoms: 10 year follow-up cohort study. BMJ
2011 Mar 1;342:d738. doi: 10.1136/bmj.d738.
>
Kuepper R, van Os J, Lieb R, Wittchen HU, Henquet C. Do
cannabis and urbanicity co-participate in causing psychosis?
Evidence from a 10-year follow-up cohort study. Psychol Med
2011:1-9.
Sous-estimation du nombre
de troubles bipolaires chez
lespatients soignés en première
intention pour dépression
Cardiff (Grande-Bretagne)
Bien que les troubles de l’humeur aient tradi-
tionnellement été rigoureusement subdivisés
en dépression unipolaire et trouble affectif
bipolaire (manie en alternance avec dépres-
sion), des recherches récentes suggèrent qu’une
proportion importante de patients atteints de
dépression sévère pourraient en fait présenter
un trouble bipolaire non diagnostiqué. Une
étude publiée tout récemment en ligne par le
British Journal of Psychiatry
révèle ainsi que
près d’une personne sur5 traitées pour dépres-
sion en soins primaires pourrait en fait souffrir
d’un trouble bipolaire non diagnostiqué. Pour
mener à bien cette recherche, des psychiatres
de l’université de Cardiff ont identifié plus de
3 000personnes originaires du pays de Galles
et traitées pour dépression par leur médecin
généraliste : 576 d’entre elles (soit 18,5 %
des personnes invitées) ont accepté de parti-
ciper, et ont rempli un questionnaire destiné à
déterminer si elles présentaient des symptômes
du trouble bipolaire. Cent cinquante-quatre
des répondants ont ensuite été invités à une
évaluation en face à face clinique. Vingt-neuf
de ces 154personnes évaluées (18,8 %) répon-
daient aux critères diagnostiques du trouble
bipolaire. Toutefois, les chercheurs ont réalisé
3 estimations du nombre de patients traités
en soins primaires pour dépression, suscep-
tibles de présenter un trouble bipolaire non
diagnostiqué. Leur estimation la plus prudente,
de 3,3 %, est fondée sur l’hypothèse que toutes
les personnes qui ont abandonné l’étude, soit
en ne renvoyant pas leurs questionnaires, soit
en cours d’évaluation, ne présentaient pas de
trouble bipolaire. Leur estimation conserva-
trice suppose que toutes les personnes qui ont
abandonné l’étude auraient réagi de la même
manière que celles qui ont été évaluées, ce
dont résulte un taux de 21,6 %. Il en ressort
donc que de 3,3 % à 21,6 % des patients
soignés en première intention pour dépres-
sion unipolaire souffraient en fait d’un trouble
bipolaire non diagnostiqué. De nombreux
patients souffrant de trouble bipolaire ne
seraient pas correctement diagnostiqués
pendant de nombreuses années, ce qui aurait
des conséquences parfois dévastatrices. Il est
probable que beaucoup de personnes traitées
pour dépression par leur médecin généraliste
aient reçu des prescriptions d’antidépresseurs.
Or, selon le Dr Daniel Smith, responsable de
cette étude, pour les patients qui présentent
un trouble bipolaire, ces médicaments peuvent
être au mieux inutiles, au pire nuisibles. La
principale raison de ces erreurs de diagnostic
encore fréquentes semble être un manque de
formation des médecins généralistes en ce qui
concerne les questions de santé mentale. Il
serait donc important que les médecins géné-
ralistes soient soutenus dans l’élaboration
de stratégies destinées à s’assurer que leurs
patients souffrant de dépression reçoivent le
bon diagnostic.
> Smith DJ, Griffiths E, Kelly M, Hood K, Craddock N, Simpson
SA. Unrecognised bipolar disorder in primary care patients with
depression. British Journal of Psychiatry 2011 ; Epub ahead of
print. doi:10.1192/bjp.bp.110.083840.
1
/
5
100%