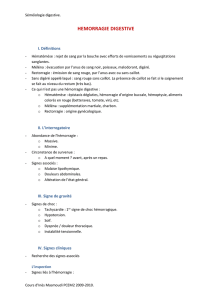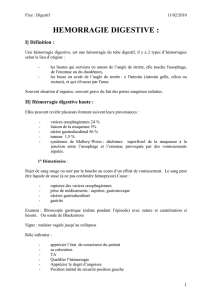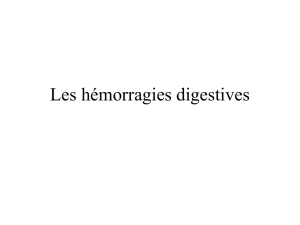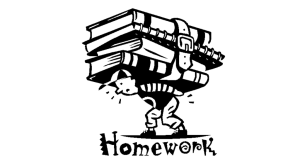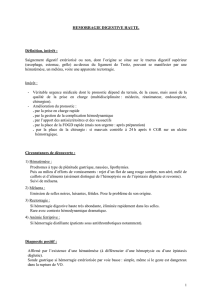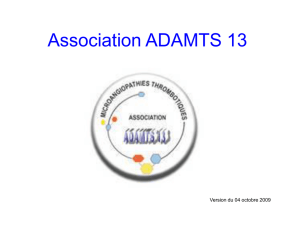Lire l'article complet

301
L’infection bactérienne est fréquente
chez les malades cirrhotiques au cours de
l’hémorragie digestive. Elle est docu-
mentée dans 50 à 60 % des cas, et la mor-
talité à court terme chez ces malades
atteint 40 %. Une seule étude suggère
que l’infection bactérienne est un facteur
prédictif de récidive, mais la définition
de la récidive survenant dans les sept
jours manque de précision.
Le but de cette étude prospective est de
déterminer l’influence de l’infection sur
l’absence de contrôle du saignement
chez des malades cirrhotiques admis
pour rupture de varices œsophagiennes et
suivis pendant cinq jours après leur
admission.
Malades
• Population
Cent cinquante et un malades atteints de
cirrhose ont été admis consécutivement
177 fois pour hémorragie digestive. On
dénombrait 163 admissions, concernant
137 malades, dues à une rupture de
varices œsophagiennes.
• Critères d’évaluation
L’échec du contrôle de l’hémorragie était
défini par :
– la nécessité de transfuser un nombre
supérieur ou égal à 6 unités de sang ou de
plasma pendant six heures consécutives
au cours des cinq premiers jours, ou la
nécessité de transfuser 2 unités ou plus
pendant six heures consécutives pour
maintenir les signes vitaux après les 12
premières heures et au cours des cinq
premiers jours, avec persistance d’un
méléna ;
– l’hématémèse après les 12 premières
heures et au cours des cinq premiers jours ;
– le décès dans les cinq jours.
L’échec initial du contrôle de l’hémorra-
gie était défini par la présence des deux
premiers critères au cours des 24 pre-
mières heures, tandis que la récidive hémor-
ragique précoce était définie par la pré-
sence des deux mêmes critères après les
24 premières heures et dans les cinq
jours. Les malades chez lesquels il y
avait un échec du contrôle de l’hémorra-
gie constituaient le groupe 1, les autres le
groupe 2.
• Prise en charge des malades
Tous les malades sans hémorragie active
à l’endoscopie étaient traités avec une
Analyse commentée
Hepatology 1998; 27: 1207-12
L’infection bactérienne est associée
à l’échec du contrôle
de l’hémorragie digestive
chez les malades cirrhotiques
Goulis J., Armonis A., Patch D., Sabin C., Greenslade L., Burroughs A.K.
Bacterial infection is independently associated with failure to control of bleeding in cir-
rhotic patients with gastrointestinal hemorrhage
La rupture de varices œsophagiennes est une complica-
tion fréquente et grave de la cirrhose. La mortalité de
chaque épisode varie de 30 à 50 % dans les semaines qui
suivent l’hémorragie. La mortalité est essentiellement liée à
l’absence de contrôle du saignement et à la récidive pré-
coce qui se produit au cours des premiers jours chez 50 %
des malades. Les facteurs pronostiques d’échec du contrôle
de l’hémorragie et de la récidive précoce ont été peu étu-
diés. De plus, l’analyse des résultats est rendue difficile à
cause de l’hétérogénéité des études recherchant ces fac-
teurs, notamment en ce qui concerne les définitions utilisées
pour le contrôle du saignement, la cause de la récidive, la
durée d’observation qui varie de cinq jours à six semaines,
ou les critères pronostiques étudiés.

drogue vaso-active, terlipressine ou octréo-
tide, pendant cinq jours. Un traitement
endoscopique (sclérose ou ligature) était
effectué chez les malades ayant un sai-
gnement actif. Un tamponnement œso-
phagien était utilisé en cas d’hémorragie
massive, un TIPS était posé en cas
d’échec de tous ces traitements. Une
transfusion était prescrite si le taux d’hé-
moglobine était inférieur à 10 g/dl. Les
prélèvements bactériologiques (sang,
urine et ascite) étaient systématiquement
effectués à l’admission, et répétés en cas
d’apparition de signes d’infection. Le
diagnostic des infections reposait sur
les critères habituels. Des antibiotiques
étaient prescrits uniquement si une infec-
tion était documentée, ou si des signes
patents d’infection étaient présents.
• Analyse statistique
Vingt-six variables qualitatives et 13 va-
riables quantitatives ont été collectées à
l’admission et évaluées dans les groupes
1 et 2. Ces variables ont été incluses dans
une analyse unidimensionnelle dans le
but d’identifier les facteurs prédictifs
d’échec du contrôle de l’hémorragie. Les
variables qui montraient une éventuelle
relation avec l’évolution (p < 0,10)
étaient incluses dans une analyse multi-
dimensionnelle en régression logistique.
L’analyse multidimensionnelle a été réa-
lisée séparément avec les variables
“infection prouvée” et “antibiothérapie
pour suspicion d’infection”, sachant
qu’elles sont très liées entre elles. Les
analyses ont été effectuées pour les
admissions avec rupture de varices œso-
phagiennes et pour toutes les admissions
avec hémorragie digestive.
Résultats
Cent soixante-trois admissions pour rup-
ture de varices œsophagiennes (93 %) ou
gastriques (7 %) chez 137 malades ont
été étudiées. La cirrhose était Child A
dans 19 % des cas, B dans 37 % et C
dans 44 %. Le saignement était actif à
l’endoscopie dans 76 cas (53 %). Une
sclérothérapie a été effectuée dans
117 cas et 29 malades ont eu un TIPS.
L’échec du contrôle de l’hémorragie
était constaté dans 76 cas (47 %),
l’échec initial du contrôle de l’hémorra-
gie dans 21 cas (13 %), et une récidive
hémorragique précoce est survenue dans
51 cas (31,5 %). Quatre malades sont
morts dans les cinq jours (2,5 %). La
mortalité hospitalière était en moyenne
de 22 %, dont 36 % dans le groupe 1 et
9 % dans le groupe 2 (p < 0,0002).
Une antibiothérapie pour suspicion d’in-
fection a été débutée à l’admission dans
113 cas (69 %). Cent deux infections ont
été documentées pour 91 admissions
(91/163 : 56 %) : 35 pneumopathies,
24 bactériémies, 6 infections d’ascite,
15 infections urinaires, 11 malades avec
deux infections. Une infection était
documentée chez 56 % des malades trai-
tés par sclérothérapie et dans 48 % des
cas chez ceux non traités par sclérothé-
rapie (NS).
L’analyse unidimensionnelle a identifié
comme facteurs pronostiques d’échec du
contrôle de l’hémorragie : le score de
Child (p < 0,001), le taux de prothrom-
bine (p < 0,002), l’utilisation d’une anti-
biothérapie (p < 0,0001) et une infection
prouvée (p < 0,0001), un saignement
actif (p < 0,0007), un tamponnement
œsophagien (p < 0,05).
La première analyse multidimensionnelle
montre que les trois variables testées sont
liées à l’échec du contrôle de l’hémorra-
gie : infection prouvée (p < 0,0001), sai-
gnement actif (p < 0,001) et score de
Child (p < 0,005). La seconde montre
également que les trois variables testées
sont liées à l’échec du contrôle de l’hé-
morragie : antibiothérapie (p < 0,003),
saignement actif (p < 0,005) et score de
Child (p < 0,02). Les résultats sont simi-
laires dans la population globale des
malades, quelle que soit l’origine du sai-
gnement.
Discussion
Cette étude montre que l’échec du
contrôle de l’hémorragie, défini par
l’échec du contrôle initial du saignement,
la récidive précoce ou le décès dans les
cinq jours, survient chez 47 % des
malades après rupture de varices œsogas-
triques. Les variables pronostiques étu-
diées étaient en partie déjà connues pour
leur association avec l’évolution : sévé-
rité de la cirrhose, abondance du saigne-
ment, constatations endoscopiques. Les
auteurs ont également inclus des variables
nouvelles : la présence d’une infection
bactérienne ou l’antibiothérapie empi-
rique pour suspicion d’infection. Cette
dernière variable a été testée en raison du
fait que de nombreuses infections bacté-
riennes ne sont pas bactériologiquement
documentées chez les malades cirrho-
tiques. Les résultats montrent que ces
deux variables sont des facteurs pronos-
tiques de l’échec du contrôle de l’hémor-
ragie. Une infection bactérienne a été
documentée chez 56 % des malades, ce
qui correspond aux taux observés dans
les autres études prospectives. Une seule
étude a montré que la présence d’une
infection était un facteur prédictif indé-
pendant de la récidive précoce (Bernard
et coll., Gastroenterology 1995 ; 108 :
1828-34). La sévérité de la cirrhose,
reflétée par le score de Child, et le carac-
tère actif du saignement initial sont éga-
lement des facteurs pronostiques indé-
pendants de l’échec du contrôle de l’hé-
morragie, confirmant les résultats de plu-
sieurs études prospectives préalables.
Les résultats sont identiques si l’on
considère l’ensemble des malades cirrho-
tiques avec hémorragie digestive quelle
qu’en soit l’origine. Cela renforce le
caractère robuste du modèle, sachant que
l’erreur diagnostique concernant la source
Act. Méd. Int. - Gastroentérologie (12), n° 9, novembre 1998
302
Analyse commentée

303
de l’hémorragie est fréquente. D’autre
part, les résultats sont d’autant plus
convaincants qu’ils sont validés sur l’en-
semble de la population, dans la mesure
où cela permet d’éviter les pièges d’un
biais d’échantillonnage.
Il existe une étroite relation entre infec-
tion et hémorragie digestive chez ces
malades. L’hémorragie digestive au
cours de la cirrhose et les procédures thé-
rapeutiques invasives favorisent les
infections à cause du risque accru de
translocation bactérienne et de l’altéra-
tion du système réticulo-endothélial liée
à l’hypovolémie. Cependant, il existe des
arguments permettant de penser que l’in-
fection joue un rôle dans la genèse de
l’hémorragie, car elle entraîne une
décharge d’endotoxines dans la circula-
tion, favorisée par l’altération du système
réticulo-endothélial. Ces endotoxines
déclenchent une activation des média-
teurs de l’inflammation, tels que les cyto-
kines, l’oxyde nitrique ou les leuco-
triènes. Ces médiateurs occasionnent des
lésions structurelles et fonctionnelles du
tube digestif à type de congestion vascu-
laire et de nécrose, ainsi que des altéra-
tions hématologiques (dysfonction-
nement plaquettaire et activation des syn-
dromes de défibrination). Les hémorra-
gies digestives s’observent au cours des
infections sévères. Cette hypothèse est
renforcée par le fait que la plupart des
infections sont documentées au cours des
premiers jours.
La signification pronostique de l’infec-
tion montre que sa présence doit être dis-
cutée lors de l’analyse et de la planifica-
tion des essais cliniques randomisés dans
le traitement des hémorragies digestives
chez les malades cirrhotiques. Le rôle
prédictif de l’infection sur l’échec du
contrôle de l’hémorragie souligne l’inté-
rêt de l’utilisation prophylactique d’une
antibiothérapie chez ces malades.
Dr B. Bernard,
service d’hépato-gastroentérologie,
CHU Pitié-Salpêtrière, Paris.
1
/
3
100%