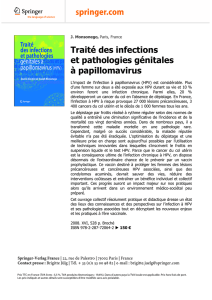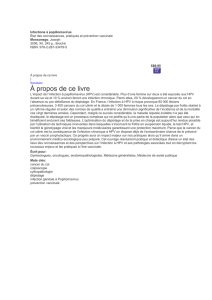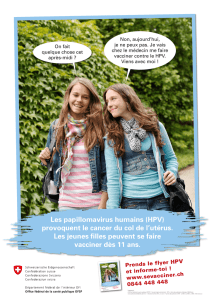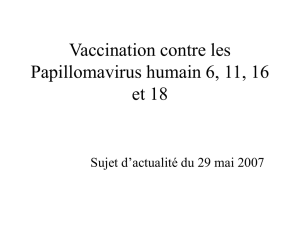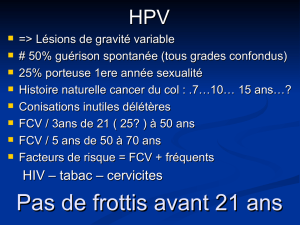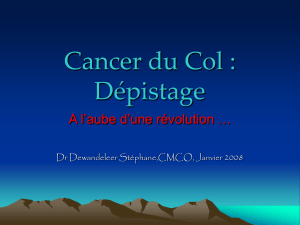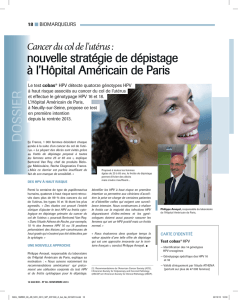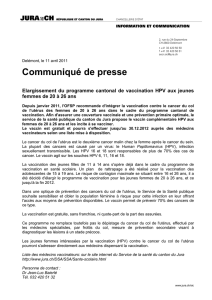ÉDITORIAL

6 | La Lettre du Gynécologue • n° 362 - mai 2011
ÉDITORIAL
e caractère viro-induit du cancer du col de l’utérus
est formel, et le virus HPV oncogène (une quin-
zaine de génotypes différents) est le seul facteur
de risque indépendant (nécessaire mais
non suffisant). La force d’association entre
ce cancer et cet agent viral est un exemple, à part en
pathologie humaine, et il est tel qu’il ne peut y avoir de
cancer du col sans HPV oncogène. Ce cancer fait suite à
la progression non obligatoire de lésions précancéreuses,
qui sont toutes la conséquence d’un portage persistant
en HPV oncogène. Ces états précancéreux relèvent d’une
prévention secondaire, mais, malgré le dépistage par
frottis cervico-utérin, le cancer du col reste fréquent avec
une incidence moyenne estimée en 2005 en France à 7,1
pour 100 000 femmes. De nombreuses études, rando-
misées et contrôlées pour certaines, démontrent que
l’intégration de la biologie moléculaire pour la recherche
du virus HPV améliore le dépistage en diminuant notable-
ment les faux négatifs. Deux vaccins HPV prophylactiques
extrêmement efficaces sont disponibles, l’un quadrivalent
dirigé contre les HPV-6, 11, 16 et 18, l’autre bivalent dirigé
contre les HPV-16 et 18. Ils sont recommandés en France
par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP), avec
comme population cible les jeunes filles de 14 ans et un
rattrapage possible chez les 15-23 ans.
Si les outils pour une excellente prévention du cancer du
col existent aujourd'hui, son impact a été largement sous-
évalué. En effet, le taux de cancers du col évité grâce à la
vaccination a été calculé sur la base d’une responsabilité
à l’échelon mondial à hauteur de 70 % pour les HPV-16
et 18, alors qu’en France, ces 2 génotypes sont respon-
sables à eux seuls de plus de 80 % des cas. De même,
les condylomes acuminés sont évités par la vaccination
quadrivalente plus de 9 fois sur 10.
Mais la carcinogenèse HPV induite ne se limite pas au
col de l’utérus, et même si les forces d’association des
autres sites n’atteignent pas les 100 %, elles n’en sont pas
moins importantes. En effet, au niveau du tractus génital,
d’autres cancers peuvent être dus à l’HPV : le cancer du
vagin pour 90 % des cas, de la vulve pour 40 % des cas et
du pénis pour 40 % des cas. De même et plus fortement
lié, le cancer de l’anus est dû à l’HPV dans plus de 90 %
des cas et c’est très majoritairement l’HPV-16 qui est en
cause (plus que pour le col). Enfin, les cancers ORL, en
particulier de l’oropharynx, sont clairement en relation
avec les HPV oncogènes.
Tout cela montre, d’une part, que les impacts réels de la
prévention primaire que sont les vaccins ont été totale-
ment sous-évalués et, d’autre part, qu’il faudra réfléchir
prochainement à l’extension de la vaccination à l’homme.
La prévention secondaire du cancer du col de l’utérus, qui
a pour but d’éviter l’invasion, nécessite des méthodes de
dépistage sensibles pour prendre en charge efficacement
les lésions précancéreuses. La difficulté post-thérapeu-
tique réside dans notre capacité à affirmer la guérison
dans cette population à risque réel et prolongé d’inva-
sion ; là encore, les tests HPV sont très utiles. Ces tests
permettraient également une optimisation du dépistage
dans des populations à risque majoré comme les immuno-
déprimés iatrogènes.
Il faut donc poursuivre la promotion de la préven-
tion en proposant activement la vaccination dans
le cadre des recommandations afin d’améliorer la
couverture vaccinale et son observance,
et militer pour une organisation
du dépistage avec une intégration
logique et raisonnée des nou-
velles technologies.
Ce dossier de La Lettre du Gyné-
cologue, rédigé par des experts
reconnus de la question, a pour but
de faire le point, au travers d’une
approche de certaines populations, sur l’infection et les
pathologies dues aux HPV et de reparler de la prévention
au sens large.
Les maladies HPV induites (human
papillomavirus) ou l’évidente sous-évaluation
de l’impact de la prévention
HPV infections or the under evaluation of the prevention impact
D. Riethmuller*
* Service de gynécologie obstétrique, hôpital Saint-Jacques, 2, place Saint-Jacques,
25030 Besancon Cedex.
LG 2011-05 bonne version.indd 6 17/05/11 16:41
1
/
1
100%