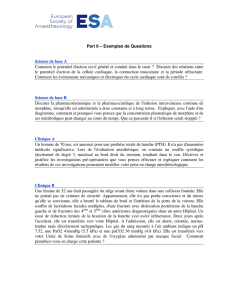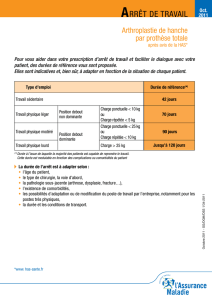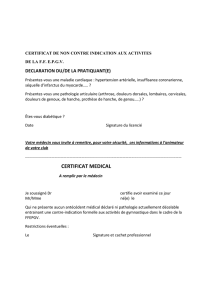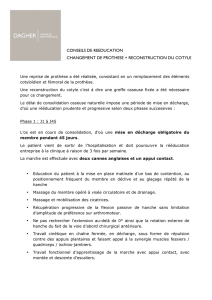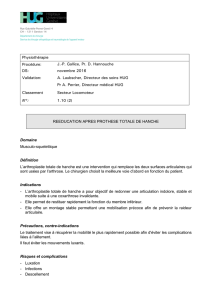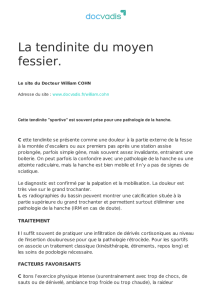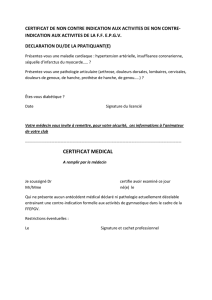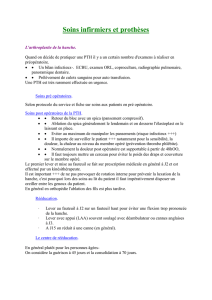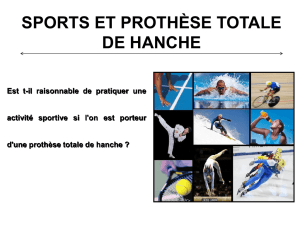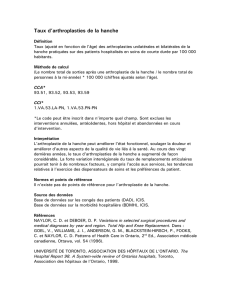L TrIBUNE Le traitement de la coxarthrose par prothèse de hanche

TrIBUNE
36 | La Lettre du Rhumatologue • N° 353 - juin 2009
Le traitement de la coxarthrose
par prothèse de hanche
É. Lesur*
L
e rhumatologue peut être amené à adresser
son patient au chirurgien. L’ objectif de
ce dernier est de proposer un protocole
thérapeutique précis, et éventuellement de
programmer un geste opératoire qui devra
être réalisé durant une intervention unique,
dont les résultats immédiats sont à l’heure
actuelle excellents. Mais qu’en est-il sur le long
terme ?
Les données acquises dans le domaine de l’arthro-
plastie prothétique de la hanche depuis plus de
60 ans permettent de proposer à nos malades
les solutions techniques ayant résisté à l’épreuve
du temps. Pour le chirurgien, il est encore parfois
difficile de faire le bon choix.
Les voies d’abord
La mode des techniques moins invasives, dont
la presse spécialisée s’est fait l’écho à l’aube de
notre siècle, et qui relève parfois du marketing, a
permis de stimuler la réflexion des chirurgiens. En
effet, beaucoup d’écoles restaient sur des posi-
tions anciennes, rendant parfois paradoxale la
diminution de longueur des incisions, mais la
persistance d’une morbidité liée à l’abord de
l’articulation.
À nos yeux, une seule voie d’abord de hanche
peut se prévaloir d’être la moins invasive : la voie
de Hueter.
Elle est la plus naturelle, car la seule à emprunter
l’espace intermusculaire entre le tenseur du fascia
lata et le droit antérieur, mais aussi un espace
internerveux, entre les territoires sciatique et
crural. Décrite à la fin du XIXe siècle, cette voie
d’abord est retenue par l’école du Pr Judet, dès
1946, afin de réaliser le traitement prothétique
des fractures du col du fémur. Quelques années
plus tard, elle fut adaptée à l’arthroplastie
totale.
À l’heure actuelle, son évolution peu invasive en
fait la voie d’abord de référence ; en effet, son
innocuité sur l’appareil musculaire fessier, sur
la capsule postérieure (par l’auteur) et sur les
pelvi- trochantériens garantit la stabilité de la
néo- articulation, ses plus fines évolutions per-
mettant d’étendre son innocuité au psoas et au
tenseur du fascia lata.
Les autres abords de hanche
Au milieu du XXe siècle, Sir John Charnley
implante, à Wrightington, en Angleterre,
les prothèses de hanche par voie “trans-
trochantérienne” (qualificatif assez éloquent
quant au traumatisme osseux causé !). D’autres
utilisent la voie dite “transglutéale”, qui a très
fréquemment pour séquelle majeure une insuffi-
sance du moyen fessier. On peut donc considérer
que ces voies sont intrinsèquement vulnérantes,
car elles peuvent entraîner des complications par
insuffisance musculaire.
Peu après Judet, Moore propose des prothèses
cervico-céphaliques, implantées par une voie
postéro-externe. Elles présentent l’avantage de
traiter les fractures du col fémoral, dont l’évo-
lution est souvent fatale, et d’être facilement
implantables ; elles sont ainsi privilégiées par
beaucoup de services de traumatologie. Malheu-
reusement, elles entraînent souvent une luxation
postérieure, ce qui motive la création de nom-
breux artifices anti-luxation. La technique est de
nouveau extrapolée aux arthroplasties totales,
avec bien entendu les mêmes risques majorés
d’instabilité, du fait de la réduction du diamètre
des têtes prothétiques fémorales. Or, l’évolution
pérenne d’une arthroplastie de hanche dépend
d’abord de sa stabilité, ce qui rend nécessaire
l’utilisation d’une voie d’abord sans morbidité.
Le couple de friction
Une fois stabilisée, la néo-articulation doit encore
faire preuve de longévité.
Plus un système est contraint, plus il est fragile.
Cet état de fait conduit donc à éliminer d’emblée
les artifices de stabilisation en polyéthylène, tels
que les cotyles rétentifs, les rebords anti-luxation
ou la double mobilité. Concernant cette dernière
solution, très à la mode dans les pays franco-
phones européens, les dernières publications de
la Société française de chirurgie orthopédique
concluent à la non-amélioration de la durée de
vie des arthroplasties mais aussi à des compli-
cations intrinsèques telles que des luxations
intraprothétiques et une usure prématurée du
polyéthylène. Nous ne retenons donc le poly-
* Service chirurgie orthopédique et
traumatologie, clinique Saint-André,
Vandœuvre-lès-Nancy.

TrIBUNE
La Lettre du Rhumatologue • N° 353 - juin 2009 | 37
éthylène que dans sa forme la plus simple et la
plus ancienne : reprenant le principe de Charnley
en 22 mm, le polyéthylène est scellé dans un
manteau de ciment, dont le diamètre articulaire
est le plus petit possible.
Quid des nouveaux biomatériaux ?
Certains auteurs parlent beaucoup des nouveaux
polyéthylènes dits “hautement réticulés”. Mal-
heureusement, à ce jour, les résultats ne sont
pas homogènes. En effet, certains explants mon-
trent un comportement in vivo moins satisfaisant
que ne le laissaient présager les travaux in vitro ;
d’autres expériences, plus optimistes, considè-
rent que la diminution de l’usure de ces nouveaux
polyéthylènes est d’environ 30 % par rapport aux
polyéthylènes “classiques”, ce qui ne met pas à
l’abri de cette redoutable complication qu’est
le granulome à corps étranger, si ostéolytique.
Nous ne saurons donc que dans 15 ou 20 ans
si ces nouveaux polyéthylènes offrent les pro-
priétés espérées.
Aujourd’hui, les céramiques d’oxyde d’alumi-
nium offrent 35 ans d’expérience favorable en
termes de biocompatibilité, et, depuis une quin-
zaine d’ années, les procédés de fabrication sont
extrêmement fiables, d’autant que les diamètres
des têtes vont croissant et que ceux des néo-cols
fémoraux en titane s’affinent. Le risque d’ébré-
chage par conflit entre le col et l’insert cotyloï-
dien s’éloigne donc.
L’utilisation du couple céramique-céramique
nous permet d’éliminer les granulomes à corps
étranger. Ils sont en effet exceptionnels avec
la céramique ; le volume libéré est très faible,
l’usure étant d’environ un micron par an, et
les débris n’ont pour l’instant fait courir aucun
risque, contrairement à ce qui a pu être observé
lors de l’usure de couples métal-métal avec la
libération d’ions métalliques.
Le risque d’ostéolyse périprothétique par gra-
nulome ostéolytique est maîtrisé au mieux
par l’utilisation de couples céramique d’alu-
mine. La solidité de ces implants reste toute-
fois à discuter : le taux de rupture actuel est de
1/ 10 000 lorsqu’ils sont bien mis en place. Cette
compli cation est donc rare et trouve sa solution
thérapeutique dans l’utilisation de nouvelles
têtes céramiques avec jupes en titane, dont la
résistance est améliorée par un fort pourcen-
tage d’oxyde de zirconium, et qui permettent
de laisser en place les implants sans ciment fixés
par ostéo-intégration.
En effet, chez la grande majorité des patients,
le choix d’un couple céramique-céramique est
associé à l’implantation de tiges et de cotyles
sans ciment. Cette philosophie arthroplastique
a pour but d’éviter les polymères – et donc le
ciment, qui est un polymétacrylate de méthyle –,
ces derniers ayant l’inconvénient majeur de pour-
suivre leur polymérisation en vieillissant, ce qui
modifie leurs propriétés biomécaniques et peut
aboutir à la rupture.
Le défi à relever passe donc par l’implantation de
prothèses au fort potentiel d’ostéo- intégration
par repousse osseuse, grâce à un état de surface
dont les caractéristiques actuelles sont bien
connues. Le matériau idéal au niveau de la
hanche est le titane ; son module de Young est
en effet celui qui se rapproche le plus de l’os.
Les traitements de surface peuvent être obtenus
par une couche poreuse en titane, à laquelle peut
être ajouté un revêtement d’hydroxy apatite
favorisant l’ostéo- intégration – qui, à long terme,
passe toujours par la repousse dans le métal
poreux (100 à 400 microns).
Des études scientifiques récentes permettent
de déterminer les formes idéales des implants
pour une repousse osseuse satisfaisante, tout en
évitant l’accumulation de contraintes souvent
distales, qui aboutissent sur certains dessins à
ce que est appelé le “stress-shielding”, soit une
ostéopénie proximale.
Conclusion
La question que l’on peut se poser aujourd’hui,
compte tenu de l’expérience acquise avec des
concepts éprouvés par le temps, ne serait-elle
pas : une meilleure formation des jeunes chirur-
giens et une certaine modestie des aînés n’offri-
raient-elles pas des résultats plus satisfaisants à
nos patients ? ■
1
/
2
100%