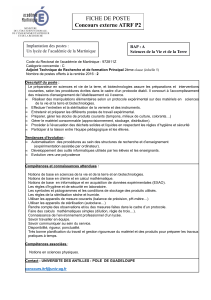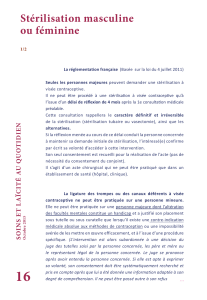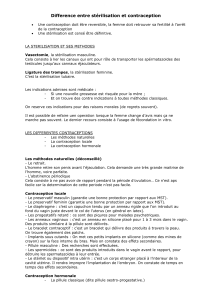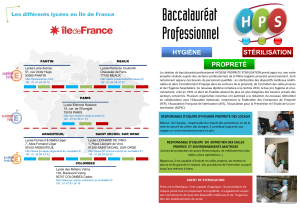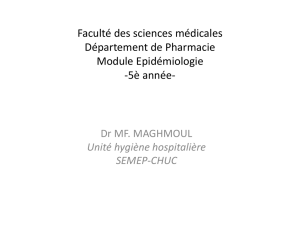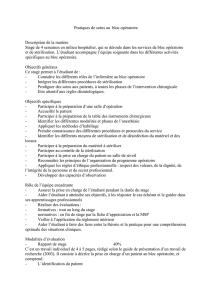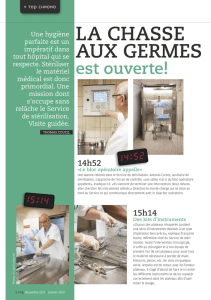DOSSIER
32
La Lettre du Gynécologue - n° 253 - juin 2000
u titre choisi découle une première affirmation : la
stérilisation est indéniablement l’une des nom-
breuses méthodes contraceptives disponibles,
qu’elle soit féminine (tubaire) ou masculine (vasectomie).
À l’époque où l’on voit se multiplier des prises de position
autoritaires, aboutissant à la “quasi”-interdiction de la pratique
des stérilisations tubaires par diverses instances administra-
tives ou professionnelles, il me semble qu’il est grand temps
de clarifier la situation afin de permettre aux praticiens de
poursuivre, tout au moins, leur devoir d’apporter des soins
dans le cadre d’interventions honnêtement réfléchies sur des
bases médicales.
Mes propos porteront surtout sur la stérilisation féminine, qui
reste au centre du débat, la stérilisation masculine n’étant que
peu discutée, même dans les pays où elle est plus largement
pratiquée, probablement du fait du moindre risque qui y est lié.
LA STÉRILISATION TUBAIRE EST
UNE MÉTHODE CONTRACEPTIVE...
... assez largement pratiquée
Ce constat s’impose si l’on se reporte aux résultats de
l’enquête “cœliochirurgie gynécologique en France, instantané
1996” menée pour la Société française d’endoscopie gynécolo-
gique, ainsi qu’aux données encore plus actualisées du réseau
constitué au sein de cette même société (1). En effet, la stérili-
sation tubaire représente environ 15 % de l’activité cœliochi-
rurgicale de la gynécologie en France, soit un peu moins de
10 % de l’ensemble de l’activité chirurgicale effectuée sur
l’appareil génital pelvien par les gynécologues (dix actes par
opérateur et par an en moyenne). Si l’on rapporte ces chiffres à
une dimension nationale en y incluant un certain nombre
d’actes effectués par les chirurgiens viscéraux entre autres, le
nombre de stérilisations tubaires effectuées en France chaque
année est de 30 à 40 000, et ce à une période où certains opéra-
teurs ont abandonné ou se voient interdire ce type d’interven-
tions au sein des établissements où ils pratiquent ! Des don-
nées encore plus actualisées seront d’ailleurs disponibles dans
le courant de l’année, lorsque l’exploitation des résultats de
l’enquête nationale, menée en décembre 1999, sera terminée.
Sans être plus affirmatif, des données préliminaires (et donc
partielles) tendent à faire penser que la part relative de la stéri-
lisation tubaire est en baisse par rapport à l’activité chirurgi-
cale, si l’on compare les premiers chiffres de 1999 à ceux de
1996. Cela renforcerait l’intérêt de la tentative de clarification
en cours sur le sujet, qui ne pourra être que bénéfique.
La pratique de la vasectomie est beaucoup plus anecdotique
en France, bien que nous ne disposions pas d’évaluations
précises.
... largement débattue
Le débat porte d’ailleurs plus sur le fond que sur la forme.
Ainsi, des prises de position éthiques et juridiques ont été
régulièrement élaborées et diffusées. De façon non exhaustive,
et pour ne citer que les plus récentes et notables :
– Rapport du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) en
1996 (2) qui, tout en constatant la “difficulté d’accès de cer-
tains patients à une stérilisation contraceptive”, n’est pas allé
jusqu’à dire que cet accès peut parfois être médicalement justi-
fié, mais a conclu en présentant l’éventail des possibilités, de
la stérilisation à “seule nécessité thérapeutique” jusqu’à celle à
but contraceptif. Ne souhaitant pas prendre part aux choix, qui
reste du rôle de la société, et ne relève pas de sa compétence,
le CCNE a déjà, à l’époque, posé “l’exigence d’un cadre per-
mettant une information précise sur la procédure et ses risques,
un consentement et une prise de décision éclairée de la per-
sonne concernée par l’intervention”. Notons que c’était avant
“l’avalanche” jurisprudentielle sur l’information des patients !
– Avis de la Cour de cassation du 6 juillet 1998, si souvent
cité, et probablement moins “péjoratif” qu’il n’y paraît, si l’on
retient que l’intervention n’est prohibée par l’article 16-3 du
Code civil que si l’intervention est pratiquée “... en dehors de
toute nécessité thérapeutique...”. Encore faut-il rappeler que,
dans les dernières décennies, il y a manifestement eu une évo-
lution de ce que l’on appelle la nécessité thérapeutique. En
effet, penserait-on, en 2000, qu’il est raisonnable de remettre
en question la prise en charge de soins à but fonctionnel dont
l’objectif est de corriger un certain nombre de difficultés ren-
contrées dans la vie familiale, professionnelle ou sociale de
nos contemporains ? Qui songerait à remettre en question la
prise en charge d’une incontinence urinaire d’effort permettant
à une patiente de reprendre certaines activités sportives ou
d’éviter des situations socialement gênantes ? Qui compren-
drait que l’on intervienne sur un utérus myomateux, non pas
lorsqu’il occasionne une gêne, mais seulement lorsqu’il se
complique ? Et, pour sortir du domaine gynécologique, pense-
rait-on à remettre en question la réalisation d’une otoplastie
La stérilisation comme méthode contraceptive
●F. Pierre*
* CHU, 350, avenue Jacques-Cœur, 86021 Poitiers cedex.
D

correctrice (d’ailleurs mentionnée dans la nomenclature), pour
peu, bien sûr, qu’elle soit la réponse médicale adaptée à une
gêne sociale ? Les exemples sont multiples et variés, dans le
cadre de la pratique médicale actuelle.
... qui doit être défendue
Un certain nombre de professionnels ont, par des échanges
impliquant, entre autres, le Conseil national de l’Ordre des
médecins et le Collège national des gynécologues et obstétri-
ciens français, insisté sur le fait qu’une récente modification
législative pouvait avoir un retentissement éventuel sur la
“reconnaissance de la stérilisation volontaire à but contraceptif
comme acte médical”. En effet, la loi n° 99-641 du 28 juillet
1999, portant création de la couverture maladie universelle,
stipule, dans son article 70, que “dans le premier alinéa de
l’article 16.3 du Code civil, le mot ‘thérapeutique’ est rem-
placé par le mot ‘médicale’”. Bien que cet article 16-3 – rédigé
dans le chapitre “Du respect du corps humain” du Code civil, à
laquelle de nombreux auteurs ayant pris position sur la stérili-
sation font régulièrement référence – n’ait pas été élaboré spé-
cifiquement pour la stérilisation, mais pour les soins médicaux
en général, et que cette modification ne change pas les prin-
cipes de l’appréciation d’une démarche médicale, cette prise
de position exprime bien la volonté d’accepter que la réflexion
sur le choix et la prescription d’une contraception, quelle
qu’elle soit, puisse être une démarche de soin, un acte médical.
L’action menée actuellement devrait donc permettre aux
couples d’avoir, dans un contexte comparable, un accès simi-
laire et équitable aux différentes méthodes sans se trouver
confrontés à des réserves ou oppositions uniquement fondées
sur une perception personnelle négative de la part du (ou des)
médecin(s) consulté(s).
... mais dont le choix devra aussi être pesé
La stérilisation fait donc partie d’un “arsenal” contraceptif, et
quel que soit le contexte de sa demande, elle devra être mise
en balance avec les méthodes contraceptives les plus clas-
siques et diffusées (méthodes hormonales, dispositifs intra-uté-
rins). Le devoir “d’information et de conseil” qui s’impose au
praticien prend alors toute sa valeur.
Les prises de position extrêmes ont été nombreuses, et nous ne
reviendrons pas sur les débats partisans quels qu’ils soient.
Cependant, à l’époque où la charge de la preuve de l’informa-
tion incombe à l’opérateur, comment un praticien pourra-t-il
défendre (malgré des écrits, même complets, paraphés ou non)
le choix d’une méthode opératoire dont le risque de complica-
tions graves est, dans les publications les plus récentes, estimé
à environ 1 pour 1 000 (3), plutôt que celui d’une méthode
contraceptive plus simple et moins invasive (contraception
orale ou dispositif intra-utérin) pour laquelle la patiente
n’aurait pas de contre-indication ?
Ce n’est, d’ailleurs, que dans le contexte de contre-indications
médicales aux contraceptions les plus usuelles que les risques
graves de celles-ci ou d’une absence de contraception efficace
s’équilibrent avec ceux encourus lors d’une stérilisation
tubaire.
Prenons quelques exemples de la pratique contraceptive quoti-
dienne pour mettre en valeur les orientations qu’impose ce
devoir d’information et de conseil :
– Prescririez-vous une contraception estroprogestative à une
femme à risque accentué de thrombose, qui, de plus, peut dis-
poser d’une autre méthode contraceptive moins dangereuse ?
Non, bien sûr, et ce même si elle vous suppliait de le faire, car
elle ne “supporte” pas les dispositifs intra-utérins. Vous vous
emploieriez à la convaincre du bien-fondé des options vers les-
quelles vous tentez de l’orienter, en restant dans le cadre de sa
demande d’une contraception fiable. Alors, n’en sera-t-il pas
de même face à une patiente qui souhaite une stérilisation
tubaire, mais n’a pas de contre-indication à la pilule ou au sté-
rilet ?
– Accepteriez-vous encore d’appliquer aveuglément une
méthode censée être irréversible (ou “mal” réversible) à une
femme de moins de 35 ans, alors qu’elle exprime une demande
fondée sur sa perception actuelle de son équilibre génital ?
Non, car il est clair, à la lecture de la littérature sur le sujet,
que le risque de regret est d’autant plus élevé que la femme est
jeune, que son dernier enfant n’est pas âgé, et qu’elle va refaire
sa vie (… mais cela n’est pas, ou rarement, prévisible).
EN PRATIQUE
Il existe, de façon indéniable, des éléments de réflexion qui
plaident en faveur de la poursuite d’une pratique médicalement
justifiée et raisonnablement réfléchie.
Il reste à en poser, très clairement pour tous, les bases, afin de
ne pas laisser les patientes se diriger, “par manque de clair-
voyance”, vers des impasses qu’elles regretteraient ultérieure-
ment, et qui leur imposeraient une prise en charge thérapeu-
tique lourde et exposée à des échecs, alors très mal vécus.
C’est ainsi que, dans une population nord-américaine, dans
une enquête rétrospective sur plus de 11 000 patientes ayant
subi une stérilisation tubaire, le taux de regret (dans les
14 années suivant la stérilisation), qui s’élevait à 20,3 % chez
les femmes stérilisées avant 30 ans, atteignait aussi 5,9 % chez
celles stérilisées au-delà de 30 ans (4). On peut regretter de ne
pas disposer d’informations plus précises pour des tranches
d’âge plus étroites sur une telle cohorte, mais de tels résultats
doivent inciter à une information exhaustive, très détaillée,
compréhensible et adaptée chez les patientes demandeuses
d’une stérilisation. Un article destiné au personnel paramédical
anglo-saxon me semble particulièrement bien synthétiser ces
éléments de bonne pratique, en insistant, entre autres, sur les
points suivants : “… Aborder et expliquer les autres méthodes
de contraception courantes disponibles ; évaluer l’intérêt réel
et le fait que la patiente y soit vraiment préparée… ; insister
sur le caractère définitif de la méthode, mais aussi ses possibi-
lités d’échec ; bien expliquer la technique chirurgicale utilisée
(de façon explicite et imagée), et y intégrer la notion
bénéfice/risques ; s’assurer du recueil d’un consentement bien
éclairé…” (5).
Ainsi, si l’on se reporte aux derniers travaux collaboratifs
nord-américains, la possibilité de survenue d’une grossesse
33
La Lettre du Gynécologue - n° 253 - juin 2000

DOSSIER
34
La Lettre du Gynécologue - n° 253 - juin 2000
après stérilisation tubaire serait plus élevée que les chiffres
classiquement annoncés, puisqu’elle serait de 1 à 4 % selon la
méthode employée (6).
À l’heure de la validation, par tous les régimes jurispruden-
tiels, du principe du renversement de la charge de la preuve en
termes d’information sur les soins médicaux prodigués, il y a
changement de “donne”… N’oublions pas, de plus, que ces
recommandations de prudence proviennent d’un pays où la
stérilisation est pourtant, de loin, la méthode contraceptive la
plus utilisée (3), et qu’elles avaient déjà été énumérées de
manière formalisée, sous l’éclairage des premières prises de
position de Raoul Palmer (7).
CONCLUSION
La concertation sur la stérilisation tubaire se poursuit entre dif-
férentes instances professionnelles représentatives. En atten-
dant une issue à ce débat qui se prolonge, il me semble diffi-
cile de ne pas pouvoir poursuivre une pratique chirurgicale
bien pesée, dans le cadre d’une démarche médicale qui se doit,
comme pour toute intervention, de privilégier l’information
honnête et complète sur les alternatives moins risquées, et le
délai de réflexion, qui semble indispensable dans une situation
où il n’y a jamais d’urgence.
Le débat de société ne doit pas rester cantonné à la stérilisation
tubaire, mais s’élargir à la stérilisation en général, comme le
suggèrent le rapport du CCNE (1) ainsi que les plus récentes
mises au point sur le sujet (3).
Enfin, rappelons que le cas de chaque patient reste, comme
pour toute décision médicale, l’objet d’une évaluation indivi-
duelle, et que le rôle du médecin est, tout en prenant en compte
la demande du patient, de le guider dans son choix, par une
information honnête, classiquement “loyale, claire, et appro-
priée”, qui ne doit pas laisser de place à des décisions hâtives
et inconsidérées, surtout dans un contexte dénué de toute
urgence. C’est le devoir de conseil du médecin, qui ne doit pas
s’effacer derrière le devoir d’information actuellement omni-
présent et prédominant. ■
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. De Poncheville L, Chapron C, Pierre F. A nationwide enquiry on gynaecolo-
gic laparoscopic activity. Human Reprod 2000 ; 15 : sous presse.
2. CCNE. La stérilisation envisagée comme mode de contraception définitive.
Rapport n° 50 du 3 avril 1996.
3. Hendrix NW, Chauhan SP, Morrison JC. Sterilization and its consequences.
Obstet Gynecol Surv 1999 ; 54 : 766-77.
4. Hillis SD, Marchbanks PA, Tylor LR, Peterson HB. Poststerilization regret :
findings from the United States Collaborative Review of Sterilization. Obstet
Gynecol 1999 ; 93 : 889-95.
5. Haws JM, Butta PG, Girvin S. A comprehensive and efficient process for
counseling patients desiring sterilization. Nurse Pract 1997 ; 22 : 52.
6. Peterson HB, Xia Z, Hugues JM et al. The risk of pregnancy after tubal steri-
lization : findings from the United States Collaborative Review of Sterilization.
Am J Obstet Gynecol 1996 ; 174 : 1161-70.
7. Pierre F, Soutoul JH, Fabre H, Gombault N. L’indispensable nécessité d’un
accord après information en vue d’une stérilisation tubaire féminine. J Gynecol
Obstet Biol Reprod 1995 ; 24 : 71-2.
À tous nos lecteurs, à tous nos abonnés...
La Lettre du Gynécologue
vous souhaite un bel été
et vous remercie de votre soutien.
Le prochain numéro paraîtra en septembre.
1
/
3
100%