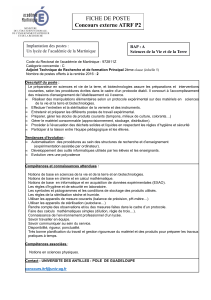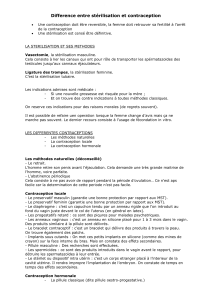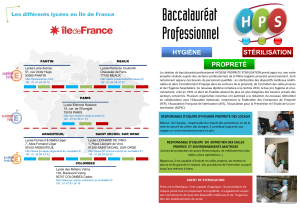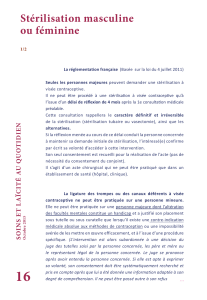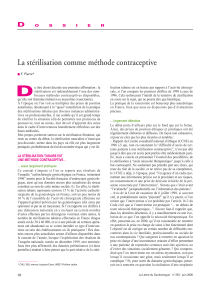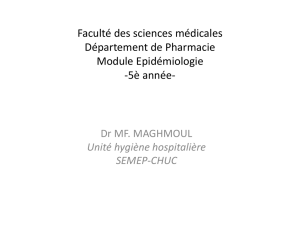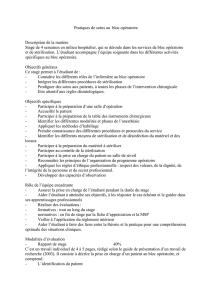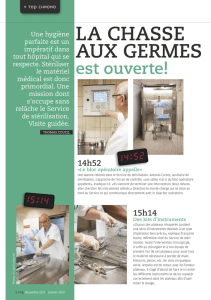L Stérilisation tubaire : ce qui a changé d

La Lettre du Gynécologue - n ° 328-329 - janvier-février 2008
dossier
dossier
15
Stérilisation tubaire : ce qui a changé
Tubal sterilization: what has changed
IP P. Panel*, P. This * et **
* Service de gynécologie obstétrique, hôpital de Versailles, 177, rue de Versailles, 78157 Le
Chesnay Cedex.
** Institut Curie, 26, rue d’Ulm, 75231 Paris Cedex 05.
Le 4 juillet 2001, l’Assemblée nationale votait en catimini,
au cours d’une séance de nuit et en lien avec une loi mo-
difiant la pratique de l’IVG, les dispositions autorisant la
pratique de la stérilisation tubaire (ST). Six ans après, faisons
le bilan de ce que cela a modifié.
Le premier constat est qu’aucun chiffre national officiel n’existe
pour estimer quantitativement cette pratique. Pourtant, ce n’est
pas faute d’alimenter consciencieusement la CCAM (Classifica-
tion commune des actes médicaux) en codes divers et variés de
plus en plus précis.
Le deuxième est que les femmes sont encore relativement peu
et mal informées de l’existence de cette loi et de son contenu,
comme on peut facilement s’en rendre compte en visitant les
forums de discussion sur Internet.
Le troisième est que nombre de médecins sont encore réticents
à accéder à la demande de leurs patientes qui, “de bouche à
oreille”, ont entendu dire que cela était possible.
“Vous êtes trop jeune” est le leitmotiv communément rapporté
et ce quel que soit l’âge de la patiente. “Vous n’avez qu’un ou
deux enfants” est le second leitmotiv, comme si le chiffre trois
avait un caractère magique. Certes, d’après les résultats d’une
enquête permanente sur les conditions de vie auprès de 2 600
hommes et femmes âgés de 15 ans à 45 ans, menée en colla-
boration entre l’INSEE (Institut national de la statistique et
des études économiques) et l’INED (Institut national d’études
démographiques), on retiendra que le nombre “idéal” d’en-
fants est plutôt de trois (2,6 en moyenne), qu’il est supérieur au
renouvellement des générations, mais qu’il présente un écart de
0,37 enfant en moyenne par famille par rapport à la réalité (2,23
en moyenne) [1].
Surtout, les études sur le sujet nous ont appris le fréquent regret
de “l’enfant de plus”. La problématique n’est donc pas quanti-
tative mais bien celle du “deuil” de la fertilité. Trop souvent
encore, notre approche est plus “médico-technique” que “psy-
chosociologique”. Trop souvent, les médecins que nous sommes
transposent, à leur insu, leurs propres représentations, histoi-
res, frustrations, pour accorder ou non de façon régalienne leur
blanc-seing à cette stérilisation.
Et c’est bien cela que la loi a profondément changé. Car, avant
la loi, les médecins qui pratiquaient ces ST devaient nécessaire-
ment se “couvrir” et donc limiter les indications qu’ils posaient,
comme peuvent être posées des indications de césariennes, en
y associant plus ou moins la femme concernée. Même si leur
démarche procédait d’une bonne intention, la crainte du procès
les conduisait bien souvent à décider seuls “en leur âme et/ou
conscience” ce qui était bon où non pour leurs patientes.
Avant 2001, la pratique réalisée, malgré son caractère illégal,
était somme toute relativement importante – de l’ordre de
40 000 par an. Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE),
dans son avis du 3 avril 1996, notait déjà : “Certaines personnes
qui souhaiteraient avoir accès à une stérilisation contraceptive
rencontrent des difficultés car l’état du droit leur interdit cette
possibilité ; en revanche, d’autres personnes, souvent vulnéra-
bles, n’ont aucune demande de stérilisation, mais se la voient
proposée dans des conditions discutables quant à leur consen-
tement. Par ailleurs, certains chirurgiens pratiquent des inter-
ventions aux conséquences stérilisantes, qui répondent bien à
la condition légale d’une nécessité thérapeutique, sans respec-
ter toujours l’exigence d’une information et d’un consentement
préalables.” Le CCNE constatait : “qu’un manque de clarté
quant à l’état du droit en vigueur se traduit dans la pratique par
des conceptions divergentes de ce qui est acceptable en matière
de stérilisation” et en concluait : “que cet état de fait appelle un
débat de société sur les situations dans lesquelles on peut esti-
mer que la suppression de la capacité de procréer est morale-
ment acceptable” (2).
Certes, le 27 juillet 1999, l’article 16-3 du code civil avait été
modifié par l’article 70 de la loi n° 99-641. À l’adjectif “théra-
peutique”, qui pouvait prêter à interprétation restrictive, a été
substitué l’adjectif “médical” : “Il ne peut être porté atteinte à
l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale
pour la personne.”
Certes, dans un rapport adopté le 18 avril 2000, l’Académie de
médecine et le conseil de l’ordre avaient entrouvert la porte :
“Pour des raisons médicales précises, le médecin peut être
amené à porter l’indication d’une telle contraception, qu’il y ait
une demande initiale du patient ou que sa situation conduise à
le lui proposer” (3).
Cependant, paradoxalement, le caractère limitatif de cette loi
et de cet avis, donnait au médecin le pouvoir absolu de décider,
suivant ses représentions psychosociales, ses alibis médicaux et
éventuellement son humeur du moment, de réaliser ou non ce
geste. Certains praticiens (de ceux pour qui braver un interdit
constitue un devoir moral) pouvaient effectuer ce geste de façon
“militante”, sans percevoir que cela renforçait avant tout leur
ego et leur sentiment de toute puissance. D’autres praticiens

La Lettre du Gynécologue - n ° 328-329 - janvier-février 2008
dossier
dossier
16
pouvaient pratiquer une ST, car tel ou tel problème médical
(antécédent thromboembolique, cardiovasculaire et même une
troisième césarienne) rendait, de leur point de vue, une nou-
velle grossesse trop dangereuse, sans toujours prendre le temps
suffisant pour écouter les patientes (ou les couples) concerné(e)s
et les aider à discerner ce que cela impliquait pour eux.
Au fond, qui sommes-nous pour juger de tout cela ? C’est bien
cela que la loi de 2001 a changé : la pratique en la matière ne doit
plus se situer dans le domaine de la toute puissance médicale,
mais bien dans celui de l’information, de l’accompagnement, de
la révélation des préférences, de la décision médicale partagée.
Cette révolution dans l’exercice de la médecine n’est pas nou-
velle et a été ouverte par les patients atteints du virus du sida.
Clairement, cette loi marque un tournant éthique dans le
domaine de la gynécologie, et ouvre une ère nouvelle dans notre
pratique.
D’autre part, en 2008, un autre changement va faire tomber le
deuxième rempart derrière lequel pouvaient encore se retran-
cher certains praticiens, celui des indications restrictives de la
méthode ESSURE. En effet, l’avis du 12 mai 2004 de la com-
mission d’évaluation des produits et prestations de la Haute
Autorité de Santé (HAS) stipulait dans ses recommandations
à la rubrique “indications” que cette méthode s’adressait aux
“femmes désirant une stérilisation permanente et pour lesquel-
les l’abord cœlioscopique est risqué (pathologies cardiaques,
maladies thromboemboliques, obésité…)” (4).
Ainsi, cela pouvait finalement se traduire par un refus médi-
cal “déguisé” si, par ailleurs, la ST cœlioscopique était présen-
tée sous un jour peu fiable (1,5 % de grossesse) et dangereux (1
décès pour 40 000). Le 31 octobre 2007, l’HAS s’est prononcée
de la façon suivante : cette méthode peut être proposée aux
“femmes majeures en âge de procréer souhaitant une stérilisa-
tion tubaire permanente comme moyen de contraception défi-
nitive et irréversible”. L’avis de la commission précise : “ESSURE
présente un intérêt pour la santé publique dans la prévention
des grossesses non désirées” et encore : “Chez la femme autour
ou après 40 ans, ESSURE peut être proposé comme technique
de stérilisation en première intention” (5).
À l’heure où l’Institut national pour la prévention et l’éducation
pour la santé (INPES) lance une grande campagne d’informa-
tion au slogan non équivoque : “La meilleure contraception,
c’est celle que l’on choisit” (6), il est grand temps de considérer
que la ST fait effectivement partie de l’arsenal contraceptif, per-
manent birth control disent les Anglo-Saxons, et que ce choix
revient à la patiente.
Bien évidemment, comme le souligne l’HAS dans ses recom-
mandations de décembre 2004 sur les Stratégies de choix
des méthodes contraceptives chez la femme : “Il est recom-
mandé de n’envisager cette méthode chez les femmes jeunes
ou nullipares qu’avec la plus grande réserve et la plus grande
précaution” et “il est recommandé d’évoquer de manière sys-
tématique avec la femme qui envisage cette méthode le risque
de regret potentiel et d’explorer avec elle ses motivations et son
désir d’enfant” (7).
Bien sûr, Il faut parfois du temps avant d’envisager une ST, et
parfois aussi l’aide d’un psychologue, mais tous les acteurs en
sortent grandis. Au-delà de l’information et de l’éclairage, il
s’agit de redonner aux femmes tous les éléments et les clés du
processus décisionnel.
n
RéféRences bibliogRaphiques
1. Le Voyer AC. Les processus menant au désir d’enfant en France. Dossiers et
Recherches, INED, septembre 1998, n° 75. http://www.caf.fr/web/WebCnaf.nsf/
090ba6646193ccc8c125684f005898f3/05783a834ef8f96cc125730f0047b03f/
$FILE/RP64-1-CCrepin.pdf
2. Comité consultatif national d’éthique. Rapport sur la stérilisation envisagée
comme mode de contraception définitive. 3 avril 1996, n° 50. http://www.ccne-
ethique.fr/docs/fr/avis050.pdf
3. Académie nationale de médecine. Stérilisation chirurgicale et article 16-3
du code civil. Rapport adopté le 18 avril 2000. http://www.academie-medecine.
fr/detailPublication.cfm?idRub=26&idLigne=135
4. Haute Autorité de Santé. ESSURE ESS 202, dispositif pour stérilisation tu-
baire par voie hystéroscopique. Avis de la commission d’évaluation des produits
et prestations. 12 mai 2004. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/ap-
plication/pdf/pp020246.pdf
5. Haute Autorité de Santé. ESSURE, dispositif pour stérilisation tubaire par
voie hystéroscopique. Avis de la commission d’évaluation des produits et pres-
tations. 31 octobre 2007. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/applica-
tion/pdf/cepp-1359essure.pdf
6. http://www.choisirsacontraception.fr/
7. Recommandations professionnelles de l’HAS. Stratégies de choix des métho-
des contraceptives chez la femme. Décembre 2004. http://www.has-sante.fr/por-
tail/upload/docs/application/pdf/recommandations_contraception_vvd-2006.
pdf
Les articles publiés dans “La Lettre du Gynécologue” le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Tous droits de reproduction, d'adaptation et de traduction
par tous procédés réservés pour tous pays.
EDIMARK SAS © mai 1983 -
Imprimé en France - Differdange SAS - Sannois -
Dépôt légal : à parution
1
/
2
100%