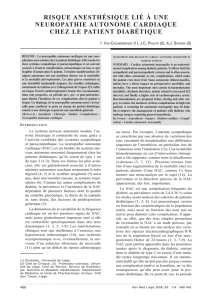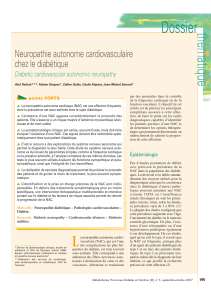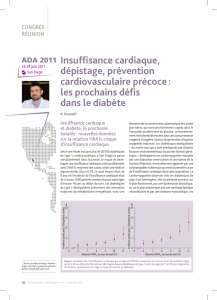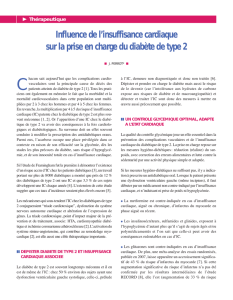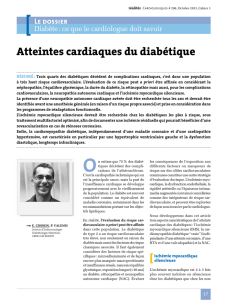Rôle du système nerveux autonome dans la régulation énergétique Nouvelles réfl exions

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVII - n° 6 - juin 2013
175175
dossier thématique
do
do
do
do
o
ssss
ss
s
s
s
s
ie
i
ie
i
r
r
r
r
r
r
th
th
t
th
th
ém
ém
ém
ém
ém
m
m
ém
at
a
at
at
t
a
iq
i
iq
q
q
q
ue
ue
ue
e
ue
e
e
e
e
e
e
e
e
Nouvelles réfl exions
sur l’obésité
et ses complications
Rôle du système nerveux autonome
dans la régulation énergétique
et les complications cardiovasculaires
Role of the autonomic nervous system in energy regulation and
cardiovascular complications
Paul Valensi*
* Service d’endocrinologie,
diabétologie, nutrition,
université Paris-Nord
(AP-HP), hôpital Jean-
Verdier, centre de
recherche en nutrition
humaine (CRNH) d’Île-de-
France, centre intégré
nord-francilien de prise
en charge de l’obésité
de l’adulte et de l’enfant
(CINFO), Bondy.
points forts
Highlights
»
Les altérations les plus précoces du système nerveux autonome
consistent chez les obèses et les diabétiques en une réduction
de l’activité vagale cardiaque.
»
Le déséquilibre de la balance vagosympathique au profi t de
l’activité sympathique peut résulter de l’insulinorésistance mais
peut aussi y contribuer.
»
L’augmentation de l’activité sympathique à l’état basal chez
les obèses devrait limiter la prise de poids, mais la “réserve
sympathique” mobilisable sous l’infl uence de diff érents stimuli
est réduite.
»
La neuropathie autonome cardiaque (NAC) est un marqueur de
risque de mortalité totale et de mortalité cardiaque.
»
Le déséquilibre vagosympathique peut être impliqué dans
diff érentes altérations cardiovasculaires associées à la NAC.
»
Les mesures hygiénodiététiques permettent chez l’obèse
de récupérer une bonne activité vagale, d’abaisser le tonus
sympathique au repos et de restaurer sa réactivité.
»
Le contrôle glycémique, en association avec le contrôle
lipidique et tensionnel chez les diabétiques de type 2 prévient
la dégradation de l’activité vagale, mais l’hypoglycémie doit être
évitée, en particulier chez les patients ayant une NAC et chez
les coronariens.
Mots-clés : Système nerveux autonome – Activité sympathique –
Activité vagale – Thermogenèse – Diabète – Obésité – Complications
cardiovasculaires – Hypertension.
In the obese and diabetic patients the earliest alteration of
the autonomic nervous system consists in the reduction of
cardiac vagal activity.
The changes in vago-sympathetic balance in favor of an
increase in sympathetic activity may result from insulin
resistance but may also contribute to aggravate insulin
resistance.
The increase in sympathetic activity at rest in the obese
individuals should reduce weight gain but “sympathetic
reserve” in response to various stimuli is reduced.
Cardiac autonomic neuropathy (CAN) is a marker of all-cause
and cardiac mortality.
The impairment of vago-sympathetic balance may be
involved in various cardiovascular changes associated with
CAN.
Lifestyle improvement is able in obese individuals to restore
a good vagal activity, to lower sympathetic tone at rest and
to restore sympathetic reactivity.
The multifactorial control of blood glucose, lipids and
blood pressure in type 2 diabetic patients prevents vagal
degradation but hypoglycemia must be avoided in particular
in patients with CAN and in coronary patients.
Keywords: Autonomic nervous system – Sympathetic
activity – Vagal activity – Thermogenesis – Diabetes – Obesity
– Cardiovascular complications – Hypertension.
L
e système nerveux autonome joue un rôle dans
l’homéostasie énergétique et l’utilisation des
substrats. Une dysfonction autonome cardiaque
(DAC) est fréquemment rencontrée chez les patients
obèses ou diabétiques. Le déséquilibre de la balance
vagosympathique contribue aux désordres métabo-
liques chez des individus en excès de poids et a des
conséquences potentiellement sévères chez les patients
obèses ou diabétiques. Il contribue aussi à altérer le
pronostic cardiovasculaire par diff érents mécanismes.
Il est possible de rétablir l’équilibre de la balance vago-
sympathique par des mesures hygiénodiététiques chez

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVII - n° 6 - juin 2013
176176
dossier thématique
do
do
d
d
d
d
do
d
d
d
o
d
d
d
d
d
d
d
s
ss
s
s
s
s
ss
ss
ss
s
s
ss
ie
e
ie
e
r
r
th
th
th
th
th
é
ém
m
ém
m
é
ém
é
at
at
a
at
t
t
iqiq
q
q
q
i
i
ue
ue
ue
ue
u
Nouvelles réfl exions
sur l’obésité
et ses complications
Figure 1. Relations entre déséquilibre de la balance vagosympathique et insulinorésistance.
Obésité
Insulinorésistance
Syndrome métabolique
Altérations de l’activité du système nerveux autonome
Réduction de l’activité vagale
Prédominance sympathique
Acides gras
libres, insuline,
stress oxydant,
autres signaux
hormonaux et
nutritionnels
les patients obèses et de prévenir cette complication
ou sa progression chez les patients diabétiques.
Altération de la balance vagosympathique
chez le patient obèse
Les altérations les plus précoces du système nerveux
autonome consistent, chez les patients obèses ou diabé-
tiques, en une réduction de l’activité vagale cardiaque.
Cette anomalie asymptomatique, qui peut être détectée
par des épreuves standard examinant les variations de
la fréquence cardiaque, aff ecte plus de 20 % des patients
obèses non diabétiques (1). Cette prévalence est aussi
élevée que chez les patients diabétiques (2). Le rôle de
l’excès de poids a été retrouvé comme un déterminant
de l’altération des variations de la fréquence cardiaque
dans la cohorte DESIR (3).
Chez les patients obèses, l’activité vagale cardiaque
est encore plus fortement altérée en présence d’un
syndrome métabolique, et l’augmentation de l’adiposité
abdominale est associée à une plus forte activité sympa-
thique (4). Ainsi, l’augmentation relative de l’activité du
système nerveux sympathique au détriment de l’activité
vagale est associée aux désordres métaboliques (5).
Relations entre altérations de la balance vago-
sympathique et insulinorésistance
Ces relations sont complexes, la DAC pouvant résulter
de l’insulinorésistance mais pouvant aussi y contribuer
(fi gure 1).
En faveur du rôle de l’insulinorésistance et de l’hyper-
insulinisme secondaire dans l’apparition d’une DAC,
rappelons qu’il a été montré, par le clamp hyperinsuli-
nique euglycémique, que l’insuline est capable d’activer
le système sympathique et de déprimer l’activité para-
sympathique. L’hyperinsulinisme associé à l’augmenta-
tion de la graisse abdominale peut ainsi participer au
déséquilibre vagosympathique en faveur d’une acti-
vité sympathique prédominante. L’hyperleptinémie
peut également y concourir, de même que le défaut
d’adiponectine (6). Cependant, chez les sujets insuli-
norésistants comme chez les diabétiques de type 2,
l’hyperinsulinisme chronique semble limiter l’activation
sympathique observée au cours du clamp. Une telle
limitation de l’activation sympathique a été rapportée
au cours d’autres épreuves chez les obèses et chez les
diabétiques de type 2 (7-9), suggérant une réduction
de la réserve sympathique lorsque l’activité sympa-
thique est élevée à l’état basal. Cette réduction de la
réponse sympathique pourrait résulter de défauts de
transport de l’insuline à travers la barrière hématoencé-
phalique (10).
Cependant, la DAC peut précéder l’insulinorésis-
tance (11). Chez les sujets en surpoids, l’oxydation des
glucides n’est négativement corrélée à l’insulinémie
que chez ceux ayant une altération vagale, ce qui sug-
gère qu’une insulinorésistance plus sévère pourrait
résulter de l’hyperactivité sympathique (12). L’analyse
spectrale permet d’évaluer la balance sympathovagale
par le rapport des pics de basse et de haute fréquences
(LF/HF) des variations de fréquence cardiaque. Une
corrélation négative a été rapportée entre l’utilisation
du glucose et le rapport LF/HF, ce qui indique que l’uti-
lisation du glucose est réduite lorsque l’activité sym-
pathique est relativement élevée (13). La réduction de
l’oxydation lipidique après une charge orale en glucose
est plus marquée chez les patients obèses ayant une
faible activité vagale, ce qui suggère qu’un défaut de
la réponse sympathique au glucose pourrait contri-
buer à la réduction plus ample de l’oxydation lipidique
postprandiale (14). L’hypothèse du rôle du déséquilibre
vagosympathique au profi t d’une activité sympathique
prédominante dans l’aggravation de l’insulinorésis-
tance, la réduction de l’insulinosécrétion et l’élévation
glycémique est soutenue par d’autres observations.
La progression vers le diabète de type 2 est associée
à une augmentation de l’activité sympathique, à une
réduction de la réactivité sympathique et à une alté-
ration de la fi xation tissulaire de la noradrénaline (7).
Dans le Diabetes Prevention Program, une fréquence
cardiaque plus élevée, témoignant probablement du
déséquilibre vagosympathique, prédisait la survenue
d’un diabète (15). Enfi n, nous avons récemment montré
que, chez des patients obèses à risque élevé de diabète,

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVII - n° 6 - juin 2013
177177
Rôle du système nerveux autonome dans la régulation
énergétique et les complications cardiovasculaires
Figure 2. Évolution de l’activité vagale et sympathique au cours des états prédiabétiques
et du diabète de type 2.
Obésité, syndrome
métabolique,
prédiabète
Hypertension
Hyperactivité sympathique relative
mais défaut de “réserve sympathique”
Défi cit sympathique tardif
associé au défi cit vagal
Élévation tensionnelle, rigidité artérielle,
hypertrophie ventriculaire gauche,
allongement du QT
Hypotension orthostatique
ou postprandiale
Diabète : rôle principal de l’hyperglycémie
Sympathique
Parasympathique
Zone d’activité normale
Figure 3. Conséquences cardiovasculaires du déséquilibre de la balance vagosympathique.
Hypertension
Non dipping
Rigidité artérielle
Ischémie
myocardique
silencieuse
Hypertrophie
ventriculaire
gauche
Dysfonction
VG
Réduction de la
réserve coronaire
Intolérance
à l’eff ort Arythmie
Complications cardiovasculaires
Altérations de l’activité du système nerveux autonome
Réduction de l’activité vagale
Prédominance sympathique
selon le score Findrisc (Finnish Diabetes Risk Score), les
anomalies glycémiques étaient plus fréquentes chez
les patients ayant un défi cit vagal cardiaque.
Relations entre altérations de la balance
vagosympathique et métabolisme énergétique
L’augmentation de l’activité sympathique à l’état
basal chez les patients obèses devrait permettre de
contribuer au maintien de la dépense énergétique et
de l’oxydation lipidique et de limiter la prise de poids.
Toutefois, la moindre réactivité sympathique évoquée
plus haut peut limiter ces eff ets favorables. En accord
avec ce phénomène, il a été observé qu’une bonne
activité sympathique de repos et une bonne réacti-
vité lors d’une charge orale en glucose permettent de
prédire une perte de poids plus ample sous restriction
énergétique (16), de même qu’après la réalisation d’un
court-circuit gastro-intestinal (17).
L’homéostasie énergétique et le comportement ali-
mentaire sont bien sûr complexes, fi nement modulés
par des signaux périphériques hormonaux et nutrition-
nels impliquant, outre l’insuline, la leptine et l’adipo-
nectine, la ghréline, d’autres hormones digestives, le
glucose et les acides gras, signaux détectés par des
neurones hypo thalamiques spécialisés (18). Le rôle de
ces signaux et des mécanismes de leur intervention
doit être clarifi é et pourrait ouvrir de nouvelles voies
thérapeutiques dans le traitement de l’obésité et du
diabète de type 2 (19).
Neuropathie autonome cardiaque
et complications cardiovasculaires
Chez les diabétiques de type 2, la neuropathie auto-
nome cardiaque (NAC) est un marqueur de risque de
mortalité totale et de mortalité cardiaque, d’accident
vasculaire cérébral, d’accident coronarien, d’ischémie
myocardique silencieuse, de dysfonction ventriculaire
gauche, d’arythmie et de progression vers la néphro-
pathie (20). En particulier, dans l’étude ACCORD, la NAC
était prédictive d’une augmentation de la mortalité
totale et de la mortalité cardiaque, indépendamment
des facteurs de risque traditionnels (21). Diff érents méca-
nismes peuvent rendre compte des complications car-
diovasculaires associées à la NAC et conduisent à en faire
un authentique facteur de risque cardiovas culaire (20).
Au cours du diabète de type 2, l’activité vagale est sou-
vent réduite dès la découverte de la maladie, ce qui est
cohérent avec la présence de ce trouble dans l’obésité
précédant ce diabète et avec le rôle de l’excès de graisse
abdominale, et l’activité sympathique est alors prédo-
minante (fi gure 2). Ce déséquilibre vagosympathique
peut être impliqué dans diff érentes altérations cardio-
vasculaires associées à la NAC (fi gure 3).
L’hypertension artérielle peut être favorisée par ce désé-
quilibre. Selon des données expérimentales dans un
modèle animal d’obésité massive, l’activité vagale peut
être considérée comme protectrice contre l’hyperten-
sion associée à l’obésité (22). Chez les diabétiques de
type 1 ou de type 2, nous avons rapporté une préva-
lence d’hypertension croissant avec la sévérité du défi cit
vagal (23). De même, nous avons récemment observé

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVII - n° 6 - juin 2013
178178
dossier thématique
do
do
d
d
d
d
do
d
d
d
o
d
d
d
d
d
d
d
s
ss
s
s
s
s
ss
ss
ss
s
s
ss
ie
e
ie
e
r
r
th
th
th
th
th
é
ém
m
ém
m
é
ém
é
at
at
a
at
t
t
iqiq
q
q
q
i
i
ue
ue
ue
ue
u
Nouvelles réfl exions
sur l’obésité
et ses complications
une corrélation entre la sévérité du défi cit vagal et la
prévalence de l’hypertension chez les patients obèses
non diabétiques. En outre, une forte proportion de
patients diabétiques ayant des complications macro-
ou microvasculaires présentent le profi l combinant
NAC et hypertension (23). Ainsi la NAC ajouterait des
eff ets délétères sur l’hémodynamique et la structure
vasculaire à ceux induits par l’hypertension.
La NAC est associée à des altérations du profi l nyc-
théméral de pression artérielle par sa contribution à
la suppression du “dipping” (baisse tensionnelle) noc-
turne et au “reverse dipping” (élévation tensionnelle)
[24] et peut, par ce mécanisme, favoriser l’hypertrophie
ventriculaire gauche.
La NAC est également associée à une augmentation
de la rigidité artérielle (25, 26).
La tachycardie permanente est une manifestation
classique mais rare de la NAC, témoignant encore de
l’altération vagale et de l’hyperactivité sympathique.
L’allongement de l’intervalle QT sur l’électrocardio-
gramme, rapporté il y a fort longtemps chez les dia-
bétiques présentant une NAC, peut également résulter
du déséquilibre vagosympathique et accroître le risque
d’arythmie grave (27). L’enregistrement électrocardio-
graphique pendant 24 heures nous a montré que la
modulation nycthémérale de la relation entre QT et
RR était altérée chez des patients diabétiques présen-
tant une NAC, l’intervalle QT devenant plus long la nuit
que le jour pour une fréquence cardiaque donnée (28).
La mesure de l’intervalle QT peut donc servir à la stra-
tifi cation du risque cardiovasculaire. Rappelons que
l’intervalle QT peut s’allonger au cours d’une hypo-
glycémie. Ainsi, la présence d’une NAC pourrait iden-
tifi er des diabétiques plus exposés aux eff ets néfastes
de l’hypoglycémie, en particulier chez ceux d’entre eux
atteints de maladie coronaire. La détection d’une NAC
peut ainsi servir à affi ner l’objectif glycémique selon le
profi l de risque du patient et à peser les avantages et les
risques liés à un traitement antidiabétique agressif (20).
Les infarctus du myocarde silencieux représentent 1/3
des infarctus chez les patients diabétiques (29). Une
méta-analyse a montré que la prévalence de l’ischémie
myocardique silencieuse est 2 fois plus élevée chez
les patients présentant une NAC (30). En outre, la NAC
aggrave le pronostic des patients ayant une ischémie
myocardique silencieuse (31).
La NAC peut rendre compte d’une altération de la
réponse hémodynamique et de la tolérance à l’eff ort. En
particulier, la fréquence cardiaque maximale atteinte au
cours de l’exercice est réduite, et nous avons également
observé une réduction de la récupération cardiaque
après l’exercice. Il peut être important de prendre en
compte ces données au cours d’une épreuve d’eff ort
et d’un programme de réadaptation physique.
Enfi n, une altération de la fonction contractile et de la
fonction diastolique du ventricule gauche a été rap-
portée chez les patients présentant une NAC (32, 33).
Nous avons récemment observé une altération plus
marquée de la fonction systolique chez les patients
cumulant NAC et ischémie myocardique silencieuse.
Quant à l’hypotension orthostatique survenant en
l’absence d’hypovolémie et de facteurs iatrogènes, elle
constitue une complication classique de la NAC : une
NAC sévère avec atteinte sympathique survenant à un
stade tardif de la maladie diabétique et s’ajoutant à l’at-
teinte vagale (fi gure 2). Il en est de même de l’hypoten-
sion postprandiale, qui peut rendre compte de certains
malaises indépendants de toute hypoglycémie ou d’un
éventuel dumping syndrome. L’hypotension orthostatique
et l’hypotension postprandiale peuvent être mises sur
le compte d’une NAC une fois que l’on a vérifi é que les
épreuves standard reposant sur l’analyse des variations de
la fréquence cardiaque sont eff ectivement altérées (20).
Comment prévenir la dysfonction
autonome cardiaque et son aggravation ?
Dans le Diabetes Prevention Program, les indices de fonc-
tion autonomique se sont améliorés chez les sujets
prédiabétiques randomisés dans le bras d’intervention
hygiénodiététique visant à réduire le poids et à augmen-
ter l’activité physique (15). Chez des sujets en surpoids,
la perte pondérale obtenue par restriction calorique
combinée à l’exercice physique améliore la balance
vagosympathique en restaurant l’activité vagale, en
réduisant l’activité sympathique et en restaurant la
réactivité sympathique (34).
Le rôle du déséquilibre glycémique est largement mon-
tré dans la détérioration de l’activité vagale. Chez les
patients diabétiques de type 1, le DCCT (Diabetes Control
and Complications Trial) a montré que le contrôle gly-
cémique renforcé est capable de réduire l’incidence
de la NAC, et le résultat favorable s’est maintenu au
cours de la période d’observation suivant la fin de
l’étude EDIC (Epidemiology of Diabetes Intervention and
Complications) [35]. Selon l’étude Steno-2, une interven-
tion multifactorielle intensifi ée visant le contrôle glycé-
mique, lipidique et tensionnel est capable de prévenir
l’apparition d’une NAC chez les patients diabétiques
de type 2 (36).
L’obtention d’un équilibre glycémique renforcé implique
une augmentation du risque d’hypoglycémie. En activant
le système sympathique, une hypoglycémie peut induire

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVII - n° 6 - juin 2013
179179
Figure 4. Risque cardiovasculaire pendant une hypoglycémie : eff ets additionnels de l’insuline
et d’une neuropathie autonome cardiaque (NAC).
NAC Hypoglycémie
Hyperactivité sympathique
Arythmie cardiaque
Allongement du QT
fréquence et débit cardiaques,
résistances périphériques
pression artérielle
Insuline
1. Valensi P, Thi BN, Lormeau B, Pariès J, Attali JR. Cardiac
autonomic function in obese patients. Int J Obes Relat Metab
Disord 1995;19(2):113-8.
2.
Valensi P, Pariès J, Attali JR; French Group for Research and
Study of Diabetic Neuropathy. Cardiac autonomic neuropathy
in diabetic patients: infl uence of diabetes duration, obesity,
and microangiopathic complications–the French multicenter
study. Metabolism 2003;52(7):815-20.
3. Valensi P, Extramiana F, Lange C et al.; DESIR Study Group.
Infl uence of blood glucose on heart rate and cardiac autono-
mic function. The DESIR study. Diabet Med 2011;28(4):440-9.
4. Grassi G, Dell’Oro R, Facchini A, Quarti Trevano F, Bolla GB,
Mancia G. Eff ect of central and peripheral body fat distribution
on sympathetic and barorefl ex function in obese normoten-
sives. J Hypertens 2004;22(12):2363-9.
5. Licht CM, Vreeburg SA, van Reedt Dortland AK et al. Increased
sympathetic and decreased parasympathetic activity rather
than changes in hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity
is associated with metabolic abnormalities. J Clin Endocrinol
Références
Rôle du système nerveux autonome dans la régulation
énergétique et les complications cardiovasculaires
L’auteur déclare
ne pas avoir
de liens d’intérêts.
>>>
une élévation tensionnelle, un allongement du QT, une
réduction de la réserve coronaire et une augmentation
du travail cardiaque. Mais les hypoglycémies sont suscep-
tibles de modifi er le fonctionnement du système nerveux
autonome cardiovasculaire et d’avoir des conséquences
sur les réponses survenant au cours d’hypoglycémies
ultérieures. Il a été montré chez des sujets sains qu’un
clamp hypoglycémique de 2 heures à 0,50 g/l peut altérer
l’activité sympathique mesurée 16 heures plus tard (37).
Un tel mécanisme peut contribuer à la survenue d’autres
hypoglycémies et à l’absence de perception d’hypogly-
cémies récurrentes. Ce concept de défaillance autono-
mique associée aux hypoglycémies répétées est soutenu
par la récupération de la réponse adrénergique et de
la perception des hypoglycémies après 2 à 3 semaines
d’éviction totale des hypoglycémies (38).
Ainsi, l’activité sympathique déjà exagérée aux stades
initiaux de la NAC peut se trouver amplifi ée au cours
d’une hypoglycémie et peut-être encore davantage
chez le patient insulinotraité, créant des conditions sus-
ceptibles d’accroître le risque arythmogène (fi gure 4).
L’hypoglycémie doit particulièrement être évitée
lorsqu’une NAC a été mise en évidence, surtout chez
un patient coronarien.
Comme nous l’avons évoqué plus haut, l’insuline réduit
l’activité vagale et amplifi e l’activité sympathique. Des
études expérimentales indiquent que le GLP-1 aurait les
mêmes eff ets. Une étude récente suggère que le GLP-1
pourrait eff ectivement réduire l’activité vagale chez
l’homme (39). L’accélération de la fréquence cardiaque
de l’ordre de 3 battements par minute en moyenne
observée au cours de plusieurs essais cliniques menés
avec des analogues du GLP-1 résulterait de cette dépres-
sion vagale et peut-être d’une activation sympathique.
Toutefois, ces eff ets de l’insuline et du GLP-1 pourraient
diff érer selon le statut autonomique (40).
Conclusion
Si le maintien d’une bonne activité sympathique est
favorable sur le plan énergétique chez le patient obèse
et contribue à la contre-régulation en situation d’hypo-
glycémie, l’augmentation de l’activité sympathique
semble jouer un rôle dans l’insulinorésistance et le
développement d’un diabète de type 2. Conjuguée à
un défi cit vagal, l’hyperactivité sympathique peut être
impliquée dans de nombreuses altérations cardiovas-
culaires et dans l’altération du pronostic des diabé-
tiques. Les mesures hygiénodiététiques permettent,
chez le patient obèse, de récupérer une balance
vagosympathique normale caractérisée par le main-
tien d’une bonne activité vagale, la baisse de l’activité
sympathique au repos et la restauration de sa réactivité
au cours du stress. Le contrôle glycémique, en asso-
ciation avec le contrôle lipidique et tensionnel chez
les diabétiques de type 2, prévient la dégradation de
l’activité vagale, mais l’hypoglycémie doit être évitée,
en particulier chez les patients présentant une NAC et
chez les patients coronariens. ■
 6
6
1
/
6
100%