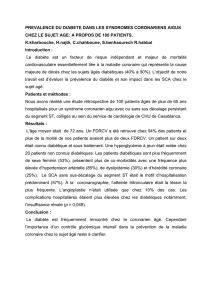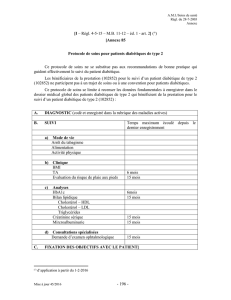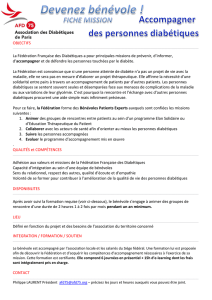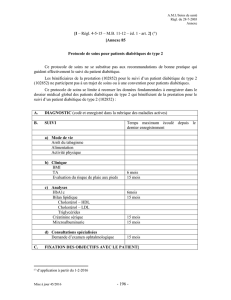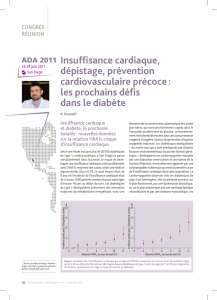5 Diabetes & Cardiovascular Disease Association for the Study of Diabetes

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVII - n° 2 - février 2013
8
Échos des congrès
© Valerijs Kostreckis
5e réunion annuelle du groupe Diabetes
& Cardiovascular Disease de l’European
Association for the Study of Diabetes
Paris, 15-17 novembre 2012
Emmanuel Cosson*
*Service diabétologie
endocrinologie nutrition,
pôle spécialités médico-
chirurgicales à orientation
digestive et métabolique,
CHU Jean-Verdier, Bondy.
Le présent compte rendu est le lieu d’une sélection issue des excellentes présen-
tations de la 5e réunion annuelle du groupe Diabetes & Cardiovascular Disease
(D&CVD) de l’European Association for the Study of Diabetes (EASD). Le congrès,
dont l’organisation a été présidée par Paul Valensi, s’est déroulé à Paris du 15 au 17
novembre 2012 et a réuni plus de 120 spécialistes mondiaux. Les communications
ont donné lieu à un numéro spécial de Diabetes & Metabolism (2012, special issue 5),
qui comprend 27 présentations d’orateurs invités (Invited Speakers Presentations
[ISP]), 13 présentations orales (OP) et 31 présentations affichées (P).
Ces journées étaient passionnantes. Elles ont permis de faire avancer notre réflexion
sur l’optimisation des soins apportés à nos patients diabétiques. Leur pronostic
s’est particulièrement amélioré grâce à notre prise en charge préventive, plus
précoce et multifactorielle. Ils gardent cependant un risque résiduel. Le résumé
devrait vous aider à améliorer votre pratique et à entrevoir les possibilités d’avenir.
Comment mieux évaluer le risque
de nos patients ?
Utiliser de nouvelles équations de risque
L’évaluation du risque par des scores anciens créés à partir
de la population générale (Framingham) ou de diabétiques
de type 2 (UKPDS risk score) apparaît dépassée. F. Travers a
rapporté le score créé plus récemment, à l’ère du traitement
optimisé, à partir de l’étude ADVANCE. Dix critères sont pris
en compte et pondérés dans l’équation : âge au diagnostic,
durée du diabète, sexe, pression pulsée, hypertension
traitée, fibrillation auriculaire, rétinopathie, HbA1c, néph-
ropathie et LDL-cholestérol (Kengne A.P. Eur J Cardiovasc
Prev Rehabil 2011:393). De façon assez surprenante, ni le
tabagisme, ni le traitement, ni l’origine, ni le pays n’étaient
prédictifs d’événements cardiovasculaires (ISP10. Travert F.,
Paris). Ce score a été validé dans la cohorte DIABHYCAR.
Préciser, et éventuellement reclassifier,
le risque de nos patients en allant au-delà
des équations de risque
Des marqueurs supplémentaires peuvent être utiles
pour mieux catégoriser le risque des diabétiques, avec
même une éventuelle recatégorisation de leur risque.
Par exemple, des patients ayant un score de Framingham
élevé, mais un score de calcification coronaire (CAC)
inférieur à 100 en tomodensitométrie ont en fait un
pronostic aussi bon que des patients ayant un score de
Framingham bas (Erbel R. J Am Coll Cardiol 2010:1397).
Une même stratification peut également être utilisée
avec une protéine C réactive supérieure ou égale à 3 (ISP4.
Möhlenkamp S., Moers, Allemagne), une épaisseur intima
media augmentée (Bernard S. Diabetes Care 2005:1158),
la présence d’une neuropathie autonome cardiaque
(Pop-Bosui R. Diabetes Care 2010:1578) ou d’une rigidité
artérielle plus forte (ISP11. Valensi P., Bondy). L’ischémie
myocardique silencieuse est également un marqueur de
risque cardiovasculaire indépendant du risque a priori
(Cosson E. et al. Diabetes Care 2011:2101).
Le syndrome d’apnée du sommeil (SAS) pourrait éga-
lement être un marqueur pronostique. S. Möhlenkamp
a rapporté que SAS et obésité étaient associés au CAC
score, mais que l’association pour le SAS disparaissait
cependant après ajustement sur les facteurs de risque
cardiovasculaire (ISP4. Möhlenkamp S., Moers, Allemagne).

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVII - n° 2 - février 2013
9
5e réunion annuelle du groupe Diabetes & Cardiovascular Disease
de l’European Association for the Study of Diabetes
Le SAS pourrait lui-même être impliqué dans la pathophy-
siologie du syndrome métabolique. Il est probable que
l’hypoxie répétée au niveau du tissu adipeux conduise
à une réponse inflammatoire augmentée, à un stress
oxydant, avec une activation du système nerveux sym-
pathique et des modifications des adipocytokines. Enfin,
l’axe hypothalamohypophysaire corticotrope est proba-
blement modifié par les réveils nocturnes et la fragmen-
tation du sommeil (ISP5. Wilding J., Liverpool, Angleterre).
Utiliser de nouveaux outils
Marqueurs biologiques
Dans une étude cas-témoins réalisée chez des diabé-
tiques de type 2, les niveaux de LDL oxydées étaient
plus élevés en cas de coronaropathie (OP3. Rajkovic N.,
Belgrade, Serbie). La fibuline 1 est une protéine de
la matrice extracellulaire (Cangemi C. et al. Clin Chem
2011:1556) dont la concentration au niveau de la paroi
artérielle et dans le sérum des diabétiques est augmen-
tée. Des taux augmentés sont également associés à la
rigidité artérielle et à une surmortalité (OP4. Rasmussen
L.M., Esberg, Danemark).
Échographie-doppler cardiaque
transthoracique
La vélocité du flux coronaire peut maintenant être
étudiée par doppler transthoracique, à l’état basal
et après une épreuve physiologique stimulant le sys-
tème sympathique, le test au froid. Les altérations
du flux après test au froid sont associées à l’ischémie
myocardique silencieuse (ISP6. Cosson E., Bondy) et
à la neuropathie autonome cardiaque (P20. Nguyen
M.T., Bondy). La faisabilité est d’environ 60 %, et cet
examen qui explore directement la microcirculation
coronaire n’est utilisable que pour des études phy-
siopathologiques. L’échographie peut actuellement
évaluer les phénomènes de torsion au niveau du
ventricule gauche. La torsion est augmentée chez les
diabétiques de type 2. La neuropathie autonome car-
diaque, les anomalies de la microcirculation – mais pas
le métabolisme énergétique mitochondrial – semblent
impliquées dans son développement (OP11. Kuehl M.,
Birmingham, Angleterre). La dysfonction diastolique a
été retrouvée particulièrement souvent (57,2 %) chez
des diabétiques de type 2 dont les pressions artérielles
étaient contrôlées et indemnes de valvulopathie ou
de coronaropathie connue. Les déterminants en sont
l’âge et la rétinopathie. La dysfonction systolique est
moins fréquente (26 %) et associée dans 2/3 des cas
à la dysfonction diastolique. Ses déterminants sont
le sexe masculin, l’indice de masse corporelle et la
pression artérielle systolique (OP12. Decker-Bellaton
A., Bron). Dans une étude épidémiologique italienne
prospective (DYDA) incluant des diabétiques de type 2
de plus de 45 ans sans cardiopathie connue (Giorda
C.B. et al. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2011:415), les
prévalences des dysfonctions ventriculaires droite et
gauche étaient respectivement de 63,9 et 66,5 % ! Sur
un suivi de 2 ans, 16 % des patients avec dysfonction
ventriculaire gauche meurent ou sont hospitalisés,
essentiellement pour des raisons non cardiovasculaires
(ISP25. Giorda C., Turin, Italie).
Imagerie moléculaire (ISP26. Rouzet F., Paris)
La tomographie par émission de positons (PET) permet
de visualiser et de quantifier des processus biologiques
sur le plan moléculaire et cellulaire (revue dans Sinusas
A.J. et al. Circ Cardiovasc Imaging 2008;1:244). Son emploi
est encore limité, mais quelques études sont maintenant
disponibles à plus grande échelle, et on entrevoit une
utilisation afin de personnaliser les soins aux patients
suivant leur métabolisme. Par exemple, l’évaluation
de la réserve coronaire par PET, en intégrant à la fois
la dynamique des fluides au niveau des artères épicar-
diques et de la microcirculation, est un marqueur de
mortalité cardiaque, indépendant des facteurs de risque
cardiovasculaire (Murthy V.L. et al. Circulation 2011:2215).
L’étude du flux myocardique au repos et lors d’un stress
vasomoteur permet d’évaluer les altérations précoces de
la microcirculation, et pourrait identifier les patients les
plus à risque (Schindler T.H. et al. JACC Cardiovasc Imaging
2010:623). Enfin, l’activité métabolique au niveau de la
plaque d’athérosclérose peut être évaluée par PET en
utilisant comme marqueur le 18-fluorodésoxyglucose
(Fayad Z.A. et al. Lancet 2011:1547). L’utilisation à grande
échelle n’est pas encore possible en raison du coût de
la méthode et des conséquences de l’irradiation qui
doivent limiter cette exploration à certains patients dans
des indications précises. Enfin, l’étude de l’innervation
sympathique cardiaque grâce à la méta-iodo-benzyl-
guanidine marquée à l’iode 123 (Jacobson J. et al. Am Coll
Cardiol 2010:2212) pourrait permettre la sélection des
patients insuffisants cardiaques pouvant bénéficier
d’un défibrillateur implanté.
Améliorer encore les traitements
Comment lutter contre le risque résiduel, chez des patients
bien contrôlés pour leurs facteurs de risque ? En plus d’être
éventuellement plus incisifs, il faut bien sûr lutter contre
l’inertie thérapeutique, favoriser la compliance de nos
patients. Des points spécifiques ont également été déve-
loppés en termes de thérapeutique.

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVII - n° 2 - février 2013
10
Échos des congrès
Des choix éclairés,
une consultation dynamisée.
Pour vous et vos patients.
Contour® next USB de Bayer :
• Utilisation simple et intuitive guidée par des messages textuels.
• Journal électronique complet intégrant les glucides et l’insuline.
• Tendances et comptes rendus à consulter directement sur le lecteur ou sur l’ordinateur.
• Logiciel de gestion du diabète Glucofacts® Deluxe embarqué dans le lecteur.
Quand le design et l’innovation s’allient
pour optimiser l’autosurveillance glycémique.
Contour® next USB : Dispositif d’Auto Surveillance Glycémique (ASG) destiné aux patients diabétiques. Utilisation: le lecteur de glycémie Contour® next USB s’utilise avec les bandelettes réactives Contour® next. Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions fi gurant
dans le manuel d’utilisation du lecteur de glycémie et la notice des bandelettes réactives. L’ASG ne doit pas être une mesure automatiquement généralisée à l’ensemble des diabétiques ; ni une mesure passive, n’entraînant pas de conséquence thérapeutique immédiate. Fabricant:
Bayer Consumer Care AG (Suisse). Classi cation : DMDIV Liste B, conformément à l’annexe II de la Directive 98/79/CE. Organisme noti é : Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd (LRQA) - Identifi cation n°0088. Remboursement dans les limites suivantes au titre de la LPP : lecteur
(adulte : 1 / 4 ans - enfant : 2 / 4 ans), bandelettes réactives (200 / an pour DT2 non insulinodépendant).
ARSENAL-CDM - PP667047 - 01/2013 - Bayer Santé - 220 avenue de la Recherche - 59120 Loos - SIREN : 706 580 149 RCS Lille
FreCan
French
®
Système d’autosurveillance
glycémique
®
Système d’autosurveillance
glycémique
®
Bandelettes réactives
PP667047-Bayer AP USB 388x130-220113.indd 1 23/01/13 13:24
Traitement médical
Le fénofibrate a montré des résultats encourageants chez
les diabétiques dans la protection contre la microan-
giopathie et les événements cardiovasculaires chez les
diabétiques de type 2 avec dyslipidémie athérogène
(HDL-cholestérol bas et triglycérides élevés) ayant un
LDL-cholestérol à l’objectif thérapeutique (ISP11. Valensi
P., Bondy). Les nouvelles classes impliquant les voies des
incrétines apportent des résultats rassurants en termes
d’événements cardiovasculaires, avec, par exemple, une
réduction du risque (hazard-ratio = 0,36 [0,17-0,74]) sous
linagliptine par rapport au comparateur (placebo ou glimé-
piride ou voglibose) dans une méta-analyse (OP5. Johansen
O., Inghelheim, Allemagne). Il s’agit probablement d’un effet
de classe thérapeutique (ISP2. Avogaro A., Padoue, Italie).
Concernant les antiagrégants plaquettaires (ISP21. Gilard M.,
Brest), il n’y a pas de preuves de l’utilité de l’aspirine en pré-
vention primaire chez le diabétique. En outre, on observe
une résistance aux antiagrégants chez un grand nombre
de diabétiques (Angiolillo D. et al. Diabetes 2005:2430).
Notamment, la résistance à l’aspirine est due à un turno-
ver plaquettaire augmenté chez le diabétique, qui devrait
nous faire prescrire le traitement par aspirine en 2 prises par
jour (ISP23. Dillinger J.G., Bal dit Sollier C., Henry P., Drouet L.,
Paris). Malheureusement, il n’existe pas de tests utilisables
en routine pour évaluer cette résistance. Une dose standard
de prasugrel permet une meilleure inhibition plaquettaire
chez des diabétiques de type 2 traités par aspirine qu’une
double dose de clopidogrel (Angiolillo D.J. et al. Eur Heart J
2011:838). Enfin, l’efficacité du ticagrelor, un antagoniste
du récepteur P2Y, est meilleure que celle du clopidogrel
et réduit les événements cardio-vasculaires des patients
faisant un syndrome coronarien aigu, qu’ils soient dia-
bétiques ou non, sans augmentation de l’incidence des
hémorragies graves (James S. et al. Eur Heart J 2010:3006).
Revascularisation coronaire (ISP20. Varenne O.,
Paris)
La revascularisation coronaire est remise en cause par
rapport à un traitement médical multifactoriel intensifié,
notamment depuis l’étude COURAGE (Boden W.E. et al.
New Engl J Med 2007:1503) qui montrait des résultats
homogènes dans la population diabétique ou non, puis
l’étude BARI 2D, qui montrait que, dans une population
diabétique avec coronaropathie stable, les patients rele-
vant d’une angioplastie randomisés pour une angio-
plastie ou un traitement médical seul avaient le même
pronostic. En revanche, les patients avec indication de
pontage et randomisés dans le groupe revascularisa-
tion et pontés avaient un meilleur pronostic que ceux

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVII - n° 2 - février 2013
11
5e réunion annuelle du groupe Diabetes & Cardiovascular Disease
de l’European Association for the Study of Diabetes
Des choix éclairés,
une consultation dynamisée.
Pour vous et vos patients.
Contour® next USB de Bayer :
• Utilisation simple et intuitive guidée par des messages textuels.
• Journal électronique complet intégrant les glucides et l’insuline.
• Tendances et comptes rendus à consulter directement sur le lecteur ou sur l’ordinateur.
• Logiciel de gestion du diabète Glucofacts® Deluxe embarqué dans le lecteur.
Quand le design et l’innovation s’allient
pour optimiser l’autosurveillance glycémique.
Contour® next USB : Dispositif d’Auto Surveillance Glycémique (ASG) destiné aux patients diabétiques. Utilisation: le lecteur de glycémie Contour® next USB s’utilise avec les bandelettes réactives Contour® next. Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions fi gurant
dans le manuel d’utilisation du lecteur de glycémie et la notice des bandelettes réactives. L’ASG ne doit pas être une mesure automatiquement généralisée à l’ensemble des diabétiques ; ni une mesure passive, n’entraînant pas de conséquence thérapeutique immédiate. Fabricant:
Bayer Consumer Care AG (Suisse). Classi cation : DMDIV Liste B, conformément à l’annexe II de la Directive 98/79/CE. Organisme noti é : Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd (LRQA) - Identifi cation n°0088. Remboursement dans les limites suivantes au titre de la LPP : lecteur
(adulte : 1 / 4 ans - enfant : 2 / 4 ans), bandelettes réactives (200 / an pour DT2 non insulinodépendant).
ARSENAL-CDM - PP667047 - 01/2013 - Bayer Santé - 220 avenue de la Recherche - 59120 Loos - SIREN : 706 580 149 RCS Lille
FreCan
French
®
Système d’autosurveillance
glycémique
®
Système d’autosurveillance
glycémique
®
Bandelettes réactives
PP667047-Bayer AP USB 388x130-220113.indd 1 23/01/13 13:24
traités médicalement (Chaitman B.R. et al. Circulation
2009:2529). Les revascularisations permettaient toutefois
de réduire la symptomatologie, même après angioplas-
tie (Dagenais G. et al. Circulation 2011:1492). Depuis, les
angioplasties avec stent actif ont montré une meilleure
efficacité que les anciennes méthodes d’angioplastie
(Banning A.P. et al. J Am Coll Cardiol 2010:1067), avec
cependant un risque de thrombose plus important
qu’après pontage. L’étude FREEDOM, réalisée chez
des diabétiques de type 2 – dont 80 % présentaient
des lésions tritronculaires – et publiée très récemment
(Farkouh M.E. et al. N Engl J Med 2012:epub ahead of print),
a montré que les performances du pontage restaient
meilleures que celles de l’angioplastie avec stent actif.
Au final, en cas de lésion unique simple, le traitement
médical seul pourrait être envisagé ; en cas de lésions
multiples ou plus complexes, chez des patients opé-
rables, il faut actuellement privilégier les pontages. Dans
les autres cas, les angioplasties doivent être réalisées
avec stent actif et double antiagrégation.
La mise en pratique : un exemple pour finir
Considérons un patient diabétique de type 2 depuis
quelques années, avec hypertension artérielle et dysli-
pidémie traitées selon les standards actuels. Il présente,
en outre, une néphropathie, qui est associée à un risque
cardiovasculaire augmenté et à une plus forte préva-
lence d’ischémie myocardique silencieuse et de sténose
coronaire (OP2. Sanghoon S., Séoul, Corée), de même
que la présence d’une rétinopathie, le sexe masculin,
la présence d’une artériopathie périphérique (Cosson
E. et al. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2012:epub ahead of
print). On peut envisager la recherche d’une ischémie
myocardique silencieuse, qui reste un bon marqueur
de risque additionnel aux facteurs de risque conven-
tionnels (Young L. et al. JAMA 2009:1547; Cosson E. et al.
Diabetes Care 2011:2410). En cas de positivité, le traite-
ment médical pourra être encore intensifié : objectifs de
LDL-cholestérol plus bas encore, traitement par féno-
fibrate en cas de dyslipidémie athérogène persistante
après mesures hygiénodiététiques (ISP11. Valensi P.,
Bondy), coronarographie pour identifier des sténoses
coronaires qui pourront être revascularisées, au mieux
par pontage (Faglia E. et al. Am Heart J 2005:e1). Une
démarche active incluant le dépistage de l’ischémie
myocardique silencieuse et sa prise en charge spéci-
fique apparaît en effet efficace pour améliorer encore
le pronostic des diabétiques de type 2 (Gazzaruso C.
et al. Intern Emerg Med 2012:257). ■
1
/
4
100%