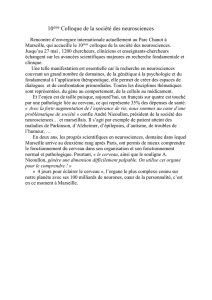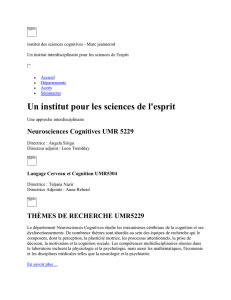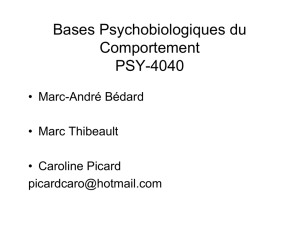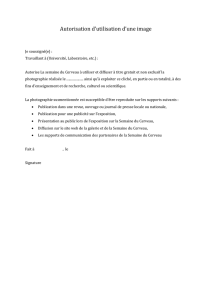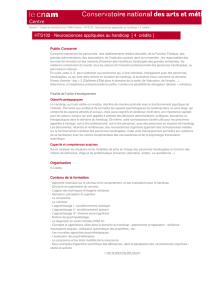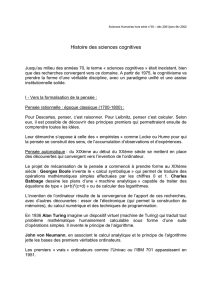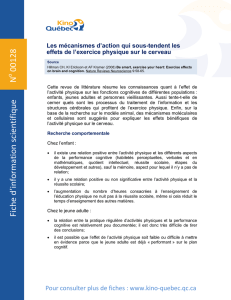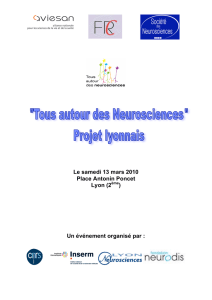Nécessité de croisement entre neurosciences et sciences humaines

Vous êtes ici :
Accueil> Territoire
> Nécessité de croisement entre neurosciences et sciences humaines
Nécessité de croisement entre neurosciences et
sciences humaines
INTERVIEW DE IRA NOVECK
<< ...nous apportons des données et des théories sur le langage aux neurosciences qui, en retour, nous donnent
des connaissances physiologiques sur le cerveau et des outils de mesure >>.
Interview de Ira Noveck, Chercheur à l’Institut des Sciences Cognitives (Laboratoire sur le Langage, Cognition et
Cerveau).
Dans les recherches sur le cerveau, l’interdisciplinarité apparaît comme nécessaire à une meilleure connaissance de
son fonctionnement. Ainsi le croisement entre les neurosciences et les sciences humaines apparaissent comme
nécessaires.
Réalisée par : Marianne CHOUTEAU
Tag(s) : Biotechnologie, SHS, Recherche, Sciences et société
Date : 23/02/2006
Comment les acquisitions de connaissances nouvelles en matière de neurosciences peuvent-elles s’articuler
avec les SHS ?
Les deux champs sont extrêmement vastes mais il y a effectivement des croisements. En neurosciences, par exemple, il
y a des chercheurs qui travaillent sur le neurone, sur ses fonctions, etc., et en SHS, des chercheurs peuvent s’intéresser
aux phénomènes linguistiques ou à l’acquisition des connaissances. Mais, le point de contact le plus évident entre des
disciplines purement scientifiques et des disciplines de sciences humaines et sociales est probablement la question du
langage. C’est en effet un domaine qui peut être étudié par un linguiste autant que par un sociolinguiste ou des
neurophysiologistes. Prenons exemple sur les recherches que nous menons ici. Nous nous intéressons à la linguistique
et aux différents niveaux d’appréciation d’un terme. Il y a en effet une distinction entre la sémantique – c’est-à-dire ce
que le terme veut dire – et la pragmatique – c’est-à-dire la façon dont on utilise le terme ou la phrase pour transmettre un
message. Ce qui nous intéresse ici c’est justement le contexte d’utilisation d’un terme ou d’une expression et la façon
dont ils sont reçus par le récepteur.Par exemple, nous travaillons sur la dimension logique qui rassemble le sens
sémantique et le sens pragmatique. Quand nous disons : « Certains enfants sont gardés par la nounou… », cela
implique un choix : ce n’est pas tous les enfants. C’est comme si l’expression « pas tous » était implicitement incluse
dans la phrase. On retrouve le même phénomène avec le terme « ou ». Lorsque l’on dit : « C’est ton papa ou ta maman
qui viendra te chercher à l’école », cela implique soit l’un soit l’autre, mais, si les deux viennent, la phrase reste juste.
C’est ce que l’on nomme des enrichissements de terme. Les adultes effectuent facilement ces enrichissements
contrairement aux enfants. Ces constations apportent des précisions non négligeables sur le fonctionnement du cerveau.
Précisions qui sont visibles d’un point de vue physiologique et qui peuvent être utiles pour la compréhension de certaines
maladies. Nous pouvons observer des choses qui sont ensuite visibles en neurophysiologie, par exemple en étudiant
l’activité cérébrale ou en tentant de mieux comprendre et mieux cerner certaines maladies.Par exemple, chez les

parkinsoniens : on observe qu’ils ont du mal à faire les enrichissements pragmatiques de la même manière qu’un sujet
sain. Il y a, à l’heure actuelle, des travaux assez connus sur des populations exceptionnelles, comme les autistes. Ces
enfants sont incapables d’apprécier des choses pragmatiques, c’est-à-dire d’aller au-delà du code linguistique d’une
phrase. Ils ont du mal avec la métaphore, l’ironie, car cela demande de l’interprétation. Ces populations sont un vivier
très intéressant pour nous, en tant que chercheur en sciences humaines. Par ailleurs, nos recherches permettent aussi
de mieux les comprendre.
En d’autres termes l’intersection entre les connaissances purement scientifiques et les connaissances sur le
langage permet une appréciation précise du fonctionnement du cerveau ?
En quelque sorte, oui. Nous pouvons avoir des données fines sur la façon dont les mots sont réceptionnés par les
individus. Par exemple, un verbe est traité différemment qu’un substantif. L’idée développée est qu’il y a dans le cerveau
des neurones miroirs qui résonnent l’action d’une autre personne. Par exemple, lorsqu’un singe voit son voisin qui
s’apprête à manger une banane, cela déclenche la même action au moins au niveau neuronal. Il y a donc un neurone
impliqué dans l’action qu’il voit qui se déclenche comme si c’était à lui d’agir.
Avec la neuro-imagerie, on peut pratiquement suivre l’activité neuronale au moment où une personne dit un mot. On a
constaté que la réaction n’était pas la même s’il s’agissait d’un verbe ou d’un substantif. On demande à un sujet
d’appuyer sur un bouton lorsqu’il entend un vrai mot. Mais on constate une légère hésitation – non perceptible à l’œil nu
mais détecté en neuro-imagerie – lorsque qu’on lui présente un verbe. Il y a une espèce d’interférence entre les deux
ordres donnés. Lorsque le sujet entend «saisir», ses neurones hésitent entre l’action de « saisir» et l’action d’appuyer sur
le bouton pour signifier qu’il s’agit d’un terme existant. Cette expérience nous permet de comprendre finement la façon
dont le langage est compris et conçu.
L’interdisciplinarité est donc nécessaire en matière de sciences cognitives ?
Elle est rendue fortement possible grâce à l’Institut des Sciences Cognitives qui rassemble dans un même lieu des
chercheurs de divers horizons. Aujourd’hui, les interactions existent dans la communauté des chercheurs en sciences
cognitives – par exemple, entre linguistes, psycholinguistes, etc. – et avec les neurosciences.
Mais chaque discipline a sa culture, sa méthodologie, ses concepts scientifiques, ce qui rend les interactions parfois
difficiles. La technologie est un moyen d’égaliser les choses car les machines ont leurs contraintes méthodologiques :
Par exemple, ici nous avons un projet pour étudier le raisonnement. Ce dernier utilise le Magneto-Encephalo-Graphe
(MEG) qui est installé au CERMEP, à Lyon, et qui est destiné à la recherche. Par ailleurs, nous avons à l’Institut des
Sciences Cognitives, un Electro-EncephaloGraphe (EEG) qui permet de détecter l’activité électrique au moment où notre
cerveau réceptionne ou émet une phrase, un mot, etc. Il nous faut trouver des expériences qui puissent à la fois utiliser
les contraintes de ces deux appareils.
Avec d’autres projets, nous avons également accès à l’IMRf, technique avec laquelle on capte précisément l’endroit où
se trouve l’activité dans les zones corticales mais où on ne détecte pas l’instant précis où elle apparaît.En d’autres
termes, chaque machine offre des perspectives différentes. Mais, pour avoir une bonne mesure, chaque machine
nécessite un nombre d’essais assez élevés. Cette contrainte déplait aux linguistes car la répétition rend l’acte
linguistique moins naturel. Dans ce type de démarche, il est intéressant de prendre en compte les allers-retours entre les
sciences. En tant que chercheurs à la jonction entre sciences de la vie et sciences humaines et sociales nous apportons
des données et des théories sur le langage aux neurosciences qui, en retour, nous donnent des connaissances
physiologiques sur le cerveau et des outils de mesure.
Cette interdisciplinarité touche-t-elle d’autres domaines que le langage ?
Certainement. Il y a, par exemple, une interaction entre les neurosciences et l’économie.
Ce qui est intéressant pour les sciences cognitives est justement qu’il existe ces interactions.
Autre exemple, cette fois-ci entre la génétique et les sciences cognitives. Nous avons ici, à l’Institut, un médecin
spécialiste de la génétique. Il a trouvé dans une sous-population de personnes des liens entre leur difficulté
d’apprentissage et une déformation génétique. Peu à peu, on trouve le lien entre les phénomènes de cognition et la
génétique. Cette vision génétique pourrait permettre de trouver des traitements pour des personnes qui ont des
difficultés cognitives et qui étaient, jusqu’à présent, traitées dans un même ensemble. Par exemple, aujourd’hui, on sait
distinguer les différentes formes d’autisme, on sait aussi mieux travailler sur les enfants atteints du syndrome de William
(qui donne aux individus un comportement inverse à celui des autistes).
Les neurosciences mettent beaucoup en avant le déterminisme. En tant que chercheur en sciences cognitives,
comment appréciez-vous ce mouvement ?
C’est une question complexe qui renvoie à la phrénologie du XIXe siècle. A l’époque, on avait proposé que des zones du
cerveau (et leur importance, indiquées par les bosses sur la tête) étaient responsables de telles ou telles capacités.
Cette théorie a été rejetée évidemment mais, aujourd’hui, on est dans la même mouvance avec la vision des zones
corticales. Toutefois, ce n’est pas parce que l’on sait qu’une zone peut-être responsable de la vision ou du langage, ou

qu’une autre est en charge de la prise de décision, que l’on comprend comment l’ensemble de ces zones s’articule et ce
qui va privilégier un choix plutôt qu’un autre. Comprendre mieux le fonctionnement de chaque région du cerveau ne va
pas forcément nous donner des réponses par rapport à cette question de déterminisme.
Est-ce pareil pour ce qui touche à l’âme, à la conscience ?
Aujourd’hui, le cerveau est vu comme un organe fonctionnel comme un autre : les yeux servent pour attraper le monde
visuel, le cerveau capte ces informations et les intègre. Le concept d’âme est un concept riche au niveau poétique mais
peut-être pas au niveau scientifique.
En tant qu’êtres humains, nous n’étions pas « préparés » à réfléchir. Nous étions programmés pour chasser, pour nous
reproduire. Toutefois, la société que nous avons créée nous a donné la possibilité de nous libérer des besoins vitaux :
les hommes occidentaux n’ont pas le souci de savoir quoi et quand chasser pour se nourrir. Cette libération a permis à
l’espèce humaine de réfléchir et de profiter des concepts qu’elle développe.
Le cerveau est un organe comme les autres qui traite l’information – cela nous renvoie d’emblée à la théorie de Noam
Chomsky qui voyait le langage comme quelque chose de naturel, comme un bras ou un cœur. Le langage n’est pas
quelque chose de construit, nous sommes nés avec la capacité d’apprendre le langage. L’idée est de dire que chaque
langue nécessite des paramètres et que nous développons les capacités de développer ces paramètres en fonction des
aspects culturels dans lesquels nous vivons.
1
/
3
100%