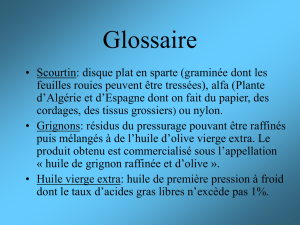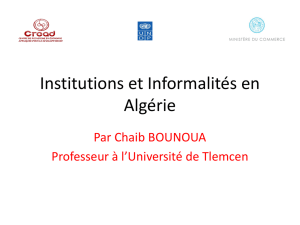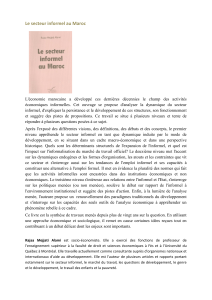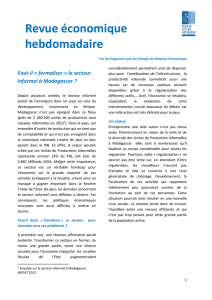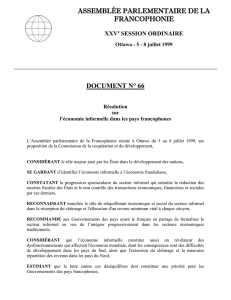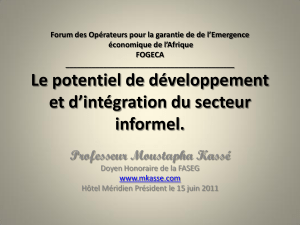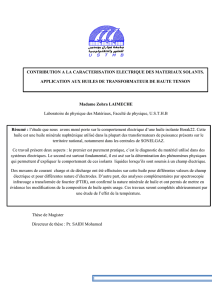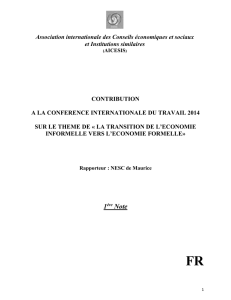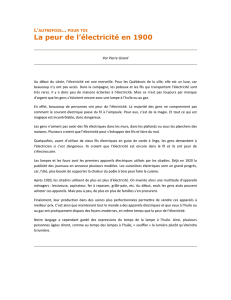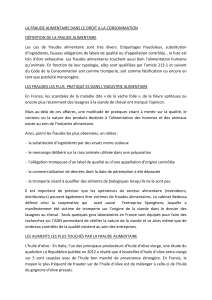La production du miel et de l’huile d’olive entre contre... cas d’un village de Ouaguenoun dans la wilaya de Tizi-Ouzou...

La production du miel et de l’huile d’olive entre contre façon et pratiques informelles :
cas d’un village de Ouaguenoun dans la wilaya de Tizi-Ouzou (Algérie)
Rosa Aknine-Soudi1, Naima Agharmiou-Rahmoun2, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou
Résumé
L’économie informelle, identifiée souvent aux milieux urbains, trouve son essor dans un environnement
économique et social hostile. Mais de nouvelles formes sont observées aujourd’hui, plus discrètes car
s’appuyant sur les rapports sociaux du village, haut lieu des solidarités traditionnelles. C’est l’exemple de la
production/commercialisation de miel et d’huile d’olive dans un village de Kabylie, en Algérie. Un moyen
de survie « inventé » » par une population sans emploi pour assurer, revenus et ascension sociale. Ayant pu
perdurer depuis des décennies il constitue, aujourd’hui une dynamique économique au sein du village, c’est
le socle de son économie.
Mots clés: acteurs de l’informel, chômage, production illicite, réseaux de solidarité, village.
JEL: L23 et O17
Title: The production of honey and olive oil between counterfeiting and informal practices: the
case of a village in Ouaguenoun the wilaya of Tizi-Ouzou (Algeria).
Abstract
The informal economy, often identified with the urban areas, has its rise in economic and social
environment hostile. But new forms are observed today, more discreet because based on the social
relations of village, Mecca of traditional solidarities. This is an example of the production / marketing of
honey and olive oil in a village in Kabylia, Algeria. A means of survival "invented" "an unemployed
population to ensure income and social mobility. Who could continue for decades it is now an economic
dynamic in the village is the base of its economy.
Keywords : actors in informal employment, unemployment, illicit production, solidarity networks,
village.
1 Faculté des Sciences Economiques, Commerciale et des Sciences de Gestion, r_aknine@yahoo.fr
2 Faculté des Sciences Economiques, Commerciale et des Sciences de Gestion, rahmounaima@yahoo.fr

Introduction
Le recours aux activités de la « débrouille » liées à l’économie informelle, s’explique souvent, par
un environnement économique hostile, l’accès difficile à l’emploi, le coût de la vie... L’illégalité
des activités exercées est imputable à la situation d’un chômage structurel, une situation de vie
difficile et défavorable (échec scolaire, manque d’instruction…). Des moyens de survie sont alors
« inventés » afin de mener une vie décente et la possibilité d’un travail lucratif. Néanmoins, le
choix des produits contrefaits répond aussi à une logique d’« imposture» dans l’objectif de gains
rapides. C’est le cas des activités informelles que nous examinons à travers les
productions/commercialisations de miel depuis les années 60-70, d’huile d’olive depuis les années
80 et plus récemment et à une plus petite échelle de tabac à chiquer dans la région de
Ouaguenoun. Au-delà des raisons, quelques fois « légitimes », qui ont poussée à l’informel, les
activités que nous analysons sont accablées par leur côté « contre façon ». Qu’il s’agisse du
secteur informel ou de l’économie informelle, dans tous les cas, il s’agit de groupes d’individus
travaillant pour leurs propres comptes.
L’informel est souvent identifié aux milieux urbains, pourtant, aux fins fonds des villages, toute
une fourmilière s’active, inventant et se fabriquant de nouveaux processus pour se faire une part
de marché. Des activités qui se font dans l’ombre et dans toute discrétion, tant elles se font dans
le giron familial, dans l’aire du village, haut lieu des solidarités traditionnelles à l’abri de la rigueur
des lois de la république. Aucune étude, à notre avis, n’a été menée sur ce sujet. L’objet de cette
communication, est de nous interroger sur les motivations et les profils des acteurs et les
stratégies engagées pour la survie et la pérennité de ces activités informelles.
1. Emergence du secteur informel en Algérie : des stratégies évolutives des acteurs
L’apparition du secteur informel en Algérie est liée à la gestion administrative de l’économie
algérienne des années 70 et 80. Pendant cette période, la gestion centralisée de l’économie et le
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ont souvent été à l’origine de la rareté de certains
produits notamment ceux de première nécessité. Ce qui a créé des conditions propices à
l’émergence de monopoles aux mains d’individus proches de centres de commande (A.Henni,
1991). C’est l’essor d’un commerce informel des produits d’importation illégale, employant des
jeunes sans emploi notamment dans les milieux urbains. Le secteur économique informel s’est
ensuite développé dans les années 90 avec le trabendo3. D’ailleurs, la question du commerce
informel est souvent réduite, à tort, à ce phénomène. Face aux difficultés d’accès au secteur
d’investissement et aux financements bancaires (malgré des lois facilitatrices pour
l’entrepreneuriat), des structures économiques échappant aux statistiques et au contrôle de l’État
se développent. L’entreprise informelle est venue non seulement pour fructifier l’épargne
familiale mais aussi pour répondre aux besoins d’emploi et d’autonomie d’une population de
jeunes de plus en plus croissante.
Le recours aux activités informelles en Algérie, se justifie par un ensemble de facteurs macro-
économiques (conjoncture nationale d’ouverture, libéralisation de l’économie, ajustement
structurel, précarité de l’emploi...) et microéconomique (coût de la légalité, coût d’opportunité,
survie, gain facile et rapide,…). L’économie informelle représenterait plus de 50% du PIB de
l’Algérie.
1.1 Le secteur informel en Algérie, essai de caractérisation
L’informel, notion relative, est un secteur échappant au contrôle de l’Etat, il s’organise en petites
unités, touche les activités de commerce et de production et s’inscrit dans une stratégie de survie
des acteurs. C’est « un ensemble d’unités produisant des biens et services en vue, principalement,
de créer des emplois et des revenus pour les personnes concernées. Elles ont un faible niveau
d’organisation, opèrent à petite échelle avec peu, ou pas, de division entre le travail et le capital en
tant que facteurs de production,… » (C. Maldonado, 2000, 3). Ces activités sont entreprises en
vue principalement de créer des emplois et des revenus pour les personnes concernées, plutôt
que de maximiser le profit ou le retour sur investissements comme cela est typiquement le cas
dans le secteur formel.
3Commerce portant sur des produits de consommation importés mais ayant suivi des canaux non officiels, répandu dès
les débuts des années 80, des commerçants sans registre ni fonds de commerce.

Les conditions dans lesquelles ces activités apparaissent, et les contraintes sous lesquelles elles
sont exercées, leur confèrent certaines caractéristiques. « Elles sont informelles en ce sens que la
plupart ne sont ni consignées ni enregistrées dans les statistiques officielles, et qu’elles s’opèrent
sur une très petite échelle et avec un faible niveau d’organisation. La majorité d’entre elles
impliquent un très faible niveau de capital, de productivité et de revenu. Elles tendent à avoir peu
ou pas d’accès aux marchés organisés, aux institutions de crédit, à la technologie moderne, à
l’éducation formelle et aux outils de formation, et à nombre de services et aménagements
publics » (R. Hussmanns, 1997, 10). L’activité ou les activités informelles prennent de plus en
plus de l’ampleur, elles font partie de l’environnement économique et social de l’Algérie. Le lien
est étroit entre pauvreté et informel, chômage et informel, fraude et informel, contrôle de l’Etat
et informel, rareté, spéculation et informel. Les chiffres sur le secteur informel dans toutes ses
facettes ne sont pas disponibles, de par notre observation et les informations fournies par les
médias en Algérie, le secteur informel prend de l’ampleur à fur et à mesure que l’économie
évolue, il paralyse le secteur formel, voire l’économie toute entière. Qu’est ce qui explique la
tendance des acteurs économiques à l’informel ?
On retrouve le phénomène dans les cités et les campus universitaires (coiffure, couture, saisie de
texte, commerce cigarettes et tabacs à chiquer, et d’autres d’objets utilisés par les étudiants…),
dans les villes (pain fait maison, couture, tricotage, mercerie…) ainsi que des étalages de
différents produits aux abords des routes et des trottoirs. Le porte à porte, une forme de
colportage, fait partie de ces activités avec laquelle les produits fabriqués se font écouler. Dans les
caves des bâtiments et les domiciles, les produits de l’artisanat traditionnel (bijoux, …) se
fabriquent. L’activité informelle se livre à une concurrence par les prix étant donné que les coûts
de production sont plus faibles. Des sommes exorbitantes, semblent échapper au fisc et au
contrôle de l’Etat. Depuis deux ans, l’Etat tente d’éradiquer les marchés informels (apparents)
dans les villes jugés comme source de prolifération d’une activité productive illégale (Agharmiou-
Aknine, 2012), mais elle ne peut toucher l’origine de la production qui se trouve dans les
domiciles et les caves. Parmi les éléments à l’origine de ce phénomène :
Lourdeurs bureaucratiques
Depuis les années 1990, l’Algérie a consenti de grands efforts pour contenir la pauvreté,
encourager la création des entreprises privées… Mais cela n’a pas empêché la prolifération de
l’informel. Un certain nombre d’entreprises préfèrent rester non déclarées ou non autorisées dans
le but de ne pas avoir à se conformer à la réglementation. Selon doing business 2012, « En
Algérie, créer une entreprise relève toujours d’un parcours de combattant. Dans ce domaine
l’Algérie est classé à la 153eplace. Quatorze procédures, 25 jours, un coût représentant 12,9% du
revenu par habitant et un capital minimum de 30,6% de revenu par habitant, sont nécessaires
pour créer une entreprise en Algérie ». Faire des affaires en Algérie est, en effet, plus contraignant
que dans le reste des pays du Maghreb.
L’informalisation d’une économie est le signe d’une crise de confiance face aux institutions
existantes (manque de transparence dans les banques, bureaucratie exagérée, un système de
prélèvement fiscal démesuré…). C’est le « coût de la légalité » que les entrepreneurs déclinent. Un
acteur économique n’est enclin à la transparence que si la somme des avantages dépasse celle des
inconvénients, puisque ses décisions sont mues par la rationalité économique.
Chômage et exclusion
Si le secteur informel est toléré dans certain cas en Algérie, c’est dans l’objectif d’appuyer la
sphère des questions sociales (absorber le chômage avec n’importe quel moyen). C’est un
instrument de lutte contre la pauvreté.
La déconfiture du salariat permanent régulier et pas seulement dans le secteur public est le facteur
majeur de cette place ouverte à l’informel, c’est-à-dire que la non permanisation des travailleurs
les rend vulnérables vis-à-vis de leur emploi. Cette évolution fabrique des chômeurs qui n’ont
guère d’autres ressources que de grossir les rangs de l’informel que ce soit comme salariés ou
comme de libres entrepreneurs.
Les barrières à l’entrée, la corruption généralisée et la non-équité supposée dans le partage de la
rente pétrolière en Algérie, engendrent des frustrations et un sentiment de marginalité des régions
et des jeunes. Selon H. Elsenhans (2000, 14) « Les sociétés dominées par l’économie informelle

sont incapables d’intégrer les jeunes dans des emplois décents et adaptés à leurs niveaux
d’éducation et de formation, elles sont par conséquent des sociétés d’exclusion de la génération
montante ». Face au sentiment d’exclusion, beaucoup d’individus ont décidé de réagir en
investissant le terrain. C’est aussi une revanche contre les institutions.
Avec une surabondance de main d’œuvre moyennement qualifiée, la solidarité de parenté fournit
un critère de sélection. « Le secteur tend à choisir sa main d’œuvre d’une part en fonction des
coûts, d’autre part en fonction des relations non économiques » (H. Elsenhans, 2000, 48). La
marginalité est aussi une condition structurante pour les entrepreneurs, ils continueront à
respecter les obligations de solidarité dans le cadre de parenté même au détriment de leur pouvoir
d’accumulation » (Kennedy cité par Elsenhans, 49).
Avidité de gain facile
L’intérêt du secteur des petites activités ne peut être expliqué autrement que le manque de
dynamisme d’un secteur « moderne », formel. Ce sont des individus à la recherche de gains faciles
et d’ascension sociale. L’origine des capitaux de ce secteur se trouve dans l’épargne familiale
souvent d’origine informelle. Le profit dégagé de ces activités est en général investi non dans les
secteurs productifs mais dans la spéculation immobilière et les constructions, forme ostentatoire
de richesses et de réussite sociale. Par ailleurs, il existe des liens étroits entre le secteur formel et
informel. L’argent circule entre les deux secteurs, le premier sert d’appui et de couverture pour les
activités informelles qui sont considérées beaucoup plus juteuses (A. Bouyakoub, 2004,89).
Toutes les caractéristiques citées ci-dessus décrivent un informel touchant les milieux urbains,
réceptacles de l’exode rural. Celui-ci accentue le chômage et l’informel en ville. Il se trouve
cependant, que les activités informelles s’avèrent être bien présentes dans le milieu rural.
1.2 L’économie informelle est aussi présente dans les villages de montagne
Notre travail s’intéresse à l’activité économique informelle dans un milieu rural, le cas d’un village
de Kabylie. L’activité exercée est discrète et les acteurs difficiles à repérer par les autorités
publiques. Forts d’un réseau social produit de leur activité formelle et/ ou de leur milieu
villageois propre, les jeunes et les moins jeunes exploitant l’opportunité de gains faciles vont
amplifier les rangs de l’informel.
Il s’agit d’un village d’une commune de 20471 habitants en 2010, avec une densité
démographique de 564 habitants au km2. La commune est fortement rurale, près des ¾ d’entre
eux résident dans les villages. Elle est classée comme une commune à handicap4 au vu de son
sous-équipement et de l’absence de projets économiques. Le village est habité par quelques 1500
âmes, dont la moitié, sont des jeunes de moins de 30 ans, les ¾ ont moins de 50 ans et près d’un
tiers ont moins de 20 ans. Une grande proportion des jeunes est exclue de l’école et le taux de
chômage avoisine les 30%. Près de la moitié des personnes actives ont aujourd’hui une affaire
dans l’informel, qu’on peut estimer à 200-300 personnes. C’est dans ce contexte d’enclavement
que des activités économiques sont nées en marge de la sphère économique officielle. Ces
activités (la production et la commercialisation du miel et de l’huile d’olive, puis la fabrication du
tabac à chiquer) ne sont pas apparues simultanément. Elles vont évoluer progressivement pour
devenir structurantes pour l’économie locale en dépit de leur caractère informel.
1.3 Méthodologie
Pour tenter de comprendre les processus qui rendent possible l’activité informelle dans un village
de montagne, nous avons émis quelques hypothèses. Les motivations des acteurs sont le
chômage, le gain facile, l’absence d’horizon et de possibilité d’émigrer à l’étranger, la disponibilité
de capitaux familiaux, mais aussi l’entraide et la solidarité, deux éléments essentiels pour se lancer
dans l’activité. Par ailleurs, il s’agit d’un marché porteur et une garantie de revenus pour les
acteurs, en général, des jeunes rejetés par le système scolaire.
Pour vérifier ces hypothèses nous avons procédés par une investigation de terrain qui consiste
dans une série d’entretiens menés avec les acteurs et/ou leurs proches, de manière confidentielle
4Elle n’a pas de marché hebdomadaire. Elle est classée comme commune à handicap dans le dernier PAWT(Plan
d’aménagement du Territoire de la wilaya) de Juin 2012, sous-équipée en santé, éducation, jeunesse, sport, culture,
formation professionnelle...

et contournée. Le but était de connaitre leurs profils ; ce qui les a poussés à investir dans le
secteur informel (tout en tenant compte des facilités que l’Etat algérien offre aux jeunes créateurs
d’entreprise) ; comment cette activité a perduré depuis des décennies ?
L’enquête directe par questionnaire est quasi impossible à mener. Les intervenants dans ces
activités informelles ou leurs proches se méfient toujours de telles investigations craignant les
implications des pouvoirs publics, l’État ou les démêlés avec la justice. L’activité étant reconnue
comme informelle, s’exerçant en marge de la légalité. Même si paradoxalement, les signes
ostentatoires des revenus de l’activité sont exposés au grand jour et au vu et au su de tout le
monde (maisons, locaux commerciaux, véhicules neufs, train de vie,…)
2. Du processus de production à la distribution, (présentation des résultats de
l’enquête)
Les individus interviewés n’ont aucune qualification, ni formation particulière pour la production.
Le processus est simple et rudimentaire ne nécessitant pas des compétences particulières. Sa
prolifération s’explique par son accessibilité pour tous. Pour ce qui est de la commercialisation
des produits « nerf » des projets, il a nécessité des compétences en stratégie commerciale et en
subterfuges. Comment sont nées ces activités, comment ont-elles évolué, quels sont les effets
économiques et sociaux produits, emplois revenus, niveau de vie.
2.1 Le miel, l’éclosion d’une nouvelle activité informelle
C’est vers la fin des années 60 et durant les années 70 que le métier du miel fait son apparition.
Deux principaux acteurs du village sont à l’origine de cette activité Ouachour et Chabane. Ce
sont les premiers intervenants dans la filière qui va ouvrir la voie à une grande partie des jeunes
du village, qui par imitation trouvent une opportunité de profit. Il s’agit du miel « interverti »
mais vendu comme du vrai miel au moyen de subterfuge qui trompera pendant longtemps une
clientèle crédule, mais de plus en plus éloignée, donc moins au fait de l’artifice employé.
Le processus de « production »
Le sucre étant subventionné par l’Etat5 est acheté en grande quantité, puisqu’il constitue l’intrant
principal. D’autres ingrédients sont ajoutés, telle une substance appelée le « Spigou » additif qui
donne la coloration du miel pur puis la pierre d’alun, un minéral pour assurer consistance,
couleur et odeur du miel. Tous les intrants sont ramenés à la maison et tout s’y fait jusqu’à la mise
en pots. La cuisson du sucre avec ces adjuvants donneront la couleur et le gout du vrai miel.
L’activité nécessite quelques outils, de grandes marmites pour la cuisson, des bocaux en plastique
pour le remplissage mais surtout un local pour mener à bien l’opération de production, une
stabilité spatiale. L’opération a lieu à la maison, au village, du moins au démarrage de l’activité.
Quand l’activité prend de l’ampleur on opère à partir d’autres lieux, une autre wilaya en général
(Béjaia, Oran…) où on loue des locaux ou même une chambre d’hôtel (de bas de gamme) et on
procède à la fabrication sur place. C’est la deuxième étape de production, aller sur le marché
même, dans l’Oranie, dans le constantinois, dans l’algérois, et là on prépare le produit pour
l’écouler sur place. L’organisation en réseaux, l’entraide entre jeunes issus du même village,
permet une sorte de protection et de vie sociale, même loin de la famille. Tous les membres de la
famille participent à la production, notamment les femmes. Des pots en plastique de 500g ou de
1 litre sont remplis pour la distribution. La mise en pot se termine souvent par l’entremise d’une
« abeille » ou d’un petit morceau pain de la « ruche » et le tour est joué. Pour un non connaisseur,
il s’agit du vrai miel naturel.
La distribution, du colportage à l’essaimage
Elle se fait par colportage essentiellement. Deux échelles sont à distinguer. Une petite échelle où
l’acteur achemine lui-même la petite quantité de pots de miel vers le marché qu’il a préalablement
ciblé, généralement pas trop loin de sa résidence, vers les villes voisines, Alger, Bejaia, en faisant
du porte à porte, et même parfois en sillonnant les cités résidentielles. Il n’est pas rare de voir de
jeunes revendeurs proposer leurs produits à des estivants au bord de la plage, ou dans la rue. La
5L’Algérie est classée parmi les 10 premiers importateurs de sucre dans le monde avec une consommation
annuelle moyenne de 24 kg par habitant.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%