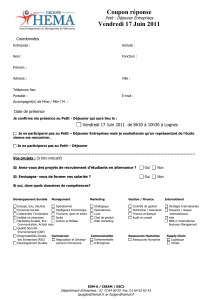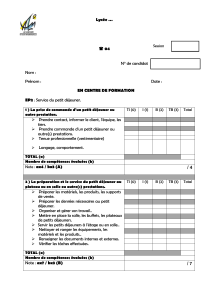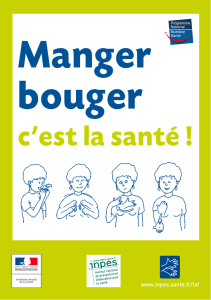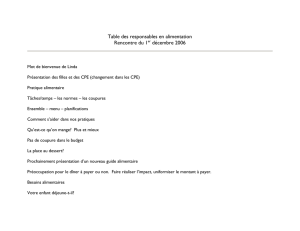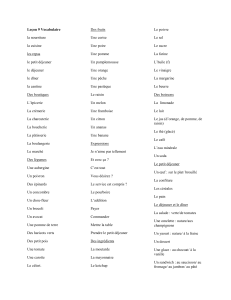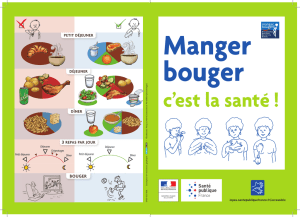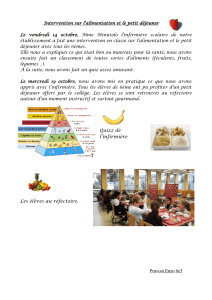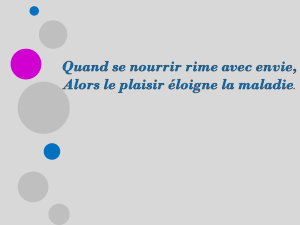DIABETE DE TYPE 2 l Pour améliorer le contrôle de la glycémie

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XV - nos 9-10 - novembre-décembre 2011
306
Revue de presse
Pour contrôler la glycémie
différemment
DIABETE DE TYPE 2 l
Pour améliorer le contrôle de la glycémie
des patients diabétiques de type 2 insuffisamment contrôlés par la dose maximale tolérée
de metformine seule en complément du régime alimentaire et de l’exercice physique
(indication remboursée)
JANUMET® 50 mg/1000 mg comprimés pelliculés. COMPOSITION (*) : Principes actifs : 50 mg de sitagliptine (sous forme de phosphate monohydraté) et 1000 mg de chlorhydrate de metformine.
INDICATIONS : Chez les patients diabétiques de type 2, Janumet est indiqué pour améliorer le contrôle de la glycémie, en complément du régime alimentaire et de l’exercice physique : •chez les patients
insufsamment contrôlés par la metformine seule à la dose maximale tolérée ou chez les patients déjà traités par l’association sitagliptine/metformine. • en association à un sulfamide hypoglycémiant
(trithérapie) lorsque les doses maximales tolérées de metformine et de sulfamide ne permettent pas d’obtenir un contrôle adéquat de la glycémie. •en trithérapie avec un agoniste des récepteurs activateurs
de la prolifération des peroxysomes gamma (PPARγ) (thiazolidinedione) lorsque les doses maximales tolérées de metformine et de l’agoniste des récepteurs PPARγ ne permettent pas d’obtenir un contrôle
adéquat de la glycémie. •en addition à l’insuline (trithérapie) lorsque l’insuline et la metformine, seules, à doses stables, ne permettent pas d’obtenir un contrôle adéquat de la glycémie. POSOLOGIE ET
MODE D’ADMINISTRATION (*) : • Ne pas dépasser 100 mg de sitagliptine. • A prendre 2 fois par jour, au cours des repas pour diminuer les effets indésirables gastro-intestinaux liés à la
metformine. • 50 mg de sitagliptine 2 fois par jour + dose de metformine déjà prise par le patient. • En association à un sulfamide hypoglycémiant ou à l’insuline, envisager de diminuer la
posologie de ces derniers pour réduire le risque d’hypoglycémie. •Insuffisants rénaux : ne pas utiliser en cas d’IR modérée ou sévère. •Insuffisants hépatiques : ne pas utiliser. •Sujets âgés : prudence
chez les patients > 75 ans ; surveiller la fonction rénale pour prévenir une acidose lactique. •Enfants : non recommandé en dessous de 18 ans. C.T.J. : 1,60 €. CONTRE-INDICATIONS : • Hypersensibilité
aux substances actives ou à l’un des excipients. • Acidocétose diabétique, précoma diabétique. • Insufsance rénale modérée ou sévère (clairance de la créatinine < 60 ml/mn). • Affections
aiguës susceptibles d’altérer la fonction rénale, telles que déshydratation, infection grave, choc, administration intravasculaire de produits de contraste iodés. • Maladies aiguës ou chroniques
pouvant provoquer une hypoxie tissulaire telles que insufsance cardiaque ou respiratoire, infarctus du myocarde récent, choc. • Insufsance hépatique. • Intoxication éthylique aiguë,
alcoolisme. • Allaitement. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI (*) : • Ne pas utiliser chez les patients diabétiques de type 1 et absolument pas pour le traitement de
l’acidocétose diabétique. • Les patients doivent être informés du symptôme caractéristique d’une pancréatite aiguë : douleur abdominale intense et persistante. • En cas de pancréatite,
arrêter Janumet et les autres médicaments suspects. • Fonction rénale : surveiller régulièrement la créatininémie (au moins 1 fois par an en cas de fonction rénale normale, au moins 2
à 4 fois par an chez les patients ayant une créatininémie supérieure ou égale à la limite supérieure de la normale et chez les patients âgés. • Cas graves de réactions d’hypersensibilité
avec la sitagliptine : arrêter le traitement et instaurer un autre traitement antidiabétique. • Interventions chirurgicales et administration de produits de contraste iodés : interrompre le
traitement 48 heures avant et ne le reprendre que 48 heures au moins après, si la fonction rénale est normale. • Modication de l’état clinique chez les patients dont le diabète de type 2
était préalablement équilibré : rechercher acidocétose ou acidose lactique. En cas de suspicion, arrêter le traitement et hospitaliser le patient d’urgence. INTERACTIONS AVEC D’AUTRES
MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES D’INTERACTION (*) : •Risque d’acidose lactique en cas d’intoxication éthylique aiguë. •Cimétidine et autres agents cationiques. •Produits de contraste iodés.
•Glucocorticoïdes, bêta-2 agonistes, diurétiques, IEC. •Surveiller les patients à risque de toxicité de la digoxine. FECONDITE, GROSSESSE ET ALLAITEMENT (*) : ne pas utiliser. CONDUITE DE VEHICULES
ET UTILISATION DES MACHINES (*) : prudence. EFFETS INDESIRABLES (*) : nausées, baisse de la glycé mie, somnolence, douleur abdominale haute, hypoglycémie, constipation, céphalées,
diarrhée, vomissements, œdème périphérique, toux, infection fongique cutanée, infection des voies respiratoires supérieures, étourdissements, rhinopharyngites, réactions d’hypersensibilité
incluant anaphylaxie, angio-œdème, rash, urticaire, lésions cutanées exfoliatives y compris syndrome de Stevens-Johnson (apparues dans les 3 mois suivant l’instauration du traitement, voire
dès la première prise), vascularite cutanée, pancréatite y compris pancréatite hémorragique et nécrosante fatale ou non, altération de la fonction rénale y compris insufsance rénale aiguë
(nécessitant parfois le recours à la dialyse), douleurs abdominales, perte d’appétit, goût métallique, acidose lactique, carence en vitamine B12, troubles de la fonction hépatique, hépatite.
SURDOSAGE(*). PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES (*) : Classe pharmacothérapeutique : médicaments utilisés dans le diabète, association d’agents hypoglycémiants oraux, code ATC : A10BD07.
DONNEES ADMINISTRATIVES : •ListeI. •A.M.M. EU/1/08/455/010 - Code CIP n°3400938678116 : boîte de 56 cps (2008, rév. 26.11.10) -Prix: 44,69 € - Remb. Séc. Soc. 65 %. - Agréé Collect.
Non remb. à la date du 03.12.10 dans les indications : «Chez les patients diabétiques de type 2, Janumet est indiqué pour améliorer le contrôle de la glycémie, en complément du régime alimentaire et de
l’exercice physique : •en trithérapie avec un agoniste des récepteurs PPARγ (thiazolidinedione) lorsque les doses maximales tolérées de metformine et de l’agoniste des récepteurs PPARγ ne permettent
pas d’obtenir un contrôle adéquat de la glycémie ; •en addition à l’insuline (trithérapie) lorsque l’insu line et la metformine, seules, à doses stables, ne permettent pas d’obtenir un contrôle adéquat de la
glycémie.» •A.M.M. EU/1/08/455/014 - Code CIP n° 34009 573 121 1 4 : boîte de 50 cps (2008, rév. 26.11.10) -Conditionnement exclusivement hospitalier. •Agréé Collect. •JANUMET 50 mg/850mg
n’est pas commercialisé en France. REPRESENTANT LOCAL : Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret - 3, avenue Hoche - 75114 Paris cedex 08 - Tél. 01 47 54 87 00 - Centre d’Information : Tél.
01 47 54 88 00. (*) Pour une information complète, consulter le Résumé des Caractéristiques du Produit sur le site internet de l’EMA.
01 12 - JMT11F - 0182J - JANVIER 2011
HbA1c
Illustration schématique et pas
nécessairement représentative
des effets cliniques
Avant de prescrire, pour des informations complètes,
consulter le RCP disponible sur le site www.afssaps.fr ou
sur notre site www.msd-france.com
1 comprimé
2 fois/jour
au cours
des repas
Coordination : Estelle Louiset (Rouen)
L’ocytocine, une hormone
antalgique
Alimentation, dépression
et adiposité
Apport en protéines,
synthèse protidique et
exercice physique
Expression concomitante
des récepteurs du GnRH
et de la LH dans les
adénomes de Conn
Petit déjeuner et repas
suivants
>>>
L’ocytocine, une hormone antalgique
L’ocytocine est connue de longue date pour ses
actions stimulantes durant l’accouchement et la lac-
tation. Des études plus récentes ont mis en lumière
ses effets dans des comportements sociaux, ouvrant
la voie au concept d’hormone de l’attachement, de la
confiance et de l’altruisme. L’exploration des effets phy-
siologiques de l’ocytocine ne semble pas terminée. En
effet, des chercheurs de l’université de la Méditerranée,
à Marseille, ont spéculé sur une action antalgique de
l’ocytocine en constatant que les bébés nés par voie
basse étaient beaucoup plus résistants à la douleur
que ceux nés par césarienne programmée. En utilisant
un modèle animal, M. Mazzuca et al. ont recherché
l’action de cette hormone dans le contrôle de la dou-
leur lors de la période périnatale. Ils ont observé que
la sensibilité des ratons à une douleur thermique ou
électrique était plus faible juste après leur naissance
que durant les jours qui suivent. L’administration d’un
antagoniste du récepteur de l’ocytocine augmente la
sensibilité à la douleur des ratons immédiatement après
leur naissance mais reste sans effet les jours suivants.
À l’inverse, l’injection de l’hormone à des animaux âgés
de 2 jours améliore leur résistance à la douleur. L’effet
antalgique de l’ocytocine résulte d’une modulation
de l’activité de neurones GABA-ergiques de la voie de
transmission nociceptive. Ces résultats suggèrent qu’au
cours de l’accouchement, l’ocytocine – qui stimule les
contractions utérines – pourrait réduire la sensibilité du
fœtus à la douleur générée par le travail. Ces données
nouvelles contribuent aussi à attribuer une propriété
supplémentaire à cette hormone.
E. Louiset (Rouen)
•Mazzuca M, Minlebaev M, Shakirzyanova A et al. Newborn analgesia
mediated by oxytocin during delivery. Front Cell Neurosci 2011;5:3.
Alimentation, dépression et adiposité
L’obésité et la dépression augmentent dans les pays
développés. Ces pathologies sont-elles liées dans leur
genèse, au-delà de la relation que l’on peut faire entre
obésité et dépression ? Le lien peut également être
inverse. Il peut s’agir aussi de causes communes (stress
social et conditions socioéconomiques) ou de méca-
nismes communs. Le but de l’étude de Konttinen et
al. était d’analyser le rôle de facteurs psychologiques
conditionnant le comportement alimentaire et l’activité
physique. La prise alimentaire émotionnelle se solde
très souvent par une consommation d’aliments denses
et énergétiques (snacks). Par ailleurs, la pratique d’une
activité physique est influencée par la confiance en soi,
ou plutôt par la confiance en sa propre capacité à la
pratiquer. L’équipe finlandaise a étudié 2 312 hommes et
2 674 femmes âgés de 25 à 74 ans enrôlés dans l’étude
National Cardiovascular Risk Factor Survey en 2007.
Les symptômes de dépression, les freins à l’activité
physique, ainsi que l’IMC, le tour de taille et le pour-
centage de graisse corporelle ont été quantifiés. Les
symptômes de dépression et le “manger-émotionnel”
sont corrélés positivement. À l’inverse, la confiance en
soi pour pratiquer une activité physique est corrélée
négativement à l’IMC, au tour de taille et au pourcen-
tage de graisse corporelle. Des symptômes élevés de
dépression sont liés au “manger-émotionnel” et à une
plus faible confiance en soi pour l’activité physique,
tandis que le “manger-émotionnel” et la confiance en
soi pour l’activité physique sont inversement corrélés.
L’association dépression-adiposité devient non signifi-
cative dans les modèles qui incluent le “manger-émo-
tionnel” et la confiance en soi pour l’activité physique,
ce qui signifie que ces 2 facteurs sont vraiment des
intermédiaires entre dépression et adiposité. C’est donc
tout un travail de soutien psychologique qui doit être
mis en œuvre dans la prise en charge des patients en
surpoids, afin de ne pas aggraver l’obésité par des
conseils à la fois frustrants et culpabilisants quand on
n’y arrive pas…
J.M. Lecerf
•Konttinen H, Silventoinen K, Sarlio-Lähteenkorva S, Männistö S, Haukkala A.
Emotional eating and physical activity self-efficacy as pathways in the asso-
ciatin between depressive symptoms and adiposity indicators. Am J Clin Nutr
2010;92,1031-9.
Apport en protéines, synthèse protidique
et exercice physique
La sarcopénie est une diminution progressive de la
masse maigre, squelettique et musculaire survenant
avec l’âge. On peut considérer qu’elle est liée à une
diminution de la synthèse protidique entraînant un
déséquilibre entre l’anabolisme et le catabolisme. La
hausse de l’anabolisme correspondrait à une diminution
de la synthèse postprandiale et après exercice en rap-
port avec une altération de la digestion des protéines,
de la cinétique de leur absorption, conduisant à une
baisse de la disponibilité postprandiale des acides ami-
nés. Cette résistance anabolique est considérée comme

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XV - nos 9-10 - novembre-décembre 2011
308
Revue de presse
CoDia 2012 annonce presse:CoDia 2012 annonce presse 24/11/11 16:27 Page1
>>>
un facteur clé de l’étiologie de la sarcopénie.
Si l’on considère que l’activité physique pré-
cède souvent la prise alimentaire, il convient
d’étudier cette résistance anabolique au repos
et après un exercice physique. Pennings et al.
ont comparé la digestion et l’absorption des
protéines, ainsi que la synthèse protidique
musculaire postprandiale, au repos et après
exercice, chez des hommes jeunes et des
hommes âgés. Les sujets ont consommé un
bolus de 20 g de protéines contenant de la
phénylalanine marquée au C13. Vingt-quatre
hommes âgés de 74 ± 1 ans ont été appariés
pour le poids à 24 hommes de 21 ± 1 ans. La
cinétique d’apparition de la phénylalanine
n’était pas différente dans les 2 groupes.
Aucune différence n’a été observée entre les
2 groupes d’âge en termes de biodisponibilité
de la phénylalanine, tant au repos qu’après
l’exercice. De plus, le taux de synthèse de
protéines calculé à partir des traceurs était
plus élevé en cas d’exercices physiques, tant
chez le sujet jeune (+ 16 %) que chez le sujet
âgé (+ 30 %). L’exercice physique avant une
prise alimentaire est donc le meilleur moyen
pour augmenter l’anabolisme protidique quel
que soit l’âge. Il est susceptible d’accroître
l’accrétion protidique postprandiale et de
contribuer ainsi à la réduction de la sarco-
pénie liée à l’âge.
J.M. Lecerf
•Pennings B, Koopman R, Beleen M, Senden JM, Saris WH, Van
Loon LJ. Exercising before protein intake allows for greater
use of dietary protein-derived amino acids for de novo muscle
protein synthesis in booth young and elderly meh. Am J Clin
Nutr 2011;93 :322-31.
Expression concomitante des
récepteurs du GnRH et de la LH
dans les adénomes de Conn
L’implication de récepteurs illégitimes dans
le contrôle de la sécrétion de cortisol par
des lésions corticosurrénaliennes associées
à un syndrome de Cushing a largement été
documentée. Des études génomiques ont
également permis de mettre en évidence
l’expression anormale de gènes codant pour
des récepteurs membranaires dans des adé-
nomes surrénaliens associés à un hyper-
aldostéronisme primaire. Quelques études
fonctionnelles ont démontré le rôle de récep-
teurs illégitimes dans le contrôle de la sécré-
tion d’aldostérone. L’équipe de F. Mantero a
suspecté l’expression aberrante de récep-
teurs chez une femme âgée de 32 ans qui
a développé un hyperaldostéronisme au
cours d’une grossesse. L’aldostéronémie de
cette patiente a augmenté après adminis-
tration de GnRH (+ 114 %) ou de triptoréline
(Décapeptyl® + 120 %), ainsi qu’en réponse à
l’hCG (+ 77 %). Ces effets stimulateurs n’ont
pas été retrouvés après surrénalectomie uni-
latérale. L’expression des récepteurs du GnRH
et de la LH dans la tumeur a été objectivée
par PCR quantitative et immunohistochimie.
La présence de ces récepteurs a été retrou-
vée dans 6 des 22 autres adénomes de Conn
étudiés. Ces données montrent que l’expres-
sion concomitante de récepteurs du GnRH
et de la LH dans un adénome de Conn peut
contribuer au développement d’un hyperal-
dostéronisme quand les taux circulants de
GnRH et d’hCG sont élevés, c’est-à-dire au
cours de la grossesse.
E. Louiset
•Albiger NM, Sartorato P, Mariniello B et al. Eur J Endocrinol
2011;164:405-12.
Petit déjeuner et repas suivants
La relation entre le petit déjeuner et l’obésité
n’est pas simple (1). Les personnes prenant un
petit déjeuner mangent plus équilibré, ont
un poids inférieur, font davantage d’activité
physique et ont un niveau socioéconomique
plus élevé que celles qui omettent ce repas.
Sauter un petit déjeuner peut faire man-
ger plus au repas suivant et sur la journée.
Toutefois, les personnes qui prennent un petit
déjeuner copieux ne mangent pas forcément
moins sur la journée. Kral et al. (2) ont mesuré
les effets de la prise d’un petit déjeuner ou
de son omission sur l’appétit et sur la prise
alimentaire lors des repas suivants chez
21 enfants âgés de 8 à 10 ans. Les enfants ont
participé à 2 séries de tests durant lesquels
ils ont pris ou non un petit déjeuner, puis un
déjeuner proposé ad libitum. Les sujets ont
évalué leur appétit durant toute la matinée
à travers une échelle visuelle analogique. Les
parents ont consigné les apports alimentaires
de leur enfant sur toute la journée. Il n’a pas
été constaté d’effet important de la prise
ou non d’un petit déjeuner sur les apports
alimentaires au repas de midi (p = 0,36) ou
durant le reste de la journée (p = 0,85). En
revanche, l’absence de prise de petit déjeu-
ner était associée à un apport énergétique
moindre (– 362 kilocalories) sur l’ensemble
de la journée, ce qui signifie qu’il n’y a pas
eu de compensation. Néanmoins, les sujets
ne prenant pas de petit déjeuner ont ressenti
davantage de sensation de faim, moins de
sensation de plénitude, et ont déclaré avoir
un plus grand appétit avant le repas de midi
que le jour où ils ont pris un petit déjeu-
ner. Cette étude ne semble pas confirmer
les résultats des données antérieures mais
révèle la complexité des faits. Elle montre la
différence entre des données expérimentales
qui, certes, standardisent, mais n’intègrent
pas toutes les composantes (mode de vie,
comportement). On peut aisément penser
que les enfants qui sautent quotidiennement
le petit déjeuner ont davantage faim durant
la matinée et mangent plus au repas suivant
en présence d’une alimentation abondante
et palatable. Les facteurs associés jouent
donc probablement un rôle majeur pour
expliquer que les enfants ne prenant pas de
petit déjeuner ont un poids plus élevé et sont
plus souvent obèses.
J.M. Lecerf
1. Lecerf JM et al. Petit déjeuner, est-ce utile ? Cah Nutr Diet
2011;46,30-9.
2. Kral TV, Whiteford LM, Heo M, Faith MS. Am J Clin Nutr
2011;93:284-91.
1
/
2
100%