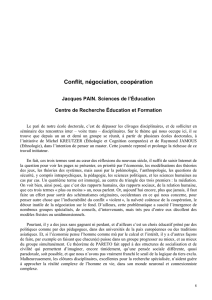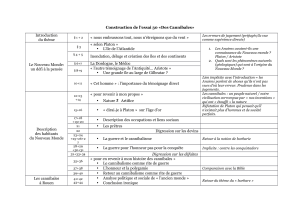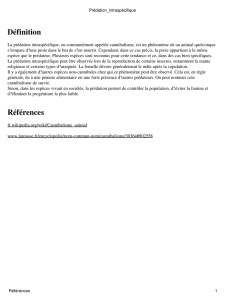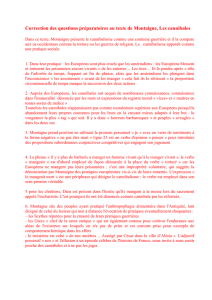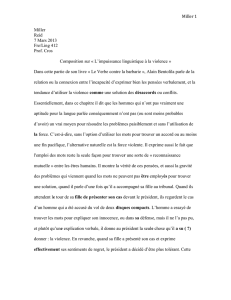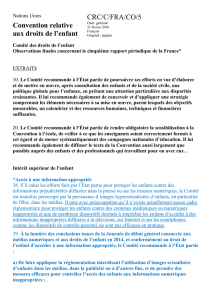Français

Violence extrême et dévoration cannibale.
Production et destruction du lien social
Mondher Kilani
J’aimerais traiter dans ce texte de la question de la violence dans sa relation à la
culture. J’entends cette dernière, d’une part, comme une production de schèmes
de significations qui médiatisent la relation de l’acteur à l’univers social dans
lequel il vit et, de l’autre, comme «une série de modèles de contrôle – projets,
prescriptions, règles, instructions – pour diriger [s]es comportements» (Geertz
1973). Bref, je l’entends comme la «condition sociale d’existence» à la fois de
«l’expérience “réelle” du sujet» et des «conceptions idéelles» qu’il s’en fait
(Sahlins 1976). J’aimerais plus précisément soulever la question du rapport de la
violence au travail de la culture, de son rapport à la «liaison» et/ou à la
«déliaison» sociale. J’aimerais comprendre le lien que la dévoration, sous ses
différentes formes, entretient avec le lien social. Pour illustrer mon propos, je
m’emparerai de deux objets que je traiterai l’un après l’autre. Le premier se
rapporte à la violence extrême, celle qui cherche l’extermination de l’autre, et le
deuxième au cannibalisme, entendu comme l’ingestion de son semblable. Deux
phénomènes que tout semble identifier dans un premier temps au même univers
– la capacité d’annihilation totale de l’autre – mais que tout semble séparer du
point de vue de leur production respective du lien social. La violence
exterminatrice provoque son délitement, le cannibalisme contribue à son
renforcement. L’une s’abîme dans la terreur de la destruction pure, l’autre
consolide le lien social dans l’ambivalence de la dévoration.
Cette opposition par rapport à la finalité produite n’empêche pas que les deux
configurations s’accompagnent d’une élaboration symbolique. Si, dans le cas du
cannibalisme, la dimension symbolique – la capacité d’opérer une distinction
entre le pur et l’impur, la force et la faiblesse, le licite et l’illicite, etc. – est
facilement reconnue ou reconnaissable, du moins par la théorie anthropologique,
on pourrait plus facilement croire que la destruction dans la violence extrême
échappe, elle, a priori à toute forme de symbolisation. Or, celle-ci ne peut
véritablement déployer son efficacité en dehors d’un quelconque langage
symbolique. La destruction des hommes et des femmes dans la violence extrême
repose, en effet, sur une certaine idée de l’humain. Si, dans le cas du
cannibalisme, il a été montré que l’absorption de l’autre contribue positivement à
la production de l’humain, donc de soi-même (Kilani 2003), dans
l’anéantissement de l’autre, il y aurait également production de l’humain, mais
d’un humain fondé sur l’absence d’un extérieur.
La violence extrême : lien et délitement du lien social
On peut commencer par se demander en quoi la violence extrême participe de la
production de la culture (Kilani 2009) ? Si nous admettons, avec le philosophe
allemand du XVIIIe siècle Johan Gottfried Herder (1991), l’idée que l’humain ne
relève ni d’une essence, ni d’une évidence spécifiques ; si nous considérons, avec
l’anthropologue américain du XXe siècle Clifford Geertz (1973), qu’il doit, à cause
de cet inachèvement, être constamment construit dans le cadre d’une
anthropopoièse (Calame et Kilani 1998), que pouvons-nous dire alors quand

2
nous constatons que des êtres humains baignant dans les cultures les plus
cultivées sont capables de détruire d’autres êtres humains ? Pouvons-nous nous
contenter de penser que l’humain cesse d’être produit lorsqu’il est détruit ? Mais
alors comment qualifier cette destruction ? Si nous rejetons l’idée d’une ontologie
sur laquelle pourrait reposer notre conception de l’humain et de la culture, sur
quel fondement s’étaierait la destruction des hommes/des femmes, sinon sur une
certaine idée de l’humain capable de haïr et de détruire son semblable ?
Il s’agit, ni plus ni moins, de reconnaître ici l’«humaine inhumanité de l’humain»
ou, selon la formule de Martin Hébert, «l’inhumanité de l’humain envers
l’humain» (2006 : 18). La violence extrême ne saurait, en effet, être réduite à
une pure brutalité, sachant que les représentations idéologiques et les structures
sociales sont à l’origine de la production de toutes les formes possibles de
violence, certaines pour les réprimer, d’autres pour les promouvoir. L’acte de
violenter relève d’un apprentissage social. Toutes les époques, toutes les cultures
ont dressé des êtres humains à infliger une violence systématique à d’autres
êtres humains (Scheper-Hughes & Bourgois 2004).
On a généralement considéré la cruauté au cœur de la violence infligée comme
une surenchère gratuite. On a pensé que la cruauté n’avait d’autres fins qu’elle-
même, que sa réalité s’épuisait dans la jouissance qu’elle procurait au bourreau
(Sofsky 2002). Ce faisant, on a omis de relever sa dimension politique. En la
naturalisant, on a caché le programme politique qui la sous-tendait et la rendait
possible. Or, la gratuité de la cruauté fait partie intégrante du programme
politique de la terreur (Nahoum-Grappe 2002). Quant à la haine, au
soubassement énergétique de la cruauté, dans un premier temps sans objet
précis ou pleine d’objets hétérogènes, elle ne déploie pleinement ses effets que
lorsqu’elle se fixe sur une communauté précise (Anders 2007). Autrement dit, la
haine s’incarne dans le mouvement même où se construit l’«étranger absolu,
souvent mauvais, menaçant et pourvu de topiques négatifs que le groupe
projette sur lui» (Crettiez 2006 208), et où se met en place une communauté
haineuse prête à passer à l’acte.
Dans ces conditions, le massacre de masse apparaît au croisement de
l’institution et de la destitution de la culture humaine (Houillon 2005). Il relève à
la fois de la structure et de l’anti-structure. Bref, cette violence-là sollicite
également le travail de la culture. Elle est pourvue d’un objectif, celui de
produire une communauté de responsabilité, une «confraternité de destruction
soudée par les liens de la cruauté» (Crettiez 2006 : 220). Nous serions ainsi au
cœur même du lien social et de son délitement, de la communitas et de l’anti-
communitas (Crettiez 2006)
Plusieurs caractères du sacrifice, au fondement du lien social ou du moins qui le
traversent, marquent la «communauté massacrante» qui se construit autour du
meurtre de masse : désigner un ennemi-bouc émissaire ; assurer l’unité (la
pureté) de la communauté à travers l’impureté construite de l’ennemi ;
euphémiser l’autre, à travers son animalisation et sa chosification ; lever les
inhibitions et les interdits comme condition et garantie de l’exercice de la
violence ; brutaliser l’autre et le mettre en scène, notamment à travers la
profanation de son corps ; enfin, développer le sentiment d’impunité face à
l’exercice de la violence extrême.
Une telle structure autorise et facilite le massacre de masse. Elle encadre ses
acteurs et justifie leurs actions comme dans le cadre du sacrifice qui autorise la
transgression de l’interdit et libère la main du sacrificateur. A la différence près,
toutefois, que si le sacrifice traditionnel cherche une «prise de bénéfice
continue», qui suppose de préserver la victime jusqu’au prochain sacrifice,

3
l’extermination de masse veut, elle, s’assurer un «bénéfice symbolique infini»
(Coquio 2005), dans lequel prime la volonté de supprimer une fois pour toute
l’ennemi. La violence extrême débouche sur un «état d’urgence» devenu la règle,
sur un état qui incorpore la vie humaine à l’ordre juridique sous la forme de son
exclusion radicale, de sa réclusion dans l’«espace du camp» (Agamben 1997).
Travail culturel et déliaison sociale
Peut-on dès lors parler de «déliaison» dans ce type de situation par opposition à
la «liaison» que le «travail culturel» est censé, lui, assurer ? On sait que
Sigmund Freud a recouru à cette notion de liaison à plusieurs reprises et dans
différents endroits de son œuvre pour évoquer les sublimations pulsionnelles
croissantes auxquelles a été soumis l’homme au cours du procès de civilisation
(Smadja 2009). Utilisée également comme synonyme de développement culturel
et de procès culturel, cette notion est associée chez Freud à sa capacité à
construire un sujet moral et social. Plus spécifiquement encore, le travail culturel
consiste à neutraliser les pulsions agressives en cherchant d’une part à produire
des modalités de liaisons sociales assurant la cohésion du groupe et de l’autre à
produire des idéaux culturels et artistiques propres à contrebalancer le
renoncement libidinal, narcissique et agressif (Smadja 2009).
Lorsque l’agressivité triomphe, devrait-on dès lors nécessairement pointer
l’échec du travail culturel ? Un échec qui s’inscrirait en dehors de la culture, voire
contre elle. Ne pourrait-on imaginer, au contraire, que le travail culturel puisse
contribuer à produire cette agressivité ? Plusieurs éléments chez Freud font
penser qu’il ne partage pas ce dernier point de vue. Dans ses Considérations
actuelles sur la guerre et la mort, le psychanalyste viennois est convaincu qu’une
forme de violence comme la guerre correspond à un échec du travail culturel
dans la mesure où «elle nous dépouille des couches récentes déposées par la
civilisation et fait réapparaître en nous l’homme des origines» (Freud 1915,
1981 : 23). Par ailleurs, dans son échange épistolaire avec le physicien Albert
Einstein sur la guerre et sur comment la prévenir – publié sous le titre de
Pourquoi la guerre ? en 1933 – il affirme également que «tout ce qui travaille au
développement de la culture travaille aussi contre la guerre» (Einstein & Freud
2005 : 65).
Il y aurait même une certaine naïveté chez lui lorsque, dans la même lettre, il
affirme que ce sont généralement les sujets et non les chefs qui «se rangent
presque toujours sans réserves» (Einstein & Freud 2005 : 60) derrière l’autorité,
et qu’à ce titre, il faudrait former une «catégorie supérieure de penseurs
indépendants» à même de combattre «le penchant à la guerre» (Einstein &
Freud 2005 : 19). Or, nous savons que c’est souvent le contraire qui se passe,
comme le relève très justement Albert Einstein dans le même échange épistolaire
avec Freud. L’éminent physicien y souligne, en effet, que ce ne sont pas les
«êtres dits incultes», mais bien plutôt «la soi-disant «“intelligence”» qui est la
plus prompte à la guerre, étant souvent «la proie la plus facile des funestes
suggestions collectives» (Einstein & Freud 2005 : 38), sinon à leur origine.
Pensons aux juristes, médecins, anthropologues, architectes, artistes,
journalistes, ecclésiastes et autres éminents intellectuels et savants qui ont
inspiré, planifié et fait appliquer les lois d’exception du nazisme et les
programmes de destruction massive des populations «inférieures» qui les
accompagnaient. Pensons également aux élites hutues – journalistes,
universitaires, prêtres, hommes politiques – qui ont théorisé puis exacerbé la
haine raciale pour enfin appeler au génocide des Tutsis. Pensons également aux
dirigeants serbo-bosniaques comme le médecin psychiatre Radovan Karadzic ou

4
le général Ratko Mladic dans l’orchestration de la haine des musulmans
bosniaques et de leur massacre.
Pour qu’une explosion d’agressivité se produise, faudrait-il encore qu’un travail
culturel de déshumanisation – d’exclusion d’une partie de l’humanité de sa
sphère – puisse s’effectuer au préalable, qu’une construction symbolique de
l’autre en tant qu’ennemi à détruire puisse d’abord s’élaborer. De là les
nombreuses justifications idéologiques des formes de violence passées et à
venir ; de là également les autorisations accordées au passage à l’acte, dans le
but de soulager la conscience des exécutants et des bourreaux et de leur faciliter
la tache.
Vis-à-vis du travail culturel, Sigmund Freud serait un peu dans la même position
que le philosophe René Girard (1972) vis-à-vis du rituel sacrificiel. En effet,
lorsque Girard admet l’idée de l’échec du rituel à contenir la violence entre les
hommes/les femmes, il n’imagine pas un instant qu’un tel rituel puisse se doter
d’un «planning politique», qu’il utilise la violence contenue en son sein pour
détruire sciemment l’autre (Coquio 2005, Kilani 2006, 2009). Voyez les sacrifices
humains aztèques effectués au nom du dieu Quetzalcóatl et de la lutte contre
l’entropie de l’univers (Graulich 2005), ou à l’époque moderne, les sacrifices
effectués au nom de la Patrie (Crettiez 2006) ou du Parti (Zizek 1993), sacrifices
qui ont vu des milliers d’individus s’offrir à la mort en chantant ou en s’accusant
de crimes imaginaires. Freud ne semble concevoir l’échec du travail culturel que
sous la forme «de productions psychopathologiques favorisées et/ou induites par
des exigences culturelles et des circonstances sociales pathogènes» (Smadja
2009 : 379). Mais une question surgit ici, Freud aurait-il changé d’opinion sur le
travail culturel et aurait-il admis sa capacité à concevoir et à planifier
l’extermination en masse de populations entières, s’il avait vécu le nazisme dans
tous ses développements ?
La dévoration cannibale ou la conjonction des opposés
Passons maintenant au cannibalisme. La consommation de chair humaine est
spontanément perçue dans notre société comme une forme d’avilissement de
l’identité fondamentale de l’humain. Elle suscite le sentiment d’un «crime primitif
contre l’humanité». Le cannibalisme est, selon la théorie freudienne, l’événement
primordial qui, par le truchement du meurtre du père, a permis l’avènement de
la civilisation – la reconnaissance de la loi du père – et à ce titre doit demeurer
un interdit absolu, qu’aucune transgression ne justifie. Or, ici également, les
choses ne sont pas simples.
Au-delà de la simple manducation, de l’ingestion de la chair, le cannibalisme est
d’abord une métaphore, celle de la construction de l’humain. En tant
qu’«anthropopoiésis», il a la capacité de configurer des modèles ou des anti-
modèles de l’humain auxquels les sociétés adhèrent ou desquels, au contraire,
elles se distancient (Kilani 2001/2002). Le cannibalisme apparaîtrait dans ce sens
comme un opérateur symbolique de l’identité et de l’altérité, du dedans et du
dehors, de l’ordre culturel et de l’ordre naturel, de l’humain et du non-humain.
Au même titre que d’autres institutions symboliques comme le mythe ou le
rituel, ou de structures de significations comme le système alimentaire, le
cannibalisme aurait le pouvoir de produire du sens et d’instituer du social. À
travers l’imagination et la pratique cannibales, l’humain se présente et se
représente. Bref, le cannibalisme serait une fiction modélisante de l’humain. Il

5
constituerait l’opérateur symbolique qui permet de faire passer le groupe humain
de l’inorganisé à l’organisé.
Une fiction romanesque comme L’ancêtre, de l’écrivain argentin Juan José Saer
(1992), nous introduit de plain-pied dans cette problématique. Elle nous permet
de comprendre comment l’acte d’ingérer l’autre permet de palper l’extériorité en
se voyant du dehors. Pendant des années, les gens composant la peuplade qui
accueillait le héros du roman, qui va fonctionner à ce titre comme le révélateur
de leurs fantasmes les plus enfouis, avaient, en effet, l’habitude de se manger
entre eux, accentuant ainsi le sentiment de viscosité générale dans laquelle ils
vivaient. C’est pour sortir de cet état d’indistinction et se voir enfin du dehors
qu’ils se mirent à manger des hommes provenant de l’extérieur. C’est pour
dépasser le sentiment primordial de ne pas s’appartenir, pour se sentir des
hommes véritables, qu’ils cessèrent de s’entredévorer et se tournèrent vers
l’extérieur. Dans l’acte de manducation des autres, ils apprenaient à faire une
distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Manger les autres, c’était palper
l’extériorité et témoigner enfin de sa propre existence, de sa propre humanité.
Mais cette victoire n’était cependant de loin pas acquise. L’anxiété de retomber
dans l’état antérieur continuait à les tarauder. Ils n'étaient pas sûrs d’être
suffisamment humains, d'avoir gagné ce statut pour toujours. Ils le savaient
d’autant plus que derrière le désir de dévorer l’étranger se tapissait le désir plus
enfoui de se manger soi-même. Autrement dit, construire son humanité n’est
jamais un processus achevé, et le danger de retomber dans l’auto-dévoration,
dans l’indistinct guette toujours.
Le cas du cannibale de Rotenburg, en Allemagne, qui a défrayé la chronique des
faits divers en 2002, en est une illustration pertinente. Dans ce cas, la dévoration
de l’autre recouvre directement le désir de dévoration du même, suscitant ainsi
le fantasme d’une régression à l’état originel, à l’état d’indistinction. La scène a
commencé par le consentement intervenu entre les deux protagonistes, entre
celui qui a pris l’initiative de l’acte, par l’intermédiaire d’une annonce sur le
réseau de l’Internet mentionnant les qualités précises recherchées de la future
victime redoublant les siennes propres, et cette dernière qui y répondit avec
conviction et total engagement. Elle s’est poursuivie par une relation
homosexuelle entre le meurtrier et la victime, qui culminera dans une ingestion
communielle du pénis de la victime, redoublant ainsi le lien de promiscuité. Elle
s’est enfin terminée par le «festin cannibale». L’union entre deux individus de
même sexe, le contact de leurs humeurs intimes ont dessiné un premier cercle
de l’identique – comme le fait la transgression de l’inceste et l’union entre
proches – et l’acte cannibale, précédé de la consommation de l’organe sexuel,
n’a fait qu’exacerber cette recherche de l’identique et la volonté de se dissoudre
dans l’autre.
Ce dernier exemple de cannibalisme, dans lequel on assiste à un double cumul
de l’identique qui mène à la mort, est différent du premier, celui de la société
décrite par Saer, où l’ingestion de l’autre devait au contraire permettre de sortir
de soi et de découvrir l’extérieur. Autrement dit, la pratique cannibale oscille
entre construction et destruction, et un cannibalisme «positif» suppose de
trouver la juste mesure entre soi et l’autre, entre le semblable et le différent,
entre l’identité et l’altérité. Manger trop près, c’est se condamner à disparaître,
manger trop loin c’est se dissoudre dans l’indistinct.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%