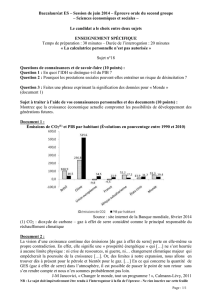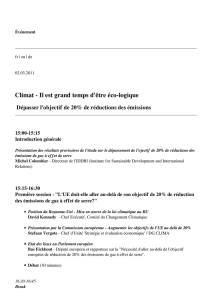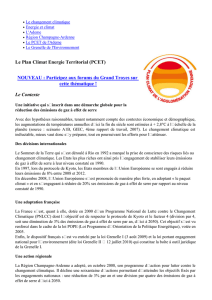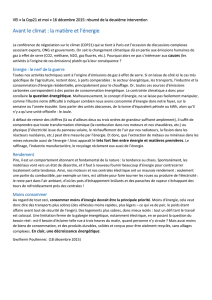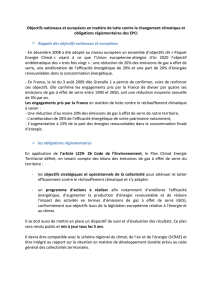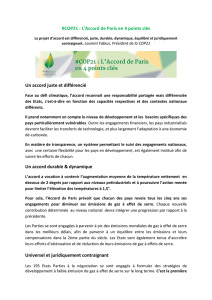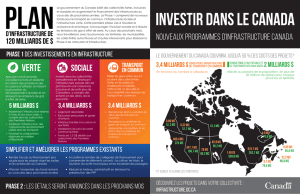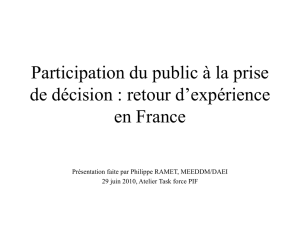La France,
bonne élève
du développement
durable ?
Robin Degron
dF
Diffusion
Direction de l’information
légale et administrative
La documentation Française
Tél. : 01 40 15 70 10
www.ladocumentationfrancaise.fr
Prix : 7,90 €
ISBN : 978-2-11-009003-4
DF : 1FP30180
Imprimé en France
Robin Degron La France, bonne élève du développement durable ?
-:HSMBLA=U^UUXY:
’
12
DOC’EN POCHE
place au débat
DOC’EN POCHE
Place au dÉBaT
L’analyse pour éclairer le débat
Une présentation claire et accessible des enjeux
d’un grand débat de société.
Des comparaisons internationales pour ouvrir la réflexion.
Des encadrés pour apporter des informations
complémentaires.
La France, bonne élève
du développement durable?
Le Sommet de Rio du 20 au 22 juin 2012 a célébré les vingt ans
du Sommet de la Terre de 1992, également organisé à Rio. Ce
Sommet fondateur avait mobilisé la communauté internationale
autour de la lutte contre le réchauffement climatique et consacré la
notion de développement durable en soulignant les enjeux pour les
générations futures. La France s’est inscrite dans ce mouvement.
Elle a adopté des mesures en faveur du développement durable,
associé une Charte de l’environnement à la Constitution et mis en
œuvre le Grenelle de l’environnement. Mais ces avancées sont-elles
suffisamment importantes? Reste-t-il des progrès à accomplir?
Pour répondre à ces questions, «Place au débat» vous propose
l’analyse d’un auteur spécialiste.
Robin Degron, énarque et géographe, est le rédacteur en chef de
L’environnement en France en 2010.
152 pages = 11,5 mm
Photo : © Ikon Images/Corbis
D'EP PAD Développement durable.indd 1 31/07/12 16:19

La France,
bonne élève
du développement
durable ?
Robin Degron
énarque et géographe,
rédacteur en chef de
L’environnement en France
en 2010
La documentation Française

« En application du Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992, une reproduction
partielle ou totale à usage collectif de la présente publication est strictement interdite sans
autorisation de l’éditeur. Il est rappelé à cet égard que l’usage abusif de la photocopie met
en danger l’équilibre économique des circuits du livre. »
© Direction de l’information légale et administrative, Paris, 2012.
ISBN : 978-2-11-009003-4
Responsable de la collection
et direction du titre
Isabelle Flahault
Secrétariat de rédaction
Martine Paradis
Conception graphique
Sandra Lumbroso
Bernard Vaneville
Mise en page
Éliane Rakoto
Édition
Bernadette Bouvattier
Promotion
Stéphane Wolff
Avertissement au lecteur
Les opinions exprimées n’engagent que leurs auteurs.
Ces textes ne peuvent être reproduits sans autorisation.
Celle-ci doit être demandée à :
Direction de l’information légale et administrative
29, quai Voltaire
75344 Paris cedex 07

3
Sommaire
Chapitre 1
Vingt ans après le Sommet de la Terre,
qu’en est-il du développement durable ? ����������������������������������5
Chapitre 2
Le Sommet de Rio de 1992,
une feuille de route exigeante ?����������������������������������������������������������21
Chapitre 3
La France, tête de classe européenne ? �������������������������������������43
Chapitre 4
Avant le Grenelle, un bilan français contrasté ������������������67
Chapitre 5
Le Grenelle de l’environnement,
des eorts de rattrapage susants ?��������������������������������������������93
Chapitre 6
L’économique et le social:
encore beaucoup à faire����������������������������������������������������������������������������111
Chapitre 7
De nouvelles règles du jeu
pour un développement durable ? ���������������������������������������������� 133
Bibliographie et sitothèque ������������������������������������������������������������������147

 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
1
/
150
100%