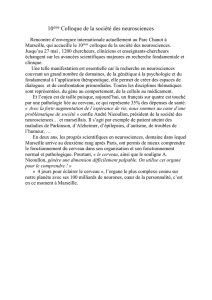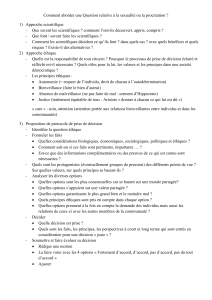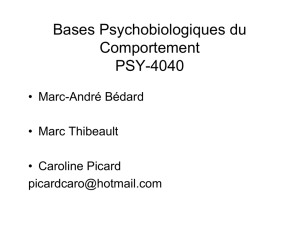Neurosciences et éthique

Vous êtes ici : Accueil> Territoire> Neurosciences et éthique
Neurosciences et éthique
INTERVIEW DE FRANÇOIS CHAPUIS ET CAROLINE TILIKETE
<< Dans l’esprit de la législation française, on part du principe que quelque que soit l'organe exploré ou
l’innovation testée, ce qui compte est la protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales >>.
Interview de François Chapuis, médecin des hôpitaux, méthodologiste de la recherche clinique aux HCL et
coordonnateur du projet d’éthique de la recherche, et Caroline Tilikete, de réseau européen des comités, médecin des
hôpitaux et neurologue au Laboratoire « Espace et action », INSERM.
Réalisée par : Marianne CHOUTEAU
Tag(s) : Ethique, Santé, Biotechnologie, Sciences et société
Date : 23/02/2006
Quel est le rôle du Comité de protection dans la recherche biomédicale ?
François Chapuis : Historiquement nos sociétés occidentales ont ressenti un blocage complet – et justifié – à l'issue de
la Seconde Guerre Mondiale par rapport à tout ce qui concernait l'expérimentation sur le vivant. Il a fallu attendre 1964
pour que l'Association Médicale Mondiale proclame le code d'Helsinki. Dans cette déclaration, les principes du code de
Nuremberg seront repris et rendus opérationnels. En effet, il était stipulé qu'on ne pouvait mener d’expérimentation sur
un sujet sans recueillir son consentement et sans qu'il en connaisse les risques. Cela présuppose un équilibre des
informations entre les deux parties, ce qui, il faut l'avouer n'est pas forcément le cas en médecine. Bien que la France ait
ratifié ce texte en 1964, il faudra encore attendre 1988 pour qu'il y ait une loi protégeant les personnes dans la recherche
biomédicale. Cette loi, votée le 20 décembre 1988 est la loi connue sous le nom de Loi Huriet-Serusclat. Suite au vote de
cette loi les Comités Consultatifs de Protection des Personnes dans la Recherche Bio-médicale (CCPPRB) ont été créés.
Leur mission est de vérifier que la recherche est conduite dans des conditions dignes et recevables pour le participant
comme pour la société. Le concept de discussion en groupe, né chez les philosophes allemands, est connu comme le
principe de l'éthique de la discussion : c'est parce que l'on considère qu'il n'y a pas de solution toute faite pour un sujet
donné qu'il convient de le discuter au cas par cas. Ces comités ont donc été créés pour donner un avis, aujourd'hui
consultatif mais dans un avenir proche cet avis vaudra autorisation. La finalité est de donner confiance à nos sociétés,
aux instances de recherches et de soin et en conséquence aux patients sur les conditions de la recherche menée. Leur
mission est donc de protéger les personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale en France. Cela a évolué depuis
1988 puisque l'Europe s'est saisie de cette idée et a édicté une directive européenne en mai 2001 qui a été mise en
application dans l'ensemble des 25 pays en mai 2004. En revanche, l'Europe ne s'intéresse pour l’instant qu'aux
médicaments. En France, les comités protègent les personnes qui se prêtent à la recherche alors qu’en Europe, on a mis
en place des comités d'éthique pour la recherche médicamenteuse. Cela ne se recouvre pas : l'Europe garantit
l’évaluation des médicaments, la France protège les personnes dans la recherche biomédicale qu'elle soit
médicamenteuse ou pas.
Par qui sont composés des comités ?

Aujourd'hui, il y a 12 membres titulaires et 12 suppléants. Parmi les 12 titulaires, huit sontFrançois Chapuis :
considérés comme ayant la valence scientifique et 4 sont considérés comme ayant la valence éthique. Parmi les 8
scientifiques, 4 doivent avoir l'expérience de la recherche dont au mois trois médecins, deux sont pharmarciens, un est
médecin généraliste et une est infirmière.
Pour les quatre « éthique », il y a un spécialisé en éthique,(il s'agit souvent d'un philosophe) une assistante sociale, un
psychologue et un juriste.
Ces douze titulaires sont doublés de douze suppléants. Dans l'avenir, on garde à peu près la même configuration mais il
y aura un équilibre total entre scientifique et éthique. Il y aura normalement 7 membres de chaque groupe. Ce qui fait 14
personnes titulaires et 14 personnes suppléantes.
Le changement résidera aussi dans le fait que les usagers seront représentés. L'avènement des neurosciences
entraîne-t-il de nouveaux questionnements éthiques auxquels jusqu'alors nous n'étions pas forcément préparés
?
Dans l’esprit de la législation française, on part du principe que quelque que soit l'organe exploré ouFrançois Chapuis :
l’innovation testée, ce qui compte est la protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales. Les grands
principes reposant sur une recherche de qualité – suivant l’avis de Jean Bernard considérant que ce qui n'est pas
scientifique n'est pas éthique – la protection des personnes, le respect des lois, le respect des bonnes pratiques cliniques
s'appliquent globalement sur l'ensemble des recherches cliniques, et ce quel que soit l'organe étudié... du gros orteil au
cerveau.
Les modalités sont-elles différentes parce qu'elles concernent le cerveau ? Ce n'est pas évident : il y a des mesures
objectives, des mesures subjectives. Certes, dans le cas des recherches sur le cerveau, on utilise volontiers des
questionnaires mais c'est aussi le cas pour les recherches sur la qualité de vie après une intervention chirurgicale par
exemple.
Caroline Tilikete : Ce qui peut éventuellement poser des questions en neurologie par rapport aux autres neurosciences,
c'est le consentement du patient. On est parfois face à des patients qui ont des troubles du jugement. Mais il y a aussi
une protection puisque nous faisons appel à la famille, au conjoint, aux proches.
Et en terme de traitement ?
Effectivement, on a la problématique de la pharmacologie en psychiatrie qui peut poser desCaroline Tilikete :
problèmes éthiques particuliers. On est ici davantage dans des thérapies risquées que par rapport à d'autres organes.
On prend des risques vitaux ou de pronostics fonctionnels qui sont importants mais cela ne change pas notre
comportement par rapport à la recherche.
Pour chaque étude, dispositif, etc. il nous faut peser la balance entre le bénéfice et le risque. Dans le cas du cerveau, il
se peut, effectivement, que le risque soit plus important que sur un autre organe tel le bras, le pied, la main, etc. mais le
bénéfice l'est également.
François Chapuis : On n'aime rien perdre en médecine... pas plus la vie qu'un organe... pas plus le cerveau qu'un autre
organe. Peut-être que le cerveau soulève plus de fantasmes.
Que voulez-vous dire exactement sur les « fantasmes » autour de la recherche sur le cerveau ?
François Chapuis : Autour de cette valeur supérieure de la connaissance, de grosses attentes et de grosses peurs
s’expriment. La neurologie a pendant très longtemps décrit car nous ne disposions pas des thérapeutiques adéquates.
Aujourd'hui arrive enfin le moment où on pense pouvoir traiter, améliorer, prévenir certaines pathologies neurologiques.
Ce qui est bien compris et accepté pour le coeur commence à le devenir pour le cerveau. Les questions qui ont agité la
cardiologie, il y a quelques années, touchent aujourd'hui la neurologie.
Mais, si on prend l'exemple d'une transplantation : dans le cas du cœur, cela ne modifie pas l'individu... si cela
était possible avec le cerveau, on aurait du mal à se dire qu'une personne avec un cerveau d'un autre reste la
même ?

François Chapuis : Avant de pouvoir faire une transplantation de cerveau, il y a des greffes de neurones ou de cellules
souches en milieu neuronal. Les questions de personnalité sont beaucoup plus complexes.
En recherche en neurosciences, le risque que nous parvenions à modifier la personnalité n’existeCaroline Tilikete :
pas. Il est vrai que cet organe reste un organe différent. Le retard que nous avons accusé en matière de recherche
s'explique aussi par le fait que nous avons eu du mal à y accéder : les méthodes qui nous permettent aujourd'hui
d'étudier l'activité cérébrale sans ouvrir la boîte crânienne sont récentes et ont permis un réel bond en avant des
connaissances sur le cerveau.
En matière de thérapie, nous sommes aujourd'hui plus dans une phase active et moins descriptive : nous savons
introduire des électrodes dans le cas de la maladie de Parkinson par exemple, ou nous savons effectuer de la chirurgie
du cerveau et ce notamment, dans le cas de l'épilepsie.
Sentez-vous que l’avancée des connaissances en matière de neurosciences crée certaines tensions ?
François Chapuis : Ce n'est pas forcément palpable. Il y a un développement extraordinaire des connaissances
aujourd'hui et notre société a besoin de temps pour les absorber. Les sociétés ont peur quand elles n'ont plus les
moyens d'absorber les nouvelles connaissances qui lui parviennent. Par exemple, les cellules souches provoquent des
inquiétudes de façon totalement injustifiée. Les cellules souches sont des cellules comme les autres à qui on offre la
possibilité de se différencier en cellules spécialisées.
Et cette possibilité de différenciation ne pose pas de problèmes éthiques ?
Caroline Tilikete : On pourrait évidemment envisager d'utiliser ces cellules dans le cas de réparation d'une zone
musculaire et là, ça pose moins de questionnements éthiques. Toutefois, des questions peuvent émerger : si on est
capable de le faire pour la zone motrice du genou le pourra-t-on pour l'intelligence, la mémoire, l’émotivité ? On en est
encore loin et le cerveau est à considérer comme un organe global. Lorsqu’on touche une zone, on n’altère pas la
personnalité d’un individu voire son « individualité ».
Le fait que les neuro-sciences aient accompli de tels progrès ces 20 dernières années, n'a-t'il pas cependant
introduit de nouveaux questionnements en matière d'éthique ?
François Chapuis : D'un point de vue global, non. Mais il y a forcément des inquiétudes relatives à chaque science. Par
exemple, lorsqu'on dit que les grands psychiatres de demain seront de grands biologistes et auront compris le rôle
primordial des molécules. On sent que la molécule est susceptible d'amener des changements, peut-être pas de
personnalité mais au moins de comportements. Toutefois, il faut rappeler que les thérapies cognitives, la sophrologie
entraînent des modifications de comportements et cela ne gène personne. On est dans le même cas de figure avec les
substances psycho actives.
Les questions liées à la recherche diffèrent-elles des questions liées au traitement ?
Les grands principes éthiques sont « liberté du patient », « autonomie dans la décision », «François Chapuis :
répartition juste », etc. En conséquence, ils sont identiques pour la recherche et pour la thérapie. En recherche, il y a la
notion de responsabilité sans faute. Cette notion est née avec la loi « Huriet-Serusclat ». Si un patient accepte de
participer à une recherche qu'un investigateur lui a proposée, en cas de problème, l'investigateur en question est
responsable mais il n'est pas forcément fautif ni coupable. Ce concept a été transféré aux soins avec la notion d’aléa
thérapeutique. On est responsable car on a prescrit un médicament, en revanche s'il y a un effet secondaire, on n'est
pas nécessairement fautif ni coupable.
Ces notions identifiées dans le cadre de la recherche et s'appliquant secondairement aux soins sont assez fréquentes.
Par exemple, on a mis en place le consentement à la recherche puis plus tard le consentement aux soins avec la
possibilité pour un patient de les refuser. Il faut qu'il y ait un entre recherche, soin, et connaissances. Le fait
continuum
que les protocoles de recherche soient contrôlés par un comité large plaide pour un regard de la société sur les actes de
recherche.

Apparemment la vigilance est plus importante pour ce qui est de la recherche ?
Dans notre société s'impose assez subrepticement le principe de précaution. « Si on ne sait pas,François Chapuis :
alors on ne fait pas. » Le principe de recherche est très différent : c'est justement parce que l'on ne sait pas qu'il faut «
aller voir ». Il y a donc une balance permanente entre le principe de précaution et le principe de recherche ou, dans la
recherche, entre le bénéfice attendu et le risque. L'évaluation de la mise en oeuvre d'une recherche, en sachant que la
société a besoin de beaucoup de sécurité, peut se révéler très subtile. L'adage en médecine est « d'abord ne pas nuire »
avant de soigner et en éthique, le principe de « non maléficience » précède celui de bienfaisance. En d’autres termes, on
essaie de ne pas nuire avant de tenter de faire le bien.
Dans l'éducation du jeune médecin français, cette notion est très présente. Les jeunes médecins reçoivent un
enseignement en Sciences Humaines et Sociales. Au concours de première année de médecine, cela représente plus
de 20% de la note finale.
Cela fait plus de 10 ans (1993) que nos sociétés ont compris l'importance de la sensibilisation des jeunes médecins à
ces questions d'éthique.
Caroline Tilikete : L'aboutissement immédiat d'une recherche thérapeutique est évident : le bénéfice est immédiat. Mais
pour la recherche en amont, c'est-à-dire pour la physiologie, le bénéficie est souvent moins visible car moins direct. Par
exemple, au sein du comité, tester des psychotropes sur des sujets sains paraît nécessaire, car la finalité est d'aider, à
terme, les patients. Pourtant, il y a aussi ici des problèmes éthiques évidents
En d’autres termes, le contrôle doit davantage se faire sur les conditions d’utilisation des résultats de la
recherche que sur la recherche elle-même ?
C’est ce que la société a mis en place. Une autorisation de commercialisation de procédés parFrançois Chapuis :
exemple répond à des cahiers des charges très exigeants. Mais la recherche progresse par petits pas : les grandes
révolutions technologiques sont rares. Certaines sociétés ont toutefois des inquiétudes : par exemple au Japon la
recherche en thérapie cellulaire est tellement encadrée qu’elle ne se fait pas sans grande difficulté. En revanche en
France, où nous avons correctement défini les conditions d’exercice d’une recherche, elle est autorisée.
Le cerveau est un champ immense en matière de développement des connaissances. A Lyon il y a historiquement de
nombreux projets de recherche sur le cerveau et sur les neuro-sciences, ainsi que sur les maladies neuro-dégénératives,
l’épilepsie, la sclérose en plaques, la neuro-chirurgie, etc.
Est-ce que le développement des maladies neuro-dégénératives pose des questions éthiques en terme
d’amélioration de la vie, de la fin de la vie et par voie de conséquence en terme d’euthanasie ?
On a jusqu’à présent ajouté des années à la vie : on a amélioré l’espérance de vie tant pour le sujetFrançois Chapuis :
sain que pour le sujet malade. Il n’y a pas que la médecine qui influe, il y a également l’éducation, l’alimentation, l’habitat,
la prévention, l’hygiène, la lutte contre la pollution… Mais maintenant se pose la question de la qualité de vie ; En effet,
alors que nous avons ajouté des années à la vie, il faut également ajouter de la vie aux années. La recherche sur les
neuro-sciences et les maladies neuro-dégénératives en est une bonne illustration.
Mais nous prenons tous un risque en naissant… « La vie est une maladie sexuellement transmissible et constamment
mortelle » (W. Allen).
1
/
4
100%