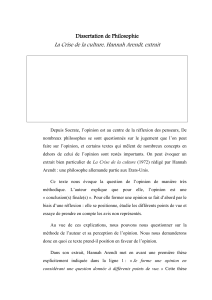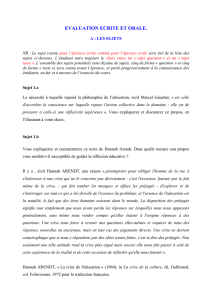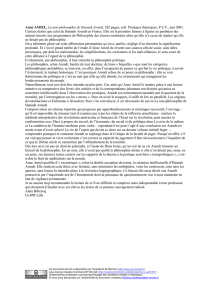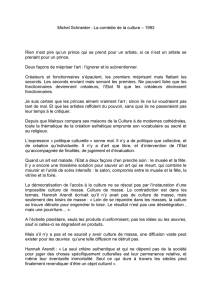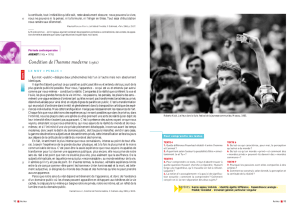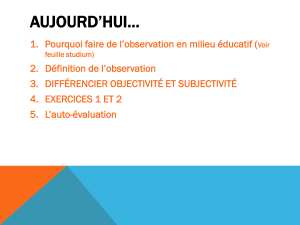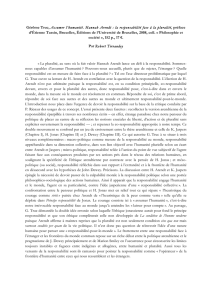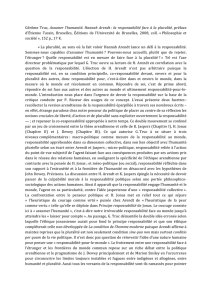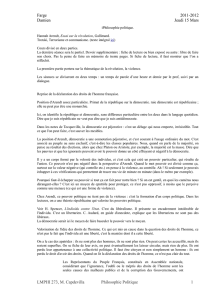La Crise de la culture, Hannah Arendt, extrait Dissertation de Philosophie

Dissertation de Philosophie
La Crise de la culture, Hannah Arendt, extrait
Depuis Socrate, l’opinion est au centre de la réflexion des penseurs, De
nombreux philosophes se sont questionnés sur le jugement que l’on peut
faire sur l’opinion, et certains textes qui mêlent de nombreux concepts en
dehors de celui de l’opinion sont restés importants. On peut évoquer un
extrait bien particulier de La Crise de la culture (1972) rédigé par Hannah
Arendt : une philosophe allemande partie aux Etats-Unis.
Ce texte nous évoque la question de l’opinion de manière très
méthodique. L’auteur explique que pour elle, l’opinion est une
« conclusion(s) finale(s) ». Pour elle former une opinion se fait d’abord par le
biais d’une réflexion : elle se positionne, étudie les différents points de vue et
essaye de prendre en compte les avis non représentés.
Au vue de ces explications, nous pouvons nous questionner sur la
méthode de l’auteur et sa perception de l’opinion. Nous nous demanderons
donc en quoi ce texte prend-il position en faveur de l’opinion.
Dans son extrait, Hannah Arendt met en avant une première thèse
explicitement indiquée dans la ligne 1 : « Je forme une opinion en
considérant une question donnée à différents points de vue. » Cette thèse

s’accompagne d’une explication : L’auteur évoque la formation de l’opinion.
Elle enseigne la méthode de l’étude de la question « à différents points de
vue », pour elle, tout est une question de position ; ceci nous est d’ailleurs
rappelé tout au long de la première partie du texte (qui se finirait à peu près
au milieu) avec le champ lexical du lieu. Pour elle, il faut étudier un
problème, une question, à l’aide de différentes positions. Dans la suite de
cette partie, elle évoque l’idée du « processus de représentation » qui doit
selon elle, se faire dans le cerveau. De manière plus inductive : Un individu
est capable de se représenter tous les points de vue adopté face à une
problématique, selon Arendt.
Avec cette idée qui est celle de la formation du point de vue, il y aussi la
perspective différente : la philosophe indique qu’elle ne se mêle pas aux
idées opposés, simplement à leur point de vue ; « il ne s’agit pas de
sympathie » explique-t-elle ligne 4. Par exemple s’il y avait débat sur une
question comme celle du mariage « Pour tous » évoquée dans l’actualité, elle
essayerait de se mettre à la place des homosexuels, des représentants de
l’Eglise et d’un français lambda pour essayer de comprendre les points de
vue de chacun sans pour autant exprimer son avis vu qu’elle chercherait
d’abord à s’attacher à celui des autres. Néanmoins, il ne faut pas chercher à
étiqueter les points de vue en fonction du rôle de la personne dans la société :
Son orientation sexuelle, son âge ou sa confession ne font pas ses idées ni sa
position... Aussi, l’exemple précédemment développé n’est qu’une
proposition, il semble intéressant de dire que l’idéologie d’Arendt s’étale sur
de nombreux domaines, de nombreuses questions et qu’elle couvre de
manière assez subtile l’ensemble des problématiques d’une société où les
différentes opinions sont confrontées. Enfin, pour elle, adopter un point de
vue ce n’est pas jouer la carte de la majorité en « compt[ant] les voix » de
celle-ci et en s’y joignant mais bien d’étudier de manière construite et neutre.
La question de la neutralité, ou plutôt de l’objectivité porte sur une partie
de la thèse. En effet, si l’on peut faire une analyse des différents points de

vue, alors on peut dire que l’on est doté d’objectivité dans la pure subjectivité.
On peut expliquer le paradoxe de la manière suivante : Etant donné qu’elle
porte un avis sur quelque chose, l’auteure est déjà dans une certaine
subjectivité (le sujet forme l’avis) Si elle fait l’effort d’analyse cela va
conduire à un effort d’objectivité : De l’objectivité dans l’analyse mais aussi
dans l’effort de se retenir de critiquer ou de soutenir telle ou telle thèse en
fonction du point de vue. C’est donc un travail du cerveau qui nécessite une
profonde réflexion et un entrainement particulier pour calmer sa propre
vision et pour privilégier celle des autres.
Le mot « opinion » ne vient qu’à la ligne 10, il s’affiche pour la première
fois et est le résultat d’une assez longue phrase où l’auteur met en avant une
démonstration. Elle indique que si les positions et les points de vue d’un
problème sont étudiés de manière plus importante, alors elle pourra mieux
« s’imaginer » (ligne 8) car ses capacités de réflexions plus développées, et
donc sa capacité de représentativité, ses conclusions et par conséquent son
opinion seront meilleures. Cela conduit assez rapidement à l’expression
« mentalité élargie » définie par la philosophe. On comprend par le biais de
cette expression l’ensemble de sa réflexion : En fait, la mentalité élargie peut
être considérée comme l’ouverture d’esprit dans le débat, elle est le fruit
d’une prise de conscience des autres avis, de l’adoption de différents points
de vues, ces points de vues permettent une certaine objectivité, un
perfectionnement des capacités de l’esprit mais la mentalité élargie n’a pas
vocation à soutenir, prendre parti pour les autres opinions : il ne s’agit pas
d’appréciation mais de compréhension.
Après cette première partie basée sur une définition de son processus de
formation de l’idée, elle explique comment former une bonne opinion.
Ligne 11, on évoque l’idée de « véritable processus». L’intérêt de
l’emploi du mot « véritable » est qu’il insinue tout de suite qu’il y a un faux

processus – sans doute pense-t-elle à l’éducation. Après tout, il est vrai que
l’éducation nous transmet des idées, des valeurs, des préjugés, des opinions
sans qu’elles soient vraiment forgées par nous. C’est donc pour elle deux
choses différentes : l’éducation et la formation de l’opinion. Dans cette
« quête de la bonne opinion », la première idée est d’exclure l’éducation.
Arendt indique qu’il faut aussi « être désintéressé, libéré des intérêts privés »
(ligne 12). Comme le dit le bon sens populaire, il ne faut « pas avoir d’idées
derrière la tête » : la méthode de formation d’opinion doit se fonder sur une
certaine neutralité de la personne. Pour faire simple : ceux qui ont des choses
à gagner dans telle ou telle question, problème doivent se retenir d’y penser.
On peut donc penser qu’il sera difficile de remplir ce critère parce qu’il y a
de nombreuses oppositions d’opinions qui se soldent par un gain ou une perte,
d’un côté ou de l’autre. Par exemple, concernant la guerre : Il y aura toujours
les pacifistes face aux bellicistes. Il y aura toujours le lobby d’extension du
territoire, de la réussite diplomatique d’un pays ou d’autres raisons (comme
Buch qui évoquait « la civilisation en Irak ») face au lobby anti-morts, anti-
victimes or qui peut aujourd’hui dire qu’il soutient telle ou telle faction sans
avoir lui-même une idée derrière la tête, comme la thèse qui expliquerait
qu’une guerre gagnée peut rapporter de l’argent au pays et donc augmenter
les revenus de la population.
La dernière phrase du texte est assez longue, mais comprend une partie
importante de la réflexion de l’auteur. Pour Arendt, l’idée est que l’opinion
puisse se former de manière indépendante. Elle se positionne face à ceux qui
établissent, comme Descartes l’idée que l’opinion se forme à cause de
l’éducation et de l’entourage. Sa conclusion est que si elle est totalement
« isolé[e] » (ligne 14) pendant qu’elle forme une opinion, ça ne reste qu’une
solitude matérielle. Selon elle, l’individu reste dans « ce monde d’universelle
interdépendance » ; cela signifie entre autre qu’elle reste dans un monde,
carrefour de toutes les consciences et de toutes les réflexions. La notion
d’interdépendance tend à se rapprocher de celle d’intersubjectivité tout
simplement car ici : il y a dépendance entre les différentes consciences, les

différents sujets même si le second terme se rapporte plus au questionnement
sur la conscience, l’inconscient que sur celui de l’opinion.
Finalement, on peut penser que ce texte traite de la question de l’opinion,
déjà étudiée par de nombreux philosophes. On voit ici l’absence totale de
remise en question de cette notion considérée comme déjà acquise dans la
réflexion vu qu’à priori l’auteur enseigne une méthode, contrairement à la
longue tradition de la critique de l’opinion. On peut se poser une question
très importante : S’agit-il vraiment de l’opinion ? Après tout dans ce texte on
se rend compte que c’est plutôt la méthode, l’objectivité et l’impartialité qui
sont mises en avant.
Il est important d’évoquer l’idée d’opinion mais pas pour les raisons que
l’on pourrait croire : même si de grands philosophes comme Bachelard
s’opposent à l’opinion en disant qu’ « il faut la détruire », qu’ « en droit,
l’opinion a toujours tort » il semble important de chercher à comprendre où
chacun veut en venir, faudrait-il étiqueter Arendt comme protectrice de la
notion ? Dans le cas d’Arendt ce n’est pas une défense de cette notion, c’est
une explication plus profonde : peut-on d’un point de vue purement
intellectuel opposé deux textes qui n’ont pas une portée offensive ? Si Arendt
avait voulu défendre l’opinion, elle l’aurait fait dans un manifeste, dans un
pamphlet, en expliquant les vertus de l’opinion, pas en définissant une bonne
opinion. Selon moi, il n’y a pas d’opposition dans ce sujet, simplement une
définition variable en fonction des philosophes du mot opinion qui fait que
certains seront contre, d’autres pour. Il semble remarquable que le conflit
n’est pas le même.
Il semble donc qu’il y ait deux problèmes : d’abord celui qui porte sur la
définition de l’opinion, et ensuite celui de l’impartialité.
La première question est celle de l’opinion. Qu’est-ce que n’est pas
l’opinion ? L’opinion n’est pas un préjugé : une idée reçue qui ne requiert
 6
6
 7
7
1
/
7
100%