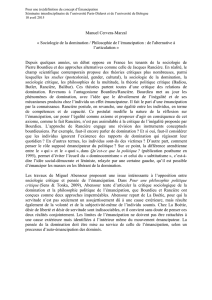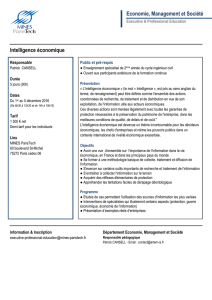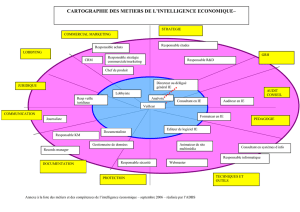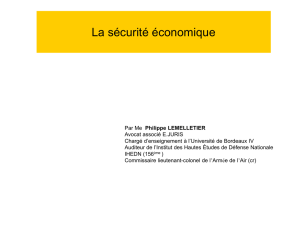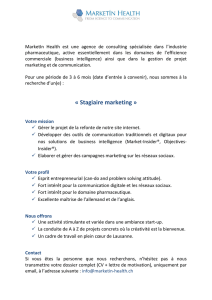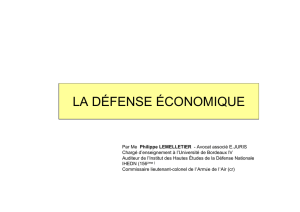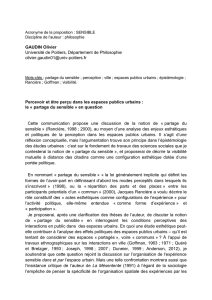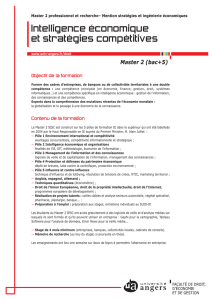http://media.wix.com/ugd/08846d_9e3bf2fd804434c81759e73083521bcf.pdf

Mépris et
reconnaissance sociale
Donner une voix
à ceux dont la parole ne compte pas
Gaëlle Jeanmart (coord.)
Publication pédagogique d’éducation permanente
Publication pédagogique d’éducation permanente
Groupe
Groupe &
&Société
Société
12-me?pris:Mise en page 1 23/01/12 18:34 Page 1

CDGAI
Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl
Publication pédagogique d’éducation permanente
Mépris et reconnaissance sociale
Donner une voix à ceux dont la parole ne compte pas
Coordination du dossier pour PhiloCité
Gaëlle Jeanmart
Auteurs-eures
Gaëlle Jeanmart, Anne Herla, Denis Pieret
Concept et coordination
Marie-Anne Muyshondt - CDGAI
Collection Culture en mouvement - 2011
Éditrice responsable : Chantal Faidherbe
Présidente du C.D.G.A.I.
Parc Scientifique du Sart Tilman
Rue Bois Saint-Jean, 9
B 4102 - Seraing - Belgique
Graphisme : Le Graphoscope
3
12-me?pris:Mise en page 1 23/01/12 18:34 Page 3

Des réactions à nous communiquer,
des expériences à partager,
des questions à poser aux auteurs
des collaborations à envisager ?
Centre de Dynamique des Groupes
et d'Analyse Institutionnelle asbl
Parc Scientifique du Sart Tilman
Rue Bois Saint-Jean, 9
B.4102 - Seraing
Belgique
Marie-Anne MUYSHONDT
Coordinatrice Education permanente
www.cdgai.be
Horaire : 9h à 13h et de 14h à 17h
12-me?pris:Mise en page 1 23/01/12 18:34 Page 4

Les publications d’éducation permanente du CDGAI
La finalité de ces publications est de contribuer à construire des
échanges de regards et de savoirs de tout type qui nous
permettront, collectivement, d’élaborer une société plus
humaine, plus «reliante» que celle qui domine actuellement.
Fondée sur un système économique capitaliste qui encourage la
concurrence de tous avec tous et sur une morale de la respon-
sabilité, notre société fragilise les humains, fragmente leur
psychisme et mutile de nombreuses dimensions d’eux-mêmes,
les rendant plus vulnérables à toutes les formes de
domination et d’oppression sociétales, institutionnelles,
organisationnelles, groupales et interpersonnelles.
La collection Culture en mouvement
La collection «Culture en mouvement» a été développée au
départ d’un cheminement apparenté à la recherche-action.
Les livrets de la collection abordent les questions de la création
culturelle, du récit de vie, de la narration, des ateliers d’écriture,
des fonctionnements collectifs, de la reconnaissance de l’Autre
versus mépris, de l’identité en création, de la transmission, des
partenariats, de la dimension politique de la musique, des luttes
sociales, du sentiment d’appartenance, des étiquettes et des
stéréotypes...
Deux expériences collectives sont la source d’inspiration et de
réflexion des publications 2011 de la collection «Culture en
mouvement» : les projets «Bobine-Bibliothèque de Droixhe» et
«Albalianza». Nous tenons à remercier chaque partenaire,
interlocuteur, intervenant de ces deux projets de l’accueil qu’ils
nous ont réservé, de la franchise de nos échanges,
des cheminements et prises de conscience qu’ils nous ont
ouverts et qui ont permis de mûrir les publications que nous
vous proposons dans cette collection.
5
12-me?pris:Mise en page 1 23/01/12 18:34 Page 5

6
12-me?pris:Mise en page 1 23/01/12 18:34 Page 6
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
1
/
63
100%