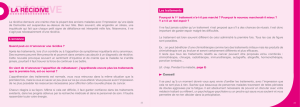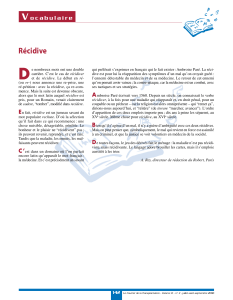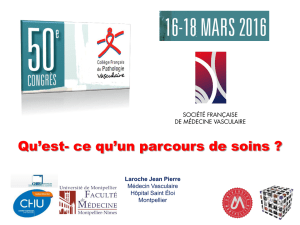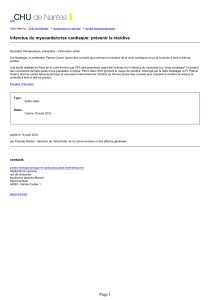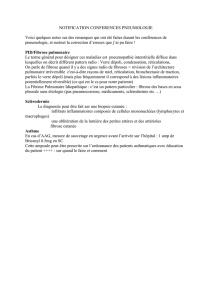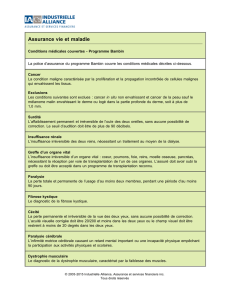U réunion C Actualités sur la transplantation hépatique

60
40
20
0012 34 56
Score de brose (Ishak)
Élasticité du foie (kPa)
18,6 kPa
16 %
6,0 kPa
69 % 8,6 kPa
15 %
Figure 1. Corrélation entre la brose hépatique histologique évaluée selon le score d’Ishak
et l’élasticité mesurée par le FibroScan®.
i
Le Courrier de la Transplantation - Volume VII - n
o 2 - avril-mai-juin 2007
102
Congrès
Actualités sur la transplantation hépatique
57th Congress of the American Association for the Study
of Liver Diseases[1] (AASLD)
F. Saliba*●
[1] Boston, 27-31 octobre 2006.
* AP-HP hôpital Paul-Brousse, centre hépato-biliaire,
Villejuif ; université Paris-Sud ; Inserm, unité 785,
Villejuif.
Une fois de plus, la transplanta-
tion hépatique (TH) a occupé
une place importante au sein
du Congrès de l’AASLD. Une journée
de formation médicale continue (Post-
Graduate Course), riche en conférences
de haut niveau avec des controverses,
était consacrée aux grandes thématiques
actuelles, reprenant des cas cliniques
représentant les principales indications
de la TH. La représentation médicale
française, comme tous les ans, était
importante. Nous résumons ci-dessous
quelques communications qui nous
ont paru intéressantes du point de vue
clinique ou thérapeutique.
PLACE DU FIBROSCAN®
DANS L’ÉVALUATION DE LA FIBROSE
APRÈS TH
(D’après C. Rigamonti et al., Milan,
Italie, abstract 20 actualisé)
L’élastométrie, ayant fait ses preuves chez
le patient non transplanté, commence à
chercher sa place, comme technique non
invasive, dans la surveillance du greffon,
et particulièrement de la brose après
transplantation hépatique. Le groupe
de Milan a comparé, dans une étude
prospective chez 105 patients trans-
plantés, la biopsie hépatique à l’élas-
tométrie réalisée dans le même temps.
La pathologie initiale était une hépatite
virale C (n = 68), une hépatite virale B
(n = 15), une cirrhose biliaire primitive,
une cholangite sclérosante primitive et
d’autres causes (n = 16) ; l’élastomé-
trie était techniquement impossible
chez 6 patients. Les patients ont eu
une biopsie et une élastométrie hépa-
tique avec un délai médian de 32 mois
(extrêmes 6-237 mois). Les biopsies
hépatiques n’étaient retenues que pour
des fragments > 1,5 cm. Le score d’Ishak
était utilisé pour l’évaluation histolo-
gique de la brose. Le FibroScan
®
était
réalisé par deux opérateurs et nécessitait
l’obtention de dix mesures avec un taux
de succès > 65 %. Le coef cient inter-
observateur était de 0,97.
Soixante-neuf pour cent des patients
avaient une brose signi cative de F0
à F2 (F0 : 12 patients, F1 : 39 patients
et F2 : 25 patients), correspondant à
une médiane de valeur d’élasticité de
6,0 kPa. Seize patients (15 %) avaient un
score de brose histologique de stade F3
et une médiane d’élasticité de 8,6 kPa.
Seize pour cent des patients avaient un
score de brose histologique de stade ≥ 4
et une médiane d’élasticité de 18,6 kPa
(figure 1). Dans cette étude, l’élasti-
cité était signi cativement plus élevée
pour un même degré de fibrose chez
les patients ayant une récidive virale C,
probablement en raison de phénomènes
nécrotico-in ammatoires.
Les auteurs retrouvent une corréla-
tion signi cative entre l’élasticité et le
stade histologique de brose (r = 0,71 ;
p < 0,0001). La précision de l’élasto-
métrie était très bonne, avec un score
de brose ≥ F2 reconnu par une élasti-
cité > 7,9 kPa. Une valeur-seuil d’élas-
ticité de 12 kPa semblait permettre de
diagnostiquer les patients ayant une
fibrose sévère ou une cirrhose. Les
seuils discriminants des valeurs de
l’élasticité entre les différents stades de
brose, notamment F1 à F3, sont très
rapprochés, rendant nécessaires d’autres
études comparatives. Un suivi longitu-
dinal des patients et de l’évolution de la
brose pourrait apporter des informa-
tions complémentaires sur la valeur du
FibroScan® chez le patient transplanté.
Cependant, le FibroScan® ne pourrait
pas se substituer à la biopsie hépatique
chez ces patients particuliers, qui ont
souvent d’autres lésions associées.
© Droits réservés

Non préemptif
Préemptif
1
0,76
0,5
0,25
0
01224 364860
Test log-rank
p = 0,006
Probabilité de progression à F2
Mois
Figure 2. Traitement préemptif de la récidive virale C après TH comparé à un groupe histo-
rique de traitement non préemptif : délai de progression histologique de la brose ≥ F2.
i
Le Courrier de la Transplantation - Volume VII - n
o 2 - avril-mai-juin 2007
103
Congrès
TRAITEMENT PRÉEMPTIF
DE LA RÉCIDIVE VIRALE C APRÈS TH.
EFFET HISTOLOGIQUE DE LA RÉCIDIVE
VIRALE C APRÈS TH
(D’après A. Kuo et al., San Francisco,
États-Unis, abstract 3 actualisé)
Les avantages théoriques ou hypothé-
tiques d’un traitement préemptif de la
récidive virale C après TH pourraient
être :
La charge virale C peu élevée durant
la phase post-transplantation immédiate
peut entraîner des réponses virologiques
au traitement antiviral plus élevées.
L’absence de brose, ou du moins de
brose à un stade avancé, implique un
meilleur pronostic histologique post-
traitement.
Le traitement antiviral pourrait ralentir
la progression de la brose, même chez
les non-répondeurs.
Cependant, un traitement antiviral
précoce est très difficile à mettre en
place en pratique, du fait de ses contre-
indications (anémie, thrombopénie,
insuf sance rénale, risque de rejet aigu,
complications chirurgicales…) et de sa
tolérance médiocre, particulièrement à
cette phase.
L’équipe de San Francisco rapporte une
étude rétrospective portant sur l’analyse
d’une cohorte antérieure de 44 patients
transplantés pour une hépatite C et traités
de façon préemptive entre la deuxième et
la sixième semaine post-transplantation
par de l’IFNα-2b ou du PEG-IFNα-2b
✓
✓
✓
seul (n = 22), ou encore par de la riba-
virine en association avec de l’IFNα-2b
ou du PEG-IFN
α
-2b (22 patients). La
réponse virologique soutenue globale
de cette cohorte était de 9 %. Quarante
et un patients ont été retenus. Cette
cohorte était comparée rétrospective-
ment au groupe de patients (n = 45) qui
n’ont pas été traités du tout ou l’ont été
plus tardivement (n = 26 ; 58 %), dont
18 patients (40 %) avant le stade F2 de
brose. Le délai médian du traitement
était de 5,2 mois (extrêmes 2-52,9 mois).
Les résultats de cette analyse montrent
que le délai médian pour développer
une fibrose F > 2 est de 40,5 mois et
33,4 mois respectivement dans le groupe
traité préemptivement et dans le groupe
non traité (p = NS). Cependant, l’analyse
ajustée sur l’utilisation par la suite de
l’IFN avant le stade F2 montre que le
délai de développement d’une brose
supérieure ou égale au stade F2 était
signi cativement plus court (p = 0,006)
chez les patients traités de façon préemp-
tive que dans le groupe comportant des
patients non traités ou traités plus tardi-
vement (figure 2). Dans l’analyse multi-
variée, le traitement préemptif semble
réduire de 52 % le risque de progression
au stade F2 de la brose (RR = 0,48 ; IC95
[0,23-1,03]). Même si le message est inté-
ressant, le traitement préemptif comporte
des risques et n’est applicable qu’à un
faible nombre de patients. Par ailleurs,
cette étude comporte de nombreux biais
méthodologiques et, dans l’état actuel,
le traitement préemptif ne peut pas être
recommandé.
TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE VIRALE C
APRÈS TH PAR PEG-IFN
α
-2a + RIBAVIRINE.
ÉTUDE TRANSPEG : ANALYSE
INTERMÉDIAIRE À 18 MOIS
(D’après Y. Calmus et al., Paris,
abstract 4 actualisé)
L’étude TRANSPEG est une étude
randomisée, en double aveugle, multi-
centrique et française. Cent un patients
transplantés ayant une récidive histo-
logique virale C avec un score Metavir
F > 1 entre un et cinq ans après la greffe
ont été inclus. Ils ont été traités par PEG-
IFNα-2a et ribavirine pendant 12 mois.
À 12 mois, les patients étaient rando-
misés pour poursuivre un traitement
complémentaire pendant 12 mois par
ribavirine ou placebo. L’objectif prin-
cipal de l’étude était la réponse virolo-
gique à 12 mois ( n de la bithérapie)
et à 30 mois (6 mois après la fin du
traitement d’entretien). Les résultats de
l’analyse intermédiaire à 18 mois ont été
présentés : 73,4 % des patients étaient
de génotype 1 ; 91,1 % avaient un score
histologique de brose F1 ou F2, 5,9 %
étaient F3 et 2 % F4. Soixante-quinze
pour cent des patients avaient un traite-
ment immunosuppresseur par tacrolimus
et 25 % un traitement par ciclosporine.
À la n de la première année de traite-
ment par PEG-IFNα-2a et ribavirine,
une réponse virologique (caractérisée
par l’absence de détection de l’ARN du
VHC [< 50 UI/ml]) était observée chez
61 % des patients en intention de traiter
(ITT) [62 sur 101] et chez 75 % de ceux
en per-protocole (PP) [62 sur 83]. À
18 mois, soit après 6 mois de traitement
d’entretien par ribavirine ou placebo, la
réponse virologique était maintenue chez
respectivement 40 % (40 sur 100, ITT)
et 51 % (39 sur 77, PP) des patients.
La réponse virologique à 18 mois était
de 34,6 % pour les génotypes 1 et 4
et de 75 % pour les génotypes 2 et 3
(figure 3, p. 100). La réponse virolo-
gique était signi cativement (p = 0,009)
meilleure chez les patients présen-
tant une créatininémie > 130 μmol/l
(63,6 %) que chez ceux ayant une
valeur de créatininémie < 130 μmol/l
(32,9 %). Cela peut laisser à penser

40 % 51 %
75,0 %
34,6 %
Intention de traiter Per-protocole
100
50
0
100
50
0
PCR négative (%)
PCR négative (%)
Intention de traiter modiée (ITTm)
p = 0,002
Génotype
1 ou 4 Génotype
2 ou 3
Figure 3. Traitement de la récidive virale C après TH par PEG-IFNα-2a + ribavirine. Analyse
intermédiaire : réponse virologique à 18 mois globale et en fonction du génotype .
A B
32,9 % 30,0 %
55,8 %
63,6 %
p = 0,009 p = 0,01
100
50
0
PCR négative (%)
Intention de traiter modiée (ITTm)
100
50
0
PCR négative (%)
(ITTm)
Créatinine
< 130 μmol/l Créatinine
> 130 μmol/l Pas d’EPO
(n = 60) EPO
(n = 40)
Figure 4. Traitement de la récidive virale C après TH par PEG-IFN
α
-2a + ribavirine.
Analyse intermédiaire : réponse virologique à 18 mois en fonction de la créatininémie
et de la prise d’érythropoïétine (EPO) .
A B
i
Le Courrier de la Transplantation - Volume VII - n
o 2 - avril-mai-juin 2007
104
Congrès
versus 56 % avec le placebo ; p = NS).
Néanmoins, il reste à évaluer le béné-
ce histologique de la ribavirine chez les
patients ayant une brose signi cative
(≥ F1) ainsi que les facteurs prédictifs de
réponse virologique soutenue, notam-
ment aux semaines 4 et 12.
RÉCIDIVE VIRALE C POST-TH : QUEL
TRAITEMENT IMMUNOSUPPRESSEUR ?
(D’après C. Fasola et al., Atlanta,
États-Unis, abstract 576 actualisé)
De nombreuses études dans la littéra-
ture ont rapporté une relation entre le
type et la nature du traitement immuno-
suppresseur et la sévérité de la récidive
virale C sur le greffon. L’étude HCV3
est une étude prospective randomisée
(1.1.2) multicentrique de 312 patients
transplantés pour cirrhose VHC et qui
a comparé trois stratégies thérapeu-
tiques :
groupe 1, bithérapie : tacrolimus +
corticoïdes [Cs] (n = 80) ;
groupe 2, trithérapie : mycophéno-
late mofétil [MMF] + tacrolimus + Cs
(n = 79) ;
groupe 3, sans Cs : MMF + tacrolimus +
daclizumab (n = 153).
L’objectif de l’étude est d’évaluer l’ef-
cacité et la tolérance du MMF et d’un
régime sans corticoïdes dans le but de
réduire le risque de rejet, la récidive
virale C et les effets indésirables après
transplantation hépatique. La dose de
tacrolimus était de 0,08-0,12 mg/kg/j,
celle de MMF de 2-3 g/j, celle de dacli-
zumab de 2 mg/kg à J0 et J3 et de 1 mg/kg
à J8 ; les corticoïdes étaient < 10 mg/j à
J30 et < 5 mg/j à J90. Les biopsies hépa-
tiques étaient réalisées systématiquement
à J0, J90, J365 et J730. Les résultats inter-
médiaires à deux ans montrent qu’il n’y
avait pas de différence entre les trois
groupes en termes de survie du patient
(82 %, 81 %, 87 %) et de survie du greffon
(79 %, 80 %, 85 %). L’absence de rejet
aigu histologiquement prouvé était respec-
tivement, dans les trois groupes, de 82 %,
88 % et 91 % (figure 5). L’incidence de
✓
✓
✓
que les patients ayant une insuf sance
rénale auraient des concentrations séri-
ques particulièrement plus élevées de
ribavirine. Parallèlement, les taux de
réponse virologique étaient signi cati-
vement (p = 0,01) plus importants chez
ceux ayant reçu de l’EPO (figure 4). Les
principaux effets indésirables, certains
considérés comme graves par les inves-
tigateurs et nécessitant l’arrêt du trai-
tement antiviral, ont été observés chez
18 % des patients : essentiellement rejet
aigu (2 patients), infection (4 patients),
troubles hématologiques (7 patients),
troubles psychiatriques (3 patients),
insuf sance rénale aiguë (2 patients),
infarctus du myocarde (un patient),
diabète (un patient).
Des données expérimentales et des
données cliniques humaines prélimi-
naires suggéraient un effet antiviral
béné que de la ciclosporine vis-à-vis
du virus de l’hépatite C. Ce mécanisme
a été rapporté comme étant ciblé spéci-
quement pour les virus du génotype 1
et non pour les génotypes 2 et 3. Les
résultats rapportés dans cette étude,
malgré le faible taux de patients rece-
vant de la ciclosporine (25 %), confortent
les données expérimentales. En effet,
les patients de génotypes 1 et 4 avaient
une meilleure réponse virologique à la
bithérapie PEG-IFNα-2a + ribavirine
quand ils étaient sous traitement immu-
nosuppresseur à base de ciclosporine que
quand ils étaient sous tacrolimus (52 %
versus 28 % ; p = 0,03). Dans l’ana-
lyse de régression logistique, seule la
créatinine in uençait signi cativement
la réponse virologique soutenue ; l’âge
du receveur et du donneur, le génotype
et l’inhibiteur de calcineurine utilisés
n’étaient pas significatifs. Chez les
patients transplantés hépatiques, après
12 mois de traitement par bithérapie,
la poursuite d’un traitement d’entre-
tien par ribavirine pendant 24 semaines
ne semble pas apporter de béné ce en
termes de réponse virologique (39 %

82 % 88 % 91 % 17 18 6
p = 0,029
%
100
50
0Bithérapie Trithérapie Pas de Cs
Cs : corticoïdes
Absence de rejet à 2 ans
%
100
50
0Bithérapie Trithérapie Pas de Cs
Sévérité de la récidive
histologique du VHC à 2 ans
57
37
17
66 53
29
Stade 0 Stade
1 ou 2 Stade
3 ou 4
p = NS
Figure 5. Étude HCV3. Résultats à 2 ans : type d’immunosuppression et absence de rejet
et sévérité histologique (Batts-Ludwig) de la récidive virale VHC .
A B
i
Le Courrier de la Transplantation - Volume VII - n
o 2 - avril-mai-juin 2007
105
Congrès
rejet aigu histologiquement prouvé était
signi cativement plus faible (p < 0,05)
dans le groupe 3 (pas de Cs) que dans
le groupe 1 (bithérapie). La sévérité du
rejet aigu, évaluée selon la classi cation
de Banff par les anatomopathologistes
des centres participants, était, pour les
formes classées comme sévères, respec-
tivement de 11 %, 25 % et 0 % (p = NS).
L’incidence de la récidive histologique
(stade Batts-Ludwig > 2 à un an ou > 3 à
tout moment) n’était pas signi cativement
différente dans les trois groupes. Même si
l’incidence de la brose de stade 3 ou 4
était numériquement plus faible dans le
groupe sans corticoïdes, la différence
entre les trois groupes (17 %, 18 % et
6 %) n’était pas signi cative. On notait
une faible incidence, non signi cative,
d’une progression “agressive” de la réci-
dive (augmentation > un stade entre un an
et 2 ans) dans les deux groupes compor-
tant le MMF (groupe 1 : 33 %, groupe 2 :
6 %, groupe 3 : 9 %) [figure 5]. La charge
virale C était comparable dans les trois
groupes. Il n’y avait pas de différence
dans l’incidence du diabète, du cancer,
des infections, de l’hypertension arté-
rielle et de l’hyperlipidémie entre les
trois groupes. Les auteurs concluent que
les résultats intermédiaires de l’étude
montrent que le régime sans corticoïdes
associant daclizumab, MMF et tacro-
limus était bien toléré et associé à une
incidence signi cativement plus faible
de rejet. La récidive virale C dans l’état
actuel de l’avancement de l’étude semble
être comparable, avec une tendance en
faveur du groupe sans corticoïdes.
CARCINOME HÉPATOCELLULAIRE (CHC) :
PEUT-ON ÉLARGIR LES CRITÈRES
DE MILAN AUX CRITÈRES DE L’UCSF,
POUR OU CONTRE ?
(D’après F. Yao et al., San Francisco,
États-Unis, abstract 9 actualisé,
et M. Jatoi et al., Michigan, États-Unis,
abstract 587 actualisé)
Les critères de Milan sont devenus les
critères reconnus et admis par la majorité
des centres de transplantation : un nodule
de diamètre ≤ 5 cm ou ≤ 3 nodules
de diamètre ≤ 3 cm. Plus récemment,
en 2001, l’équipe de San Francisco a
proposé les critères de l’UCSF (Univer-
sity of California San Francisco), qui
vont au-delà des critères de Milan :
un nodule de diamètre ≤ 6,5 cm, ou
≤ 3 nodules de diamètre ≤ 4,5 cm
chacun, avec un diamètre total des
nodules ≤ 8 cm, et classés comme suit :
T1 : un nodule ≤ 1,9 cm ; T2 : un nodule
de 2-5 cm ou 2-3 nodules ≤ 3 cm ; T3 :
un nodule > 5 cm ou 2-3 nodules, dont
au moins un nodule > 3 cm ; T3A :
un nodule de 5-6,5 cm ou ≤ 3 nodules
≤ 4,5 cm chacun (somme < 8 cm). Ces
critères, qui ne sont pas encore admis
par toutes les équipes, particulièrement
en raison de la pénurie des greffons,
nécessitent d’être validés. Le but de
cette étude prospective est d’évaluer les
résultats de la transplantation hépatique
pour CHC en élargissant les critères de
Milan, notamment pour le groupe T3A.
Cent trente-huit patients transplantés
pour CHC ont été étudiés : 106 avaient
les critères de Milan et 32 étaient hors
critères de Milan, mais dans les critères
(T3A) de l’UCSF. Le suivi médian était
de 24 mois (1-64 mois). L’étude montre,
en tenant compte de l’imagerie (scanner
ou IRM) réalisée dans les trois mois qui
précèdent la transplantation, l’absence
de différence en termes de probabilité
de survie sans récidive à 5 ans respec-
tivement entre les patients transplantés
pour CHC selon les critères de Milan
et les 32 autres patients hors critères de
Milan, mais qui sont dans les critères
de l’UCSF (90 % et 93 %). En tenant
compte de l’examen anatomopatholo-
gique du foie natif en post-greffe, la
probabilité de survie à 5 ans sans réci-
dive des 22 patients qui avaient un CHC
au stade > T3A (61 %) était signi cati-
vement inférieure (p < 0,0001) à celle
des 116 autres patients qui restaient
dans les critères de l’UCSF (97 %).
Dans l’analyse univariée, les facteurs
signi cativement prédictifs de la récidive
du CHC étaient une histologie de stade
> T3A (hors critères UCSF), une inva-
sion vasculaire, et un taux d’AFP > 500
ou > 1 000 ng/ml.
Une analyse rétrospective du registre
américain UNOS avait pour but d’éva-
luer les résultats de la transplantation
hépatique pour carcinome hépatocel-
lulaire (CHC) en tenant compte des
critères démographiques, biologiques,
cliniques et des caractéristiques tumo-
rales obtenus au moment de l’inscription
sur la liste d’attente. Selon les données
présentées lors du congrès, 4 482 patients
étaient inscrits sur la liste d’attente de
greffe pour CHC entre janvier 1998 et
décembre 2005. La survie globale des
patients à 3 ans et 5 ans, à partir du
moment de leur inscription sur la liste
d’attente, était respectivement de 62 %
et 48 %. La survie des patients trans-
plantés était signi cativement supérieure
à celle des patients non transplantés
(figure 6, p. 102). La transplantation
réduisait de 76 % le risque de décès à
5 ans (HR = 0,24 ; IC95 : [0,21-0,27]).
Au total, 17 % des patients atteints de
CHC sont décédés ou sortis de la liste
d’attente du fait de la progression de leur
tumeur. Toujours en analysant la survie

TH
62 %
Non TH
Milan +
61 %
Milan – mais UCSF+
80
100
60
20
40
00 20 40 60 80 100
p < 0,0001
Probabilité de survie (%)
Mois
80
100
60
20
40
00 20 40 60 80 100
p < 0,0001
Probabilité de survie (%)
Mois
Figure 6. Étude rétrospective du registre UNOS : 1998-2005 ➙ 4 482 patients inscrits sur
liste pour CHC. Survie à 5 ans en intention de traiter à partir du moment de l’inscription
sur liste d’attente transplantés versus non transplantés et dans ou hors les critères de
Milan, mais dans les critères T3A de l’UCSF.
A B
DV (n = 154)
DC (n = 937)
0,8
1
0,6
0,2
0,4
0012 34567
p < 0,001
Survie (%)
Années
Figure 7. Donneur vivant (DV) versus
donneur cadavérique (DC) : survie à partir
de l’inscription sur la liste.
i
Le Courrier de la Transplantation - Volume VII - n
o 2 - avril-mai-juin 2007
106
Congrès
des patients au moment de leur inscrip-
tion sur la liste d’attente, la survie à 5 ans
des sujets qui étaient dans les critères
de Milan était de 61 %, signi cative-
ment supérieure à ceux qui étaient hors
critères de Milan mais étaient dans les
critères de l’UCSF 16 %. Ces résultats,
concluent les auteurs, ne soutiennent pas
l’expansion des critères de transplanta-
tion pour CHC.
TRANSPLANTATION HÉPATIQUE :
COMPARAISON DONNEUR
CADAVÉRIQUE (DC) VERSUS DONNEUR
VIVANT (DV)
(D’après S.A. Shah et al., Toronto,
Canada, abstract 10 actualisé)
Il s’agit d’une étude rétrospective
évaluant les résultats de la transplan-
tation hépatique, à partir du moment
de l’inscription sur liste d’attente des
patients en fonction du type de donneur
(donneur vivant [DV] versus donneur
cadavérique [DC]). Entre 2000 et
2006, 1 091 patients ont été inscrits
sur liste d’attente de transplantation :
154 avaient un donneur familial appro-
prié (un receveur est décédé sur liste
d’attente et 153 ont été transplantés avec
un foie droit) et 937 n’avaient pas de
donneur familial (350 patients [37 %]
ont été transplantés avec un donneur
cadavérique, 312 [33 %] sont décédés
sur liste d’attente ou ont été délistés et
275 [29 %] étaient toujours en attente
de greffe). Alors que le score de MELD
au moment de l’inscription était compa-
rable dans les deux groupes (DV : 14 et
DC : 15 ; p = NS), le score de MELD
au moment de la transplantation était
devenu signi cativement plus élevé dans
le groupe DC que dans le groupe DV,
et respectivement de 20 (extrêmes : 6-
40) et 15 (extrêmes : 6-40) [p = 0,002].
Le délai d’attente de transplantation
était signi cativement plus long dans
le groupe de DC (6 versus 9,8 mois ;
p < 0,001). Le taux de décès des patients
durant la période d’attente sur la liste de
greffe était de 0,6 % (un patient) dans
le groupe DV et de 20 % (195 patients)
dans le groupe DC (p < 0,001). La survie
à 5 ans après transplantation hépatique
était comparable dans les deux groupes
(DV : 80 % et DC : 81 %). Cependant,
la survie évaluée à partir du moment de
l’inscription sur la liste d’attente était
très significativement en faveur des
patients transplantés avec donneur vivant
(figure 7) [p < 0,001].
L’ACTIVATION DE LA MUTATION JAK2
TYROSINE KINASE PRÉDIT
LA RÉCIDIVE DU SYNDROME
DE BUDD-CHIARI APRÈS TH
(D’après D. Orr et al.,
Londres, Royaume-Uni,
abstract 12 actualisé)
La récidive du syndrome de Budd-Chiari
(SBC) après TH survient chez 2,4 à 30 %
des patients. La mutation génétique de
la tyrosine kinase JAK2 (JAK2V617F)
survient fréquemment chez les patients
atteints d’un syndrome myéloprolifé-
ratif patent ou latent. Le but de cette
étude était d’évaluer si cette mutation
est impliquée dans la récidive du SBC
et dans les complications thromboti-
ques observées après TH pour un SBC.
L’âge médian au moment de la trans-
plantation était de 35 ans (extrêmes : 19-
61 ans). Le délai médian de suivi était
de 45 mois (extrêmes : 1-195 mois).
La survie globale des patients était de
77,7 %. La pathologie thrombogène
sous-jacente était un syndrome myélo-
prolifératif (14 patients, 51,9 %), un
lupus (2 patients, 7,4 %), une maladie de
Behçet (2 patients, 7,4 %), un dé cit en
protéine C (un patient, 3,7 %) et d’ori-
gine idiopathique (8 patients, 29,6 %).
La mutation JAK2V617F était présente
chez 19 patients sur 27 (70,4 %) ; les
huit autres patients avaient la forme
sauvage. La récidive du syndrome de
Budd-Chiari est survenue uniquement
chez les patients avec la mutation de
JAK2. Les complications thromboti-
ques post-TH chez les patients avec
une mutation JAK2V617F (10 patients
sur 19 [52,6 %]) étaient une récidive
du SBC après TH (7 patients sur 19),
une thrombose de l’artère hépatique
(3 patients sur 19), une thrombose
de la veine mésentérique (2 patients
sur 19).
Tous les patients recevaient un traite-
ment anticoagulant après la transplan-
tation. L’aire sous la courbe de l’INR
n’était pas signi cativement différente
chez les patients ayant eu une récidive
de leur maladie comparativement à ceux
n’en ayant pas eu (2,70 versus 2,55).
 6
6
1
/
6
100%