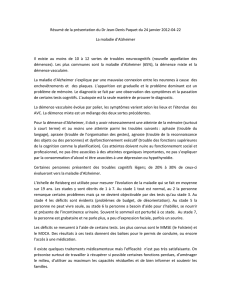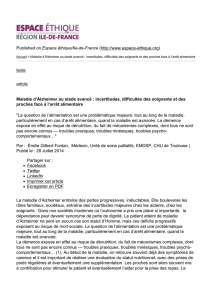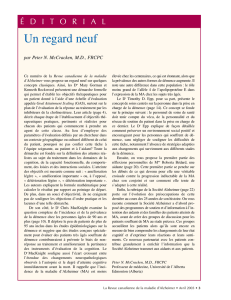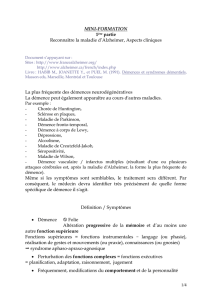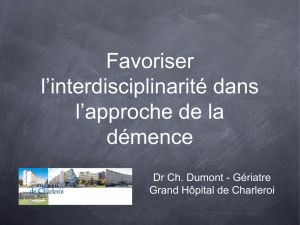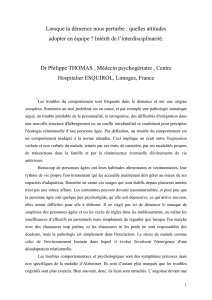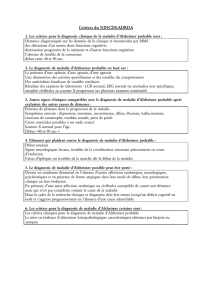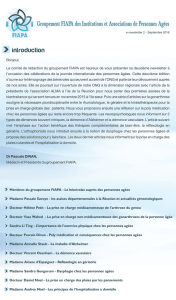U La maladie d’Alzheimer est-elle sous-diagnostiquée ? Mise au point

La Lettre du Neurologue • Vol. XIII - n° 5 - mai 2009 | 141
MISE AU POINT
La maladie d’Alzheimer
est-elle sous-diagnostiquée ?
Is Alzheimer’s disease underdiagnosed?
C. Helmer*
* Inserm U897, université de
Bordeaux 2.
U
n siècle après son identification, la maladie
d’Alzheimer (MA) est devenue un enjeu
majeur de santé publique. Peu d’études
permettent d’en donner les chiffres de prévalence
et d’incidence en France. La source principale de
données françaises est issue de l’étude PAQUID
(Personnes âgées Aquitaine ou QUID des personnes
âgées), étude de cohorte menée en population géné-
rale depuis 1989 en Gironde et en Dordogne chez
des sujets âgés de 65 ans et plus. La prévalence des
démences, incluant la MA, a été estimée en 1989 et
réévaluée en 1999 chez les sujets toujours en vie de
la cohorte initiale, alors âgés de 75 ans et plus. En
extrapolant ces estimations à la population fran-
çaise, le nombre de personnes souffrant de MA ou
de syndromes apparentés est actuellement estimé
à environ 850 000 en France (1). Pourtant, si l’on se
réfère aux deux indicateurs disponibles que sont la
prescription médicamenteuse et la déclaration en
affection de longue durée (ALD 15), les chiffres sont
beaucoup plus faibles : environ 175 000 personnes
étaient traitées par un inhibiteur de l’acétylcholines-
térase en 2005 (2), et on estime à 315 000 le nombre
de personnes en ALD 15 ou sous inhibiteur de la
cholinestérase (données non publiées). Au vu de ces
chiffres, on est en droit de se demander où se situe
la vérité. Plusieurs hypothèses sont possibles : soit
les évaluations surestiment le nombre de personnes
atteintes, soit la MA est sous-diagnostiquée, soit –
ce qui est probable mais n’explique certainement
qu’une partie du phénomène – la mise sous traite-
ment et/ou la déclaration en ALD 15 ne concerne
qu’une partie des personnes diagnostiquées.
Pour intégrer ces différentes hypothèses, il faut
d’abord bien comprendre en quoi consistent les
études de cohortes en population qui fournissent les
estimations actuelles. Le principe de ces études est
de partir d’un échantillon, représentatif de la popu-
lation, en général des personnes âgées de 65 ans
et plus. Grâce à une évaluation du déclin cognitif
au cours du temps, à une recherche systématique
et à un diagnostic actif de la survenue d’une MA,
on peut estimer la prévalence de la maladie dans
cet échantillon. Le diagnostic est essentiellement
clinique, fondé sur la détérioration et l’évolution
des performances cognitives et leur retentissement.
Contrairement à ce qui est parfois avancé, les études
en population ne portent pas le diagnostic de la
maladie de façon très précoce. Par exemple, dans
l’étude PAQUID, le MMSE moyen au moment du
diagnostic de démence lors du suivi à 10 ans était
de 17,2/30, et aucune des personnes diagnostiquées
n’avait un MMSE supérieur à 26. Si l’échantillon
est suffisamment important et représentatif des
personnes âgées, alors cette estimation peut être
considérée comme fiable et permet, en appliquant
La maladie d’Alzheimer est largement sous-diagnostiquée en population ; seule
»
la moitié des sujets atteints est aujourd’hui identifiée.
Il n’existe pas actuellement d’indicateur sanitaire fiable ou de registre permettant
»
un recensement exhaustif des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Le sous-diagnostic est principalement observé chez les personnes les plus
»
âgées.
Même quand il est porté, le diagnostic est souvent tardif, la maladie étant à un
»
stade relativement sévère.
Le diagnostic porté à un stade tardif retarde la prise en charge médicale et médico-
»
sociale.
Le diagnostic de démence n’est pas un diagnostic simple, et le diagnostic
»
étiologique encore moins.
Actuellement, le diagnostic de maladie d’Alzheimer n’est posé qu’à partir du
»
stade de démence.
Encadré. La maladie d’Alzheimer en population.

142 | La Lettre du Neurologue • Vol. XIII - n° 5 - mai 2009
Points forts
La maladie d’Alzheimer est largement sous-diagnostiquée en population. »
Le sous-diagnostic est principalement observé chez les personnes les plus âgées. »
Même quand il est porté, le diagnostic l’est souvent avec retard, à un stade relativement
»
sévère.
Le diagnostic tardif retarde la prise en charge médicale et médico-sociale. »
Actuellement, le diagnostic de maladie d’Alzheimer n’est posé qu’au stade de démence. »
Summary
The number of persons with
Alzheimer’s disease and asso-
ciated disorders is currently
estimated at 850 000 in France.
However, when considering
medical indicators such as
specific medical prescriptions or
persons with long-term illness
declarations (ALD 15), the
figures appear much lower.
The current estimates are
derived from population-
based cohorts. Due to the
underdiagnosis of Alzheimer’s
disease, this study design is
the only valid one to estimate
the number of persons with
Alzheimer’s disease. In the
literature, this underdiagnosis
has been known for many years
in most countries, in particular
at the mild or moderate stage
of the disease. Only half of
the persons with Alzheimer’s
disease are diagnosed today;
this underdiagnosis is particu-
larly predominant among the
oldest old.
Even when persons are diag-
nosed, the diagnosis often
occurs at advanced stages of
the disease, which delays the
medical and medico-social
care. However, this care of the
patient allows to slow down
the progression of the disease
and to reduce the burden for
the families. But for caring the
disease, it is necessary to diag-
nose it first.
Keywords
Alzheimer’s disease
Diagnosis
Care consultation
Elderly
cette prévalence à la population française (par caté-
gories d’âge et de sexe), d’obtenir une estimation
fiable du nombre de personnes malades.
En France, l’étude PAQUID, comme plusieurs autres
cohortes au niveau européen, a commencé entre la
fin des années 1980 et le début des années 1990,
époque à laquelle la MA et les syndromes appa-
rentés n’étaient le plus souvent pas diagnostiqués
et étaient considérés comme un état “normal pour
l’âge”. Si ce type d’étude a été mis en place pour
estimer la prévalence, c’est justement en raison du
sous-diagnostic de la maladie. Même si la situation
a évolué, les données de la littérature montrent
que, aujourd’hui encore, le diagnostic n’est pas
toujours porté ou qu’il l’est à des stades relative-
ment sévères (3, 4). Il n’existe pas actuellement en
France d’indicateur sanitaire fiable, ni de registre
permettant un recensement exhaustif et pérenne des
cas, et l’étude de cohortes est le seul type d’étude
vraiment valide pour obtenir des estimations du
nombre de personnes malades. Les estimations
de prévalence obtenues en France se situent dans
la moyenne de celles relevées dans d’autres pays
européens ou aux États-Unis.
En raison de la méthodologie utilisée et de la répli-
cation des estimations par différentes cohortes dans
différents pays, il est raisonnable de conclure que
l’estimation du nombre de personnes malades est
fiable, et que la discordance entre les estimations
et le nombre de malades réellement pris en charge
est le reflet d’un sous-diagnostic de la maladie. Ce
sous-diagnostic est observé dans la plupart des
pays occidentaux depuis de nombreuses années,
notamment à la phase légère ou modérée de la
maladie (3-6). Seule une démence sur deux est
diagnostiquée, tous stades confondus (3, 6). Aux
stades légers de la maladie, seul un cas sur trois
est connu. Même quand il est posé, le diagnostic
l’est souvent tardivement, à un stade de démence
parfois avancé, ce qui retarde de manière préjudi-
ciable la prise en charge médicale et médico-sociale
des patients et alourdit la charge des familles. Cela
est corroboré par la Facing Dementia Survey, vaste
enquête d’opinion européenne, qui montre que le
délai entre le début de la démence et le diagnostic
est de 24 mois en moyenne en France (7). Ce délai
est de 20 mois au niveau européen, et de 10 mois
seulement en Allemagne, situant la France en
avant-dernière position parmi les 6 pays européens
évalués. La recherche a posteriori des premiers
signes de la maladie est-elle la même dans chaque
pays ? Cela pourrait modifier artificiellement le délai
avant le diagnostic. Ces données ont été recueillies
dans le cadre d’une étude où l’information sur le
début de la maladie était obtenue par entretiens
standardisés. En outre, toujours selon cette étude,
seuls 40 % des patients consultent pour la première
fois à un stade de démence légère, tandis que la
plus grande part (54 %) sont diagnostiqués à un
stade modéré, et certains uniquement à un stade
sévère (7 %).
La situation française ne semble donc pas meilleure
que celle des autres pays. Cependant, il n’existe pas
d’étude spécifique permettant de préciser de façon
certaine l’ampleur du sous-diagnostic en France.
Nous pouvons toutefois en faire une approximation
grâce à l’Étude des trois cités, étude de cohorte en
population générale dont l’objectif était d’étudier
la relation entre pathologie vasculaire et démence.
L’analyse des données de presque 500 personnes
démentes âgées de 65 ans et plus et diagnostiquées
dans cette étude montre qu’environ un tiers de ces
personnes ne se sont jamais plaintes à leur médecin
généraliste et que, parmi les autres, la moitié seule-
ment a ensuite consulté un spécialiste (neurologue,
psychiatre ou gériatre) [figure] (8). La première
prescription de traitement “antidémentiel” étant
réalisée en France par le spécialiste, le recours à ce
dernier est primordial. Le sous-diagnostic de la MA
est principalement observé chez les personnes les
plus âgées : avant 75 ans, près de la moitié des sujets
déments se plaignant à leur médecin traitant consul-
tent également un spécialiste pour leurs troubles,
mais, après 85 ans, seuls 20 % d’entre eux le font
(tableau). Après 85 ans, ce sont donc 4 malades sur
5 qui n’ont pas accès aux procédures diagnostiques
recommandées officiellement. Pourtant, quel que
soit l’âge, les personnes formulent bien une plainte
à leur médecin, mais celle-ci reste sans suite, proba-
blement pour de multiples raisons. Outre l’âge, le
recours au spécialiste est également très dépendant
du niveau d’éducation : les personnes de bas niveau
d’éducation consultent 2 à 3 fois moins souvent un
spécialiste.
Mots-clés
Maladie d’Alzheimer
Diagnostic
Recours aux soins
Personnes âgées

Pas de consultation
Consultation avec le médecin
généraliste uniquement
Consultation avec le médecin
généraliste + spécialiste
(non traité)
Consultation avec le médecin
généraliste + spécialiste (traité)
34 %
31 % 16 %
15 %
34 %
Figure. Recours aux soins des personnes présentant une MA ou un syndrome apparenté
(Étude des trois cités, 1999-2004).
La Lettre du Neurologue • Vol. XIII - n° 5 - mai 2009 | 143
MISE AU POINT
Plusieurs facteurs expliquent cette insuffisance de
diagnostic (9-11). Ils sont liés en premier lieu au
patient lui-même. Une particularité de la MA est
qu’elle entraîne assez rapidement une anosognosie,
c’est-à-dire une perte de conscience de son état par
le patient. Ces facteurs sont également liés à l’entou-
rage, pour lequel la limite entre démence et vieillisse-
ment est souvent floue, en raison probablement de la
fréquence du déclin pathologique dans la population
âgée. Mais, contrairement à la démence, le vieillis-
sement non pathologique n’est responsable que
d’un ralentissement de la vitesse de traitement de
l’information ou de difficultés d’attention partagée,
sans que cela retentisse sur les activités quotidiennes
ou l’insertion socio-professionnelle des sujets. La
mauvaise crédibilité des traitements auprès de la
population explique aussi l’insuffisance du diagnostic.
Dans la Facing Dementia Survey (7), seuls 24 % des
sujets de la population générale considéraient que
ces traitements étaient efficaces. Enfin, l’insuffisance
de diagnostic peut être liée au médecin. La maladie
survenant surtout chez les personnes âgées, il est
parfois difficile de distinguer une affection dégénéra-
tive du retentissement cognitif de troubles sensoriels
ou d’affections générales (polypathologie). De plus,
l’intérêt d’une médicalisation de la maladie n’est pas
toujours évident pour les médecins généralistes,
celle-ci pouvant également faire courir le risque de
sortir le patient de son milieu, de ses repères, et
favoriser une décompensation. Une étude récente,
réalisée certes sur un très petit échantillon, décrit
très bien l’avis de généralistes australiens quant au
diagnostic de la MA et aux facteurs influençant ce
diagnostic (12).
Outre les barrières au diagnostic, le diagnostic de MA
lui-même pose problème. Si le diagnostic de démence
n’est pas simple, le diagnostic étiologique l’est encore
moins. Les difficultés diagnostiques peuvent conduire
à des problèmes de non-identification des cas de
démence, et des erreurs de diagnostic peuvent
survenir. Ces problèmes s’accentuent pour les cas
de sévérité légère à modérée, chez les sujets âgés et
en institution. En l’absence de marqueur biologique
spécifique, le diagnostic clinique de la MA ne peut
en effet pas être un diagnostic de certitude. Il est
probabiliste et repose sur une démarche en deux
temps, avec en premier lieu la mise en évidence d’un
syndrome démentiel, puis d’arguments en faveur
d’une MA. Il faut souligner l’importance d’un examen
neuropsychologique, d’une évaluation psychiatrique
et de la recherche de facteurs de risque vasculaires.
Dans la MA, les premières lésions cérébrales sont
présentes plusieurs années, voire même plusieurs
décennies avant l’apparition des premiers symp-
tômes. Cette longue phase présymptomatique,
durant laquelle les lésions s’installent à bas bruit,
précède une phase de transition où des symptômes
apparaissent sans atteindre les critères de démence.
Mais l’identification de la MA à un stade de sévérité
donné (stade de démence) empêche de diagnosti-
quer la maladie à des stades plus précoces. Ainsi,
les patients qui expriment les premiers symptômes
de la maladie mais qui n’ont pas encore de démence
sont exclus du diagnostic. Ces patients sont dans
une situation intermédiaire : ils présentent un déclin
cognitif, ce qui distingue leur cas du vieillissement
normal. Ce déclin est modéré et ne perturbe pas leur
autonomie : ils ne sont donc pas considérés comme
ayant atteint le stade de la démence. Cette situation
n’est pas propre aux seuls patients atteints de MA
au stade débutant.
Il est clair qu’il n’existe pas aujourd’hui suffisam-
ment d’arguments en faveur d’un dépistage systé-
matique de la MA et des syndromes apparentés
(13). Il y a notamment peu de preuves concernant
Tableau. Recours selon l’âge au médecin généraliste et au spécialiste chez les personnes présen-
tant une MA ou un syndrome apparenté (Étude des trois cités, 1999-2004).
Âge (ans) Plainte au généraliste (%) Consultation spécialisée (%)
65-74 69,1 46,4
75-79 69,1 31,7
80-85 63,5 30,7
> 85 62,5 19,6
p 0,197 < 0,001

144 | La Lettre du Neurologue • Vol. XIII - n° 5 - mai 2009
La maladie d’Alzheimer
est-elle sous-diagnostiquée ?
MISE AU POINT
l’amélioration du pronostic des personnes systéma-
tiquement dépistées, et le rapport bénéfice (d’une
prise en charge précoce)/risque (d’un diagnostic
chez des personnes bien entourées et qui ne se
plaignent pas) n’est pas connu. Mais dépistage
et diagnostic sont deux choses différentes. Et si
le dépistage systématique de personnes qui ne se
plaignent pas ne peut pour l’instant pas être recom-
mandé, le diagnostic plus précoce de personnes
ayant une plainte doit en revanche être encouragé.
En effet, si la MA demeure une maladie que l’on
ne guérit pas, il est possible de la soigner, tout au
moins de freiner son évolution. Il existe aujourd’hui
des médicaments symptomatiques dont l’efficacité
a été démontrée par des études de bonne qualité
conduites en double aveugle. Quatre médicaments
sont actuellement disponibles : trois inhibiteurs de
l’acétylcholinestérase (IAChE) [donépézil, rivastig-
mine, galantamine], et un antagoniste des récepteurs
glutamatergiques de type N-méthyl-D-aspartate
(NMDA) [mémantine]. Ces médicaments sont
d’autant plus bénéfiques qu’ils sont prescrits tôt,
dès le stade léger (IAChE) ou modéré (mémantine).
Il y a donc une perte de chance pour les patients
à ne pas être traités le plus tôt possible. De plus,
en dehors de ces traitements spécifiques, d’autres,
médicamenteux ou non, peuvent être efficaces sur
les différents troubles rencontrés au cours de la
maladie. Plus tôt le diagnostic est posé, plus tôt le
patient est inscrit dans une filière de prise en charge.
Cette médicalisation des patients permet d’éva-
luer les problèmes spécifiques posés par la maladie,
les capacités de l’entourage à y faire face, les besoins
et les aides à apporter tant au patient qu’à son
entourage afin d’anticiper les complications. Le
diagnostic plus précoce de la maladie permet de
préparer la personne et sa famille, d’anticiper, et
ainsi d’améliorer la qualité de vie des sujets et de
leurs proches. La reconnaissance de cette maladie
permet en outre de mieux gérer la prise en charge
des comorbidités. La prescription d’un traitement
pour une comorbidité peut en effet être vouée à
l’échec et aux complications si le patient présente
des troubles cognitifs non reconnus et oublie de ce
fait de prendre son traitement. Cette amélioration
de la prise en charge de la maladie est l’un des axes
du plan Alzheimer 2008-2012, qui prévoit une fonc-
tion de référent médico-social et de coordonnateur,
intervenant dès le diagnostic. Ce coordonnateur
participera à l’évaluation des besoins, planifiera les
services, les soins et l’accompagnement, et veillera
à leur mise en œuvre. Son rôle sera de faire le lien
avec les différents intervenants, à la fois sur le plan
sanitaire et sur le plan social.
Conclusion
La MA est une maladie fréquente, encore mal
reconnue actuellement bien que les choses aient
beaucoup évolué ces dernières années. Même si le
traitement curatif n’existe pas, la prise en charge est
globale et débute par une information des patients
et de leur famille. Mais pour bien prendre en charge
cette maladie, il faut d’abord la diagnostiquer. ◾
1. Ramaroson H, Helmer C, Barberger-Gateau P et al. Preva-
lence of dementia and Alzheimer’s disease among subjects
aged 75 years or over: updated results of the PAQUID cohort.
Rev Neurol (Paris) 2003;159(4):405-11.
2. Pariente A, Helmer C, Merliere Y et al. Prevalence of choli-
nesterase inhibitors in subjects with dementia in Europe.
Pharmacoepidemiol Drug Saf 2008;17(7):655-60.
3. Lopponen M, Raiha I, Isoaho R et al. Diagnosing cogni-
tive impairment and dementia in primary health care – a
more active approach is needed. Age Ageing 2003;32(6):
606-12.
4. Boise L, Neal MB, Kaye J. Dementia assessment in primary
care: results from a study in three managed care systems.
J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2004;59(6):M621-M626.
5. Olafsdottir M, Skoog I, Marcusson J. Detection of dementia
in primary care: the Linkoping study. Dement Geriatr Cogn
Disord 2000;11(4):223-9.
6. Kurz X, Scuvee-Moreau J, Salmon E et al. Dementia in
Belgium: prevalence in aged patients consulting in general
practice. Rev Med Liege 2001;56(12):835-9.
7. Bond J, Stave C, Sganga A et al. Inequalities in dementia
care across Europe: key findings of the Facing Dementia
Survey. Int J Clin Pract Suppl 2005(146):8-14.
8. Helmer C, Peres K, Pariente A et al. Primary and secondary
care consultations in elderly demented individuals in France.
Results from the Three-City Study. Dement Geriatr Cogn
Disord 2008;26(5):407-15.
9. Boise L, Camicioli R, Morgan DL et al. Diagnosing
dementia: perspectives of primary care physicians. Geron-
tologist 1999;39(4):457-64.
10. Van Hout H, Vernooij-Dassen M, Bakker K et al. General
practitioners on dementia: tasks, practices and obstacles.
Patient Educ Couns 2000;39(2-3):219-25.
11. Wilkinson D, Sganga A, Stave C, O’Connell B. Implications
of the Facing Dementia Survey for health care professionals
across Europe. Int J Clin Pract Suppl. 2005;(146):27-31.
12. Hansen EC, Hughes C, Routley G, Robinson AL. General
practitioners’ experiences and understandings of diagnosing
dementia: factors impacting on early diagnosis. Soc Sci Med
2008;67(11):1776-83.
13. Solomon PR, Murphy CA. Should we screen for Alzhei-
mer’s disease? A review of the evidence for and against
screening Alzheimer’s disease in primary care practice.
Geriatrics 2005;60(11):26-31.
Références bibliographiques
1
/
4
100%