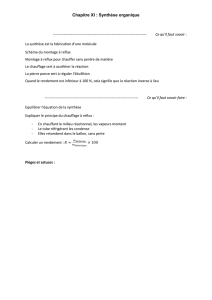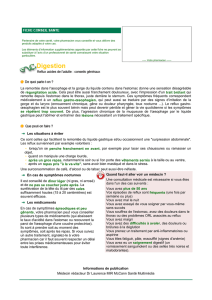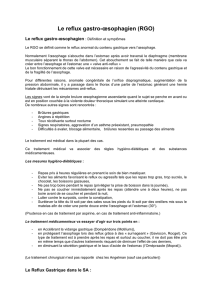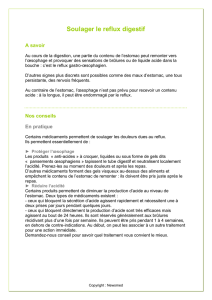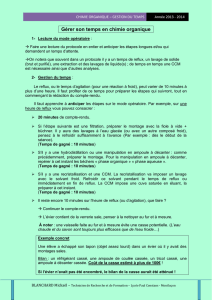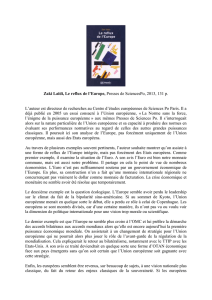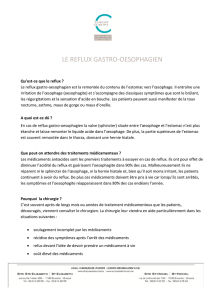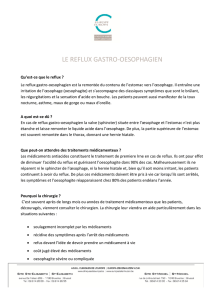Le reflux gastro-œsophagien chez l`enfant

DÉCEMBRE 2007 VOL. 54 N° 12 QUÉBEC PHARMACIE 19WWW.MONPORTAILPHARMACIE.CA
Le reflux gastro-œsophagien
chez l’enfant
Définition et prévalence
Le RGO se définit comme un retour passif
rétrograde du contenu de l’estomac, le re-
fluant gastrique, dans l’œsophage. Il sera
considéré comme physiologique ou normal
à condition de ne pas être associé à des com-
plications2. Le pic d’incidence du RGO de
l’enfance survient généralement entre l’âge
de un et quatre mois3. Cinquante à 60 % des
enfants de 6 mois et moins présenteront au
moins un épisode de vomissements ou de
régurgitation orale par jour, et 15 % à 20 %
d’entre eux en présenteront plus de 4 par
jour. Ce type de reflux se caractérise par une
résolution rapide et spontanée des symptô-
mes vers l’âge de 6 à 12 mois1. Une persis-
tance des symptômes au-delà de cet âge est
rare, mais semble associée à un risque accru
de persistance de la maladie à l’âge adulte4-6.
Après la première année de vie, seulement
5 % des enfants continueront d’avoir un
épisode de vomissement par jour et 1 %
en auront plus de quatre par jour1,7,8. La
prévalence du RGO chez la population
pédiatrique plus âgée et adulte est de 7 % à
20 %9.
Le RGO chez l’enfant est considéré com-
me pathologique (RGOP) lorsqu’il est asso-
cié à des symptômes cliniques importants
ou à un dommage tissulaire. En effet, une
perte ou une prise insuffisante de poids, des
douleurs attribuables à une œsophagite, des
problèmes respiratoires ou un changement
neurocomportemental comptent parmi les
manifestations cliniques dites pathologi-
ques7,10. Certains enfants peuvent souffrir de
RGOP silencieux, c’est-à-dire qu’ils ne pré-
senteront ni symptôme, ni régurgitation ap-
parente7. Parmi les enfants ayant du reflux,
ce dernier sera pathologique pour un sujet
sur 30010. Une histoire antérieure d’atrésie
œsophagienne corrigée chirurgicalement,
de hernie hiatale, de maladie neuromuscu-
laire, de retard développemental ou de
bronchodysplasie pulmonaire, accroît le ris-
que d’en souffrir. Inversement, la présence
de RGOP augmente le risque d’aspiration
pulmonaire, de bronchite, de toux chroni-
que, d’asthme et de bronchiectasies4.
Manifestations cliniques
et complications
La présentation clinique du RGO varie en
fonction de l’âge de l’enfant. Chez les nour-
rissons et les enfants de moins de quatre
ans, le reflux se manifeste principalement
par de la régurgitation et des vomissements
survenant dans les heures suivant les repas1.
Alors que le refluant gastrique remonte
jusqu’au pharynx ou dans la cavité buccale
lors d’épisodes de régurgitation, il sera ex-
pulsé de la bouche lors de vomissements11.
Chez les enfants plus vieux et les adoles-
cents, le tableau clinique s’apparente da-
vantage à celui décrit chez la population
adulte3.
Le RGOP, pour sa part, peut se présenter
non seulement par une gamme de symptô-
mes gastro-intestinaux (ou œsophagiens),
mais également par des symptômes extra-
œsophagiens touchant les poumons ou
d’autres systèmes12. Chez les enfants en bas
âge, les symptômes gastro-intestinaux usuels
rencontrés sont la régurgitation et les vomis-
sements récurrents accompagnés d’une
perte ou d’une prise insuffisante de poids,
une difficulté à s’alimenter, l’anorexie, les
troubles du sommeil, l’irritabilité générali-
sée ou les pleurs persistants1,7,10.
Dans la population pédiatrique plus âgée,
le tableau clinique est dominé par de la
douleur épigastrique, du pyrosis, de la dys-
phagie, des nausées matinales, des vomis-
sements récurrents ou de l’inconfort abdo-
minal. Parmi les symptômes rapportés, la
prévalence de la sensation de brûlement
gastrique, de douleur épigastrique et la ré-
gurgitation augmente avec l’âge. L’inci-
dence de ces symptômes est respective-
ment de 1,8 %, 7,2 % et 2,3 % chez les
enfants de 3 à 9 ans et de 5,2 %, 5,0 % et
8,2 % chez les adolescents de 10 à 17 ans.
Le reflux gastro-œsophagien (RGO) est fréquent chez les jeunes enfants et se manifeste généralement par de la régurgitation
ou des vomissements répétés. Chez la grande majorité d’entre eux, le reflux sera de nature bénigne et n’entraînera pas de complications
à court terme ou d’entrave à leur développement. Une résolution graduelle et spontanée des symptômes survient généralement vers
l’âge de 6 à 12 mois, et ce, sans requérir à un traitement médical énergique1. Dans cet article, nous présenterons la physiopathologie
du RGO, le diagnostic et le traitement du RGO, incluant les mesures non pharmacologiques et les options pharmacothérapeutiques.
Texte rédigé par Ingrid Wagner, B. Pharm.,
C. Ph., et Isabelle Laverdière, B. Pharm., M.Sc.,
Centre mère-enfant, CHUL, CHUQ, Québec.
Révision : Dre Anna Wieckowska,
pédiatre, gastro-entérologue,
et Chantal Duquet, pharmacienne.
Texte original soumis le 3 octobre 2007.
Texte final remis le 10 octobre 2007.
Publié grâce à une subvention sans restrictions de
LES PAGES BLEUES

20 QUÉBEC PHARMACIE VOL. 54 N° 12 DÉCEMBRE 2007
Les adultes, pour leur part, présentent de la
douleur gastrique dans 17,8 % des cas et de
la régurgitation dans 6 % des cas3. Toute-
fois, la survenue de brûlement gastrique
est influencée par la sensibilité œsopha-
gienne interindividuelle et ne corrèle pas
nécessairement avec la présence de dom-
mages de la muqueuse13. Parmi les autres
complications gastro-intestinales du re-
flux, notons l’œsophagite ainsi que l’œso-
phage de Barrett et l’adénocarcinome ob-
servés à l’âge adulte14,15. L’anémie ferriprive
et l’hématémèse sont des complications
moins communes mais tout aussi préoc-
cupantes7,14.
La présentation des symptômes extraœso-
phagiens n’est pas dépendante de l’âge de
l’enfant, outre les épisodes d’apnée et de
bradycardie. En effet, l’apnée est présente
surtout chez les prématurés et les nourris-
sons. Les manifestations extraœsophagien-
nes les plus fréquentes sont la toux chroni-
que, le bronchospasme, le wheezing et le
stridor récurrent. On a également observé
l’association du reflux avec les érosions den-
taires, la douleur à la gorge, les otites, la la-
ryngite et les sinusites12,16. Une pneumonie
d’aspiration récurrente est également possi-
ble, particulièrement chez les enfants at-
teints de troubles neurologiques concomi-
tants. De rares cas de syndrome de Sandifer
sont observés. Ce syndrome se caractérise
par des mouvements anormaux du corps et
une hyperextension du cou associés à une
modification neurocomportementale17.
Physiopathologie
L’étiologie exacte du RGO n’est pas bien
établie et elle est souvent d’origine multi-
factorielle chez les enfants en santé. Des
épisodes de relaxation transitoire inappro-
priée des muscles lisses du sphincter œso-
phagien inférieur, non coordonnée avec le
processus de déglutition, est le principal
mécanisme responsable du RGO chez la
population pédiatrique. Cette incoordina-
tion permet au contenu de l’estomac de re-
fluer dans l’œsophage11,18,19. Un retard dans
la vidange gastrique pourrait également fa-
voriser le phénomène de reflux en augmen-
tant la distension de l’estomac et la produc-
tion des sécrétions gastriques acides2,18. De
plus, la clairance œsophagienne du maté-
riel refluant est parfois inadéquate. La fré-
quence accrue du reflux chez les jeunes en-
fants concorde avec l’immaturité de leur
système digestif. Les facteurs environne-
mentaux sont souvent contributifs, in-
cluant le régime alimentaire et un position-
nement inapproprié1,3. En particulier, la
grande quantité de liquide prise quotidien-
nement par les nourrissons contribue au
phénomène de reflux. Leur consommation
liquidienne moyenne est deux fois plus im-
portante en quantité que celle des enfants
et des adultes2. Enfin, le stress est un facteur
contributif non négligeable de la percep-
tion des symptômes.
Les complications œsophagiennes possi-
bles lors du RGOP sont attribuables à plu-
sieurs processus survenant en dehors des li-
mites physiologiques usuelles. En effet, le
RGOP peut résulter d’une exposition pro-
longée de l’œsophage au refluant (clairance
inappropriée des sécrétions acides, aug-
mentation de la quantité ou de la fréquence
des reflux), d’une baisse de la résistance de
la muqueuse œsophagienne au contenu
acide de l’estomac ou d’une augmentation
de la sensibilité de celle-ci aux sucs gastri-
ques7,18.
Les symptômes extraœsophagiens s’expli-
quent par trois mécanismes généraux. Tout
d’abord, la présence de refluant dans les
voies respiratoires peut entraîner leur obs-
truction mécanique et entraver leur fonc-
tionnement optimal (p. ex., dysfonction de
la trompe d’Eustache, anomalie du drainage
des sinus). Ensuite, le reflux du contenu
gastrique peut causer des dommages aux
voies respiratoires par une agression chimi-
que directe des tissus. Cette agression favo-
rise la production de médiateurs inflamma-
toires qui pourront ultérieurement entraîner
une obstruction par inflammation des mu-
queuses. Parmi les manifestations cliniques
possibles médiées par ce mécanisme, no-
tons de l’hypertrophie épithéliale, la laryn-
gite et la pneumonite. Enfin, des influx ner-
veux générés par la présence du refluant
dans les voies aériennes ou dans l’œsophage
favorise l’hyperactivité bronchique et la
constriction des muscles lisses bronchiques.
La toux, le laryngospasme et le broncho-
spasme secondaires au reflux sont engen-
drés par ce mécanisme3,20.
Diagnostic
La plupart du temps, les tests diagnosti-
ques spécialisés ne sont pas requis pour
confirmer la présence de RGO. Une histoi-
re médicale exhaustive et un examen phy-
sique suffisent généralement pour établir
le diagnostic, évaluer les complications et
instaurer un traitement approprié. Ainsi,
la nature et la fréquence des symptômes
(gastro-intestinaux et extra-intestinaux),
les facteurs provoquant et soulageant se-
ront clarifiés. Les antécédents médicaux,
familiaux et sociaux sont très importants.
Une réponse positive au traitement est
souvent utilisée comme preuve du dia-
gnostic du reflux et permet d’éviter des
tests plus invasifs. On devrait envisager
une investigation plus poussée lorsque le
diagnostic est incertain, des complications
sont suspectées ou en cas d’échec au traite-
ment pharmacologique7,20.
Diagnostic différentiel
Dans le diagnostic différentiel, les anoma-
lies du tractus digestif telles que la sténose
du pylore, la malrotation, l’allergie aux pro-
téines bovines, l’ulcère peptique et les infec-
tions virales devront être éliminées. Les in-
fections et l’obstruction de l’arbre urinaire
doivent aussi être écartées. Parmi les mala-
dies pouvant avoir des symptômes com-
muns avec le RGOP, citons les troubles neu-
rologiques, les anomalies métaboliques, les
intoxications médicamenteuses et certaines
pathologies respiratoires3.
Monitoring 24 heures du pH œsophagien
L’examen diagnostique considéré comme
le standard d’excellence pour détecter le re-
flux acide est le monitoring du pH œso-
phagien pendant une période continue de
24 heures. Des électrodes placées dans
l’œsophage détecteront les baisses de pH.
Une diminution de ce dernier à une valeur
inférieure à quatre est considérée comme
un épisode de reflux acide. Cet examen
permet de déterminer la fréquence et le
pourcentage d’exposition de l’œsophage au
refluant, et d’obtenir différents scores nous
aidant à confirmer la présence d’un reflux
pathologique. On notera que le traitement
pharmacologique antireflux devrait être
cessé plusieurs jours avant l’examen à
moins que le but soit d’en déterminer l’effi-
cacité clinique7. Ainsi, des indications par-
ticulièrement utiles de la pHmétrie sont de
confirmer un reflux silencieux, d’évaluer la
présence du reflux acide lorsqu’il y a persis-
tance de symptômes sous traitement, et de
corréler les symptômes du patient aux épi-
sodes de reflux.
La spécificité de cet examen est de 95 %.
La sensibilité est de 90 % à 95 % chez les
adultes présentant un reflux accompagné
de lésions endoscopiques et diminue à 50 %
en l’absence de lésions20.
Bien que l’étude du pH œsophagien soit
utile pour confirmer le diagnostic chez cer-
tains sujets, il ne permet pas d’infirmer un
RGOP hors de tout doute. Un enfant peut
présenter des symptômes de reflux malgré
une exposition physiologique de l’œsopha-
ge au contenu de l’estomac. Inversement,
une exposition anormale de l’œsophage au
refluant acide ne se traduira pas nécessaire-
ment en RGOP. Également, aucune donnée
LES PAGES BLEUES

DÉCEMBRE 2007 VOL. 54 N° 12 QUÉBEC PHARMACIE 21WWW.MONPORTAILPHARMACIE.CA
ne permet à l’heure actuelle de prédire le
pronostic des enfants atteints de RGOP en
fonction des études du pH7,21.
Autres examens diagnostiques
Le barium et la radiographie de contraste,
bien qu’inappropriés pour diagnostiquer
le reflux, permettent d’éliminer la présen-
ce d’anomalies gastro-intestinales telles
qu’une hernie, une atrésie de l’œsophage
ou une malrotation, et peuvent démontrer
des complications du RGOP telles que des
sténoses. Ils sont les examens de première
intention le plus souvent réalisés12,22.
L’endoscopie avec biopsie permet de diffé-
rencier l’œsophagite secondaire au reflux
des œsophagites résultant d’autres causes
(allergie, infections, éosinophilie), de déce-
ler la présence d’une maladie du tractus gas-
tro-intestinal et de visualiser les dommages
tissulaires, le cas échéant. Toutefois, l’absen-
ce d’anomalies endoscopiques n’exclut pas
le RGOP7,12.
La scintigraphie gastro-œsophagienne
permet de qualifier le processus de vidange
gastrique. Cette méthode permettra d’iden-
tifier un retard de la vidange gastrique, de
différencier les aspirations dues au reflux de
celles résultant d’une incoordination du
processus de déglutition7,22.
Enfin, l’étude de la résistance électrique
de la lumière œsophagienne (l’impédance-
métrie) est une technique récente et pro-
metteuse qui permet de tracer un portrait
précis des épisodes de reflux. Tout comme
le monitoring du pH œsophagien, elle sera
en mesure de déterminer la fréquence, la
durée et la hauteur atteinte par le reflux.
Cette technique a l’avantage de pouvoir
répartir le reflux acide du reflux non acide.
Toutefois, les coûts matériels, la complexité
de la technique et l’absence de valeur com-
parative pédiatrique en font un test peu pra-
tique à l’heure actuelle23,24.
Traitement
Le but du traitement est de diminuer ou,
idéalement, d’éliminer les symptômes, de
guérir l’œsophagite, de prévenir les com-
plications, de permettre à l’enfant d’avoir
une croissance normale. Le traitement
comprend trois volets, soit le changement
des habitudes de vie, les traitements phar-
macologique et chirurgical. Bien que ces
trois volets soient parfois entrepris en
même temps, la majorité des enfants
n’auront besoin d’aucun traitement. Seul
un suivi de la croissance et une surveillan-
ce des signes de reflux érosif sont suffi-
sants. Un traitement plus énergique s’avé-
rera nécessaire pour les enfants atteints de
problèmes neurologiques, car ces derniers
ont plus tendance à développer des com-
plications liées au RGO25.
Traitement non pharmacologique
Habitudes de vie
Plusieurs études ont été réalisées pour dé-
terminer l’influence du positionnement de
l’enfant sur la fréquence des RGO. La posi-
tion verticale en post-prandial semble par-
fois diminuer le reflux clinique bien que les
résultats d’études soient variables26. Tobin et
ses collaborateurs ont étudié les quatre po-
sitions suivantes : couché sur le ventre, cou-
ché sur le dos, couché sur le côté droit et
couché sur le côté gauche, sans tenir compte
du fait que la tête de l’enfant soit inclinée
ou non. On a montré des différences statis-
tiquement significatives entre les positions,
favorisant la position couchée ventrale et la-
térale gauche27. Chez les enfants de moins
d’un an, les bénéfices obtenus avec la posi-
tion couchée ventrale doivent être mesurés
par rapport aux risques d’augmentation de
mort subite du nouveau-né associés avec
cette position. Pour les enfants âgés de plus
d’un an, aucune étude ne fait mention d’une
position particulière à adopter. Certains
auteurs extrapolent les données obtenues
chez l’adulte et recommandent la position
couchée sur le côté gauche avec la tête suré-
levée28. Sur le plan de l’alimentation, on pri-
vilégie de petits repas fréquents et on limite
la prise de liquides durant les repas afin de
diminuer la distension gastrique. On suggè-
re d’éviter les repas lourds avant le coucher
ou l’activité physique et on diminue la prise
d’aliments dits irritants comme les jus
d’agrumes et de tomates, les aliments épi-
cés, le café et l’alcool. De plus, il est primor-
dial de mettre l’accent sur le rôle néfaste du
stress sur la perception des symptômes du
RGO.
Laits spécialisés
Les laits maternisés épaissis avec du riz et
l’introduction de la nourriture solide rédui-
sent les symptômes cliniques du RGO, mais
non le pourcentage d’exposition de l’œso-
phage au reflux acide déterminé par la sur-
veillance du pH œsophagien. Les diarrhées
et la toux sont à surveiller avec l’utilisation
des laits épaissis. De plus, le surplus de calo-
ries obtenu avec les agents épaississants peut
être bénéfique pour les enfants de petit
poids. Lorsqu’on soupçonne une allergie
aux protéines bovines, on peut essayer d’uti-
liser une formule sans ces protéines pen-
dant une à deux semaines. Si la préparation
lactée est changée pour du lait de soya, il
faut demeurer vigilant puisque 20 % des en-
fants avec une allergie aux protéines bovines
sont aussi allergiques au soya.
Traitement pharmacologique
Le principal objectif du traitement du RGO
est de maîtriser les symptômes et de préve-
nir ses complications. Les différents agents
pharmacologiques pour le traitement du
RGO influencent les facteurs responsables
de cette pathologie, soit la maîtrise de l’aci-
dité gastrique (antiacides, antagonistes des
récepteurs H2 de l’histamine, inhibiteurs de
la pompe à protons) la protection de la mu-
queuse et l’augmentation de la vidange gas-
trique (agents procinétiques). Quelques-
uns de ces médicaments sont approuvés
chez les enfants.
Chez le nourrisson souffrant de RGO, les
antagonistes des récepteurs H2 de l’histami-
ne sont utilisés en première ligne, en ajou-
tant les procinétiques au besoin. Chez les
enfants plus âgés et les adolescents, les inhi-
biteurs de la pompe à protons sont souvent
plus efficaces pour maîtriser les brûlements
et les sensations du RGO. Les agents proci-
nétiques aident à réduire les nausées ou les
vomissements occasionnés par une dimi-
nution de la vidange gastrique.
Classes de médicaments
Les antiacides
Les antiacides neutralisent l’acide gastrique
en diminuant l’exposition de l’œsophage au
refluant lors d’épisodes de reflux. On peut
les utiliser pour un traitement à court terme
et souvent en concomitance avec des agents
antisécrétoires. De hautes doses d’hydroxy-
de de magnésium et d’aluminium ont dé-
montré une efficacité équivalente à la cimé-
tidine pour le traitement de l’œsophagite
chez les enfants de 2 à 42 mois25. La néces-
sité d’une prise journalière fréquente, les
effets indésirables entraînés par leur haut
contenu en sel d’aluminium et de magné-
sium ainsi que leur implication dans plu-
sieurs interactions médicamenteuses, en
Cas clinique
Mme L. se présente à la pharmacie. Elle a
des questions à propos des régurgitations de
son fils âgé de trois mois. Vous la sentez très
inquiète et anxieuse. Elle vous mentionne
que son enfant régurgite environ 15 millili-
tres de lait deux à trois fois par jour dans
l’heure qui suit les boires. Quels sont les
informations supplémentaires à obtenir et
les éléments à considérer pour déterminer
la gravité du reflux chez ce bébé ? Que direz-
vous à la mère pour la rassurer ?
Le reflux gastro-œsophagien chez l’enfant

22 QUÉBEC PHARMACIE VOL. 54 N° 12 DÉCEMBRE 2007
font des agents utilisés principalement com-
me traitement d’appoint de façon intermit-
tente et à court terme. La prudence est
de mise lors de l’utilisation des antiacides
qui contiennent de l’aluminium, en raison
de leur potentiel d’effets indésirables tels
qu’une neurotoxicité, une anémie et une os-
téopénie29. On recommande une dose de
0,5 à 2 mL/kg/dose 1 heure après les repas
et au coucher30.
Protecteurs de la muqueuse
Le sodium alginate (GavisconMD) forme un
gel protecteur qui flotte au-dessus du conte-
nu gastrique. Il diminue la régurgitation du
contenu gastrique dans l’œsophage et pro-
tège la muqueuse œsophagienne. Toutefois,
les études montrent des résultats contradic-
toires sur son efficacité. Le sucralfate (Sul-
crateMD), pour sa part, adhère aux lésions
peptiques de la muqueuse inflammée et
forme une couche protectrice aidant à leur
guérison. Il a montré une efficacité similaire
aux antagonistes des récepteurs H2 de l’his-
tamine dans le traitement de l’œsophagite29.
Les données ne sont pas suffisantes pour
appuyer l’utilisation de ces deux agents dans
le traitement chronique du RGOP chez
l’enfant. De plus, le sucralfate contient de
l’aluminium et son absorption peut amener
une toxicité chez l’enfant.
Agents procinétiques
La cause première du RGO est une relaxa-
tion transitoire du sphincter œsophagien in-
férieur. Les agents procinétiques augmen-
tent la vitesse de la vidange gastrique,
améliorent le péristaltisme œsophagien et
augmentent la pression du sphincter œso-
phagien inférieur. Ils représentent donc le
traitement idéal du reflux. Malheureuse-
ment, leur réponse clinique est variable et
leurs effets indésirables limitent leur utilisa-
tion. Ils n’ont aucun effet sur la suppression
de la production de l’acide gastrique. Le mé-
toclopramide (ReglanMD) est un antagoniste
des récepteurs dopaminergiques et possède
également un effet cholinergique et séro-
toninergique. Il stimule la motilité gastro-
intestinale haute, augmente le tonus du
sphincter œsophagien inférieur et accélère la
vidange gastrique. Son utilisation chez les
enfants a été évaluée dans quatre études ran-
domisées et contrôlées avec placebo, et deux
d’entre elles rapportent une diminution du
volume et de la fréquence des vomissements,
les deux autres ne rapportent aucun change-
ment significatif des symptômes par rapport
au groupe placebo1. Le métoclopramide a
des effets au niveau du système nerveux cen-
tral notamment des symptômes extrapyra-
midaux chez environ 20 % des enfants trai-
tés. La diphenhydramine peut diminuer ces
effets indésirables, mais on l’utilise peu en
raison de la somnolence qu’elle entraîne. Le
métoclopramide est métabolisé par le cyto-
chrome P450. Il est, entre autres, un faible
inhibiteur du CYP2D6. La dose de métoclo-
pramide utilisée dans le RGOP est de 0,5 à
1 mg/kg/jour divisée en trois à quatre prises.
Cette dose est beaucoup plus faible que celle
utilisée contre les nausées qui surviennent à
la suite d’une chimiothérapie30.
Le dompéridone, un antagoniste des ré-
cepteurs D2 de la dopamine périphérique,
est fréquemment utilisé en pédiatrie. Il en-
traîne moins d’effets indésirables au niveau
du système nerveux central comparative-
ment au métoclopramide. Il peut tout de
même causer des symptômes gastro-intes-
tinaux et des épisodes de mouvements ocu-
logyriques chez les jeunes enfants. Il est mé-
tabolisé par le cytochrome P450 et est
impliqué dans certaines interactions. Il ré-
duit la durée des reflux post-prandiaux et
est utilisé pour traiter la régurgitation et les
vomissements, mais, encore une fois, la ré-
ponse clinique varie. La dose utilisée est de
0,2-0,6 mg/kg/dose trois à quatre fois par
jour. Depuis que le cisapride a été retiré du
marché en 2000, il est devenu l’agent proci-
nétique le plus utilisé.
Le béthanéchol (UrécholineMD) et l’éry-
thromycine ont aussi été évalués chez les
enfants. Le béthanéchol est un agoniste
cholinergique qui stimule directement les
récepteurs muscariniques, diminuant ainsi
la motilité gastro-intestinale basse. L’éry-
thromycine est un agoniste des récepteurs de
la motiline qui augmente l’activité motrice
de l’estomac et de l’intestin. Elle est surtout
utilisée lors de gastroparésie postopératoire
et diabétique. Peu d’études ont réussi à mon-
trer que ces agents ont un effet sur le sphinc-
ter œsophagien inférieur ou sur la réduction
de la fréquence des épisodes de reflux. Une
association a été démontrée entre son utili-
sation et le développement de sténoses pylo-
riques hypertrophiques chez les jeunes en-
fants.
Le cisapride est un agent sérotoninergique
qui facilite la libération d’acétylcholine au
niveau des synapses de la paroi intestinale. Il
possède un effet procinétique prouvé au ni-
veau du sphincter œsophagien inférieur et
au niveau de l’estomac. Le cisapride est un
des médicaments qui a été le plus étudié
dans le RGOP chez les enfants et il montre
une efficacité dans l’amélioration de l’index
de reflux. Il n’a jamais été approuvé chez les
enfants âgés de moins de 12 ans, mais il a été
très utilisé chez ce groupe d’âge. Malheu-
reusement, le taux élevé d’effets cardiaques
potentiellement mortels tels que l’augmen-
tation de l’intervalle QT, les arythmies car-
diaques ainsi que des morts subites a mis
des restrictions à l’usage du cisapride. Ce
dernier n’est accessible maintenant que par
le programme d’accès spécial via la Direc-
tion générale de la protection de la santé. La
dose usuelle est de 0,1 à 0,2 mg/kg/dose 3 à
4 fois par jour administré 15 à 30 minutes
avant le repas. On l’utilise en cas d’échec au
dompéridone. Un électrocardiogramme est
souvent recommandé avant de débuter cet-
te médication. La prudence est de mise
quant à une co-administration de médica-
ments contre-indiqués.
Le baclofène est un agoniste de l’acide
gamma-aminobutyrique (GABA B) lequel,
malgré son absence d’effet procinétique, a
démontré son action au niveau de l’inhibi-
tion de la relaxation du sphincter œsopha-
gien inférieur et il semble prometteur pour
cette raison. Il est encore peu utilisé chez
les enfants pour cette indication. Dans
l’étude d’Omari et ses collaborateurs, les
épisodes de relaxation du sphincter œso-
phagien et de RGO ont été moins fréquents
chez les enfants ayant été traités par le
baclofène (0,5 mg/kg/dose) comparative-
ment au groupe placebo. Le baclofène
améliorerait la plupart des mécanismes
pathophysiologiques associés au RGO. Les
effets indésirables de ce médicament tels
que les étourdissements, la fatigue et l’abais-
sement du seuil de convulsions limitent
toutefois son utilisation.
Antagonistes des récepteurs H2
de l’histamine
L’histamine, l’acétylcholine et la gastrine
sont des médiateurs chimiques qui stimu-
lent les cellules pariétales de l’estomac à
produire de l’acide en réponse à la nourri-
ture. L’histamine agit via les récepteurs H2
Cas clinique (suite)
Quatre mois plus tard, Mme L. vous contacte
à nouveau pour son fils. Depuis quelques
semaines, son enfant présente une toux
sans symptômes apparents d’infection des
voies respiratoires supérieures. De plus, il
pleure plusieurs heures par jour et est diffici-
lement consolable. Elle est également
inquiète puisqu’elle trouve que sa prise de
poids est lente et insuffisante selon sa
courbe de croissance. L’enfant présente tou-
jours un à deux épisodes de reflux apparent
par jour. Qu’en pensez-vous ? Que recom-
mandez-vous à Mme L. ?
LES PAGES BLEUES

DÉCEMBRE 2007 VOL. 54 N° 12 QUÉBEC PHARMACIE 23WWW.MONPORTAILPHARMACIE.CA
de l’histamine localisés sur les cellules parié-
tales. Les antagonistes des récepteurs H2 de
l’histamine (ARH2) sont utilisés afin de di-
minuer la sécrétion de l’acide gastrique en
compétition avec l’histamine au niveau des
récepteurs. Cette classe de médicaments se-
rait surtout efficace pour l’élimination de la
sécrétion d’acide gastrique nocturne25. Ils
sont surtout utilisés comme traitement de
première ligne. Plusieurs études contre pla-
cebo ont montré l’efficacité des ARH2 (ci-
métidine, ranitidine, famotidine, nizatidi-
ne) chez l’adulte ainsi que quelques études
pédiatriques. Néanmoins, l’efficacité de ce
groupe de médicaments dans la guérison de
l’œsophagite est de l’ordre de 60 % à 70 %,
ce taux étant inférieur à celui obtenu par les
inhibiteurs de la pompe à protons29. Dans
certaines études, la durée pendant laquelle
le pH gastrique demeurait en bas de 4 a été
diminuée de 44 % lorsque la ranitidine était
donnée 2 fois par jour et réduit de 90 % si sa
fréquence d’administration était optimisée
à 3 fois par jour. Bien qu’il n’y ait pas d’étu-
des randomisées sur l’utilisation de la rani-
tidine et de la famotidine chez les enfants,
les experts croient que leur efficacité est si-
milaire à la cimétidine et à la nizatidine. Les
posologies recommandées chez les enfants
sont présentés au tableau I. En cas d’absence
de réponse, la maximisation de la dose est
importante, car une dose inadéquate est
une cause fréquente d’échec au traitement.
En cas d’insuffisance rénale, on doit dimi-
nuer la dose. Une augmentation du pH
gastrique par les ARH2 amène certaines in-
teractions avec les médicaments qui néces-
sitent un pH gastrique acide pour être
absorbés. Les médicaments tels que le kéto-
conazole, l’itraconazole, l’ampicilline et la
digoxine en sont des exemples. L’utilisation
de la ranitidine est à privilégier en raison de
sa faible incidence d’interactions avec les
médicaments métabolisés par le cytochro-
me P450. Bien qu’assez rares, les maux de
tête, les éruptions cutanées, les nausées, les
vomissements, la diarrhée, la constipation,
la fatigue et l’irritabilité font partie des effets
indésirables rapportés avec les ARH2. La ta-
chyphylaxie est assez fréquente et limite leur
utilisation prolongée31.
Inhibiteurs de la pompe à protons
Les inhibiteurs de la pompe à protons
(IPP), qui sont des benzimidazoles, inhi-
bent la sécrétion de l’acide gastrique des
cellules pariétales de l’estomac en se liant
de façon irréversible à la pompe à pro-
tons hydrogène/potassium ATPase blo-
quant ainsi l’échange de l’ion hydrogène
nécessaire à la production de l’acide hy-
drochlorhydrique. Ces agents maintien-
nent un pH gastrique plus élevé pendant
une longue période de temps et inhibent la
sécrétion de l’acide gastrique induite par
l’absorption de la nourriture. Les IPP inhi-
bent la sécrétion de l’acide gastrique indé-
pendamment de la stimulation faite par
l’histamine, l’acétylcholine et la gastrine,
les rendant ainsi beaucoup plus efficaces à
réduire la sécrétion d’acide, soulageant les
symptômes gastro-œsophagiens, guéris-
sant une œsophagite et maintenant une ré-
mission.
Les IPP sont activés par le contenu acide
des canules des cellules pariétales et sont
plus efficaces lorsqu’administrés 30 minutes
avant le déjeuner afin que le pic de concen-
tration plasmatique coïncide avec la sécré-
tion de l’acide gastrique stimulée par la pré-
sence de nourriture dans l’estomac. Étant
donné que l’acide gastrique inactive les IPP
avant qu’ils ne puissent être absorbés par le
petit intestin, une formulation à enrobage
Tableau I
Médicaments les plus utilisés pour le traitement du RGO en pédiatrie32,43
Agonistes des récepteurs H2 Forme galénique Posologie pédiatrique Intervalle d’âge approuvé
Famotidine Comp 10, 20, 40 mg 1 mg/kg/jour 1x/jour 3 mois
Comp 10 mg pelliculé 1 mg/kg/jour fractionné 2x/jour 3 mois- 1 an
Comp à croquer 10 mg 1-2 mg/kg/jour fractionné 2x/j 1-16 ans
(max 80 mg jour/j)
Nizatidine Caps 150, 300 mg 5-10 mg/kg/jour fractionné 12 ans
en 2x-3x/jour
Ranitidine Comp 75, 150, 300 mg 4-10 mg/kg/jour fractionné 1 mois-16 ans
Sirop 15 mg/mL 2x/jour
Inj 25 mg/mL
Inhibiteurs de la pompe Forme galénique Posologie pédiatrique Intervalle d’âge approuvé
à protons
Ésoméprazole Comp 20, 40 mg 20 mg 1x/jour 12-17 ans*
Lansoprazole Caps 15, 30 mg 10 kg : 7,5 mg 1x/jour 1-11 ans
Comp 15, 30 mg 10-30 kg : 15 mg 1x/jour 1-11 ans
microgranulés entérosolubles 30 kg : 30 mg 1x/jour 12 ans
(max 2 mg/kg/jour)
Oméprazole Comp 10, 20 mg 1 mg/kg/jour 1x/jour ou 2-16 ans
Comp 10, 20 mg pelliculé 20 kg : 10 mg 1x/jour 2-16 ans
à libération retardée 20 kg : 20 mg 1x/jour 2-16 ans
Gélule 10, 20, 40 mg
Caps 40 mg
Pantoprazole Comp 20, 40 mg 0,5-1 mg/kg/jour 6-13 ans
entérosoluble (max 20 mg 1x/jour) 13-16 ans
40 mg 1 x/jour
* Non approuvé par Santé Canada pour utilisation chez les enfants
Le reflux gastro-œsophagien chez l’enfant
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%