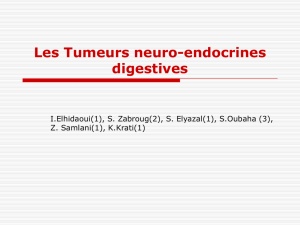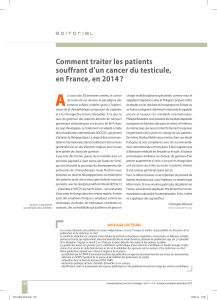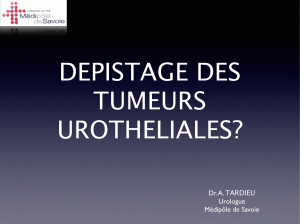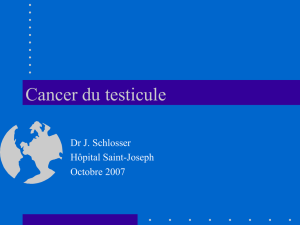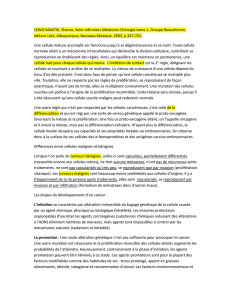Tumeurs endocrines digestives et pancréatiques

Tumeurs endocrines digestives et
pancréatiques
T. Aparicio, S. Dominguez-Tinajero et E. Mitry
Les tumeurs endocrines (TE) sont développées à partir des cellules du système
endocrinien diffus et caractérisées par leurs capacités sécrétoires. Malgré une
différenciation neuro-endocrine commune, elles constituent un groupe de
tumeurs très hétérogène dont la présentation clinique, l'évolution et le
pronostic sont extrêmement différents. Il convient en particulier de distinguer
les TE peu différenciées (TEPD), caractérisées par leur agressivité et leur rapi-
dité d’évolution, des TE bien différenciées d’évolution plus lente.
Épidémiologie
Les TE sont considérées comme des tumeurs rares et peu de données épidé-
miologiques sont disponibles. On considère que les TE digestives
représentent environ 1% des tumeurs digestives. Les TE bien différenciées
du tube digestif (TED) (« tumeurs carcinoïdes ») sont les plus fréquentes des
TE, avec une prévalence d’environ 1,5 cas pour 100 000 habitants. Les TE
du pancréas (TEP) représentent environ 0,5% des tumeurs pancréatiques et
l’insulinome en est le type le plus fréquent, avec une incidence annuelle en
France de 75 à 100 cas. Les TE pancréatiques non fonctionnelles représen-
tent 10 à 15% des TE pancréatiques et leur incidence annuelle est estimée à
0,07 cas pour 100 000 habitants. Les données épidémiologiques concernant
les TEPD sont rares et il est difficile d’apprécier avec précision leur inci-
dence, qui est probablement de l'ordre de 5 à 10% des TE. Une étude de
population réalisée par le Registre des tumeurs digestives de Dijon a montré
une augmentation de l'incidence au cours des vingt dernières années, avec
actuellement un nombre de cas attendus par an en France de 900 TE diges-
tives (1). Les TE malignes sont rares avant l’âge de 40 ans dans les deux sexes,
leur incidence augmentant ensuite plus rapidement chez l’homme que chez
la femme (1).

Diagnostic
Un grand nombre de TE présentent la particularité de produire des sécrétions
hormonales responsables de manifestations cliniques caractéristiques. Il s’agit
de TE dites fonctionnelles. Cependant, les anomalies cliniques ou biologiques
ne sont pas toujours caricaturales et nécessiteront une recherche approfondie,
voire des tests dynamiques spécifiques. Enfin, un certain nombre de tumeurs
endocrines sont non fonctionnelles et ne se manifesteront que par un
syndrome tumoral ou seront découvertes fortuitement. Le terme de « tumeur
endocrine » digestive regroupe une grande variété de tumeurs développées aux
dépens des différents types de cellules endocrines du tube digestif. L’examen
histologique va distinguer deux grands groupes :
– les TE bien différenciées du pancréas ou les tumeurs carcinoïdes du tractus
digestif ;
– les TE peu différenciées, dont l’évolution est fondamentalement différente.
Le diagnostic de tumeur endocrine repose sur la mise en évidence de
certaines caractéristiques, d’une part morphologiques, d’autre part liées aux
sécrétions endocrines (2). Morphologiquement, les TE bien différenciées
sont composées de cellules régulières avec une faible anisocaryose, d’organi-
sation insulaire, trabéculaire ou acineuse. Le stroma est richement
vascularisé, parfois fibro-hyalin. À l’inverse, les TE peu différenciées sont
formées de nappes de cellules de taille moyenne, irrégulières et atypiques, au
noyau à contour irrégulier à chromatine pulvérulente, avec un cytoplasme
peu abondant. Les cellules expriment généralement faiblement les marqueurs
endocrines. Les TE peu différenciées présentent fréquemment une nécrose
centrale.
L’immuno-histochimie permet d’affirmer le diagnostic de TE il s’appuie sur
plusieurs marqueurs :
– la chromogranine A est présente dans la plupart des grains de sécrétions des
cellules endocrines. Le marquage peut être hétérogène, difficilement mis en
évidence sur des prélèvements exigus et peut être négatif dans les TE peu diffé-
renciées ;
– la synaptophysine est une glycoprotéine membranaire présente dans les
petites vésicules des cellules endocrines. Ce marqueur est plus sensible que la
chromogranine A car il ne dépend pas du nombre de grains de sécrétion
présents dans les cellules ;
–la neuron specific enolase (NSE) est une enzyme glycolytique cytosolique non
associée aux granules sécrétoires. C’est le marqueur endocrine initialement
utilisé. Il s’agit d’un marqueur sensible, mais peu spécifique, puisque de
nombreuses tumeurs non endocrines peuvent être marquées ;
– les peptides hormonaux peuvent être mis en évidence par l’immuno-
histochimie. Un ou plusieurs peptides peuvent être produits par une même
tumeur, ce qui n’implique pas une expression symptomatique clinique.
220 Les cancers digestifs

Une classification anatomo-pathologique pronostique objective et repro-
ductible a été proposée récemment (tableau I) (3). Les caractères péjoratifs
retenus par cette classification sont la faible différenciation, la taille, la présence
d’emboles vasculaires et un index de prolifération élevé (nombre de mitoses,
indice de marquage par l’anticorps Ki-67).
Le dosage plasmatique des hormones impliquées dans le syndrome clinique
participe au diagnostic de chaque entité, notamment la gastrine, l’insuline, le
VIP, le glucagon et les 5-HIAA urinaires. D’autres marqueurs plus généraux de
tumeurs endocrines, comme la chromogranine A, la NSE et la sous-unité alpha
des hormones glycoprotéiques ont été proposés pour le diagnostic et le suivi
des tumeurs endocrines. En pratique, la chromogranine A est le meilleur
marqueur général des tumeurs endocrines, notamment pour le suivi des
tumeurs endocrines non fonctionnelles, et son dosage est utile à l’évaluation
des thérapeutiques en cas de tumeur métastatique.
Tumeurs endocrines digestives et pancréatiques 221
Tableau I – Classification de l’OMS des tumeurs endocrines du pancréas (3).
1. À l’exception des insulinomes, les tumeurs fonctionnelles ne sont jamais classées parmi les tumeurs
endocrines à comportement bénin.
2. Tumeurs non fonctionnelles : absence de signes cliniques (indépendamment du fait qu’une sécré-
tion hormonale puisse être détectée dans le sérum ou au niveau tissulaire).
3. Sécrétions hormonales ectopiques : syndrome de Cushing (ACTH), acromégalie (GRH), hypercal-
cémie.
Tumeur endocrine bien différenciée
Bénigne : tumeur limitée au pancréas, sans invasion vasculaire, taille < 2 cm, < 2 mitoses et < 2%
de cellules positives pour le Ki67 par 10 grand champ à fort grandissement
Fonctionnelle : Insulinome1.
Non fonctionnelle2.
Pronostic indéterminé : tumeur limitée au pancréas taille > 2 cm, > 2 mitoses et > 2% de cellules
positives pour le Ki67 par 10 grand champ à fort grandissement ou invasion vasculaire.
Fonctionnelle : gastrinome, insulinome, vipome, glucagonome, somatostatinome ou autres sécré-
tions hormonales ectopiques3.
Non fonctionnelle.
Carcinome endocrine bien différencié, tumeur maligne de bas grade
Seuls critères formels de malignité : invasion organes contigus et/ou métastases.
Critères très souvent présents, non formels : invasion vasculaire, engainement péri-nerveux, taille
> 3 cm, > 2 à 10 mitoses et > 5% de cellules positives pour le Ki67 par 10 grand champ à fort gran-
dissement.
Fonctionnelle : gastrinome, insulinome, vipome, glucagonome, somatostatinome ou autres sécré-
tions hormonales ectopiques3.
Non fonctionnelle.
Carcinome endocrine peu différencié, tumeur maligne de haut grade
Invasion d’organes contigus et de métastases à distance très fréquente.
Invasion vasculaire, engainement périnerveux nombreux, > 10 mitoses et > 15% de cellules posi-
tives pour le Ki67 par 10 grand champ à fort grandissement, marquage P53 positif.

Données cliniques et biologiques spécifiques
Tumeurs endocrines du pancréas
Les tumeurs endocrines du pancréas se développent, soit à partir de cellules
normalement présentes dans les îlots de Langerhans (insulinome, glucago-
nome, somatostatinome), soit à partir de cellules normalement disparues du
pancréas endocrine après quelques semaines de vie (gastrinome). Les symp-
tômes cliniques apparaissent fréquemment pour des tumeurs de très petite
taille. Le diagnostic nosologique sera porté sur la mise en évidence d’une sécré-
tion hormonale d’origine tumorale responsable de la symptomatologie
clinique. Cependant, il n’est pas rare que plusieurs sécrétions soient mises en
évidence pour une même tumeur au niveau plasmatique, sans traduction
clinique (4).
Insulinome
L'insulinome est le plus souvent révélé par des manifestations d'hypoglycémie,
l’évolution peut être sévère avec des crises convulsives ou un coma. Une
obésité est notée chez environ 40% des malades. L'hyperinsulinémie basale est
inconstante (20% à 25% des cas). Après avoir éliminé d’autres causes banales
d’hypoglycémie, le diagnostic repose sur l’épreuve de jeûne. Elle doit être
réalisée en milieu spécialisé pendant une durée de quarante-huit heures durant
laquelle le patient n’absorbe que des boissons non sucrées. Si la glycémie capil-
laire est inférieure à 0,50 g/l, l’épreuve est arrêtée après dosage immédiat
d’insuline, de peptide C et de glycémie plasmatique. L’épreuve de jeûne est
anormale dans 67% des cas d'insulinomes à la vingt-quatrième heure et dans
95% des cas à quarante-huit heures. L'absence de réduction de l'insulinémie
endogène est spécifique de la présence d'un insulinome. La présence d’une
proportion importante de précurseurs de l'insuline (pro-insuline) ou de frag-
ments de chaîne, comme le peptide C, est en faveur d’un insulinome malin ;
elle permet, en outre, d’éliminer le diagnostic d’hyperinsulinisme factice par
administration d’insuline ou de sulfamide hypoglycémiant. Si aucune hypogly-
cémie ne survient en présence d’une cétose de jeûne, le diagnostic d’insulinome
est peu probable.
Gastrinome
Le diagnostic est évoqué devant un syndrome de Zollinger et Ellison (SZE).
Les manifestations cliniques évocatrices sont des ulcérations duodénales s’éten-
dant au-delà du genu superius et a fortiori jéjunales, un ulcère duodénal résistant
à un traitement bien conduit ou une œsophagite sévère et une diarrhée volu-
mogénique. La diarrhée est liée non seulement à l'augmentation des sécrétions
digestives (gastriques, bilio-pancréatiques, duodéno-jéjunales) induites par
222 Les cancers digestifs

l'hyperacidité intra-intestinale, mais également à la maldigestion (pH intralu-
minal acide), à la malabsorption (jéjunite) et à l'accélération de la motricité
intestinale. Les lésions endoscopiques du tube digestif supérieur sont présentes
dans 85% des cas et la diarrhée dans 65% des cas. Chacun de ces symptômes
peut précéder le diagnostic pendant plusieurs années. L’utilisation large des
inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) pourrait retarder le diagnostic en
masquant les symptômes ; en effet, une étude a révélé que le nombre de
nouveaux SZE a baissé depuis l’introduction des IPP, mais qu’à l’inverse le
diagnostic de SZE métastatique était plus fréquent, comparé à la période précé-
dant l’introduction des IPP (5).
Biologiquement, le diagnostic repose sur la mise en évidence d’une hyper-
sécrétion gastrique acide et d'une hypergastrinémie à l'état basal. Un débit
acide basal horaire supérieur ou égal à 10 mmol d'ions H+/h, ainsi qu’une
concentration acide basale supérieure à 100 mmol d'H+/l, sont évocateurs. La
gastrinémie basale est élevée dans 90% des SZE. Cependant, des anomalies du
débit acide basal se rencontrent également dans des ulcères duodénaux ou des
œsophagites par reflux banales et la gastrinémie basale peut être élevée chez de
nombreux patients en cas de prise d’IPP ou de gastrite atrophique fundique
(auto-immune ou liée à Helicobacter pylori). Le diagnostic de certitude est
apporté par un test dynamique à la sécrétine. Après perfusion de sécrétine,
l’élévation du débit acide associé à l’élévation de la gastrinémie affirme le
diagnostic dans 97% des cas. Ce test permet également de redresser le
diagnostic lorsque la gastrinémie basale est normale.
Les gastrinomes sont plus souvent localisés dans la paroi duodénale ou dans
un ganglion péri-pancréatique que dans le pancréas, ceux-ci étant générale-
ment de plus grande taille (6).
Glucagonome
Le glucagonome associe un syndrome clinique d'hypersécrétion de glucagon à
une tumeur à cellules A. Le glucagonome ne devient généralement symptoma-
tique qu'après une longue période d'évolution lorsqu'il sécrète une très grande
quantité d'hormones. Il s’agit alors d’une tumeur volumineuse, le plus souvent
métastatique au moment du diagnostic.
Les manifestations cliniques sont dominées par l’atteinte cutanée, présente
dans 90% des cas. L'érythème nécrolytique migrateur est caractéristique :
nécrose superficielle de l'épiderme aux points de friction. Il évolue en une à
quatre semaines : macule érythémateuse, bulle, surface érodée, croûte et
guérison centrale, puis pigmentation cicatricielle fréquente. Cet érythème est
récurrent. Il peut s'accompagner d'alopécie, de dépilation, de conjonctivite, de
glossite et de chéilite. L'atteinte cutanée, probablement en rapport avec l'hy-
percatabolisme azoté, précède le diagnostic de glucagonome de six à huit ans
en moyenne ; la réduction de l'hyperglucagonémie (octréotide ou exérèse
tumorale) peut la faire régresser.
Tumeurs endocrines digestives et pancréatiques 223
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%