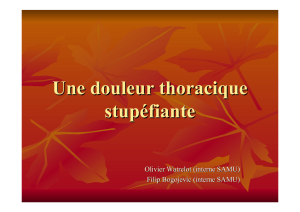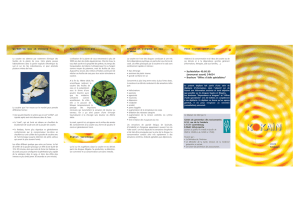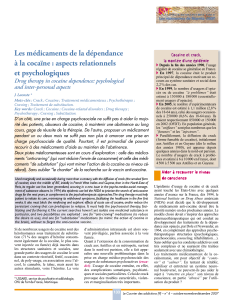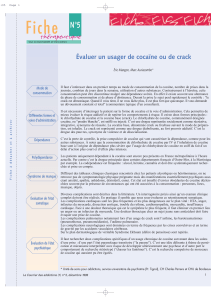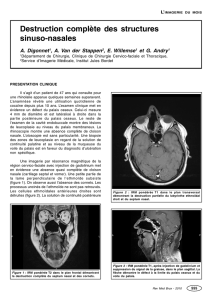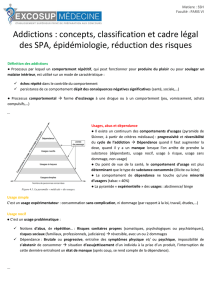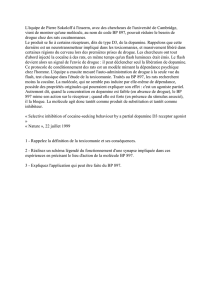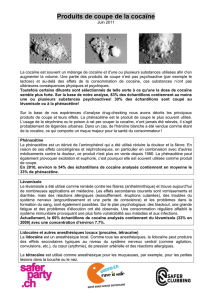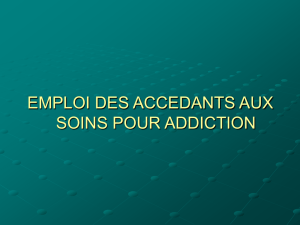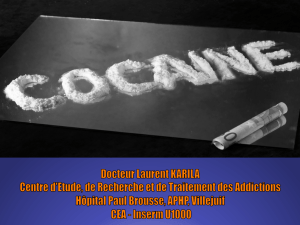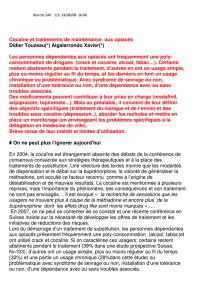oc F s

Le Courrier des addictions (12) – n ° 2 – avril-mai-juin 2010
27
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
AUX ANTILLES,
LE CRACK SURTOUT
Longtemps drogue des riches, célébrités et
artistes, la cocaïne est réapparue sur le devant
de la scène au milieu des années 1970, avec
le développement de la voie d’administra-
tion fumée. Il fallait trouver une modalité de
consommation qui n’entraîne pas les lésions
délabrantes du massif facial observées avec les
prises intranasales chroniques de chlorhydrate
(1). Après avoir essayé de fumer du chlorhy-
drate, mélangé à du tabac ou du cannabis, sont
apparus aux États-Unis, dans certains quar-
tiers de New York, le free-basing dès 1974 (2)
puis le crack dès 1985 (3). Ils ont contribué à
augmenter considérablement le nombre de
consommateurs de cocaïne dès la fin des an-
nées 1980. Les notions de dépendance et de
syndrome de sevrage apparaissent dans le cha-
pitre "cocaïne" du DSM-III-R en 1987.
Les États-Unis sont les plus concernés par la
consommation de cocaïne (en 2008 : 36,8 mil-
* Service de psychiatrie et addictologie, CHU de Fort-de-
France, 97261 Fort-de-France Cedex, Martinique.
Cocaïne et crack : quelle prise en charge
thérapeutique en 2010 ?
Jérôme Lacoste*, F. Peyrou*, Aimé Charles-Nicolas*
lions d’expérimentateurs, 5,3 millions d’usa-
gers dans l’année et 1,8 million d’usagers dans
le mois) et de crack (en 2008 : 8,4 millions
d’expérimentateurs, 1,1 million d’usagers dans
l’année et 359 000 usagers dans le mois). L’Eu-
rope dont la France est également touchée avec
de fortes disparités selon les pays : chlorhy-
drate en Espagne et Italie, crack dans certaines
régions et chez des profils de consommateurs
particuliers, en Grande-Bretagne, Pays-bas et
France. En France, on estime à 1,1 million
le nombre d’expérimentateurs de cocaïne et
à 250 000 celui des usagers occasionnels. La
cocaïne est également consommée dans de
nombreux pays d’Amérique du Sud et de la
Caraïbe, notamment en Martinique, Guade-
loupe et Guyane, sous forme de crack et plus
rarement de chlorhydrate de cocaïne. En 2005,
suite à l’étude NEMO, on estime à environ
2 000 (IC95:964-2 907) le nombre des usagers
problématiques de substances psychoactives à
la Martinique, soit 1 % des 18-45 ans, dont la
très grande majorité fume du crack.
En France, même si la majorité des patients qui
fréquentent les CSAPA sont des héroïnomanes
inscrits dans des programmes de substitution
aux opiacés, les structures de soins en addicto-
logie sont parfois confrontées à une demande
spécifique de prise en charge relative à un mé-
susage de cocaïne. Comme les profils cliniques
et psychopathologiques des consommateurs
de cocaïne ou de crack peuvent être très dif-
férents de ceux de leur "clientèle" classique, les
structures méconnaissent souvent les particu-
larités de leur prise en charge.
UNE ÉVALUATION CLINIQUE
STRUCTURÉE ET EXHAUSTIVE
En effet, celle-ci doit tenir compte des diffé-
rentes modalités de consommation de cette
drogue. L’évaluation initiale doit donc s’inté-
resser à : l’âge, mode de début de consomma-
tion, quantité consommée par prise, fréquence
et périodicité des prises, voie d’administration
préférentielle et autres voies possibles, carac-
téristiques et durée des éventuelles périodes
d’abstinence (ainsi que les stratégies spontané-
ment mises en place pour maintenir cette absti-
nence), substances associées et leur pattern de
consommation (par exemple, l’alcool comme
déclencheur ou pour réduire l’anxiété et les
manifestations dysphoriques qui apparaissent
à l’arrêt de l’intoxication par la cocaïne). Les
antécédents de prise en charge, spécialisée ou
non, ambulatoire et en hospitalisation, doivent
également être renseignés le plus précisément
possible. En effet, l’expérience des tentatives
antérieures doit permettre de renforcer la
motivation au processus thérapeutique en
cours. Les stratégies personnelles de contrôle
de la consommation, déjà expérimentées lors
des périodes d’abstinence antérieures, doi-
vent être identifiées, reconnues et renforcées,
afin d’adapter la prise en charge. Il peut être
utile, dès les premières évaluations, d’amener
le patient à identifier les contextes de consom-
mation et les situations déclenchantes les plus
fréquentes, afin de lui faire prendre conscience
de son caractère compulsif et de l’aider à la
contrôler. Une évaluation de la situation so-
ciale, juridique, économique et professionnelle
est indispensable. Il est également intéres-
sant de connaître l’existence de dettes, et les
modalités d’obtention de l’argent utilisé pour
la consommation (comportements sexuels à
risques, voire prostitution de circonstance,
comportements délictuels…), même s’il est
parfois difficile d’obtenir de tels renseigne-
ments de la part de l’usager. On doit également
rechercher les comorbidités médicales et psy-
chiatriques, ainsi que les complications soma-
tiques les plus fréquentes (cardio-vasculaires
et neurologiques, infectieuses, ORL et stoma-
tologiques), à partir d’un examen somatique
complet. Une attention particulière doit être
portée aux symptômes anxio-dépressifs asso-
ciés ou précédents les prises de cocaïne, ainsi
qu’à la recherche d’antécédents et d’idées sui-
En quelques années, la cocaïne est devenue la deuxième substance illicite la plus
consommée, après le cannabis, dans la majeure partie des pays occidentaux, en Amé-
rique comme en Europe.
Du fait de ses multiples voies d’administration (orale, intraveineuse, sniffée, fumée) et
des ses effets psychostimulants, elle est souvent associée à d’autres substances psycho-
actives. Si de nombreux usagers de cocaïne sont des héroïnomanes sous traitement de
substitution déjà inscrits dans les structures sanitaires et sociales, une grande partie des
usagers de cette drogue le sont dans un contexte récréatif, festif, occasionnel, de poly-
usage, et l'associe à l’alcool, au cannabis, au tabac, mais aussi aux autres stimulants,
voire à l’héroïne. La voie d’administration intranasale est alors souvent privilégiée, par-
fois associée à la voie fumée.
En Europe, le groupe des consommateurs de crack est constitué d’usagers souvent
extrêmement marginalisés : personnes issues de minorités ethniques, sans domicile
fixe, sans emploi ou ayant un travail précaire. Toutefois, en dehors des Antilles et de la
Guyane, confrontées au crack depuis la fin des années 1980, et de quelques structures
de l’est parisien, l’usage de crack reste marginal partout ailleurs en France. De ce fait, les
particularités de sa consommation et de sa prise en charge sont largement méconnues.
En l’absence de protocole standardisé de prise en charge des consommateurs, et alors
que l’usage de cocaïne reste un problème important de santé publique en Amérique du
Nord comme en Europe, il parait utile de faire le point sur les données actuelles de la lit-
térature concernant la prise en charge de l’intoxication, du sevrage et de la dépendance.

Le Courrier des addictions (12) – n ° 2 – avril-mai-juin 2010 28
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
cidaires. Les manifestations psychiatriques in-
duites par l’usage de cocaïne, Cocaine-Induced
Psychosis (CIP) et Cocaine-Induced Compul-
sive Foraging (CICF), peuvent être évaluées et
caractérisées en utilisant l’échelle SAPS-CIP
(4), dont il existe des traductions en français.
PSYCHOSE INDUITE
ET PROBLÈMES
CARDIO-VASCULAIRES
À court terme, la cocaïne et le crack sont
consommés pour induire une sensation de
bien-être et d’euphorie, associée à un effet psy-
chostimulant. On observe une élation de l’hu-
meur, un sentiment de facilité et de maîtrise, un
éveil sensoriel. Le sujet se sent confiant en lui.
Il a l’impression que ses capacités physiques et
mentales sont décuplées, qu’il est doué une plus
grande efficience mentale, clarté de pensée et
perspicacité. À ce sentiment de plaisir s’associe
une stimulation de la vigilance, avec disparition
de la sensation de fatigue, un surcroît d’énergie,
une diminution du besoin de sommeil (avec
insomnie) et des inhibitions sociales, une faci-
litation de la communication et une augmen-
tation de la libido. Cependant, dans certains
cas dès les premières prises, mais le plus sou-
vent après plusieurs années de consommation,
peut se développer un sentiment de méfiance,
pouvant s’organiser en véritable syndrome de
persécution. À partir de perceptions ou d’hallu-
cinations auditives et visuelles, se développent
un état d’hypervigilance. Vient ensuite le senti-
ment que l’entourage est hostile, le plus souvent
centré sur la consommation et ses risques. Il est
convaincu que la police va l’attraper, ou que les
autres consommateurs vont essayer de lui voler
sa drogue et cela peut le conduire à des com-
portements hétéro-agressifs, pour "se défendre"
contre les agresseurs. Cinquante à 80 % des
usagers expérimentent cette psychose in-
duite par les prises de cocaïne. Nombreux vont
utiliser une autre substance, le plus souvent l’al-
cool, pour tenter d’atténuer les phénomènes dé-
lirants. Si ces manifestations psychotiques sem-
blent plus fréquentes avec le crack, elles peuvent
également survenir chez les usagers de chlorhy-
drate de cocaïne. Le contexte et l’environne-
ment de la consommation influencent souvent
le développement de cette symptomatologie.
L’intoxication à la cocaïne peut également
être responsable de complications soma-
tiques (par vasoconstriction, augmentation
de la pression artérielle et de la fréquence car-
diaque, ou abaissement du seuil épileptogène).
Celles-ci peuvent conduire le consommateur
dans un service d’urgences, notamment pour
douleur thoracique (crise d’angor ou infarctus
du myocarde, troubles du rythme cardiaque,
pneumothorax…), accident vasculaire céré-
bral, poussée hypertensive, crise comitiale ou
hyperthermie et rhabdomyolyse.
Outre la prise en charge spécifique de ces
complications, les urgentistes peuvent être
confrontés à des manifestations psychocom-
portementales parfois extrêmes d’agitation et
d’agressivité, sous-tendues par un syndrome de
persécution induit. Une prise en charge dans
un environnement calme et sécurisant, avec
un minimum de stimulations sensorielles, as-
sociée à des interventions de l’équipe soignante
rassurantes et clairement explicitées, suffisent
parfois à éviter le recours à des protocoles thé-
rapeutiques lourds et traumatisants. La conten-
tion physique ne doit être utilisée qu’en cas
d’extrême nécessité, et sur une période la plus
courte possible, pour diminuer les risques d’hy-
perthermie et de rhabdomyolyse.
Les benzodiazépines doivent être préférées aux
neuroleptiques, pour contrôler l’anxiété, l’agita-
tion et les manifestations psychotiques. Ces der-
niers, par leur mécanisme d’action antagoniste
dopaminergique, pourraient en effet précipiter
l’apparition de symptômes de sevrage. Ils peu-
vent surtout majorer les risques d’hyperthermie
maligne. Les molécules à forte activité anticho-
linergique (essentiellement phénothiazines,
molécules les plus sédatives) doivent être évi-
tées, notamment pour ne pas majorer le risque
confusionnel. Les benzodiazépines les plus sou-
vent proposées sont le diazépam et le lorazé-
pam (dont la forme i.m. n’existe pas en France).
Le clonazépam semble également une alterna-
tive efficace. Par ailleurs, les benzodiazépines, en
calmant l’agitation du patient, permettent une
normalisation de la fréquence cardiaque et de
la pression artérielle, et réduisent les risques de
complications cardio-vasculaires. Elles permet-
tent également d’assurer un contrôle du risque
comitial, et pourront prévenir les complications
d’un sevrage à l’alcool en cas de consomma-
tion concomitante aux prises de cocaïne. Si les
symptômes psychotiques sont trop prégnants,
l’halopéridol ou la rispéridone sont à privi-
légier du fait de leur faible potentiel anticho-
linergique. Enfin, il n’existe pas de données
concernant la place de l’aripiprazole dans cette
indication.
PRISE EN CHARGE DU SEVRAGE
Le modèle triphasique du sevrage développé
en 1986 par F.H. Gawin et H.D. Kleber al-
terne une phase initiale de "crash", 9 heures
à 4 jours après la dernière prise, suivie d’une
phase de sevrage proprement dite durant 1 à
10 semaines, finalement suivie d’une phase
d’extinction correspondant à une période
d’abstinence prolongée. Plusieurs autres
études plus récentes ne l’ont pas retrouvé.
Les symptômes de sevrage à la cocaïne sont
souvent décrits par les patients comme peu
intenses. Ils associent : humeur dysphorique,
irritabilité, anxiété, anhédonie, difficultés de
concentration, fatigue, troubles du sommeil,
avec parfois une désorganisation du sommeil
paradoxal, une hypersomnolence et des rêves
intenses et déplaisants, augmentation de l’ap-
pétit, ralentissement ou agitation psychomo-
trice. Ces symptômes régressent généralement
dans les 15 jours après l’arrêt de l’intoxication
à la cocaïne. Ils ne nécessitent que rarement
un traitement spécifique, notamment en hos-
pitalisation. Des symptômes physiques non
spécifiques sont également possibles (dou-
leurs musculo-squelettiques diffuses, trem-
blements, frissons, nausées, mouvements in-
volontaires…), et régressent spontanément ou
après prescription d’antalgiques de palier 1.
Certains usagers, notamment de crack, peu-
vent voir réapparaître des douleurs intercur-
rentes (mauvais état bucco-dentaire, douleurs
articulaires ou de fractures osseuses, plaies
palmo-plantaires…) souvent mal soignées car
négligées pendant les périodes de consomma-
tion et calmées par l’effet anesthésiant de la
cocaïne.
Certains auteurs ont montré un lien entre la
survenue et l’intensité des symptômes de se-
vrage à la cocaïne et des antécédents de dé-
pression ou de dysthymie, ainsi que des idées
suicidaires plus fréquentes. L’intensité du syn-
drome de sevrage pourrait être liée à un moins
bon pronostic, avec notamment une dépen-
dance plus sévère, des rechutes plus rapides
après une période d’abstinence, plus de diffi-
cultés aux prises en charges thérapeutiques
en hospitalisation (sorties prématurées plus
nombreuses), et une moins bonne réponse
aux traitements pharmacologiques. Une
échelle d’évaluation spécifique, la Cocaine Se-
lective Severity Assessment (CSSA) a été mise
ou point et validée par K. Kampman (5), afin
d’évaluer la sévérité des symptômes de sevrage
à la cocaïne.
Le propranolol et plus spécifiquement des
agonistes dopaminergiques (amantadine et
bromocriptine) ont été proposés comme
traitement de la dépendance à la cocaïne
chez les patients développant un syndrome
de sevrage sévère. En effet, selon plusieurs
modèles neurobiologiques, les symptômes
de sevrage de la cocaïne pourraient être liés
à une déplétion des différents systèmes mo-
noaminergiques synaptiques, notamment du
système dopaminergique. Plus récemment, la
N-acétylcystéine (mucolytique broncho-pul-
monaire) a été proposée comme traitement
du sevrage de la cocaïne. Elle a montré chez
l’homme sa capacité à diminuer le craving
pour la cocaïne dans les premiers jours après
l’arrêt de l’intoxication. La posologie et la du-
rée de prescription, bien que précisées lors de
l’étude d’évaluation (1 200 mg à 3 600 mg par
jour, pendant 4 semaines) [6], doivent encore
être confirmées par d’autres études cliniques
en population ambulatoire ou en hospitalisa-
tion. En effet, les posologies proposées corres-
pondent, en France, à la prise de 6 à 18 sachets

Le Courrier des addictions (12) – n ° 2 – avril-mai-juin 2010
29
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
par jour (dosages à 200 mg par unité de prise,
en sachets ou comprimés). Par ailleurs, un
craving pour la cocaïne pourrait réapparaître
après plusieurs jours de traitement. La N-
acétylcystéine agirait en tant que précurseur
glutamatergique : chez le rat rendu dépen-
dant à la cocaïne, on retrouve lors des phases
de sevrage des taux bas de glutamate dans le
nucleus accumbens. Cette déplétion en gluta-
mate pourrait être responsable de l’apparition
de comportements de recherche compulsive
de cocaïne. La N-acétylcystéine rétablirait
les taux de glutamate intrasynaptiques, et ré-
duirait ainsi les comportements de recherche
compulsive. Par ailleurs, le glutamate, neuro-
médiateur excitateur, a un effet prodopami-
nergique au niveau du système méso-cortico-
limbique. Cette action pourrait expliquer la
réapparition du craving pour la cocaïne après
plusieurs jours de traitement.
D’autres molécules (modafinil ou méthylphé-
nidate) pourraient également être proposées
pour améliorer les symptômes de sevrage,
mais leur modalité de prescription en France
peut en limiter l’utilisation. Le modafinil (400
mg par jour pendant 3 semaines) améliore les
troubles du sommeil observés lors du sevrage.
AU-DELÀ : CELLE
DE LA DÉPENDANCE
Les principaux objectifs de la prise en charge
de la dépendance sont l’aide au maintien de
l’abstinence au long cours, et la prévention de
la rechute. La place de la pharmacothérapie
est actuellement limitée, faute de molécule
qui, sur le modèle de la dépendance aux opia-
cés, pourrait agir comme traitement de main-
tenance et de substitution. L’approche théra-
peutique la plus adaptée actuellement semble
devoir associer une approche psychosociale et
un traitement médicamenteux à visée "anti-
craving", qui va réduire les envies compulsives
de consommer et faciliter le travail psychothé-
rapeutique et social.
Dès le début des années 1980, à l’initiative du
NIDA, de nombreux médicaments ont été
proposés : plus de 30 agents médicamen-
teux, essentiellement agonistes et antago-
nistes dopaminergiques, antidépresseurs et
carbamazépine, qui n’ont pas fait la preuve de
leur efficacité comme traitement de la dépen-
dance.
Depuis 2000, fondées sur un même protocole
standardisé*, les études Cocaine Rapid Effica-
cy Screening Trials (CREST) [Addiction 2005;
100:s1] et de nombreuses autres indépen-
dantes utilisant des protocoles similaires, ont
évalué plus de 60 molécules différentes. Par-
mi les résultats publiés, 4 molécules (baclo-
fène, disulfirame, modafinil, topiramate) ont
donné des résultats significatifs, et près d’une
vingtaine ont obtenu des résultats promet-
teurs, à confirmer : acétylcystéine, d-amphé-
tamine, aripiprazole, bupropion, cabergoline,
levodopa/carbidopa, gabapentin, mémantine,
méthylphénidate, naltrexone, ondansétron,
propranolol, rimonabant, sertraline, tiagabine,
tolcapone, vigabatrin.
En s’appuyant sur des bases neurobiologiques,
deux pistes pharmacologiques sont propo-
sées. Un premier groupe de médicaments
pourrait être utilisé comme traitement de
substitution, par mécanisme agoniste dopa-
minergique : dérivés amphétaminiques et
méthylphénidate, mais aussi disulfirame (in-
hibiteur de la dopamine-hydroxylase, enzyme
de dégradation de la dopamine) ou bupropion
(inhibiteur de la recapture de la dopamine et
de la noradrénaline). Cependant, les résultats
obtenus avec ces nouvelles molécules sem-
blent limités (7), comme ils l’avaient été avec
les agonistes dopaminergiques dans les an-
nées 1980 (bromocriptine, amantadine, pra-
mipexole, pergolide…). La piste des agonistes
partiels des récepteurs dopaminergiques (avec
notamment l’aripiprazole) semble promet-
teuse, mais doit encore être mieux évaluée en
clinique.
Un deuxième groupe de molécules pour-
raient être utilisées comme "anticraving", en
diminuant les comportements de recherche
compulsive de drogue, par un mécanisme de
modulation des systèmes glutamatergique et
GABAergique : N-acétylcystéine et modafi-
nil (agonistes glutamate), baclofène et tiaga-
bine (agonistes GABA), topiramate (agoniste
GABA et antagoniste glutamate)… La molé-
cule la plus utilisée actuellement en France
semble être le topiramate, à des doses com-
prises entre 100 et 200 mg par jour.
LA PLACE
DES PSYCHOTHÉRAPIES
Les prises en charge psychothérapeutiques
sont indispensables dans l’accompagnement
d’un usager de cocaïne. Certaines approches
thérapeutiques, comme l’intervention brève
et l’entretien motivationnel, pourront aider à
gérer la consommation, si l’usager ne souhaite
pas devenir abstinent. Il est également utile
de développer des compétences pour main-
tenir une consommation "contrôlée", intégrée
dans la vie du sujet : maintien d’une bonne
hygiène de vie, gestion de l’argent, contrôle
de la voie d’administration en privilégiant
les moins risquées (éviter la voie i.v. ; fumer
le crack en cigarettes et non en pipes ; utili-
ser du matériel de réduction des risques), de
la quantité consommée et de la fréquence de
consommation, gestion du stress, dévelop-
pement des compétences de planification et
d’adaptation…
Il reste cependant évident qu’un sujet dépen-
dant n’est plus capable de contrôler sa consom-
mation et il doit être aidé, parfois dès la phase
de sevrage. Un séjour de rupture, en hospi-
talisation ou en centre thérapeutique résiden-
tiel, est parfois nécessaire pour consolider les
premières semaines d’abstinence. Avec la mo-
tivation comme facteur majeur de l’efficacité
de la thérapie. Les techniques d’entretien mo-
tivationnel paraissent avoir une place majeure.
Des approches comportementales, comme la
gestion des contingences (qui consiste à renfor-
cer positivement les comportements d’absti-
nence à l’aide de récompenses sous forme d’ar-
gent ou de bons échangeables), ont également
montré leur intérêt dans les premiers temps de
la prise en charge, car elle favorise la fréquen-
tation de la structure de soins. Il nous semble
que l’acupuncture, dans un autre registre,
peut participer de cet "accrochage" thérapeu-
tique, en apportant des effets positifs non spé-
cifiques immédiats (effet “séance” – moment
de détente et de bien-être), ou en agissant sur
des symptômes associés (colère, impulsivité,
anxiété, troubles du sommeil, perte d’appétit,
contrôle de la douleur…).
Les plus utilisées restent les thérapies com-
portementales et cognitives, qui permettent
une approche structurée, s’inspirant des stra-
tégies de conditionnement répondant (expo-
sitions aux stimuli avec prévention de la ré-
ponse), mais aussi s’appuyant sur la technique
des jeux de rôle (principes du conditionne-
ment vicariant). Ces approches se fondent
sur un entraînement aux compétences pour le
"faire face" (stratégies de coping). Après recueil
et hiérarchisation des situations déclenchant
le craving, des séances d’exposition indivi-
duelles ou en groupe sont proposées, jusqu’à
extinction du craving rattaché à chaque si-
tuation. Le programme thérapeutique est
"achevé" lorsque plus aucune situation ne le
déclenche. Les séances de déconditionnement
peuvent s’accompagner de restructuration co-
gnitive, après mise en évidence des distorsions
cognitives, et de techniques de résolution de
problèmes. On peut également proposer des
programmes de prévention de la rechute (se-
lon le modèle de G.A. Marlatt et J.R. Gor-
don), dont l’objectif est de diminuer le risque
de rechute par une amélioration des fonctions
d’autocontrôle, afin que le patient apprenne
à faire face aux situations à haut risque de
consommation.
Les thérapies d’inspiration analytiques peu-
vent aussi avoir leur place dans l’accompa-
gnement d’un patient dépendant (voir notre
Éditorial).
* Critères d’évaluation communs à toutes les études : 1 à 4
semaines d’évaluation préthérapeutique – étude contrôlée
avec placebo ou traitement pendant 8 semaines – associée
à une prise en charge psychosociale standardisée, sur le
modèle des TCC – évaluations pendant les 8 semaines de
traitement puis 30 jours après la fin du protocole.

Le Courrier des addictions (12) – n ° 2 – avril-mai-juin 2010 30
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
Enfin, les thérapies fondées sur des prises en
charge de groupe (12 étapes des narcotiques
anonymes et thérapies psychosociales) obtien-
nent également un maintien de l’abstinence au
long cours. Il semble que ces thérapies soient
plus efficaces lorsqu’elles sont intégrées dans
des programmes thérapeutiques longs (4 à
6mois) que courts (1 mois).
Et particulièrement lorsque l’on combine une
prescription médicamenteuse et une psycho-
thérapie, celle-ci associant thérapies brèves,
prises en charges de groupe et thérapies com-
portementales et cognitives.
QUAND L’ALCOOL OU
L'HÉROïNE SONT ASSOCIéS
La dépendance à la cocaïne est caractérisée
par un poly-usage ou une polydépendance.
Moins de 10 % des patients cocaïnomanes ne
sont dépendants à aucune autre substance.
L’alcool est le produit psychotrope le plus
souvent associé, avec une alcoolodépendance
associée dans 50 à 90 % des cas de cocaïno-
manie. Il est important de repérer un usage
d’alcool "gâchette" qui déclenche l’envie de
consommer de la cocaïne et de le distinguer
des prises d’alcool pour atténuer les effets né-
gatifs de la drogue. En effet, dans le premier
cas, une des priorités de la prise en charge est
le contrôle de cette consommation d’alcool,
ce qui permet le plus souvent d’éviter l’usage
de cocaïne. Chez les codépendants, il semble
que la meilleure stratégie thérapeutique asso-
cie une prise en charge psychothérapeutique
à un médicament anticraving, qui facilite l’ap-
proche psychologique, en maintenant l’abs-
tinence et en réduisant le risque de rechute
en début de prise en charge (8). En l’absence
de protocole standardisé, 4 molécules (disul-
firame, baclofène, topiramate et naltrexone)
peuvent être proposées, mais aucune n’a fait
la preuve de son efficacité. Leur prescription
reste encore du champ de l’expérimentation,
aucune n’ayant d’autorisation de mise sur le
marché pour des indications en addictologie.
Quelle prise en charge en cas de consom-
mation de cocaïne chez des héroïnomanes?
(9). Les usagers de cocaïne par voie intravei-
neuse peuvent la mélanger avec de l’héroïne,
en "speedballs", afin d’atténuer les effets sti-
mulants de l’une par les sédatifs de l’autre, ou
pour en contrecarrer la somnolence induite.
Ce mélange permet également de réduire l’in-
tensité de la "descente" (en atténuant le senti-
ment de dysphorie). Cette pratique majore les
risques de surdose à l’héroïne, avec détresse
respiratoire potentiellement fatale, la co-
caïne rendant la dépression respiratoire plus
intense. Par ailleurs, de l’héroïne est parfois
mélangée à de la cocaïne, puis fumée (c’est le
"chasser le dragon", une technique consistant
à inhaler des vapeurs d’héroïne chauffée au-
dessus d'une flamme, le plus souvent sur du
papier d'aluminium). Lors des binges, les usa-
gers vont alterner compulsivement morceaux
de crack et prises d’héroïne, chaque produit
contrebalançant les effets de l’autre. Enfin,
dans certains milieux festifs et chez des jeunes
consommateurs, la cocaïne et l’héroïne peu-
vent être "sniffées", dans un contexte de par-
tage et de convivialité.
Chez les usagers d’opiacés sous traitement
de substitution par méthadone ou buprénor-
phine, la consommation de cocaïne pendant
la durée du traitement est fréquente. Plusieurs
études, depuis le début des années 1990, sug-
gèrent que la mise sous traitement de substitu-
tion des patients codépendants aux opiacés et
à la cocaïne pourrait avoir un intérêt. Les ré-
sultats des premières études divergent, quant
à leur efficacité pour réduire les consomma-
tions de cocaïne associées : l’abus de cocaïne
semblait moins fréquent sous buprénorphine
que sous méthadone. La mise sous méthadone
de patients héroïnomanes, consommateurs de
cocaïne (sniffée ou intraveineuse) ou de crack,
modifiait de façon inconstante et modérée la
prise de cocaïne, et augmentait la consomma-
tion de crack.
Cependant, les études randomisées en double
aveugle ne mettent pas en évidence de su-
périorité de la buprénorphine par rapport à
la méthadone sur la réduction des prises de
cocaïne chez les patients héroïnomanes sous
substitution. Une méta-analyse Cochrane
montre que les dosages de méthadone entre
60 et 100 mg/j sont plus efficaces que les do-
sages plus faibles pour maintenir les patients
en soins, et pour réduire les consommations
d’héroïne et de cocaïne pendant la durée du
traitement. Ainsi une méthode pour réduire
la consommation de cocaïne chez des patients
déjà traités par méthadone serait d’augmen-
ter la dose de méthadone quotidienne, car il
semble que l’usage de cocaïne soit responsable
d’une diminution de ses concentrations plas-
matiques. Chez des héroïnomanes traités par
levo-acétylméthadol (LAAM), l’augmentation
des doses de LAAM permet, de même, de ré-
duire la consommation de cocaïne associée.
Pour minimiser les conséquences du mésu-
sage de cocaïne chez les patients dépendants
aux opiacés sous traitement de substitution,
plusieurs techniques psychothérapeutiques
ont été proposées. Une intervention moti-
vationnelle brève peut aider au maintien de
l’abstinence chez des coconsommateurs de
cocaïne et d’héroïne non inscrits dans une
structure de soins spécialisée. Les thérapies
de gestion des contingences se sont montrées
efficaces pour réduire la consommation de co-
caïne chez les héroïnomanes sous traitement
de substitution, seules ou en association à des
traitements médicamenteux. Les thérapies co-
gnitivo-comportementales se sont également
montrées efficaces chez ce type de population.
Plusieurs études ont montré que le disul-
firame pouvait être utile pour le traitement
de la dépendance à la cocaïne chez des hé-
roïnomanes sous traitement de substitution.
D’autres molécules ont été testées, avec des
résultats contrastés, que ce soit des antidé-
presseurs (désipramine, fluoxétine), des ago-
nistes dopaminergiques (amantadine), des
antipsychotiques (rispéridone), ou des antié-
pileptiques (gabapentine, tiagabine). La d-am-
phétamine réduit également la consommation
de cocaïne chez des héroïnomanes sous subs-
titution par méthadone.
SPéCIFIQUE : L’APPROCHE
THÉRAPEUTIQUE DU CRACK
Le problème de la prise en charge des usagers
de crack nous paraît bien différent de celui des
usagers de cocaïne chlorhydrate. Wallace, dès
1991, prônait une approche biopsychosociale
des usagers de crack, associée à une évaluation
minutieuse du patient, de son comportement
et de son environnement socio-économique,
afin de proposer une prise en charge indivi-
dualisée, adaptée à ses besoins et probléma-
tiques.
Du fait de sa voie d’administration particulière
(la voie fumée), ses effets sont plus rapides,
plus brefs, plus intenses et plus addictogènes
que ceux du chlorhydrate de cocaïne. Plus de
30 % des personnes qui ont fumé du crack sont
devenus dépendants dans les 2 ans après la
première consommation, alors que ce risque
concerne seulement 5 à 12 % des consomma-
teurs de chlorhydrate de cocaïne (10).
Pendant un binge, le consommateur peut
s’administrer du crack toutes les 10 minutes,
pendant plusieurs heures, subissant de rapides
changements d’humeur. Si un binge peut durer
8 à 12 heures, certains peuvent se prolonger
pendant plusieurs jours, laissant le consom-
mateur sans ressource, épuisé physiquement
et mentalement. Cette phase de consom-
mation va être suivie d’une période plus ou
moins longue d’abstinence et de récupéra-
tion, correspondant à un véritable syndrome
de sevrage, avec humeur triste, hypersomnie
et hyperphagie, aboulie et apathie, pouvant
s’accompagner d’idéations suicidaires plus ou
moins marquées. Certains consommateurs
vont connaître pendant des mois (voire des
années) des périodes de consommation ex-
cessive et compulsive, alternant avec des pé-
riodes d’abstinence plus ou moins longues.
Les conséquences physiques, psychologiques
et sociales peuvent être rapidement catastro-
phiques, les préoccupations étant uniquement
centrées sur la consommation à venir: altéra-
tion de l’état général (perte de poids, négligence
physique, blessures mal soignées, manque
d’hygiène…), perte des repères sociaux (amis,
travail…), détérioration progressive des liens

Le Courrier des addictions (12) – n ° 2 – avril-mai-juin 2010
31
familiaux (agressivité et violences intra-fa-
miliales), comportements délictueux pour
se procurer l’argent de la consommation et
dettes excessives, marginalisation. Tous les
consommateurs de crack ne connaissent
pas cette déchéance inéluctable, et certains
peuvent garder un certain contrôle de leur
consommation, continuer à travailler, entre-
tenir des liens familiaux satisfaisants. Il est
cependant très rare que la consommation
de crack n’ait aucun retentissement sur la
vie du consommateur. Les risques sanitaires,
psychologiques et sociaux sont toujours très
présents, et la perte de contrôle toujours à
craindre.
Les prises de crack sont impulsives, fortement
associées à des épisodes de craving déclenchés
par des situations spécifiques, mais également
"spontanés", sans raison apparente. Les pa-
tients sont alors totalement démunis face à
ces envies irrépressibles et incontrôlables de
consommer. La prescription d’un traitement
médicamenteux qui va diminuer le craving et
aider au maintien de l’abstinence nous parait
indispensable comme premier temps de la
prise en charge d’un consommateur de crack,
avant toute prise en charge psychologique.
En effet, la difficulté à rester abstinent plus
que quelques jours et la rechute sont souvent
vécues par le patient comme des échecs, en-
traînant honte et culpabilité, le décourageant
de poursuivre des soins. Par ailleurs, il nous
paraît important de proposer une réponse
thérapeutique à court terme qui, même si
elle n’est pas la solution miracle recherchée
par le patient, pourra le rassurer sur un es-
poir d’amélioration, voire de guérison. Dans
cette optique, le topiramate apporte un effet
thérapeutique rapide, souvent perceptible dès
les premiers jours (diminution des envies de
consommer). Il est possible que d’autres mo-
lécules puissent également être utilisées avec
des résultats similaires, selon l’expérience de
chaque thérapeute.
Il peut être parfois difficile d’arriver à l’absti-
nence en ambulatoire, ce qui nécessite un sé-
jour en hospitalisation. En Martinique, nous
proposons des séjours en centre résidentiel
de 1 à 3 mois, qui permettent (après la phase
de sevrage), de renforcer l’abstinence et d’ini-
tier un travail de prévention de la rechute. Il
semble actuellement nécessaire avant toute
psychothérapie, notamment avant de mettre
en place des programmes cognitivo-com-
portementaux de prévention de la rechute,
lorsque l’abstinence est obtenue et après éva-
luation neuropsychologique, de débuter la
prise en charge par un travail de remédiation
cognitive individualisé. Celui-ci est plus spé-
cifiquement centré sur un renforcement des
comportements d’inhibition et de la mémoire
de travail. En effet, de nombreux consomma-
teurs de crack souffrent d’impulsivité et d’at-
teinte des fonctions exécutives (concentration,
attention, mémoire) qui vont rendre difficile
toute prise en charge thérapeutique.
Aucune étude n’a permis d’apporter de preuve
scientifique de la meilleure efficacité d’une
technique par rapport à une autre. Quelle que
soit la thérapie choisie, les prises en charge
sont d’autant plus efficaces qu’elles sont pro-
longées (par exemple, plus de 6 mois, dans le
cas des programmes résidentiels). Les théra-
pies proposées dans la dépendance à la co-
caïne peuvent être également utilisées dans
la dépendance au crack. Un des objectifs de
la prise en charge est d’aider le patient à gérer
ses envies de consommer, qui peuvent surve-
nir dans trois grandes circonstances : face au
produit ou au dealer, dans des circonstances
de consommation antérieure et lors de stress
et d’émotions (positives ou négatives). Les re-
chutes sont fortement liées à ces épisodes de
craving, non contrôlés, qui peuvent survenir
après des mois, voire des années d’abstinence.
Il peut être utile d’aider le patient à identifier
les situations à risque de rechute, par exemple
en lui proposant de remplir la "relapse predic-
tion scale", échelle de mesure de l’intensité du
craving dans 50 situations réputées à risque
de consommer de la cocaïne ou du crack (11).
Cette évaluation nous permet d’utiliser les
situations les plus à risque identifiées par le
patient lui-même dans un programme d’ex-
position avec prévention de la réponse. Il est
également nécessaire d’identifier et d’évaluer
toutes les autres co-addictions, et de proposer
leur prise en charge concomitante.
Enfin, encore plus que pour la cocaïne, une
rechute pouvant survenir après des années
d’abstinence, la dépendance au crack nécessi-
tera des mois de prise en charge et une combi-
naison de plusieurs approches thérapeutiques
complémentaires, pharmacothérapies et psy-
chothérapies, le plus souvent en ambulatoire
mais aussi en hospitalisation si nécessaire.
v
Références bibliographiques
1. Hofstede TM, Jacob RF. Diagnostic considerations
and prosthetic rehabilitation of a cocaine-induced
midline destructive lesion: a clinical report. J Prosthet
Dent 2010;103:1-5.
2. Siegel RK. Cocaine smoking. J Psychoactive Drugs
1982;14:271-359.
3. Fagan J, Chin KL. Initiation into crack and co-
caine: a tale of two epidemics. Contemp Drug Probl
1989;16:579-618.
4. Cubells JF, Feinn R, Pearson D et al. Rating the
severity and character of transient cocaine-induced
delusions and hallucinations with a new instrument,
the Scale for Assessment of Positive Symptoms for Co-
caine-Induced Psychosis (SAPS-CIP). Drug Alcohol
Depend 2005;80:23-33.
5. Kampman K, Volpicelli JR, McGinnis DE et al. Re-
liability and validity of the cocaine selective severity
assessment. Addict Behav 1998;23:449-61.
6. Mardikian PN, LaRowe SD, Hedden S, Kalivas
PW, Malcolm RJ. An open-label trial of N-acetylcys-
teine for the treatment of cocaine dependence: a pilot
study. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry
2007;31:389-94.
7. Castells X, Casas M, Vidal X et al. Efficacy of cen-
tral nervous system stimulant treatment for cocaine
dependence: a systematic review and meta-analysis
of randomized controlled clinical trials. Addiction
2007;102(12):1871-87.
8. Lacoste J, Pedrera-Melgire M, Charles-Nicolas A,
Ballon N. Cocaïne et alcool : des liaisons dangereuses.
Presse Med 2010;39(3):291-302.
9. Lacoste J, Charles-Nicolas A. Addiction à la cocaïne
et co-addictions. In: Addiction à la cocaïne. Reynaud
M. Paris : Flammarion Médecine-Sciences, 2008.
10. Chen CY, Anthony JC. Epidemiological estimates
of risk in the process of becoming dependent upon
cocaine: cocaine hydrochloride powder versus crack
cocaine. Psychopharmacology. 2004;172(1):78-86.
11. Ballon N, Michalon M, Roy C, Charles-Nicolas
A, Lacoste J. TCC et addiction au crack/cocaine :
traduction française de la "Relapse Prediction Scale"
de A. Beck. Journal de érapie Comportementale et
Cognitive 2008;18,HS 1:36.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Les “Addictions et troubles apparentés"
entrent dans le DSM-V
vAprès dix ans de travail de 400 professionnels de tous les pays,
l’association de psychiatrie américaine vient de mettre en
ligne la version préliminaire du DSM-V. Toutefois, la version
définitive ne sera éditée qu’en 2013. Innovations dans notre "champ":
les catégories "Abus de substance" et "Dépendance" sont remplacées
par "Addictions et troubles apparentés". Conséquence : le jeu patholo-
gique, qui, dans le DSM-IV, était classé parmi "les troubles du contrôle
des impulsions", devient une "dépendance à un comportement". En
revanche, "l’addiction à Internet" ne rejoint pas cette catégorie. Bien
d’autres chapitres sont en cours de révision, comme ceux qui concer-
nent les épisodes dépressifs, la schizophrénie (qui a bien failli être
reléguée au rang des souvenirs), les psychoses…
www.dsm5.org P. de P.
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
1
/
5
100%