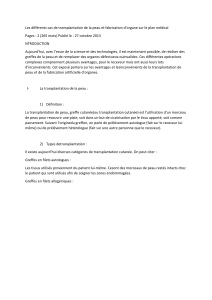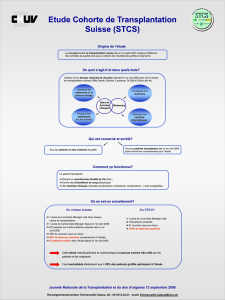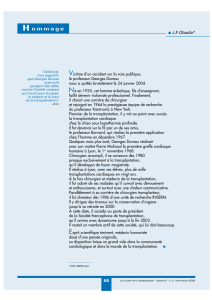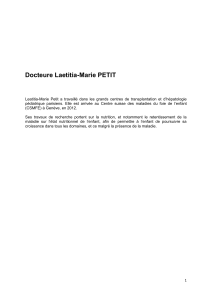Lire l'article complet

DOSSIER
tmiqu
Le Courrier de la Transplantation - Volume IX - n
o 4 - octobre-novembre-décembre 2009
141
Transplantation
combinée
Coordinateur :
Y. Calmus
Transplantation combinée
réno-pancréatique
Simultaneous pancreas kidney transplantation
●●É.●Thervet*
* Service de transplantation adulte, hôpital
Necker, Paris.
P
remière cause d’insuffisance
rénale aux États-Unis, problème
également croissant en France,
le diabète s’étend sur un mode quasi
“épidémique”. Sa prévalence mondiale
qui était de 4 % en 1995 devrait
atteindre 5,4 % en 2025, et le nombre
de patients diabétiques, passer de
135 à 300 millions.
Aux États-Unis, on estime que 29 mil-
lions de personnes seront atteintes
en 2050 (1). En France, la prévalence
du diabète traité est de 3,06 %, et il
y a environ 2 millions de patients
diabétiques de type II, 200 000 patients
diabétiques de type I et 1 800 000 per-
sonnes qui seraient des diabétiques
méconnus et non traités (2).
Le diabète sucré est devenu l’une des causes princi-
pales d’insuf sance rénale chronique. La transplanta-
tion rénale est le traitement de choix de l’insuf sance
rénale chronique terminale des patients diabétiques.
Une transplantation combinée réno-pancréatique peut
être proposée en cas de diabète de type I ou dans
quelques cas choisis de patients atteints d’un diabète
de type II. En 2009, les résultats à court terme se sont
avérés excellents, avec 90 à 95 % de survie du greffon
rénal et 90 % de survie du greffon pancréatique à 1 an.
Cette amélioration est liée à de nouvelles techniques
chirurgicales et à une amélioration des stratégies
immunosuppressives. Si la mortalité est améliorée
après transplantation, l’ef cacité de la greffe pancréa-
tique sur les complications micro- et macroangio-
pathiques du diabète reste discutée. En conclusion,
la transplantation est le traitement de choix pour
la suppléance de la fonction rénale chez le patient
diabétique. L’amélioration des résultats plaide en faveur
de la greffe combinée réno-pancréatique pour une
population de plus en plus importante de patients.
Mots-clés: Diabète – Insuf sance rénale chronique –
Transplantation rénale – Transplantation pancréa-
tique – Modalités – Complications – Pronostic.
Diabetes●mellitus●is●a●leading●cause●of●end-stage●
renal●failure●(ESRF).●Renal●transplantation●has●
become●the●treatment●of●choice●of●ESRF●for●diabetic●
patients.●Moreover,●for●type●I●diabetes●and●some●
speci●c●population●of●type●II●diabetes,●simultaneous●
pancreas●and●kidney●transplantation●provide●the●
best●therapeutic●option●available.●Nowadays,●short-
term●results●are●excellent●with●a●renal●survival●
around●90●à●95%●and●a●pancreas●survival●around●
90%●after●one●year.●●This●improvement●is●related●
to●new●surgical●techniques●and●new●immunosup-
pressive●strategies.●Even●though●patient●survival●
is●improved●after●transplantation●compared●with●
dialysis,●the●impact●of●pancreas●transplantation●
on●long-term●complications●including●macro-●and●
microangiopathic●lesions●is●still●a●matter●of●debate.●
The●choice●between●renal●or●pancreas-kidney●trans-
plantation●is●still●a●matter●of●debate.●However,●the●
improvement●of●clinical●results●support●the●choice●
of●this●latter●choice●for●a●growing●proportion●of●
diabetic●patients.
Keywords:
Diabetes●mellitus
–
●End-stage●renal●
failure
–
●Kidney●transplantation
–
●Pancreas●transplan-
tation
–
●Management
–
●Complications
–
●Prognosis.
RÉSUMÉ SUMMARY

DOSSIER
tmiqu
Le Courrier de la Transplantation - Volume IX - n
o 4 - octobre-novembre-décembre 2009
142
Un dépistage plus précoce, associé à une
meilleure prise en charge thérapeutique
grâce à des traitements agissant sur le
système rénine-angiotensine (inhibiteurs
de l’enzyme de conversion ou antago-
nistes des récepteurs de l’angioten-
sine II), a certes diminué le risque de
passage à la néphropathie ou d’évolution
de celle-ci. Cependant, l’augmentation
du nombre des patients et la meilleure
prise en charge des causes de mortalité
précoce s’associent pour expliquer le
nombre de patients diabétiques parve-
nant au stade d’insufsance rénale chro-
nique terminale (IRCT).
Malgré l’amélioration de la prise en
charge précoce du diabète, pour les
patients atteints d’une néphropathie
diabétique au stade d’IRCT, la transplan-
tation combinée réno-pancréatique prend
toute sa place. Plus de 23 000 transplan-
tations pancréatiques ont été intégrées
dans le registre international comme cela
a été rapporté dans un récent article de
synthèse (3).
ÉVALUATION D’UN PATIENT
DIABÉTIQUE AVANT TRANSPLANTATION
Stade d’inscription des patients
sur la liste d’attente
De nombreuses études ont montré que le
devenir en dialyse ou dialyse péritonéale
des patients diabétiques est signicative-
ment moins bon que celui des patients
dont la néphropathie initiale n’est pas
un diabète, ou qui ne sont pas diabé-
tiques (4).
En regard de cette observation, et
puisque la survie des patients s’amé-
liore après transplantation (cf. infra),
leur inscription en liste d’attente pour
une greffe doit être précoce (5-8).
Des recommandations ont été publiées
aux États-Unis (Kidney Disease
Outcomes Quality Initiative [KDOQI])
[9], qui précisent que les patients présen-
tant une insufsance rénale chronique
avec un débit de filtration gloméru-
laire inférieur à 30 ml/mn doivent être
adressés pour évaluation à un centre de
transplantation.
Particularités de l’évaluation
des patients avant inscription
sur la liste d’attente
●●Information●du●patient
En plus des informations habituelles, les
avantages et les inconvénients respec-
tifs de la transplantation rénale isolée
ou de la transplantation combinée réno-
pancréatique doivent être explicités.
●●Évaluation●immunologique
Cette évaluation est particulièrement
importante dans le cas de l’indication
d’une transplantation combinée réno-
pancréatique puisque les règles de répar-
tition des organes prélevés donnent la
priorité aux patients non immunisés
contre les molécules HLA.
●●Évaluation●médico-chirurgicale
Il convient, comme dans le cas d’une
transplantation chez un patient non diabé-
tique, d’étudier l’ensemble du dossier
médical. En cas de transplantation chez
un patient diabétique, une attention toute
particulière est portée sur l’état cardio-
vasculaire, trophique et infectieux, ophtal-
mologique et, dans certains cas, sur l’état
des voies urinaires basses.
– État cardio-vasculaire
L’évaluation la plus importante doit être
axée sur la sphère cardio-vasculaire.
Cinquante à 85 % des patients diabétiques
âgés de plus de 45 ans ont une pathologie
cardio-vasculaire (versus 35 % à 50 % de
la population dialysée en général) [10].
Le réseau vasculaire périphérique est
exploré par des méthodes non invasives
telles que l’écho-Doppler des membres
inférieurs et des troncs supra-aortiques
associés à un abdomen sans préparation,
à la recherche de calcications. S’il existe
des calcications, le scanner sans injec-
tion est une bonne aide pour en vérier
le caractère circonférentiel ou non. En
cas d’antécédents d’artériopathie des
membres inférieurs, de maux perforants
plantaires, voire d’amputation, il convient
d’avoir une imagerie plus précise des
membres inférieurs. La place relative
de l’artériographie ou de l’angio-IRM
dépend des habitudes des centres, des
chirurgiens vasculaires et de l’état rénal
du patient.
Sur le plan cardiaque, les coronaropathies,
souvent silencieuses sur ce terrain, sont
fréquentes. Les explorations non invasives
consistent en une scintigraphie d’effort
au thallium et une échographie de stress.
Les valeurs des différents examens sont
rappelées dans le tableau I.
La coronarographie est quasi systéma-
tique chez les patients dont les explora-
tions non invasives sont positives, qui
sont âgés de plus de 45 ans ou qui ont un
diabète évoluant depuis plus de 25 ans ou
encore des antécédents cardiaques graves
(infarctus du myocarde, pose d’un stent,
etc.). Hormis ces trois derniers points, si
la scintigraphie d’effort et l’échographie
de stress sont négatives, il est possible de
ne pas réaliser la coronarographie. Dans
tous les cas, la découverte de lésions
coronaires doit faire discuter un geste de
Tableau●I.●Évaluation●coronarienne●(10).
Nombre
d’études
Nombre
de patients Sensibilité Spécificité Valeur
prédictive
ECG d’effort 147 24 047 68 77 73
Scintigraphie d’effort au thallium 59 6 038 85 85 85
Échographie d’effort 58 5 000 84 75 80
Thallium-persantine 11 < 1 000 85 91 87
Échographie de stress à la dobutamine 5 < 1 000 88 84 86

DOSSIER
tmiqu
Le Courrier de la Transplantation - Volume IX - n
o 4 - octobre-novembre-décembre 2009
143
revascularisation pour reprendre secon-
dairement le processus d’inscription sur
liste d’attente.
– État trophique et infectieux
L’absence de toute lésion infectieuse
évolutive (par exemple, mal perforant
plantaire) doit être rigoureusement
conrmée compte tenu de l’intervention
chirurgicale et des traitements immuno-
suppresseurs, particulièrement en cas
de transplantation réno-pancréatique,
relative en cas de transplantation rénale.
– Importance de la rétinopathie
diabétique
L’objectif de la transplantation réno-
pancréatique est de permettre un contrôle
glycémique parfait. Il est connu que cet
équilibre peut exacerber une rétinopathie
diabétique grave. Un examen ophtalmo-
logique récent ainsi qu’une angiographie
rétinienne sont donc obligatoires avant
l’inscription sur liste d’attente de trans-
plantation réno-pancréatique.
– Consultation chirurgicale
Si l’indication d’une transplantation
combinée réno-pancréatique est retenue,
le patient doit être dirigé vers un centre
de référence en particulier, pour avoir
une consultation auprès des chirurgiens
de l’équipe du fait de la complexité de
cette intervention.
Indications et contre-indications
●●
Choix●de●la●méthode●de●suppléance●:●
transplantation●rénale●isolée●ou●double●
transplantation●réno-pancréatique
C’est la première question qu’il convient
de se poser lors de l’évaluation prétrans-
plantation pour un patient diabétique
présentant une IRCT. Les alternatives
possibles sont une transplantation simple
ou une transplantation combinée réno-
pancréatique soit dans le même temps,
soit une greffe pancréatique après trans-
plantation rénale. L’avenir appartiendra
peut-être à la greffe d’îlots de Langhe-
rans qui présente l’avantage d’être tech-
niquement plus simple et de ne pallier
que le décit de la sécrétion d’insuline.
Le choix entre transplantation rénale
simple ou combinée réno-pancréatique
s’appuie sur l’indication médicale et le
choix personnel du patient. Actuelle-
ment, en France, la transplantation réno-
pancréatique ne se conçoit que pour des
patients présentant une insulinosécrétion
nulle ou extrêmement réduite. Avant la
proposition d’une double transplantation,
il convient donc de rechercher par l’in-
terrogatoire des éléments évocateurs du
caractère insulinodépendant d’emblée. Il
faut également pratiquer le dosage de la
concentration plasmatique de peptide C
qui est le témoin de cette insulinosécré-
tion. Lorsqu’il est indosable ou inférieur
à 0,5 ng/ml, l’indication de la transplanta-
tion réno-pancréatique peut être retenue.
Il faut cependant rappeler qu’une équipe
a déjà rapporté des résultats d’insulino-
indépendance identiques chez les patients
recevant un pancréas et dont la concen-
tration plasmatique de peptide C initial
était supérieure ou inférieure à 0,8 ng/ml
(11). Des réexions sont en cours pour
évaluer le bénéce d’une transplantation
pancréatique combinée chez des patients
diabétiques de type II pour lesquels les
réserves d’insulino sécrétion sont incom-
patibles avec une vie après transplanta-
tion rénale sans insuline.
●●
Choix●de●la●méthode●de●suppléance●:●
diabète●de●type●II●
En ce qui concerne les patients présen-
tant un diabète de type II, en cas de
surpoids, d’obésité, d’âge chronolo-
gique supérieur à 45 ans et d’antécédents
cardio-vasculaires, il faut proposer une
transplantation rénale isolée. En l’ab-
sence de ces critères, il est possible de
proposer un dosage de peptide C, éven-
tuellement couplé à des épreuves dyna-
miques de charge en glucose par voie
orale et/ou intraveineuse pour mesurer
les capacités de sécrétion d’insuline du
pancréas. En collaboration avec l’équipe
de diabétologie, la proposition d’une
transplantation réno-pancréatique pourra
être envisagée.
●●
Choix●de●la●méthode●de●suppléance●:●
diabète●de●type●I●
De principe, il s’agit d’une indication à
greffe combinée. Les contre-indications
à une transplantation combinée réno-
pancréatique sont plus nombreuses que
pour une transplantation isolée rénale,
en particulier en raison de la complexité
plus importante de l’acte chirurgical
pour le greffon pancréatique. Elles sont
aussi en relation avec un risque infec-
tieux accru, un risque lié à la dérivation
du duodénum du donneur dans la vessie
ou dans le tube digestif du receveur.
Enn, la transplantation combinée est
associée à un risque augmenté de rejet
dont la raison n’est qu’imparfaitement
comprise.
Les indications et les contre-indica-
tions à la transplantation combinée
réno-pancréatique sont résumées dans
le tableau II (12).
Tableau●II.●Indications●et●contre-indications●à●la●transplantation●réno-pancréatique.
Indications Absolues Relatives Facteurs de risque
Âge < 55 ans
Peptide C indosable
Risque CV minime
Absence d’amputation
Bonne compliance
Désir de réaliser cette TRP
IMC < 32 kg/m2
Présence de complications potentielles du diabète ≥ 2
Cardiaque :
- coronaropathie non traitable
- IDM récent
- fraction d’éjection diminuée
Non compliance
Autres contre-indications à la transplantation
Âge > 65 ans
Hémorragie rétinienne récente
Vasculopathie symptomatique
Environnement socio-émotionnel
Obésité : poids idéal > 150 %
ou IMC > 30 kg/m2
Tabagisme
Calcifications aorto-iliaques sévères
IDM
Insuffisance cardiaque
Amputation
AVC
Syndrome thrombotique
Abréviations : AVC : accident vasculaire cérébral ; CV : cardio-vasculaire ; IDM : infarctus du myocarde ; IMC : indice de masse corporelle ; TRP : transplantation réno-pancréatique.

1 000
800
600
400
200
01988 1989 1990
Digestive
Vésicale
Autre
Nombre de transplantations
1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 19991995
Figure 1. Évolution des techniques chirurgicales des anastomoses de la transplantation
pancréatique.
DOSSIER
tmiqu
Le Courrier de la Transplantation - Volume IX - n
o 4 - octobre-novembre-décembre 2009
144
Après inscription sur liste d’attente, il
faut réaliser régulièrement, une fois par
an (13-15), une réévaluation cardiaque
des patients diabétiques qu’il s’agisse
d’une attente pour une transplantation
rénale isolée ou une transplantation
combinée réno-pancréatique.
TECHNIQUES DE TRANSPLANTATION
COMBINÉE RÉNO-PANCRÉATIQUE
Pour la transplantation réno-pancréa-
tique, historiquement, trois grandes
techniques sont appliquées. Ces trois
techniques répondent chacune à leur
manière au dé chirurgical qui consiste
à réaliser la dérivation des sécrétions
exocrines du pancréas transplanté. En
effet, à l’exception de très rares insuf-
sances pancréatiques externes associées
à une insufsance de sécrétion endo-
crine (le plus souvent secondaire à une
pancréatectomie totale), l’objectif d’une
transplantation pancréatique n’est que
la suppléance d’une insulinosécrétion
déciente.
Technique du pancréas segmentaire
La technique du pancréas segmentaire
a été mise au point par le Pr Dubernard
(Lyon). Elle repose sur l’injection de
néoprène dans le canal de Wirsung an
de bloquer les sécrétions exocrines
pancréatiques en évitant les sutures
supplémentaires nécessaires avec les
autres techniques. Depuis 1995, cette
technique a été peu à peu abandonnée
en raison des complications locales et
de moins bons résultats métaboliques
à long terme.
Drainage vésical des sécrétions
exocrines pancréatiques
L’implantation du pancréas avec drai-
nage vésical (figure 1) a été la technique
la plus utilisée jusqu’en 1997. Son prin-
cipe repose sur la suture de la collerette
duodénale du donneur dans la vessie du
receveur, permettant ainsi l’élimination
des sécrétions exocrines par les voies
urinaires basses.
Les avantages de cette technique sont :
● une suture plus simple que la suture
digestive, surtout lorsque de fortes doses
de stéroïdes, interférant avec la cicatri-
sation, sont utilisées ;
●
un suivi aisé de l’amylasurie comme
marqueur de rejet ;
● la possibilité de réaliser une biopsie
de l’organe transplanté par voie cystos-
copique ;
et les inconvénients :
● la survenue de complications locales :
hématurie par cystites et urétrites
chimiques parfois très douloureuses,
pancréatites par reux d’urine dans la
collerette duodénale puis dans le canal
de Wirsung, infections urinaires réci-
divantes ;
● le risque de déshydratation du fait de
la perte obligatoire en bicarbonates.
La technique de dérivation vésicale est
donc grevée d’une morbidité non négli-
geable, source de nombreuses hospi-
talisations. Elle nécessite de réaliser,
dans un deuxième temps, une dériva-
tion digestive chez 25 % des patients à
5 ans (3).
Drainage digestif des sécrétions
exocrines pancréatiques
L’implantation du pancréas avec déri-
vation digestive est la plus “physio-
logique”. Cette technique historique
avait été abandonnée, car les doses
importantes de corticoïdes interfé-
raient avec la cicatrisation. Elle est
de nouveau utilisée par la majorité
des centres depuis 1998. En effet, les
progrès chirurgicaux (pince à suture
automatique) ainsi que les nouveaux
immunosuppresseurs puissants qui
autorisent une diminution des doses
de corticoïdes ont amélioré les risques
immédiats suivant la transplantation.
Plusieurs techniques sont décrites selon
la localisation plus ou moins haute sur
le grêle de l’anastomose (figure 2).
Les avantages sont un drainage physio-
logique des sécrétions exocrines et l’ab-
sence de complications urinaires et de
déshydratation.
Les inconvénients sont surtout en rapport
avec le confort du patient dans la période
postopératoire immédiate.
Par ailleurs, une discussion reste ouverte
concernant les avantages et les incon-
vénients d’un drainage veineux dans le
système cave ou le système porte. Une
étude récente, reprenant l’expérience
nord-américaine du registre UNOS
portant sur plus de 10 000 patients,
a montré que si le drainage portal ne
modiait pas l’incidence du rejet et de la
survie des patients traités par tacrolimus,
il n’existait pas non plus d’avantage sur
l’équilibre glycémique (17, 18).

100
80
60
40
20
Patients (%)
01993 1994 1995
TacrolimusCiclosporine
1996 1997
Années
Années
1998 2000 2001 20021999
100
80
60
40
20
Patients (%)
01993
Source : 2003 OPTN/SRTR Annual Report. Table 8.6b.
1994 1995
Mycophénolate mofétilAzathioprine
1996 1997 1998 2000 2001 20021999
Sirolimus/rapamycine
Figure 3. Tendance pour le traitement de maintenance à la première sortie entre 1993 et 2002.
A. Dérivation vésicale B. Dérivation digestive
Figure 2. Exemples de représentation des deux types d’implantation pancréatique (16).
Greffon
en Y iliaque Greffon
en Y iliaque
Veine
porte
Veine
porte
Vessie
Colerette
duodénale
Colerette
duodénale
DOSSIER
tmiqu
Le Courrier de la Transplantation - Volume IX - n
o 4 - octobre-novembre-décembre 2009
145
TRAITEMENT IMMUNOSUPPRESSEUR
Le consensus actuel repose sur l’uti-
lisation d’un traitement d’induction
biologique en association sur le long
terme avec un traitement comportant du
mycophénolate mofétil, du tacrolimus
et éventuellement des corticostéroïdes
(figure 3).
Induction biologique
Une méta-analyse a rapporté les résultats
de 5 études (19-23) ayant évalué les trai-
tements d’induction. Toutes ont montré
une supériorité du traitement d’induction
avec une réduction signicative de l’inci-
dence du rejet aigu rénal ou pancréatique
(de 76 % à 36 %). En revanche, les études
n’ont pas montré d’amélioration signi-
cative de la survie des patients ou des
greffons chez les sujets traités par une
induction biologique.
Agent antiprolifératif
Toutes les études prospectives et rétros-
pectives (24-26) suggèrent un bénéce
de l’utilisation du mycophénolate mofétil
comparativement à l’azathioprine pour
la prévention du rejet aigu. Cependant,
là encore, les survies des patients étaient
comparables, comprises entre 93 % et
100 %, mais les survies des greffons
étaient inférieures dans le groupe
azathioprine dans l’une des études.
Inhibiteurs de la calcineurine
Le point le plus important est le type
d’inhibiteur de la calcineurine utilisé.
S’il existait un doute en raison de l’aug-
mentation de l’incidence du diabète
post-transplantation observée en cas
d’utilisation du tacrolimus, des études,
ainsi qu’une méta-analyse, ont démontré
que l’utilisation du tacrolimus diminue
signicativement l’incidence du rejet
aigu. La survie pancréatique à 1 an est
également signicativement supérieure
chez les patients traités par tacrolimus
(27-29).
Corticostéroïdes
Une élimination rapide des stéroïdes,
après 6 jours, a été rapportée chez
126 patients (30). Les résultats ont été
comparables en termes de rejet aigu. Il
faut remarquer que la non-utilisation de
stéroïdes n’est pas non plus associée à
une amélioration du profil métabo-
lique (31).
SURVEILLANCE
APRÈS TRANSPLANTATION
La surveillance du pancréas greffé
repose sur la mesure régulière de la
glycémie et de l’hémoglobine glyquée.
La majorité des équipes propose égale-
ment un dosage tous les 3 mois de
peptide C et de l’insuline pour vérier
la viabilité du greffon. Malheureuse-
ment, l’apparition d’anomalies de ces
marqueurs est très tardive par rapport à
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%