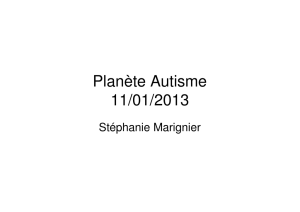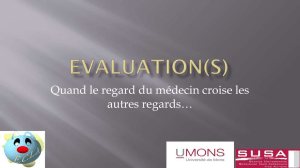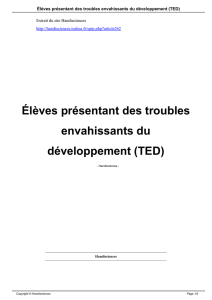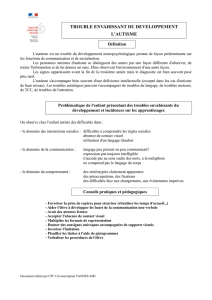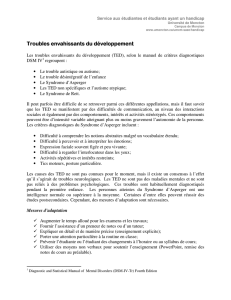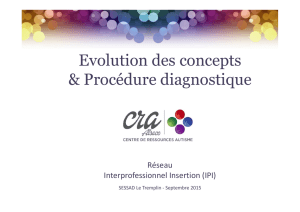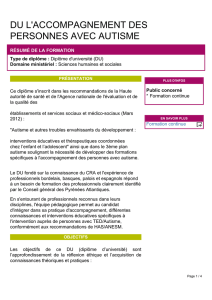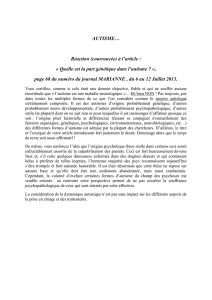L’Encéphale (2010) Supplément 3, S54–S57

© L’Encéphale, Paris, 2010. Tous droits réservés.
L’Encéphale (2010) Supplément 3, S54–S57
Disponible en lignesur www.sciencedirect.com
journalhomepage: www.elsevier.com/locate/encep
Le devenir des troubles envahissants
du développement après l’adolescence
The outcome of pervasive development disorders after
the adolescence
F. Kochman*, E. Bach, A. Dereux, G. Arens, V. Garcin
Service de Psychiatrie Infanto-Juvénile 59I03, EPSM Lille Métropole
Résumé Jusqu’à l’aube de notre nouveau millénaire, la littérature médicale s’est révélée très
pessimiste quant à l’évolution clinique à l’âge adulte des patients souffrant de troubles autistiques. Fort
heureusement, cette dernière décennie a été marquée par de profonds bouleversements dans le domaine
des troubles envahissants du développement (TED), avec notamment une révision frappante de la
prévalence de ces troubles (passant de moins d’un pour mille à près d’1 % de la population), à des
avancées majeures dans les domaines de la génétique et surtout à la mise en exergue pour la première
fois d’un continuum entre génétique, neurophysiopathologie et de nouveaux axes thérapeutiques
subséquents.
© L’Encéphale, Paris, 2010. Tous droits réservés.
MOTS CLÉS
Autisme ;
Troubles envahissants
du développement ;
Génétique ;
Connexions
synaptiques ;
Floortime ;
Analyse appliqué
du comportement
KEYWORDS
Autism; Pervasive
developmental
disorders; Genetic;
Synaptic connections;
Floortime; Applied
behavioral analysis
Abstract Until the end of the 20th century, the medical literature was very pessimistic concerning the
clinical and natural course of autistic spectrum disorders from childhood to adulthood. Fortunately,
during the last decade, we met dramatic turnovers in the domain of pervasive developmental disorders,
especially in terms of prevalence (now estimated at about 1 % of the population). Besides, for the first
time, we are now able to build a strong link between recent genetic discoveries, the neurophysiopathology
of autism and new subsequent therapeutic tools.
© L’Encéphale, Paris, 2010. All rights reserved.
* Auteur correspondant.
E-mail : [email protected]
Les auteurs n’ont pas signalé de conits d’intérêts.
Les troubles autistiques apparaissent avant l’âge de 3 ans
et sont caractérisés par une dysharmonie du développe-
ment psychique, affectif et cognitif marqués par des trou-
bles de la communication non verbale et verbale, un décit
de l’interaction sociale réciproque, ainsi que des compor-
tements restreints, répétitifs et stéréotypés [16]. La notion
de retrait autistique a été introduite au XIXe siècle par
Bleuler dans le cadre de la schizophrénie de l’adulte. En
France, la description inaugurale de Kanner, qui conduit à
une représentation restrictive de l’autisme, reste préva-
lente. Or, l’autisme de Kanner ne représente aujourd’hui
qu’une faible part des troubles autistiques. Ce spectre

Le devenir des troubles envahissants du développement après l’adolescence S55
autistique est aujourd’hui plus communément intégré dans
la sphère des troubles envahissants du développement
(TED), regroupant l’autisme, le syndrome d’Asperger, le
syndrome de Rett, le trouble désintégratif de l’enfance et
le trouble envahissant du développement non spécié [1].
La clinique actuelle s’est développée autour d’un spectre
autistique variant de l’autisme de Kanner à l’autisme de
« haut niveau » ou syndrome d’Asperger, caractérisant des
jeunes patients souffrant d’une symptomatologie autisti-
que sans retard de langage et possédant un niveau intellec-
tuel normal, voire supérieur à la moyenne.
Les chiffres de prévalence des TED ont subi au cours des
deux dernières décennies une revue à la hausse unique dans
l’histoire de la médecine. Ces troubles concernaient moins
d’un enfant sur mille en 1988 (11,6/10 000) [10]. La préva-
lence a depuis été multipliée par 10 puisque une étude
anglaise sur une population de 57 000 habitants a retrouvé
une prévalence de plus d’1 % de TED (116,1/10 000) [4]. La
prévalence ofcielle française, selon la haute autorité de la
santé est de 0,7 %, soit plus de 400 000 personnes [11].
Il existe une extrême variabilité en termes de gravité
et de sévérité de la symptomatologie autistique, et donc
de son devenir. Évaluer le pronostic évolutif des enfants
souffrant d’un TED à l’âge adulte sous-entend la prise en
compte de patient évoluant d’un extrême à l’autre du spec-
tre autistique. Il est particulièrement délicat de comparer
l’évolution d’un enfant souffrant d’un autisme de Kanner,
totalement replié sur lui-même, présentant une absence de
langage, des auto-mutilations, des troubles du comporte-
ment et celle d’un enfant souffrant d’un syndrome d’Asper-
ger, adressé en consultation en raison de symptômes semblant
s’intégrer autour de traits originaux de la personnalité et de
bizarreries dans les contacts sociaux.
Quoi qu’il en soit, une revue exhaustive de la littéra-
ture médicale nous permet de constater que les études
prospectives consacrées au devenir des jeunes patients
sont très rares : seules 21 études très hétérogènes sur le
plan méthodologique ont été retrouvées [19].
Les études prospectives courtes conrment la stabilité du
diagnostic : 88 % de très jeunes patients diagnostiqués à l’âge
de 2 ans présentent toujours le même diagnostic d’autisme à
l’âge de 9 ans [21]. Les études prospectives plus longues ren-
forcent cette notion de stabilité diagnostique. 46 patients
autistes sur 48 (95 %) suivis depuis la petite enfance, présen-
tent toujours les critères diagnostiques de leur maladie à
l’âge adulte, même si leur symptomatologie s’est atténuée
notamment au cours de l’adolescence [17]. Un suivi de
68 enfants autistes jusqu’à l’âge adulte a permis d’établir le
fait qu’une majorité des patients devenus adultes restent
dépendants de leur famille, des structures sociales et soignan-
tes. L’amélioration des symptômes et de l’insertion sociale fut
jugée pauvre à très pauvre pour 68 % des patients [12]. Une
seconde étude très proche sur le plan méthodologique évoque
une évolution péjorative pour 94 patients sur 120 (78 %) [5].
Au total, cette revue exhaustive de la littérature
concernant l’évolution à l’âge adulte d’enfants souffrant
d’autisme entraîne deux principales conclusions : la stabi-
lité du diagnostic et le mauvais pronostic évolutif lié aux
facteurs pronostiques.
De la génétique à la connectique cérébrale
Dix à 25 % des patients souffrent d’autisme syndromique,
c’est-à-dire d’un trouble autistique associé à une maladie
génétique reconnue, telle que la sclérose tubéreuse, le
syndrome de l’X fragile ou le syndrome de Rett [13].
Lorsqu’un jumeau souffre d’un TED, l’autre jumeau sera
concordant cliniquement dans 90 % des cas s’il est mono-
zygote et dans moins de 5 % des cas s’il est dizygote, conr-
mant ainsi la forte héritabilité génétique de ce trouble [6].
L’agrégation familiale est forte dans l’autisme de Kanner
puisque le risque de troubles autistiques dans la fratrie est
de 10,9 % soit bien supérieur à la prévalence en population
générale [7]. L’origine génétique est ainsi reconnue et a
surtout été enrichie depuis quelques années par de nom-
breuses publications faisant état d’anomalies impliquant
tout particulièrement les synapses. De fait, la grande majo-
rité des anomalies génétiques retrouvées dans des cohortes
familiales de patients souffrant de troubles autistiques
incriminent des gènes impliqués dans la structuration ou la
transmission synaptique [18]. Ainsi, deux gènes codant pour
les neuroligines 3 et 4 situés sur le chromosome X ont été
mis en évidence [14]. Ces protéines jouent un rôle majeur
au niveau des axones et dendrites périsynaptiques en les
agrégeant et en stabilisant ainsi les transmissions neurona-
les. Les troubles autistiques seraient donc liés à des trou-
bles de la connectique cérébrale d’origine génétique.
À partir de ces données issues de la génétique, il est
donc possible de bâtir un modèle neurophysiopathologique
basé sur un dysfonctionnement des connexions synapti-
ques. Les enfants souffrant d’un TED présenteraient à
divers degrés des difcultés à traiter en ligne les événe-
ments de leur environnement et à produire en temps réel
des ajustements sensorimoteurs, psychiques et cognitifs
[8]. Selon ces auteurs, le monde environnemental change-
rait trop vite pour être traité en temps réel par le cerveau
des personnes souffrant d’autisme, ce qui génère leurs
désordres communicatifs, cognitifs et imitatifs ainsi que
stratégies compensatoires et adaptatives [9]. De nombreu-
ses études récentes de neuro-imagerie fonctionnelle sont
depuis venues corroborer les anomalies qualitatives et
quantitatives de connexions entre différentes zones céré-
brales chez les patients souffrant de troubles autistiques
[15]. En résumé, l’étiopathogénie des troubles autistiques
n’a jamais été aussi précise ; établissant un continuum
entre des anomalies polygéniques modiant les structura-
tions synaptiques et à plus grande échelle des troubles de
connexion entre différentes aires cérébrales impliquées
notamment dans la reconnaissance des émotions, les inte-
ractions sociales, la communication.
De l’étiopathogénie aux thérapies
La clarication des mécanismes génétiques et neurophysiopa-
thologiques impliqués dans les TED ouvre une voie royale à de
nouvelles stratégies thérapeutiques, à la fois en pharmacolo-
gie mais également dans le domaine des psychothérapies.
Sur le plan pharmacologique, les anomalies au niveau
des neuroligines sus-décrites entraînent des modications

F. Kochman et al.S56
de la balance des transmissions neuronales inhibitrices et
excitatrices, principalement gérées par le couple GABA et
glutamates [22]. Un excès de glutamate pourrait expliquer
l’hypersensibilité sensorielle de nombreux jeunes patients
autistes et pourrait être contrebalancé par un traitement
ad hoc. Des essais récents et très prometteurs de l’ocyto-
cine, hormone et neurotransmetteur favorisant l’attache-
ment et certaines émotions ont été réalisés [2].
Les voies thérapeutiques les plus prometteuses sont les
nouvelles psychothérapies. L’analyse appliquée du compor-
tement (dénommée souvent par son acronyme anglais ABA
pour applied behavioral analysis) est directement issue des
courants de pensées cognitives et comportementales. Elle
repose donc sur une approche comportementale axée sur
les acquisitions de l’enfant et visant des objectifs précis et
progressifs ayant pour but de renforcer ses compétences en
communications non verbales et verbales, ses interactions
sociales, l’expression et la perception des émotions. Une
grille de lecture neurophysiologique nous permet de perce-
voir que cette thérapie éducative vise avant tout à établir
des connexions entre différentes zones cérébrales en appli-
quant notamment des techniques de renforcement. Elle
implique une prise en charge intensive, en règle de 10 à
30 heures par semaine, dont une grande partie au domicile
en y intégrant activement les parents qui deviennent ainsi
co-thérapeutes. Une méta-analyse récente de plus de
200 études contrôlées a clairement mis en exergue son ef-
cacité en termes d’évolution clinique, d’amélioration de la
communication non verbale et verbale, d’interactions et
d’insertion sociale et scolaire [23].
La psychothérapie DIR/Floortime (Developmental,
Individually and Relationship based) est basée sur le jeu
intensif, individuel et interactif à l’aide de l’implication
active des parents ou d’autres adultes proches de l’enfant.
L’enfant s’éveille et passe par les phases du développe-
ment qu’il a occultées. Elle est basée sur le jeu, les inte-
ractions en privilégiant le partage d’émotions. Elle est
également tout à fait en lien avec les avancées neuroscien-
tiques et médicales sus-décrites puisqu’elle est basée sur
les interactions et la création de connexions entre interac-
tions de l’enfant avec ses proches, le plaisir, le sensoriel et
les émotions. Elle partage avec l’ABA l’implication forte
des parents et le caractère intensif des prises en charges
(au moins 10 heures par semaine). Elle a également démon-
tré son efcacité dans une étude américaine récente [20].
Une association française a été créée pour diffuser cette
nouvelle forme de soin remarquablement appréciée par les
jeunes patients et leurs proches [3].
Une unité d’évaluation clinique
de diagnostic précoce
Fort de l’ensemble de ces nouvelles données qui s’intri-
quent, nous avons récemment créé dans notre service une
unité d’évaluation clinique (UEC) qui vise à l’évaluation
complète et précoce de jeunes enfants présentant une sus-
picion de troubles autistiques. Elle est composée d’une
équipe soignante pluridisciplinaire et spécialisée dans le dia-
gnostic complet des TED selon l’ensemble des critères pré-
conisés par la Haute Autorité de la santé [11]. Nos jeunes
patients sont adressés par leur médecin, ou via notre équipe
mobile périnatalité et petite enfance. Dans ce contexte, un
travail permanent et intensif de communication autour du
repérage précoce des troubles autistiques et réalisé sur le
terrain auprès des partenaires et des structures de la petite
enfance (PMI, crèches, écoles, médecins, etc.)
La mise en place de cette nouvelle organisation de soins,
à moyens constants en termes de personnel soignant, a per-
mis de réduire de manière importante l’âge d’admission en
soins spéciques, puisque la moyenne de prise en charge
mixte scolarisation et hôpital de jour est désormais inférieure
à 4 ans. Par ailleurs un facteur témoigne pour nous clairement
de l’amélioration de la qualité des soins de nos jeunes
patients : le taux d’enfants suivis en hôpital de jour, souffrant
d’un TED et qui bénécient d’une scolarisation extérieure est
de 88 % (36 enfants sur 41) contre moins de 40 % il y a 5 ans.
En conclusion, les troubles autistiques, beaucoup plus
connus et reconnus aujourd’hui sur le plan clinique ont vu
leur prévalence revus à la hausse de manière spectaculaire
au cours de ces dernières années. La Haute Autorité de la
santé estime que 6 à 7 enfants sur 1 000 souffrent d’un TED
[11].
Mais ce sont les découvertes les plus récentes en termes
de génétique et de neuro-imagerie qui ont plus encore bou-
leversé nos concepts. Il est ainsi possible pour la première
fois depuis l’individualisation des troubles autistiques d’éta-
blir un pont entre les anomalies génétiques, les troubles de
connectique synaptique, et les dysfonctionnements émo-
tionnels, des interactions sociales et de la communication. À
partir de ces arguments, de nouvelles voies sont ouvertes en
pharmacothérapie, actuellement marquées par les essais
récents avec l’ocytocine. Deux nouvelles psychothérapies
sont en toute logique directement en lien avec ces décou-
vertes neurophysiopathologiques : l’analyse appliquée du
comportement, ainsi que la psychothérapie DIR/Floortime
qui ont toutes deux démontré leur efcacité.
Le présent et le proche avenir viennent ainsi démentir
les données pessimistes qui ont longtemps prévalu en ce qui
concerne l’évolution et le pronostic des TED. De fait, la mise
en place, comme dans notre service de soins, d’unités spéci-
quement dédiées au repérage précoce, au diagnostic spéci-
que, puis à la prise en charge rapide et intensive de jeunes
enfants souffrant de troubles autistiques, en appliquant les
dernières avancées de la génétique, des neurosciences et
des nouvelles thérapies modient dors et déjà avec opti-
misme le pronostic et l’avenir de nos jeunes patients.
Références
[1] American Psychiatric Association. DSM-IV-TR. Manuel diagnos-
tique et statistique des troubles mentaux, 4e Ed. Révisée Mas-
son, Paris : 2000.
[2] Andari E, Duhamel JR, Zalla T et al. Promoting social behavior
with oxytocin in high-functioning autism spectrum disorders.
Proc Natl Acad Sci U S A 2010 ; 107 : 4389-94.
[3] Association Autisme Espoir vers l’École : http://www.autisme-
espoir.org/
[4] Baird G, Simonoff E, Pickles A et al. Prevalence of disorders of
the autism spectrum in a population cohort of children in

Le devenir des troubles envahissants du développement après l’adolescence S57
[15] Just MA, Cherkassky VL, Keller TA et al. Cortical activation
and synchronization during sentence comprehension in high-
functioning autism: evidence of underconnectivity. Brain
2004 ; 127 : 1811-21.
[16] Kochman F, Desmet M, Le Nouy G et al. Le devenir à l’âge
adulte des enfants souffrant d’autisme. Neuropsy News 2007 :
131-4.
[17] McGovern CW, Sigman M. Continuity and change from early
childhood to adolescence in autism. J Child Psychol Psychia-
try 2005 ; 46 : 401-8.
[18] Pinto D, Pagnamenta AT, Klei L et al. Functional impact of
global rare copy number variation in autism spectrum disor-
ders. Nature 2010 ; 466 : 368-72.
[19] Schonauer K, Klar M, Kehrer HE et al. The course of infantile
autism through adulthood. An overview of long-term follow-
up data. Fortschr Neurol Psychiatr 2001 ; 69 : 221-35.
[20] Solomon R, Necheles J, Ferch C et al. Pilot study of a parent
training program for young children with autism : the PLAY
Project Home Consultation program. Autism 2007 ; 11 : 205-
24.
[21] Turner LM, Stone WL, Pozdol SL et al. Follow-up of children
with autism spectrum disorders from age 2 to age 9. Autism
2006 ; 10 : 243-65.
[22] Varoqueaux F, aramuni G, Rawson RL et al. Neuroligins deter-
mine synapse maturation and function. Neuron 2006 ; 51 :
741-54.
[23] Virués-Ortega J. Applied behavior analytic intervention for
autism in early childhood: meta-analysis, meta-regression
and dose-response meta-analysis of multiple outcomes. Clin
Psychol Rev 2010 ; 30 : 387-99.
South Thames: the Special Needs and Autism Project (SNAP].
Lancet 2006 ; 368 : 210-5.
[5] Billstedt E, Gillberg C, Gillberg C. Autism after adolescence:
population-based 13- to 22-year follow-up study of 120 indi-
viduals with autism diagnosed in childhood. J Autism Dev Dis-
ord 2005 ; 35 : 351-60.
[6] Chaste P, Fauchereau F, Betancur C et al. Identification d’une
voie synaptique associée à l’autisme. Med Sci 2008 ; 24.
[7] Constantino JN, Zhang Y, Frazier T et al. Sibling Recurrence
and the Genetic Epidemiology of Autism. Am J Psychiatry
2010 [Epub ahead of print].
[8] Gepner B, Feron F. Autism: a world changing too fast for a
mis-wired brain? Neurosci Biobehav Rev 2009 ; 33 : 1227-42.
[9] Gepner B. Une nouvelle approche de l’autisme : des désor-
dres de la communication neuronale aux désordres de la com-
munication humaine. Interactions 2008 ; 1 : 1-25.
[10] Gillberg C, Steffenburg S, Schaumann H. Is autism more common
now than ten years ago? Br J Psychiatry 1991 ; 158 : 403-9.
[11] Haute Autorité de la Santé. Autisme et troubles envahissants
du développement. Janvier 2010. http://www.has-sante.fr/
portail/upload/docs/application/pdf/2010-03/autisme_et_
autres_ted_etat_des_connaissances_resume.pdf
[12] Howlin P, Goode S, Hutton J et al. Adult outcome for children
with autism. J Child Psychol Psychiatry 2004 ; 45 : 212-29.
[13] Jamain S, betancur C, Giros B et al. La génétique de l’autisme.
Med Sci 2003 ; 19 : 1081-90.
[14] Jamain S, Quach H, Betancur C et al. Mutations of the X-linked
genes encoding neuroligins NLGN3 and NLGN4 are associated
with autism. Nat genet 2003 ; 34 : 27-9.
1
/
4
100%