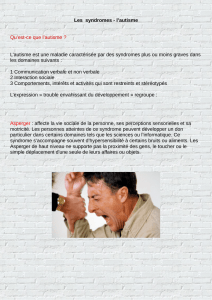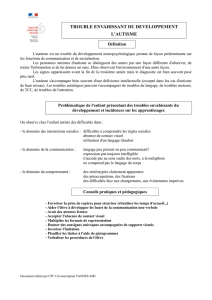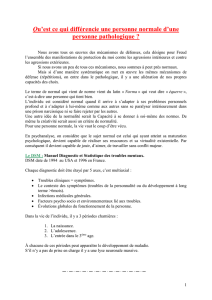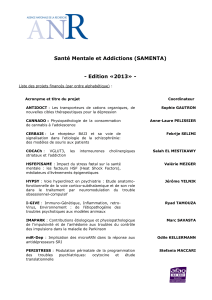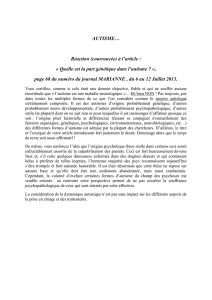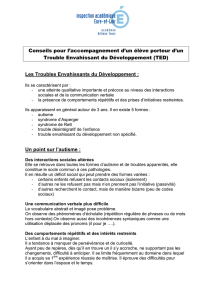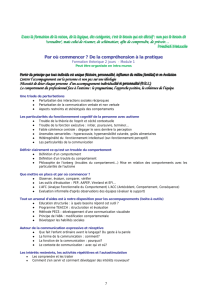Télécharger l'article au format PDF

1
23e Année. N° 6 Juin 1928
TRAVAUX ORIGINAUX
À PROPOS DE CERTAINS
ÉTATS D’ALIÉNATION CURABLES
SIMULANT LA SCHIZOPHRÉNIE
PAR
Santin-Carlos ROSSI
Professeur de clinique psychiatrique à Montevideo
I. – GÉNÉRALITÉS
Tous les aliénistes connaissent des états cliniques que l’on ne peut situer avec préci-
sion dans la nosologie psychiatrique actuelle, et auxquels nous réservons des adjectifs
commodes, tels qu’« anormal », « hybride », « incomplet », etc. Ce phénomène, d’ailleurs,
est parfaitement logique dans la période contemporaine de la psychiatrie où, faute de
critérium anatomique ou physiopathologique pour la plupart des psychoses connues,
nous devons nous résigner à décrire des syndromes cliniques.
Mais si un tel phénomène est naturel dans la relativité de nos moyens actuels de
classication, il ne l’est plus quand il s’agit de qualier d’un même nom, ou d’envi-
sager avec une même conception, des syndromes qui sont foncièrement identiques
au point de vue clinique et qui cependant ne subissent pas la même évolution. C’est
ce que je trouve dans la présentation moderne de la schizophrénie. Le mot et la
conception ont en effet fait fortune et, après avoir absorbé la démence précoce pri-
mitive et incurable, tendent à englober aussi plusieurs processus aigus ou sub-aigus,
presque épisodiques, pour la plupart curables, et cela en raison de la similitude de
quelques symptômes en somme assez répandus, tels que l’autisme ou la discordance.
Or, tant que l’ère anatomique de la démence précoce et de la schizophrénie elle-
même n’arrivera pas à leur donner la clarté et la personnalité nosographique qu’elle
a donné à la démence paralytique – qui a connu aussi son époque de confusion et de
pluralité – il convient de marquer la physionomie spéciale des cas dont les masques
cliniques font poser un diagnostic que l’évolution et le fond psychique des malades
montrent inexact. C’est le but de ce travail, qui n’a d’autre intention que de susciter
des idées critiques sur un thème que je considère comme ayant une grande portée
pathogénique.

L’encéphale, 1928: 501-507 L’Encéphale, 2010; 36
2
II. – RÉSUMÉ CLINIQUE
Voici, d’abord, le résumé clinique de quelques cas, que je choisis parmi les plus
difciles au point de vue du diagnostic. Ils ont tous eu la double particularité d’avoir fait
penser toujours au diagnostic de schizophrénie ou de démence précoce et d’avoir
abouti à une guérison.
O I. – La première observation a trait à une jeune lle de 22 ans, présentant des
antécédents héréditaires névropathiques et aussi des antécédents personnels qui la montrent
comme d’un tempérament original, sensitif, très personnel, peut-être schizoïde, d’après les
renseignements de la famille. Elle présente en outre un passé organique intestinal et ovarien.
Ses troubles mentaux débutèrent comme un état maniaque, à la suite de ançailles qui
comblaient tous ses vœux. Peu de jours après elle présenta un symptôme qui se trouvait
en discordance avec son euphorie, c’était la sitiophobie. Isolée dans une maison de santé, il
survint très rapidement un aspect clinique inattendu: maniérisme, rires immotivés, pleurs,
attitudes bizarres, rétention vésicale et salivaire, peut être même intestinale si l’on veut don-
ner ce nom à la forme très rebelle de sa constipation. Elle ne présentait pas d’état catatonique
proprement dit, mais elle restait immobile dans son lit pendant des heures et des jours. Au
point de vue psychique prédominait chez cette malade l’autisme: elle ne répondait pas un
mot à l’interrogatoire, mais souvent elle posait des questions ou bien répétait des mots mon-
trant qu’elle comprenait parfaitement. Par exemple, si on lui demandait: « Voulez-vous voir
vos parents ? » elle ne répondait que par des sourires moqueurs, et après d’autres questions du
médecin sur d’autres sujets, elle interrompait brusquement son mutisme pour dire violem-
ment: « J’ai mon père et ma mère ; il y a longtemps que je ne les vois pas, je veux les voir,
si ma mère ne vient pas me voir je ne mangerai pas ». D’autres fois, elle demandait des mets
spéciaux à des heures extraordinaires, et les avalait avec des marques de bon appétit et de plai-
sir ; mais si on lui servait les mêmes mets aux heures régulières sans qu’elle les eût demandés,
elle les refusait énergiquement. Elle avait aussi des idées hypocondriaques absurdes et appa-
remment des idées de transformation de sa personnalité. Souvent elle réclamait en pleurant
des visites de sa famillle et quand, pour provoquer un choc émotif, on faisait venir quelqu’un
des siens, elle se jetait dans ses bras éperdument, mais sans dire un mot. Parfois elle avait des
accalmies durant deux ou trois jours, mais sans se départir de son négativisme alimentaire ni
de son mutisme et dans ces intervalles mêmes, l’affectivité conservait le caractère déjà décrit:
théoriquement conservée, mais sans se manifester réellement devant sa famille ; on eut dit
que l’affectivité était empêchée de s’extérioriser, comme si elle était monopolisée par la vie
intérieure de la malade. Cet état autiste se prolongea durant vingt mois environ, exactement
de janvier 1925 à septembre 1926, pendant lesquels je me refusai à faire le diagnostic de
D.P., parce que l’aspect aigu du processus et surtout la conservation évidente de l’affectivité
m’en dissuadaient. Mais, pour répondre à mes propres doutes et aux pressantes questions de
la famille sur le pronostic, je sollicitai des consultations successives avec les deux psychiâtres
les plus distingués de mon pays, qui tous deux posèrent le même diagnostic: schizophrénie
ou démence précoce, forme incomplète ou en évolution. A partir du mois de juillet 1926 la
maladie commença à céder et le processus regressa lentement, les rires disparurent les pre-
miers, puis le négativisme et les caprices enn et en dernier lieu la réserve autistique. D’après
l’avis de sa famille la restitution à l’état normal fut complète, et elle prétendait même que la
jeune lle était devenue plus sociable qu’auparavant.
O II. – Dans un deuxième cas, dont je ne ferai pas une description aussi
longue, il s’agissait aussi d’une jeune lle d’environ 20 ans, et le processus eut beaucoup de
ressemblance clinique avec le cas précédent en ses trois traits fondamentaux: allure aiguë,

L’Encéphale, 2010; 36 L’encéphale, 1928, 1928: 501-507
3
autisme, affectivité conservée malgré les apparences, et en plus un puérilisme très marqué par
périodes. Quinze mois d’évolution. Guérison lente et graduelle.
O III. – Un troisième cas que je veux aussi rappeler est celui d’un jeune
étudiant très distingué, d’antécédents personnels sans importance mais d’un caractère altier
et réservé, agé de 20 ans, qui présenta un début mélancolique avec des idées d’hypo condrie
morale, et une tentative de suicide en rapport avec ces idées, car il prétendait que son intel-
ligence l’abandonnait et que ne pouvant continuer ses études il préférait mourir. Isolé, il
présenta très rapidement un état clinique de négativisme, maniérisme, attitudes théâtrales,
quelques crises de rires explosifs, et surtout de sourires sarcastiques, ou méprisants. Son
autisme était indubitable. Ce malade conserva aussi son affectivité, et aux moments où on
pouvait l’arracher à son autisme, il manifestait vivement son désir de voir ses parents et frères
et il les recevait mieux que les autres. Ce malade guérit d’une façon curieuse: après une crise
de catatonie de plusieurs jours et après une évolution de dix mois au total, pendant lesquels
on t en consultation le diagnostic de démence précoce, diagnostic que j’avais accepté moi-
même malgré la conservation de l’affectivité très manifeste par intervalles.
O IV et V. – Enn, je pourrais encore rapporter deux cas de jeunes lles une
de 16 ans et une autre de 23, dont l’allure fut sensiblement pareille aux deux premières:
début par excitation apparemment maniaque, absence de confusion perceptive, négativisme,
maniérisme, puérilisme, rires, autisme, et toujours avec cette curieuse conservation de l’af-
fectivité que j’appelle théorique, car elle ne se réalisait pas, pour ainsi dire, en présence de
la famille réclamée avec persistance. Dans ces deux cas, je ne demandai pas de consultation
et je hasardai une opinion favorable quant à l’évolution. L’issue heureuse de ces deux cas me
donna raison.
La thérapeutique de tous ces cas fut à peu près celle-ci: toniques lêcithinés, pyréto-
thérapie par le nucléïnate de soude ou l’essence de térébenthine, balnéation et somnifène
contre l’excitation, opothérapie symptomatique et désinfection uro-intestinale.
III. – DISCUSSION NOSOGRAPHIQUE
Voilà les faits que j’avais intérêt à évoquer, et dont la synthèse est la suivante:
processus d’excitation psychique et motrice, avec discordance et autisme et aussi
avec conservation de l’affectivité, quoique celle-ci soit troublée dans son expression
extérieure.
Cherchons à interpréter ces faits. Trois diagnostics s’offrent à l’esprit du médecin:
celui de dysthymie ou psychose maniaque dépressive ; celui de bouffée délirante des
prédisposés, type Magnan, ou celui de l’une des diverses formes qu’on a décrites de
la schizophrénie. Mais les dysthymiques ne perdent pas le contact avec la réalité,
puisqu’ils sont précisément des « syntones », et nous avons vu que le symptôme pré-
dominant dans tous les cas ci-dessus relatés était bien l’autisme. Quant aux bouffées
délirantes, je ne répugnerais pas à ce diagnostic, à condition qu’il n’exigeât pas la
confusion, l’évolution très rapide et qu’il admît cette coexistence d’autisme et de
conservation de l’affectivité, tout ce qui nous obligerait à forcer l’appellation et la
conception personnelles de Magnan.
C’est plutôt dans les cadres de la schizophrénie qu’il faudrait placer des malades
comme ceux que je viens de décrire, si l’on donne à l’autisme une importance décisive ;

L’encéphale, 1928: 501-507 L’Encéphale, 2010; 36
4
mais à cela nous trouvons un inconvénient fondamental, et qui m’a déterminé pré-
cisément à soumettre ces cas à l’attention des médecins. Il faudrait fermer les yeux
à la réalité et, aux dépens d’un symptôme capital, l’autisme, que l’on trouve comme
base de la schizophrénie, il faudrait tolérer la présence gênante de l’affectivité, dont
l’absence est une autre des bases caractéristiques de la schizophrénie typique.
Comment concilier donc ces deux concepts contradictoires ?
Je sais bien que dans les vastes cadres de la schizophrénie – si vastes que l’on peut
y faire entrer pas mal de cas syntones – il y a des formes atténuées, simples, latentes,
qui peuvent régresser vers l’état normal, mais qui peuvent aussi bien être vouées à la
démence. Mais c’est cette doctrine que je ne pourrais accepter pour les observations
que je rapporte sans une rectication pathogénique qui risquerait de dénaturer gran-
dement la conception de la schizophrénie en tant que synonyme de tout processus
mental ayant l’autisme comme symptôme prédominant, quelle qu’en soit l’évolution.
En clinique, il ne doit pas y avoir de place pour le lit de Procuste. Je crois qu’il faut
réserver les mots signicatifs pour les cas clairs, et je ne crois pas convenable de donner
un seul et même nom à des faits aussi divers que la conservation ou la disparition de
l’affectivité, l’allure rapide ou l’allure très lente, la curabilité ou l’incurabilité.
Quand le professeur Claude décrivit sa schizomanie, qui a introduit tant de clarté
dans l’étude de ces processus mentaux relevant de la constitution schizoïde, j’ai cru
éclairci le problème nosologique et pathogénique de ces états, que je commençais
à dénommer « syndrome schizothymique », tout en les considérant comme faisant
partie de la psychose maniaque dépressive. Il me semblait parfait de joindre cette
terminaison manie, qui signie processus aigu, bruyant, presque fugace, au préxe
schizo, qui signie division, séparation, enn « autisme ». Mais en lisant avec plus
d’attention les descriptions de M. Claude et de ses élèves, je crains de n’avoir pas le
droit non plus de classer ces états dans la schizomanie. En effet, si je n’ai pas mal com-
pris le très distingué maître de Sainte-Anne, la schizomanie établirait une différence
seulement de degré, de quantité et non de qualité, avec la schizophrénie typique ; elle
serait une sorte de chaînon entre le schizoïde prédisposé et le processus démentiel du
schizophrénique, quoique l’évolution totale ne se réalise pas toujours.
Et encore, il y aurait, si j’ai bien compris, la possibilité de trouver des schizomanes
avec ou sans conservation de l’affectivité, élément que je crois précisément comme
de nature sufsant à distinguer les processus schizo des autres qui ne sont pas schizo,
par exemple les dysthymiques. Or, je crois qu’il faut voir une différence essentielle et
non de degré, de qualité et non de quantité si l’on peut dire, une différence de patho-
génie entre les états aigus, curables, avec conservation de l’affectivité que nous observons
assez souvent, et ces autres états véritablement schizophréniques, et que la différence
doit consister en quelque chose dont la traduction clinique est précisément, chez les
premiers, l’installation rapide, la conservation de l’affectivité et la curabilité.
Ce quelque chose, enn, doit être en relation avec le mécanisme intime du proces-
sus, comme si les uns – les cas aigus – n’affectaient par exemple que les enveloppes
du tissu cérébral, déclanchant des syndromes mentaux seulement par réactions de
voisinage, et si les autres – les cas chroniques – relevaient de lésions primitivement
neuro-épithéliales, des mêmes systèmes neuronaux.
On dirait que parmi ces cadres qui peuvent se ressembler à première vue au point
de vue clinique, mais qui se différencient par des nuances importantes dans les

L’Encéphale, 2010; 36 L’encéphale, 1928, 1928: 501-507
5
symptômes et l’évolution, il y a les mêmes ressemblances et les mêmes différences
qu’entre le méningisme et les méningites.
Cette façon d’envisager ces processus serait, en somme, l’application particulière à
la psychiatrie du critérium prédominant en pathologie générale, qui accepte des réac-
tions syndromiques tels que l’ictère, ou l’asystolie, ou la congestion pulmonaire, ou
les sérosites variées – parmi lesquelles la méningite – avec néanmoins des évolutions
diverses et quelques nuances symptomatiques propres selon les agents pathogènes en
cause, et en réservant le nom de maladie à l’œuvre du dit facteur ou au processus anato-
mique ou physiopathologique caractéristiques. Telle a été, du reste, l’histoire clinique
de la paralysie générale, que l’on décrivit au pluriel et parfois comme syndrome curable
jusqu’au jour où le laboratoire permit de la décrire comme une méningo-encéphalite
diffuse d’origine syphilitique.
Peut-être le jour n’est-il pas lointain où la clinique psychiatrique se limitera à
décrire des syndromes, c’est-à-dire des groupements cohérents de symptômes dûs aux
réactions régionales des voies ou des centres nerveux, réactions qui peuvent être cau-
sées par des agents pathogènes variés. Elle réservera le nom de maladies aux processus
qui ont un agent décelable, une évolution prévue et une anatomie ou une physiologie
pathologique expliquant le syndrome. Ce jour-là, on pourra peut-être dire que les
syndromes autistes aigus avec conservation de l’affectivité répondent à l’inffammation des
formations mésodermiques de la base du cerveau avec répercussion dans les systèmes
neuronaux voisins, tandis que les syndromes autistes chroniques, avec affectivité abolie,
traduisent l’atteinte primitive et neuro-épithéliale de ces mêmes voies nécessaires à
l’interprétation idéo-affective de notre personnalité psychique.
Mais jusqu’à ce jour, et tout en restant sur le modeste terrain de l’observation
clinique, je crois qu’il y a lieu de signaler les différences de forme et d’évolution
existant entre ces syndromes schizotiques aigus, curables, et les syndromes schizophré-
niques, véritables différences que je trouve en deux traits que j’ai observé chez tous
les malades rapportés, à savoir la rapidité d’installation des symptômes et la conservation
persistante de l’affectivité.
C’est ce que je tenais à dire sur ces états que tous les psychiatres ont sans doute
observés comme moi et que, si je ne craignais pas d’empiéter sur la conception totale
de la schizomanie du professeur Claude, j’aurais nommé simplement « syndrome de
schizothymie » en attendant que la pathogénie nous permette de les situer dans une
classication dénitive.
1
/
5
100%